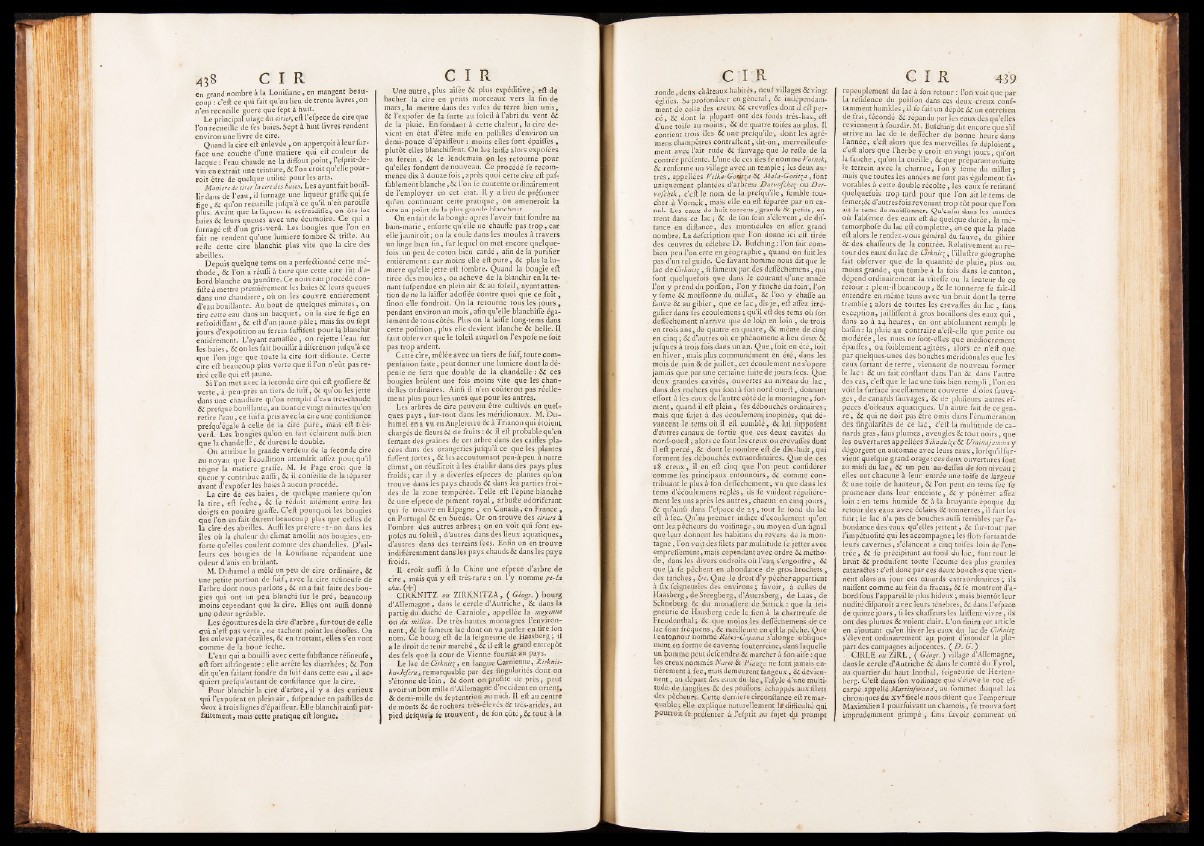
en grand nombre à la Louifiane, en mangent beaucoup
: c’ eft ce qui fait qu’au lieu de trente livres,on
n’en recueille guere que fept à huit.
Le principal ufage du ciriert eft l’efpece de cire que
l’onrecueille de les baies. Sept à huit livres fendent
environ une livre de cire.
Quand la cire eft enlevée, on apperçoit à leur fur-
face une couche d’une matière qui eft couleur de
lacque : l’eau chaude ne la diflbut point, l’elprit-de-
vin en extrait une teinture, & l’on croit qu’elle pour-
roit être de quelque utilité pour les arts. ^
Maniéré de tirer La cire des baies. Les ayant fait bouillir
dans de l’eau, il fumage une liqueur grade quife
fige, & qu’on recueille jufqu’à ce qu’il n’en paroifle
plus. Avant que la liqueur le refroidiffe, on ôte les
baies & leurs queues avec une écumoire. Ce qui a
furnagé eft d’un gris-verd. Les bougies que l’on en
fait ne rendent qu’une lumière l'ombre & trifte. Au
refte cette cire blanchit plus vite que la cire des
abeilles. * . , ,
Depuis quelque tems on a perfectionne cette méthode
, & l’on a réufli à faire que cette cire fût d’abord
blanche ou jaunâtre. Ce nouveau procédé con-
fifte à mettre premièrement les baies & leurs queues
dans une chaudière, où on les couvre entièrement
d’eau bouillante. Aii bout de quelques minutes, on
tire cette eau dans un bacquet, où la cire fe fige en
refroidiffant, & eft d’un jaune-pâle ; mais fix ou fept
jours d’expofition au ferein fuffil’ent pour la blanchir
entièrement. L’ayant ramafl'ée , on rejette l’eau fur
les baies, & on les fait bouillir àdifcrétion jufqu’à ce
que l’on juge que toute la cire loit diffoute. Cette
cire eft beaucoup plus verte que fi l’on n’eût pas retiré
celle qui eft jaune.
Si l’ on met avec la fécondé cire qui eft grofliere &
verte, à-peu-près un tiers de fuif, Ôt qu’on les jette
dans une chaudière qu’on remplit d’eau très-chaude
& prefque bouillante, au bout de vingt minutes qu’on
retire l’eau, ce fuif a pris avec la cire une confiftance
prefqu’égale à celle de la cire pure, mais eft .très-
verd. Les bougies qu’ori en fait éclairent aufli bien
que la chandelle, & durent le double.
On attribue la grande verdeur de la fécondé cire
au noyau q u e l’ébullition attendrit affez pour, q u ’il
teigne la matière graflè. M. le Page croit que la
queue y contribue aufli, & il confeille de la léparer
avant d’expofer les baies à aucun procédé.
La cire de ces baies, de quelque maniéré qu’on
la tire, eft feche, & fe réduit aifément entre les
doigts en poudre graffe. C’ eft pourquoi les bougies
que l’on en fait durent beaucoup plus que celles de
la cire des abeilles. Aufli les préfère - t - on dans les
îles où la chaleur du climat amollit nos bougies, en-
forte qu’elles coulent comme des chandelles. D ’ailleurs
ces bougies de la Louifiane répandent une
odeur d’anis en brûlant.
M. Duhamel a mêlé un peu de.cire ordinaire, &
une petite portion de fuif, avec la cire réfineufe de
l’arbre dont nous parlons, & en a fait faire des bougies
qui ont un peu blanchi fur le pré, beaucoup
moins cependant que la cire. Elles ont aufli donné
une odeur agréable.
Les égoutturës de la cire d’arbre , fur-tout de celle
qui n’eft pas verte , ne tachent point les étoffes. On
les enleve par écailles, & en frottant, elles s’en vont
comme de la boue feche.
L’eau qui a bouilli avec cette fubftance réfineufe,
eft fort aftringente : elle arrête les diarrhées.; &. l’on
dit qu’en faifant fondre du fuif dans cette eau , il acquiert
prefqu’autant de confiftance que la cire.
Pour blanchir la cire d’a r b r e il y a des curieux
qui l’expofent en plein air, fufpendue en paftilles de
deux à trois lignes d’épaifleur. Elle blanchit ainfi parfaitement,
mais cette pratique eft longue, ,
Une autre, plus aifée & plus expéditive, eft de
hacher la cire en petits morceaux vers la fin de
mars, lai mettre dans des vafes de tèrre bien unis,
& l’expofer de la forte au foleil à l’abri du vent &
de la pluie. En fondant à cette chaleur, la cire devient
en état d’être mife en paftilles d’environ un
demi-pouce d’épaifleur : moins elles font épaifles ,
plutôt elles blanchiffent. On les laifle alors expofées
au ferein , & le lendemain çn les retourne pour
qu’ elles fondent de nouveau. Ce procédé fe recommence
dix à douze fois, après quoi cette cire eft paf;
fablement blanche ,& l’on fe contente ordinairement
de l’employer en cet état. Il y a lieu de préfumer
qu’en continuant cette pratique, on ameneroit la
cire au point de la plus grande blancheur.
On en fait de la bougie après l’avoir fait fondre au
bain-marie, enforte qu’elle ne chauffe pas trop, car
elle jauniroit ; on la coule dans les moules à travers
un linge bien fin, fur lequel on met encore quelquefois
un peu de coton bien cardé, afin de la purifier
entièrement : car moins elle eft pure, & plus la lumière
qu’elle jette eft fombre. Quand la bougie eft:
tirée des moules, on achevé de la blanchir en la tenant
lufpendue en plein air & au foleil, ayant attention
de ne la laiffer adoffée contre quoi que ce {o it,
finon elle fondroit. On la retourne tous les jours ,
pendant environ un mois, afin qu’elle blanchiffe également
de tous côtés. Plus on la laifle long-tems dans
cette pofition, plus elle devient blanche & belle. II
faut obferver que le foleil auquel on l’expofe ne foit
pas trop ardent.
Cette cire, mêlée avec un tiers de fuif, toute com-
penfation faite, peut donner une lumière dont la dé-
penle ne fera que double de la chandelle : & ces
bougies brûlent une fois moins vite que les chah?
déliés ordinaires. Ainfi il n’en coûteroit pas réelle-:
ment plus pour les unes que pour les autres.
Les arbres de cire peuvent être cultivés en quelques
pays, fur-tout dans les méridionaux. M. D uhamel
en a vu en Angleterre & à Trianon qui étoient
chargés de fleurs & de fruits : & il eft probable qu’en
femant des graines de cet arbre dans des caiffes placées
dans des orangeries jufqu’à ce que les plantes
fuffentlortes, & les accoutumant peu-à-peu à notre
climat, on réufîiroit à les établir dans des pays plus
froids; car il y a diverfes efpeces de plantes qu’on
trouve dans les pays chauds & dans les, parties froides
de la zone tempérée. T elle eft l’épine blanche
& une efpece de piment royal,, arbufte odoriférant
qui fe trouve en Efpagne , en Canada, en France ,
en Portugal & en Suede. Or on trouve des ciriers à
l’ombre des autres arbres ; on en voit qui font ex-
pofés au foleil, d’autres, dans des lieux aquatiques,
d’autres dans des terreins fecs. Enfin on en trouve
indifféremment dans les pays chauds & dans les pays
froids., _ •
Il croît aufli à la Chine une efpece d’arbre de
cire , mais qui y eft très-rare : on l ’y nomme pc-la.
chu. (+ )
. CIRK.NITZ ou ZIRKNITZA, ( Gêogr. ) bourg
d’Allemagne , dans le cercle d’Autriche, & dans la
partiç du-duché de Carniole, appellée la moyenne
ou du milieu. De très-hautes montagnes l’environnent
, & lé fameux lac dont on va parler, en tire fon
nom. Ce bourg eft de la feigneurie de Haasberg ; il
a le droit de tenir marché, & il eft le grand entrepôt
des fels que la cour de Vienne fournit au pays.
Le lac de Cirknit^, en langue Carnienne, Zirknis-
ku-Jeferu9 remarquable par des Angularités dont on
s’étonne de loin, & dont on profite de près, peut
avoir un bon mille d’Allemagne d’occident en orienf,
& demi:mille du feptentriori au midi. Il eft au centre
de monts & de rochers très-élevés & très-arides, au
pied ddquels fe trouvent , de fon ç o te ,& tout à la
ronde, deux châteaux habités, neuf villages & vingt
églifes. Sa-profondeur en;général* .indépendamment
de celle des creux, & crevaffes dont il eft.per-
c é , & dont la plupart ont des fonds très-bas* eft
d’une toife au moins , & de quatre toifes au plus. Il
contient trois îles & une prefqu’île * dont les agré-
mens champêtres contraftent , dit-on, merveilleufe-
ment avise l’air rude & fauvage que le refte de la
contrée préfente. L’une dé ces îles fe nomme Vornek,
& renferme un village avec un temple ; les deux autres,
appellées k'elka-Gosit{a &C Mala-Goritça, font
uniquement plantées d’arbres» Dorvofcheç ou Der-
vofcheki c’eft le nom de. la prefqü’île , fèmble toucher
à V ornek, mais elle en eft.féparée par un canal.
Lès eaux de huit torrens, grands & petits, entrent
dans ce lac; & de fonfein s’élèvent, de dif-
tance en diftance, des monticules en affez grand
nombre,. La defcription que l’on donne ici eft tirée
des oeuvres du célébré D . Bufching: l’on fait combien
peu l’on erre en géographie , quand on fuit les
pas d’un tel guide. Ce favant homme nous, dit que le
lac de Cirknitç, fi fameux par. des defféchemens, qui
font quelquefois que dans le courant d’une année
l!on y prend du poiffon, l’on y fauche du foin", l’on
y feme & moiffonne du millet, & l’on y chafle au
fauve & au gibier, que ce lac , dis-je, eft affez irrégulier
dans fes écoulemens ; qu’il eft des tems où fon
defféchement n’arrive que de loin en loin , de trois
en trois ans, de quatre en quatre, & même de cinq
en cinq ; & d’autres où cephénomene a lieu deux &
jufques à trois fois dans un an. Qu e, foit en été, foit
en h iver, mais plus communément en été* dans les.
mois de juin & de juillet, cet écoulement ne s’opère
jamais que par une certaine fuite de jours fecs. Que
deux grandes cavités,.ouvertes au niveau.du la c ,
dans des rochers qui font à fon nord-oueft, donnant
effort à fes eaux de l’autre côté de la montagne., forment,
quand il eft plein, fes débouchés ordinaires;
mais que fujet à des écpulemens, inopinés, qui devancent
le .tems où il eft comblé, & lui fuppofent
d’autres canaux de fortie que, ces deux cavités du
nord-oueft, alors ce font les creux ou crevaffes dont
il eft .percé, & dont le nombre eft de dix-huit, qui
forment fes débouchés extraordinaires. Que de ces
18 creux , il en eft cinq que. l’on peut eonfidérer
'■ comme fes principaux entonnoirs, & comme contribuant
le plus à fon defféchement , ■ vu que dans les
tems d’écoulemens réglés , ils fe vuident régulièrement
les uns après les autres, chacun en cinq jours,
& qu’ainfi dans l’efpace de 25, tout le fond du lac
eft à fec. Qu’au premier, indice d’écoulement qu’ en
ont les pêcheurs du voiiinage, au moyen d’un lignai
que leur donnent les habitans du revers de- la montagne
, l’on voit des filets par multitude fe jetter avec
empreffement, mais cependant avec ordre &L méthode
, dans les divers endroits où Feaq s’engoüfre, &
que là fe pêchent-en abondance de gros brochets,
des tanches, &c. Que le droit d’y pêchex appartient
à fix feigneuries des environs ;, {avoir, à celles de
Haasbeçg, de Steegberg, d!Auersberg, de Laas, de
Schneberg du mon^ftere de Sittick : que la Seigneurie
de Haasberg cede le.lien.à la chartreufe de
Freudenthal ; '& que moins les defféchemens ;dé ce
lac font fréquens, & meilleure en eft la pêche; Que
l’entopnoir nommé Ribes-Cajama s’alonge obliquement
en foriqe de caverne foùterreine, dans laquelle
un bomme peut defcendre &: marcher à.fon aife : que
les creux nommés Narte & Piaule ne font jamais entièrement
à fec, mais demeurent fangeux, & deviennent
, au départ des eaux du la c , l’afyle d’unfe multitude
de; fangfu.es & des’ pôiiTons échappés aux filets
des pêche.ursl Cette derniere circonftance eft remarquable;
elle explique haturellement l£ difficulté qui
pourrpit fe préfenter à i’efprit au fujet dp prompt
repeuplement du lac à fon retour : l’on voit que par
la réfidence du poiffon dans ces deux creux conf-
tamment humides, il fe fait un dépôt & un entretien
de frai, fécondé & répandu p.ar les eaux dès qu’elles
reviennent à fourdir. M. Bufching dit encore que s’il
arrive au lac de fe deffecher de bonne heure dans
l’année, c’eft alors que fes merveilles, fe déploient,
e’eft alors que l’herbe y croît en vingt jours, qu’on
la fauche, qu’on la cueille, & que préparant enfuite
le terrein avec la charrue, l’on y feme du millet ;
mais que toutes, les années ne font pas également fâ-
vorables à cette double récolte, les eaux fe retirant
quelquefois trop tard pour que l’on ait le tems de
femer;& d’autres fois revenant trop tôt pour que l’on
ait le tems de moiffonner. Qu’enfin dans les années
ou l’abfence des eaux eft de quelque durée, la mé-
tamorphofe du lac eft complette, en ce que la place
eft alors le rendez-vous général du fauve, du gibier
& des chafleurs de la contrée. Relativement au retour
des eaux du lac de Cirknit^, l’illuftre géographe
fait.obferver que de la quantité de pluie, plus ou,
moins grande, qui tombe à la fois dans, le canton,
dépend ordinairement la vîteffe ou la lenteur de ce.
retour : pleut-il beaucoup, & le tonnerre fe fait-il
entendre en même tems avec un bruit dont la terre
tremblé ; alors de toutes les crevaffes du lac , fans
exception, jailliffent à gros bouillons des eaux q ui,
dans 20 à 24 heures, en ont abfolument rempli le.
baflin : la pluie au contraire n’eft-elle que petite ou
modérée, les nues ne font-elles que, médiocrement
épaiflès, bu foiblement agitées, alors ce n’eft que'
par quelques-unes des bouches méridionales que les'
eauxfortant de terre, viennent de nouveau former'
le lac: & un fait confiant dans l’un & dans l’autre
des cas , c ’eft que le lac une fois bien rempli, l’on en
voit la furface inceffamment couverte d’oies fauva-
.ges, de canards fauvâges, & de plufieurs autres ef-‘
peces d’oifeaux aquatiques. Un autre fait de cegen-,
re , & qui ne doit pas être omis dans l’énumération
des Angularités de ce lac, c’eft la multitude de canards
gras, fans plumes,.aveugles & tout noirs, que
les ouvertures appellées'Sékadulçe & Urainajammay
dégorgent en automne avec leurs eaux, lorfqu’ilfur-
vient quelque grand orage:ces deux ouvertures font
au midi du la c , & un peu au-deffus de fon niveau ;•
elles ont chacune à leur entrée une tbife de largeur
& une toife de hauteur, & l’on peut en tems fec fe'
promener dans leur enceinte y & y pénétrer affez-'
loin : en tems humide & à là bruyante époque dit
retour >des eâux avec éclairs & tonnerres, il faut les:
fuir; le lac ri’a pas de bouches aufli terribles par l’abondance
des eaux qu’elles jettent, & fur-tout par
Fimpétuolité qui les accompagne ; les flots fortantde
leurs cavernes, s’élancent à cinq toifes loin de l’en-'
fré e, & fe précipitant au fond du lac, font tout le-
bruit & produifent toute l’écume des plus grandes
catarâéles: c’eft donc par ces deux bouches que viennent
alors au jour ces canards extraordinaires ; ils
naiffent comme au feindu fracas, & fe montrent d’abord
fous l’appareille plus hideux ; mais bientôt leur
nudité difparoît avec leurs ténèbres, & dans l’efpace
de quinze jours, fi les chafleurs les laiffent-vivre, ils
ont des plumes & voient clair. L’on finira cet article
en ajoutant qu’en hiver les eaux du lac de Cirknitr
s’élèvent ordinairement au, point d’inonder la plu-;
part des campagnes adjacentes. ( D. G. ) :
- CIRLE ou ZIRL, ( Géogr. ) village d’Allemagne*
dans le cercle d’Autriche & dans le comté du T yrol,
au quartier du haut Innthal, feigneurie de Herten-
berg. C’eft dans fon voiiinage que s’élève le roc ef-
çarpé appellé Martinf&and, au Commet duquel les
chroniques du x v efiecle nousdifent que l’empereur
Maximilien I pourfuivant un chamois, fé trouva fort
imprudemment grimpé ., fans favoir comment eti