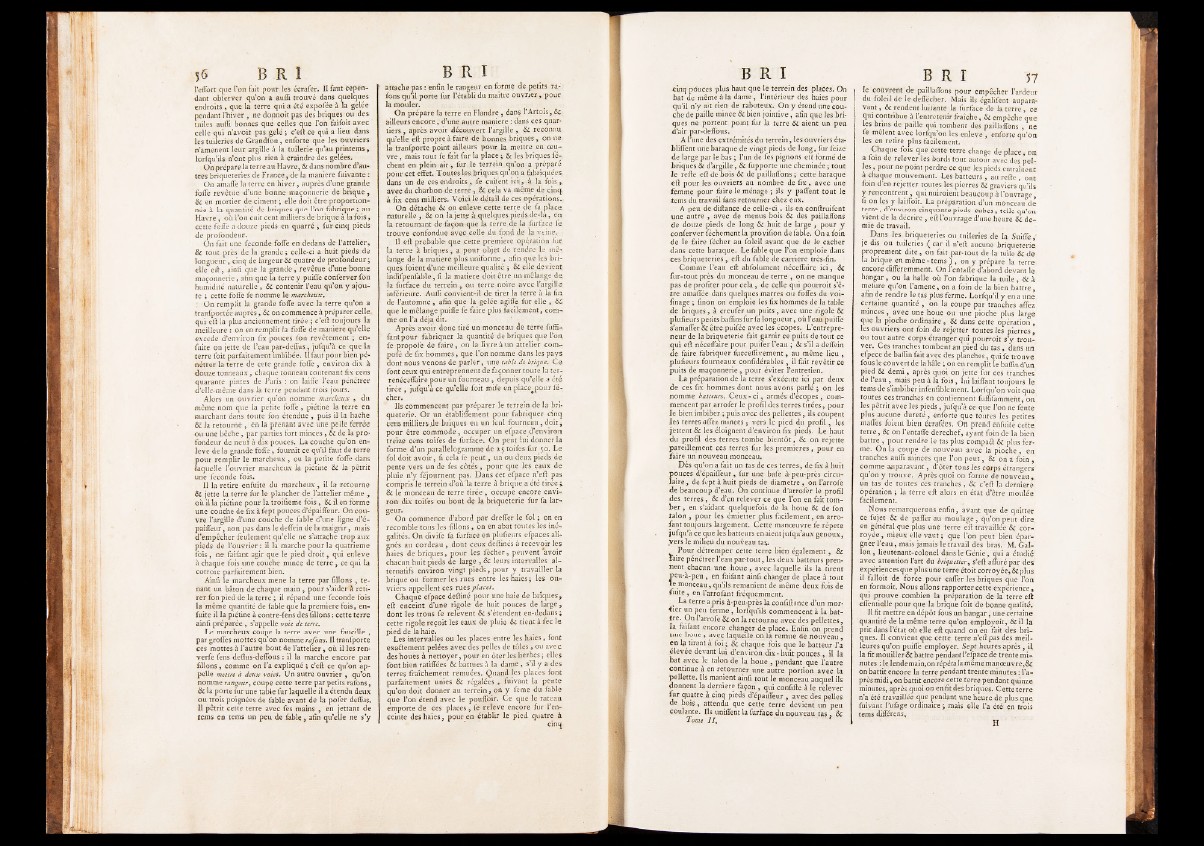
l’effoft que l'on fait pour les écrafer. Il faut Cependant
obferver qu’on a aufli trouvé dans quelques
endroits , que la terre qui a été expofée à la gelée
pendant l’hiver , ne donnait pas des briquesou des
tuiles aufli bonnes que celles que l’on faifoit avec
celle qui n’avoit pas gelé ; c’eft ce qui a lieu dans
les tuileries de Grandfon, enforte que les ouvriers
n’amenent leur argille cl la tuilerie qu’au printems,
lorfqu’ils: n’ont plus rien à craindre des gelées.
On prépare la terre au Havre, & dans nombre d’autres
briqueteries de France., de la maniéré fuivante :
On amaflé la terre en hiver, auprès d’une grande
’foffe revêtue d’une bonne maçonnerie de brique,
& en mortier de ciment ; elle doit être proportionnée
à la quantité de briques que l’on fabrique ; au
Havre , oit l’on cuit cent milliers de brique à la fois ,
cette foffe a douze pieds en quarré ; fur cinq pieds-
de profondeur.
On fait une fécondé foffe en dedans deTattelier,
& tout près de la grande ; celle-ci a huit pieds de
longueur, cinq de largeur Ôc quatre de profondeur ;
elle e f t , ainii que la grande , revêtue d’une bonne
maçonnerie, afin que la terre y puiffe conferver fon
humidité naturelle , ÔC contenir l’eau qu’on y ajoute
; cette foffe fe nomme le marcheux.
On remplit la grande foffe avec la terre qu’on a
tranfportée auprès, & on commence à préparer celle,
qui eft la plus anciennement tirée ; c ’eft toujours la
meilleure : on en remplit la foffe de maniéré qu’elle
excede d’environ fix pouces ion revêtement ; en-
fuite on jette de l’eau par-deffus, jufqu’à ce que la
terre foit parfaitement imbibéé. Il faut pour bien pénétrer
la terre de cete grande foffe , environ dix à
douze tonneaux, chaque tonneau contenant fix cens
quarante pintes de Paris : on laiffe l’eau pénétrer
d’elle-même dans la terre pendant trois jours.
Alors un ouvrier qu’on nomme march&ux , du
même nom que la petite foffe , piétine la terre en
marchant dans toute fon étendue , puis il la hache
ôc la retourne , en la prenant avec une pelle ferrée
ou une bêche, par parties fort minces , & de la profondeur
de neuf à dix pouces. La couche qu’on en-
leve de la grande foffe, fournit ce qu’il faut de terre
pour remplir le marcheux, ou la petite foffe dans
laquelle l’ouvrier marcheux la piétine 6c la pétrit
une fécondé fois.
Il la retire enfuite du marcheux, il la retourne
6c jette la terre fur le plancher de l’attelier même ,
oit il la piétine pour la troifieme fois , & il en forme
une couche de fix àfept pouces d’épaiffeur. On couvre
l’argille d’une couche de fable d’une ligne d’é-
paifl'eur, non pas dans le deffein de la maigrir, mais
d’empêcher feulement qu’elle ne s’attache trop aux
pieds de l’ouvrier : il la marche pour la quatrième
fo is , ne faifant agir que le pied droit, qui enleve
à chaque fois une couche mince de terre, ce qui la
corroie parfaitement bien.
Ainfi le marcheux mene la terre par filions , tenant
un bâton de chaque main , pour s’aider à retirer
fon pied de la terre ; il répand une fécondé fois
la même quantité de fable que la première fois, en-
fuite il la piétine à contre-fens des filions : cette terre
ainfi préparée,, s’appelle voie de terre.
Le marcheux coupe la terre avec une faucille ,
par grofl'es mottes qu’on nomme rafons. Il tranfporte
ces mottes à l’autre bout de l’attelier, oit il les ren-
verfe fens deflus-deffous : il la marche encore par
filions, comme on l’a expliqué ; c’eft ce qu’on appelle
mettre à deux voies. Un autre ouvrier , qu’on
nomme rangeur, coupe cette terre par petits rafons,
& la porte fur une table fur laquelle il a étendu deux
ou trois poignées de fable avant de la pofer deffus.
Il pétrit cette terre avec fes mains , en jettant de
teins en tems un peu de fable, afin qu’elle ne s’y
attache pas : enfin le rangeur en forme de petits ra-
foris qu’il porte fur l’établi du maître ouvrier., pour
la mouler. , . „ ,.
On prépare la terre eti Flandre , dans. l’Artois, 5c
ailleurs encore , d’une autre maniéré : dans ces quartiers
, après avoir -découvert l’argille », ôc reconnu
qu’elle éft propre à faire de bonnes briques ,, on ne
la tranfporte: point ailleurs pour la mettre en oeuvre
, mais tout fe fait fur la place ; & les briques fé-,
chent en plein air , fur îe terrein qu’on a préparé
pour cet effet. T.outes lesvbriques, qu’on a fabriquées,
dans un de ces endroits, ie çuilent ici;, à la fois»;
avec du charbon de terré , ôc cela va mêm,e de cinq
à fix cens milliers. Voici le détail de ces opérations..
On. détache & on enleye cette terre de fa place
naturelle, & on lajetreÀ.quelquespied?de-dà, en
la retournant de façon que la terre.de la fur fa ce fe
trouve confondue avec.,celle du fond de la veine.
Il eft probable que cette première opération fur
fa terre à briques, a pouf objet de rendre le mélange
de la matière plus uniforme , afin.que le;s briques
foient d’une meilleure qualité ; ôc elle devient
indifpenfable, li la matière doit'être Un mélange de
la furface du terrein , o.u terre noire avec l’argille
inférieure. Aufli convient-il de tirer la terre à la fin
de l’automne, afin que la gelée agiffe fur elle , ôc
que le mélange puiffe fe faire plus facilement, corn-*
me on l’a déj^ dit.
Après avoir donc tiré un monceau de terre fuffi-s
fantpour fabriquer la quantité de briques que l’on
fe propofe de faire, on la livre à un attelier corar
pofé de fix hommes, que l’on nomme dans les pays
dont nous venons de parler ;, une table de brique. C e
font ceux qui entreprennent de façonner toute la ter-
renéceffaire pour un fourneau , depuis qu’elle a été
tirée , jufqu’à ce qu’elle foit mife en place#pour fécher.
Ils commencent par préparer le terrçip de la briqueterie.
Or un établiffement pour fabriquer cinq
cens milliers .de briques en un ièul fourneau, doit,
pour être commode, occuper un efpace d’environ
treize cens toifes de furface. On peut lui donner la
forme d’un parallélogramme de 25 toiles fur 50. Le
fol doit avoir, fi cela fe peut, un ou deux pieds de
pente vers un de fes côté« , pour que les eaux de
pluie n’y féjournent pas. Dans cet efpace n’eft pas
compris le terrein d’oiila terre à brique a été tirée i
6c le monceau de terre tiré e , occupe encore envi-,
ron dix toifes ou bout de la briqueterie fur fa lar-,
geur.
On commence d’abord par dreffer le fol ; on en
recomble tous les filions, on en abat toutes les inégalités.
On divife fa furface en plufieurs efpaces alignés
au cordeau , dont ceux deftinés à recevoir les
haies de briques, pour les fécher, peuvent avoir
chacun huit pieds de large , 6c leurs intervalles alternatifs
environ vingt pieds, pour y travailler la
brique ou former les rues entre les haies ; les ouvriers
appellent ces rues places.
Chaque efpace deftiné pour une haie de briques,
eft enceint d’une rigole de huit pouces de large ,
dont les trous fe relevent ôc s’étendent en-dedans ;
cette rigole reçoit les eaux de pluie 5c tient à fec le
pied de la haie.
Les intervalles ou les places entre les haies, font
exa&ement pelées avec des pelles de tôles , ou avec
des houes à nettoyer, pour en ôter les herbes ; elles
font bien ratifiées 5c battues à la dame , s’il y a des
terres fraîchement remuées. Quand les places font
parfaitement unies ÔC régalées , fuivant la pente
qu’on doit donner au terrein i on y feme du fable
que l’on étend avec le pouffoir. Ce que le rateaii
emporte de ces places , fe releve encore fur l’enceinte
des haies, pour en établir le pied quatre à
cinq,
cinq pouces plus haut que le terrein des places. On 1
bat de même à la dame, l’intérieur des haies pour
qu’il n’y ait rien de raboteux. On y étend une cou- j
che de paille mince 5c bien jointive, afin que les briques
ne portent point fur la terre 5c aient un peu
.d’air par-deffous.
A l’une des extrémités du terrein, les ouvriers éta-
blifient une baraque de vingt pieds de long, fur feize
de large par le bas ; l’un de fes pignons eit formé de
briques & d’argille, ôc fupporte une cheminée ; tout
le refte eft de bois 5c de paillaffons ; cette baraque
eft pour les ouvriers au nombre de f ix , avec une
femme pour faire le ménage ; ils y paffent tout le
tems du travail fans retourner chez eux.
A peu de diftance de ce lle-ci, ils en conftruifent
une autre , avec de menus bois ôc des paillaffons
de douze pieds de long 5c huit de large , pour y
conferver îechementla provifion de fable. On a foin
de le faire fécher au foleil avant que de le cacher
dans cette baraque. Le fable que l’on emploie dans
ces briqueteries, eft du fable de carrière très-fin.
Comme l’eau eft abfolument néceffaire ic i , 5c
fur-tout près du monceau de terre , on ne manque
pas de profiter pour ce la, de celle qui pourroit s’être
amaffée dans quelques marres ou foffes du voi-
finage ; finon on emploie les fix hommes de la table
de briques, à creufer un puits, avec une rigole 5c
plufieurs petits baflins fur fa longueur, où l’eau puiffe
s’amaffer ôc être puifée avec les écopes. L’entrepreneur
de la briqueterie fait garnir ce puits de tout ce
qui eft néceffaire pour puifer l’eau ; 5c s’il a deffein
de faire fabriquer fucceflivement, au même lieu ,
plufieurs fourneaux confidérables , il fait revêtir ce
puits de maçonnerie, pour éviter l’entretien.
La préparation de la terre s’exécute ici par deux
de ces fix hommes dont nous avons parlé ; on les
nomme batteurs. C e u x - c i , armés d’écopes, commencent
par arrofer le profil des terres tirées, pour
le bien imbiber ; puis avec des pellettes, ils coupent
les terres affez minces , vers le pied du profil, les
jettent 5c les éloignent d’environ fix pieds. Le haut
du profil des terres tombe bientôt, ôc on rejette
pareillement ces terres fur les premières, pour en
faire un nouveau monceau.
Dès qu’on a fait un tas de ces terres, de fix à huit
pouces d’épaiffeur, fur une bafe à-peu-près circulaire
, de fept à huit pieds de diamètre , on l’arrofe
de beaucoup d’eau. On continue d’arrofer le profil
des terres, 5c d’en relever ce que l’on en fait tomber
, en s’aidant quelquefois de la houe 5c de fon
talon , pour les émietter plus facilement, en arro-
fant toujours largement. Cette manoeuvre fe répété
jufqu’à ce que les batteurs en aient julqu’aux genoux,
Vers le milieu du nouveau ta$.
Pour détremper cette terre bien également, 5c
taire pénétrer l’eau par-tout, les deux batteurs prennent
chacun une houe, avec laquelle ils la tirent
{>eu-à-peu , en faifant ainfi changer de place à tout
e monceau, qu’ils remanient de même deux fois de
fuite , en l’arrofant fréquemment.
, La terre a pris à-peu-près la confiftance d’un mortier
un peu ferme, lorfqu’ils commencent à la battre.
On l’arrofe 5c on la retourne avec des pellettes,
la faifant encore changer de place. Enfin on prend
line houe , avec laquelle on la remue de nouveau ,
en la tirant à foi ; 6c chaque fois que le batteur l’a
élevée devant lui d’environ, dix- huit pouces , il la
bat avec le talon de la houe , pendant que l’autre
continue à.en retourner une autre portion avec la
pellette. Ils manient ainfi tout le monceau auquel ils
donnent la derniere façon , qui confifte à le relever
fur quatre à cinq pieds d’épaiffeur , avec des pelles
de bois , attendu que cette terre devient un peu
coulante. Ils unifient la furface du nouveau tas * 5c
Tome I I . 1
le coûvrent de paillaffons pour empêcher l’ardeur
du foleil de le deffécher. Mais ils égalifent auparavant
, 5c rendent luilânte la furface de la terre, ce
qui contribue à l’entretenir fraîche, ôc empêche que
les brins de paille qui tombent des paillaffons , ne
fe melenyavec lorfqu’on les enleve , enforte qu’on
les en retire plus facilement.
Chaque fois que cette terre change de place, on
a foin de relever les bords tout autour avec des pelles
, pour ne point perdre ce que les pieds entraînent
à chaque mouvement. Les batteurs , au refte , ont
foin d’en rèjetter toutes les pierres 5c graviers qu’ils
y rencontrent, qui nuiroient beaucoup à l’ouvrage,
fi on les y laiffoit. La préparation d’un monceau de
terre, d’environ cinquante pieds cubes, telle qu’on
vient de la décrire , eft l’ouvrage d’une heure 5c demie
de travail.
Dans les. briqueteries ou tuileries de la Suiffe,'
je dis ou tuileries ( car il n’eft aucune briqueterie
proprement dite, on fait par-tout de la tuile 5c de
la brique en même-tems ) , on y préparé la terre
encore différemment. On l’entafle d’abord devant le
hangar, ou la halle où l’on fabrique la tuile, 5c à
mefure qu’on l’amene, on a foin.de la bien battre,
afin de rendre le tas plus ferme. Lorfqu’il y en a une
certaine quantité , on la coupe par tranches affez
minces, avec une houe ou une pioche plus large
que la pioche ordinaire., 5c dans cette opération ,
les ouvriers ont foin de rejetter toutes les pierres ,
ou tout autre corps étranger qui pourroit s’y trouver.
Ces tranches tombent au pied du tas , dans un
efpece de baffm fait avec des planches, qui fe trouve
fous le couvert de la liâle ; on en remplit le baffm d’un
pied 5c demi, après quoi on jette fur ces tranches
de l’eau , niais peu à la fois , lui laiffant toujours le
tems de s’imbiber irifénfiblement. Lorfqu’on voit que
toutes ces tranches en contiennent fuffifammeht, on
les pétrit avec les pieds, jufqu’à ce que l’on ne fente
plus aucune dureté, enforte que toutes les petites
maffes foient bien écrafées. On prend enfuite cette
terre, 6c on I’entaffe derechef, ayant foin de la bien
battre , pour rendre le tas plus compaâ: ôc plus ferme.
On la coupe de nouveau avec la pioche, en
tranches aufli minces que l’on peut, 6c on a foin ,
comme auparavant, d’ôter tous les c&rps étrangers
qu’on y trouve. Après quoi on forme de nouveau,
un tas de toutes ces tranches, ôc c’eft la derniere
opération ; la terre eft alors en état d’être moulée
facilement.
Nous remarquerons,enfin, avant que de quitter
ce fujet ôc de paffer au moulage , qu’on peut dire,
en général que plus une terre eft travaillée 5c corroyée
, mieux elle vaut ; que l’on peut bien épargner
Beau, mais jamais le travail des bras. M. Gallon,
lieutenant-colonel dans le Génie, qui a étudie
avec attention l’art du briquetier, s’eft affurépar des
expériences que plus une terre étoit corroyée, 6c plus,
il falloit de force pour caffer les briques que l’on
en formoit. Nous allons rapporter cette expérience,
qui prouve combien la préparation de la terre eft
effentielle pour que la brique foit de bonne qualité.
Il fit mettre en dépôt fous un hangar, une certaine
quantité de la même terre qu’on employoit, & i l la
prit dans l’état où elle eft quand on en fait des briques.
Il convient que cette terre n’eft pas des meilleures
qu’on puiffe employer. Sept heures après , il
la fit mouiller 5c battre pendant l’efpace de trente minutes
: le lendemain,on répéta la même manoeuvre,5c
on battit encore la terre pendant trente minutes : l’a-
près midi, on battit encore cette terre pendant quinze
minutes, après quoi on en fit des briques. Cette terre
n’a été travaillée que pendant une heure de plus que
fuivant l’ufage ordinaire 5 mais elle l’a été en trois
tems différons,
H