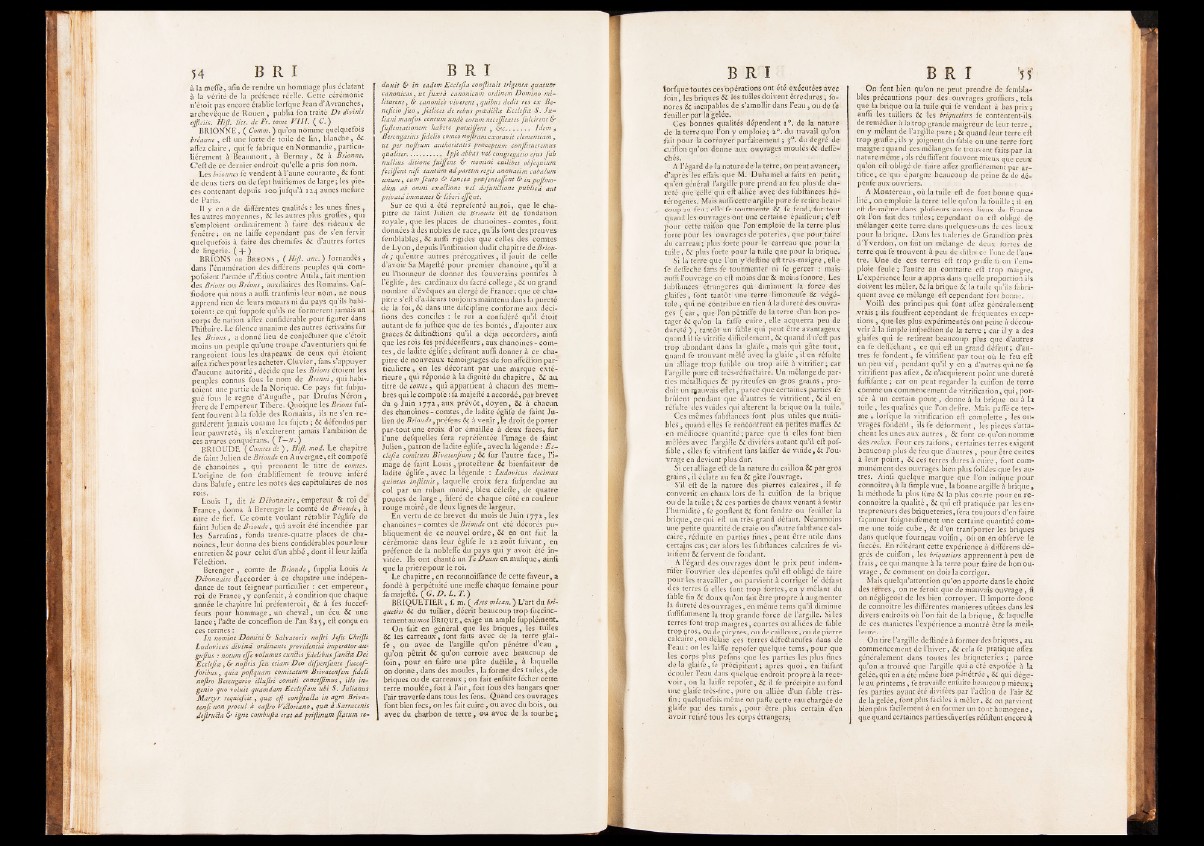
à la meffe, afin de rendre un hommage plus éclatant
à la vérité de la préfence réelle. Cette cérémonie
n’étoit pas encore établie lorfque Jean d’Avranches,
archevêque de Rouen , publia fon traité De divinis
officiis. Hiß. litt, de Fr. tome VIII. ( C. )
BRIONNE, ( Comm. ) qu’on nomme quelquefois
bréaune , eft une foTte de toile de lin, blanche, &
affez claire, qui fe fabrique en Normandie, particuliérement
à Beaumont, à Bernay, 6c à Brionne.
C ’eft de ce dernier endroit qu’elle a pris fon nom.
Les brionnes fe vendent à l ’aune courante, & font
de deux tiers ou de fept huitièmes de large ; les pièces
contenant depuis 100 jufqu’à 114 aunes mefure
de Paris. -
Il y en a de différentes qualités : les unes fines ,
les autres moyennes, 6c les autres plus groffes, qui
s’emploient ordinairement à faire des rideaux de
fenêtre;, on ne laiffe cependant pas de s’en fervir
quelquefois à faire des chemifes 6c d’autres fortes
de lingerie. ( + )
BRIONS ou BreONS , ( Hiß. une.) Jornandès ,
dans l’énumération des différens peuples qui com-
pofoient l’armée d’Ætius contre Attila , fait mention
des Brions ou B rions, auxiliaires des Romains. Caf-
fiodore qui nous a aufli tranfmis leur nom, ne nous
apprend rien de leurs moeurs ni du pays qu’ils habi-
toient: ce qui fuppofe qu’ils ne formèrent jamais un
corps de nation affez confidérable pour figurer dans
l ’hiftoire. Le filencé unanime des autres écrivains fur
les Brions, a donné lieu de conjecturer que c’etoit
moins un peuple qu’une troupe d’aventuriers qui fe
rangeoient fous les drapeaux de ceux qui étoient
affez riches pour les acheter. Cluvier, fans s’appuyer
d’aucune autorité, décide que les Brions étoient les
peuples connus fous le nom de Brenni, qui habi-
toient une partie de la Norique. Ce pays fut fubju-
gué fous le regne d’Augufte, par Drufus Néron,
frere de l’empereur Tibere. Quoique les Brions fuf-
fent fouvent à la foide des Romains, ils ne s’en regardèrent
jamais comme les fujets ; 6c défendus par
leur pauvreté, ils n’exciterent jamais l’ambition de
ces avares conquérans. ( T— N. )
BRIOUDE {Comtes d e ) , Hiß. moi. Le chapitre
de faint Julien de Brioude en Auvergne,eft compofé
dé chanoines , qui prennent le titre de comtes.
L’origine de fon établiffement fe trouve inféré
dans Balufe, entre les notes des capitulaires de nos
rois. H H
Louis I , dit le Débonnaire, empereur & roi de
France, donna à Berenger le comté de Brioude, à
titre de fief. Ce comte voulant rétablir l’églife de
faint Julien de Brioude, qui avoit été incendiée par
les Sarrafins, fonda trente-quatre places de chanoines
, leur donna des biens confidérables pour-leur
entretien 6c pour celui d’un abbé, dont il leur laiffa
l’éleCtiori.
Berenger , comte de Brioude, fupplia Louis le
Débonnaire d’accorder à ce chapitre une indépendance
de tout feigneur particulier : cet empereur,
roi de France , y confentit, à condition que chaque
année le chapitre lui préfenteroit, & à fes fuccef-
feurs pour hommage, un cheval, un écu 6c une
lance ; l’aCte de concefîion de l’an 815, eft conçu en
ces termes :
In nomine Domini & Salvatoris nofiri Jefu Chrifit
Ludovicus divinâ ordinante providentiâ imperator au-
gußus : notum effe volumus cunclis fidelibus fanclee Dei
Ecclefice, 6* noßris feu etiam Deo difpenfante fuccef-
foribus , quia poßquam comitatum Brivatenfem fideli
noßro Berengario illufiri corniti conceffimus, Me in-
genio quo voluit quamdam Ecclefiam ubi S. Julianus
Martyr requiefeit, quæ eß conßrucla in agro Briva-
tenfi non procul à caßro Vïcloriano, quee a Sarracems
deßrucla & ignt combußa erat ad prifiinutn fiatum rc»
duxit & in eadem Ecclefia conflituit trigenta quatuor
canonicos, ut juxtà canonicum ordmern Domino mi-
litarent, & canonice viverent, quibus dédit res ex Bénéficia
fu o , fcilicet de rebus prcediclce Ecclefice S. Ju-
liani rnanfos centum undè eorum necejfitates fulcirent & .
fufientaùonem habere potuifftnt , &c............. Idem ,
Berengarius fidelis cornes nofiram exoravit clementiam,
ut per nofirum authoritatis proeceptum confiitueremus
qualiter............... . Ipfe abbas vel congregatio ejus Jub
nullius ditione fuiffent & nomini cuilibet obfequium
fecifient nifi tantum adpartem regis annuaùm cabalum
unum, cum feuto & lancea preefentaffent & in pofimo-
dàm ab ornni exaclione vel defunctione publicâ aut
privatâ immunes & liberi effent.
Sur ce qui a été repréfenté a u /o i, que le chapitre
de faint Julien de Brioude eft de fondation
royale, que les places de chanoines - comtes, font.
données à des nobles de race, qu’ils font des preuves
femblâbles, & aufli rigides que celles des comtes
de Ly on , depuis l’inftitution dudit chapitre de Brioude
; qu’entre autres prérogatives , il jouit de celle
d’avoir Sa Majefté pour premier chanoine, qu’il a
eu l’honneur de donner des fouverains pontifes à
l’églife, des cardinaux du facré college, 6c un grand
nombre d’évêques au clergé de France; que ce chapitre
s’eft d’ailleurs toujours maintenu dans la pureté
de la foi, 6c dans une difcipline conforme aux décriions
des conciles : le roi a confidéré qu’il étoit
autant de fa juftice que de fes bontés, d’ajouter aux
grâces 6c diftinûions qu’il a déjà accordées, ainfi
que les rois fes prédéceffeurs, aux chanoines - comtes
, de ladite églife ; délirant aufli donner à ce chapitre
de nouveaux témoignages de fon affeCtion par-
, ticuliere, en les décorant par une marque extérieure
, qui réponde à la dignité du chapitre, & au
titre de comte, qui appartient à chacun des membres
qui lecompofe : fa majefté a accordé, pat brevet
du 9 Juin 1 7 7 2 ,aux prévôt, doyen, 6c à chacun
des chanoines - comtes, de ladite églife de faint Julien
de Brioude, préfens 6c à venir , 1e droit de porter
par-tout une croix d’or émaillée à deux faces, fur
l’une defquelles fera repréfentée l’image de faint
Julien, patron de ladite églife, avec la légende : Ec -
clefia comitum Bivatenfium ; 6c fur l’autre face, l’image
de faint Louis, protecteur 6c bienfaiteur de
ladite églife , avec la légende : Ludovicus decimus
quintus infiituit, laquelle croix fera fufpendue au
col par un ruban moiré, bleu célefte, de quatre
pouces de large , liferé de chaque côté en couleur
rouge moiré, de deux lignes de largeur.
En vertu de ce brevet du mois de Juin 17 72 , les
chanoines - comtes de Brioude ont été décorés publiquement
de ce nouvel ordre, & en ont fait la
cérémonie dans leur églife le 12 août fuivant, en
préfence de la noblefle du pays qui y avoit été invitée.
Ils ont chanté un Te Deum en mufique* ainfi
que la priere>pour le roi.
Le chapitre, en reconnoiflance de cette faveur, a
fondé à perpétuité une meffe chaque femaine pour
fa majefté. ( G. D . L. T. )
BRIQUETIER, f. m. ( Arts mécan. ) L’art du bri-
quetier & du tuilier, décrit beaucoup trop fuccinc-
tementauTOor Br iq u e , exige un ample fupplément.
On fait en général que les briques, les tuiles
6c les carreaux, font faits avec de la terre glai-
fe , ou avec de l’argille qu’on pénétre d’eau ,
qu’on pétrit & qu’on corroie avec beaucoup de
foin, pour en faire une pâte duftile, à laquelle
on donne, dans des moules, la forme des tuiles, de
briques ou de carreaux ; on fait enfuite fécher cette
terre moulée, foit à l’air, foit fous des hangars que’
l’air traverfe dans tous les fens. Quand ces ouvrages
font bien fecs, on les fait cuire, ou avec du bois, ou
avec du charbon de terre, ou avec de la tourbe ;
lorfque toutes ces'opérations ont été exé&itê'e$ avec
foin, les briques & les tuiles doivent être dures j fo-
nores & incapables de s’amollir dans l’eau, ou de fe
feuiller par la gelée.
Ces bonnes qualités dépendent î° . de la nature
de la terre que l’on y emploie ; a°. du travail qu’on
fait pour la corroyer parfaitement ; 30. du degré de
cuiflonqu’on donne aux ouvrages moulés &• defle-1
chés.
A l’égard de la nature de la terre, 0"n peut avancer,
d’après les eflais que M. Duhamel a1 faits en petit,
qu’en général Fargillfe pure prend au feu plus de dureté
que céllé qui eft alliée avec desfubftances hétérogènes.
Mais aufli'cette argille pute fe retire beau-:
coupau fed ; elle: fe tourmente 6c fe fend ^furftôut
quand les ouvrages Ont une certaine épaifleur ; c’eft
pour cette raifon qite l’on'emplo'ie de la terre plus
forte pour les ouvrages de poteries, que pour faire'-
du carreau ; plus forte pour le carreau que pour la
tuile, 6c plus forte pour la tuile que pour la brique.
Si la terre que l’on y ’deftiné eft très-maigre , elle
fe deffeche fans fe tourmenter ni fe gercer mais-
aufli l’ouvràge en eft moins dur & moins fonoré. Les
lubftanceS ■ étrangères qui diminuent la force des
glaifes, font' tantôt! une' terre • limoneufe & végétale,
qui né contribue en rien à la dureté des ouvragés
( car, que l’on pétrifie de la terre d’un bon potager
& qu’on la fa lié cuire , elle acquerra peu de
dureté ) , tantôt un fable' qui peut être avantageux
quand il fe vitrifie difficilement , 6c quand il n’eft pas
trop abondant dans la glaife, mais qui gâte tout,
quand fe trouvant mêlé avec la glaife , iL en réfulte
un alliage trop fitfible ou trop aifé à vitrifier; car
l’argille pure eft très-réfraftaire. Un mélange de parties
métalliques & pyriteufes en gros grains , produit
un qjauvais effet , parce qUé certaines parties fe
brûlent pendant que d’autres fe vitrifient, 6c il en
réfulte des vuides qui altèrent la brique ou la tuile.v
Ces mêmes fubftances font plus utiles que nuifi-
bles , quand elles fe rencontrent en petites mafles &
■ en médiocre quantité ; parce que fi elles font bien
mêlées avec l’argille & divifées autant qu’il eft pof-
fib le, elles fe vitrifient làns laifler de vuide, & l’ouvrage
en devient plus dur.
Si cet alliage eft de la nature du caillou & par gros
grains, il éclate au feu & gâte l’ouvrage.
S’il èft de la nature des pierres calcaires, il fe
convertit en chaux lors de la cuiflon de la brique
ou de la tuile ; 6c ces parties de chaux venant à fentir
l ’humidité, fe gonflent 6c font fendre ou feuiller la
brique, ce qui eft un très-grand défaut. Néanmoins
une petite quantité de craie ou d’autre fubftance calcaire,
réduite en parties fines, peut être utile dans
certains cas; car alors les fubftances calcaires fe vitrifient
6c fervent de fondant.
A l’égard des ouvrages dont le prix peut indem-
nifer l’ouvrier des dépenfes qu’il eft obligé de faire
pour les travailler , on parvient à corriger lé défaut
des terres fi elles font trop fortes, en y mêlant du
fable fin & doux qu’on fait être propre à augmenter
la dureté des ouvrages, en même tems qu’il diminue
fuffifamment la trop grande force de l’argille. Si les
terres font trop maigres, courtes ou alliées de fable
trop gros, ou de piry tes, ou de cailloux, ou de pierre
calcaire, on délaie ,ces terres défeftueufes dans de
l’eau : on les laiffe repofer quelque tems, pour que
les corps plus pefans que les parties les plus fines
de la glaife, fe précipitent ; après q u o i, en faifant
écouler l’eau dans quelque endroit propre à la recev
o ir , on la laiflè repofer, 6c il fe précipite au fond
uue glaife très-fine, pure ou alliée d’un fable très-
fin ; quelquefois même ou pafle cette eau chargée de
glaife par des tamis,,pour être plus certain d’en
avoir retiré tous les eprps étrangers;
On lent bien qu’on ne peut prendre de fembla-*
blés précautions pqur des. ouvrages grofliers, telà
que la brique ou la tuile qui fe vendent à bas prix ;
aufli les tuiliers 6c les briquetiers fe contentent-ils
de remédier à la trop grande maigreur de leur terre,
en y mêlant de l’argille pure ; & quand leur terre eft
trop grafle, ils y joignent du fable ou une terre fort
maigre tqtiand ces mêlangés:fe trouvent faits par la
nature même * ils réufliflent fouvent mieux que ceux
qu’on eft'obligé de faire affez grofliérement par artifice,
ce qui épargrie beaucoup de peine 6c de dé-
penfe aux ouvriers.
A Montèreau , oii la tuile eft de fort bonne qua*
lité , on emploie la terre telle qu’on la fouille ; il en
eft de même dans plufieurs'autres lieux de France
où Fon fait des tuiles ; cependant on eft obligé de
mélanger cette terre dans quelques-uns de ces lieux
pour la brique. Dans les tuileries de Grandfon près
d’YverdÔn, on fait un mélange de deux fortes de
terre qui fe trouvent à peu de diftance l’une de l’au*
tre. Une de ces terres eft trop graffe li on l’emploie
feule ; l’autre au contraire eft trop maigre.
L’expérience leur a appris dans quelle proportion ils
doivent les mêler, 6c la brique. 6c la tuile qu’ils fabri*
quent avec ce mélange eft cependant fort bonne., s
Voilà des principes qui font affez généralement
.vrais ; ils fouffrent cependant de fréquentes excep*
tions , que les plus expérimentés ont peihe à décou-*
vrir à la fimple infpéâibn de la terre ; car il y a des
glaifes qui fe retirent beaucoup plus que d’autres
en fe defféchant, ce qui eft un grand défaut ; d’autres
fe fondent, fe vitrifient par tout oii le feu eft
un peu v if , pendant qu’il y en a d’autres qui ne fe
vitrifient pas affez, 6c n’acquierent point une dureté
fuffifante ; car on peut regarder la cuiffon de terre
comme un commencement de vitrification, qui, por-»
tée à un certain point, donne à la brique ou à la
tuile , les'qualités que l’on defire. Mais pafle ce terme
, lorfque la vitrification eft complette , les ou*
vrages fondent, ils fe déforment, les pièces s’afta*
chent les unes aux autres , 6c font ce.qu’on nomme
des roches. Pour ces raifons, certaines terres exigent
beaucoup plus de feu que d’autres , pour être cuites
à leur point, 6c ces terres dures à cuire, font communément
des ouvrages bien plus folides que les autres.
Ainfi quelque marque que l’on indique pour
connoître -, à la fimplé vue, la bonne argille à brique,
la méthode la plus lûre 6c la plus courte pour en re-
connoître la qualité, & qui eft pratiquée par les entrepreneurs
des briqueteries, fera toujours d’en faire
façonner foigneufement une certaine quantité comme
une toife cube , 6t d’en tranfporter les briques
dans quelque fourneau voifin , oit on en obfervë le
fuccès. En réitérant cette expérience à différens degrés
de cuiffon , les briquetiers apprennent à peu de
frais, ce qui manque à la terre pour faire de bon ouvrage
, 6c comment on doit la corriger.
. Mais quelqu’attention qu’on apporte dans le choix
des téh-es, on ne feroit que de mauvais ouvrage , fi
on négligeoit de les bien corroyer. Il importe donc
de connoître les différentes maniérés ufitées dans les
divers endroits où l’on fait de la brique, & laquelle
de ces maniérés l’expérience a montré être la meilr
leure.
On tire l’argille deftinée à former des briques, au
commencement de l’hiver, 6c cela fe pratique affez
généralement dans toutes les briqueteries ; parce
qu’on a trouvé que l’argille qui a été expofée à la
gelée, qui en a été même bien pénétrée, 6c qui dégelé
au printems, fe travaille enfuite beaucoup mieux;
fes parties ayant été divifées par Faction de l ’air 6c
de la £elée, font plus faciles à mêler, & on parvient
bien plus facilement à en former un tout homogène,
que quand certaines parties diverfes réfiftent encore à