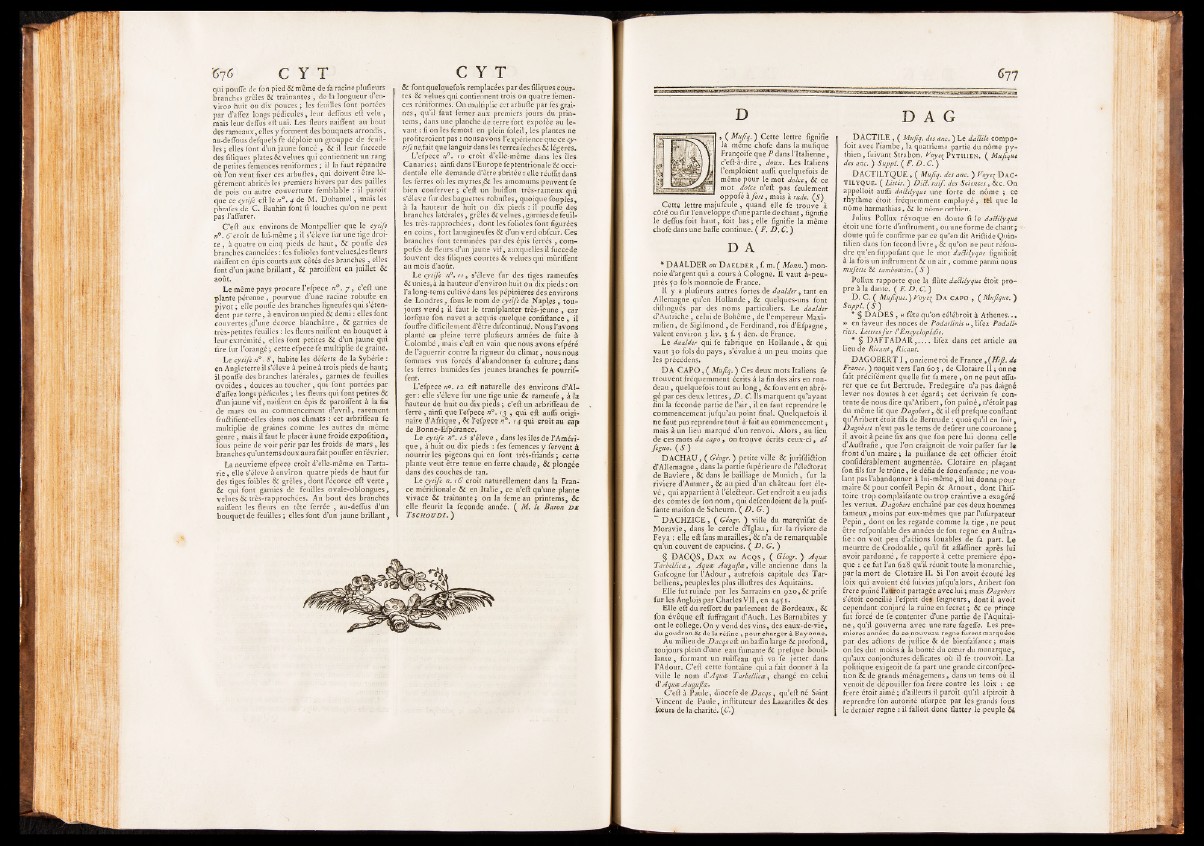
qüi pouffe de Ton pied & même de fa racine plufieurs
branches grêles 5c traînantes , de la longueur d’environ
huit ou dix pouces ; les feuilles font portées
par d’affez longs pédicules, leur deffous eft velu ,
mais leur deffus eft uni. Les fleurs naiffent au bout
des rameaux, elles y forment des bouquets arrondis,
âu-deffous defquels fe déploie un grouppe de feuil-
les ; elles font d’un jaune foncé , 5c il leur fuccede
des liliques plates Ôi velues qui contiennent un rang
de petites femences reniformes ; il la faut répandre
où l’on veut fixer ces arbuftes, qui doivent etre légèrement
abrités les premiers hivers par des pailles
de pois ou autre couverture femblable : il par'oît
que ce cytife eft le n°. 4 de M. Duhamel, mais les
phrafes de C. Bauhin font fi louches qu’on ne peut
pas Paffurer.
C’eft aux environs de Montpellier que le cytife
n°. 6 croît de lui-même ; il s’élève fur une tige droite
, à quatre ou cinq pieds de haut, 5c pouffe des
branches Cannelées : fes folioles font velues,les fleurs
naiffent en épis courts aux côtés des branches , elles
font d’un jaune brillant, 5c paroiffent en juillet 5c
août.
Le même pays procure l’efpece n°. y , c’eft une
plante pérenne , pourvue d’une racine robufte en
pivot ; elle pouffe des branches ligneufes qui s’étendent
par terre, à environ un pied 5c demi : elles font
couvertes (d’une écorce blanchâtre, 5c garnies de
très-petites feuilles : les fleurs naiffent en bouquet à
leur extrémité, elles font petites & d’un jaune qui
tire fur l’orangé ; cette efpece fe multiplie de graine.
Le cytife n°. 8 , habite les déferts de la Sybérie :
en Angleterre il s’élève à peineà trois pieds de haut;
il pouffe des branches latérales, garnies de feuilles
ovoïdes , douces au toucher, qui font portées par
d’affez longs pédicules ; les fleurs qui font petites 5c
d’un jaune vif, naiffent en épis 5c paroiffent à la fin
de mars ou au commencement d’avril, rarement
fruétifient-elles dans nos climats : cet arbriffeau fe
multiplie de graines comme les autres du même
genre , mais il faut le placer à une froide expofition,
fous peine de voir périr par les froids de mars, les
branches qu’un tems doux aura fait pouffer en février.
La neuvième efpece croît d’ elle-même en Tarta-
r ie , elle s’élève à environ quatre pieds de haut fur
des tiges foibles 5c grêles, dont l’ecorce eft ve r te ,
& qui font garnies de feuilles ovale-oblongues,
velues 5c très-rapproehées. Au bout des branches
naiffent les fleurs en tête ferrée , au-deffus d’un
bouquet de feuilles ; elles font d’un jaune brillant,
5c font quelquefois remplacées par des filiques courtes
5c velues qui contiennent trois ou quatre femences
réniformes. On multiplie cet arbufte par fes graines,
qu’il-faut femer aux premiers jours du prin-
tems, dans une planche de terre fort expofée au levant
: fi on les femoit en plein foleil, les plantes ne
profiteroient pas : nous avons l’expérience que ce cytife
ne.fait que languir dans les terres feches 5c légères.
L’efpece n°. 10 croît d’elle-même dans les îles
Canaries; ainfi dans l’Europe feptentrionale & occidentale
elle demande d’être abritée : elle réuffit dans
les ferres où les myrtesjk. les amomums peuvent fe
bien conferver ; c’eft un buiffon très-rameux qui
s’élève fur des baguettes robuftes, quoique fouples,
à la hauteur de huit ou dix pieds : il pouffe des
branches latérales, grêles 5c velues, garnies de feuilles
très-rapprochées, dont les folioles font figurées
en coins, fort lanugineufes 5c d’un verd obfcur. Ces
branches font terminées par des épis ferrés , com-
pofés de fleurs d’un jaune v if, auxquelles il fuccede
fouvent dés filiques courtes & velues qui mûriffent
au mois d’août.
Le cytife n°. 11, s’élève fur des tiges rameufes
5c unies, à la hauteur d’environ huit ou dix pieds : on
l’a long-tems cultivé dans les pépinières des environs
de Londres, fous le nom de cytife de Naples , toujours
verd ; il faut le tranfplanter très-jeune , car
lorfque fon navet a acquis quelque confiftance , il
fouffre difficilement d’être difcontinué. Nous l’avons
planté ea pleine terre plufieurs années de fuite à
Colombé, mais c’eil en vain que nous avons efpéré
de l’aguerrir contre la rigueur du climat, nous nous
fommes vus forcés d’abandonner fa culture;dans
les ferres humides fes jeunes branches fe pourrif-
fent.
L’efpece no. 12 eft naturelle des environs d’Alger
: elle s’élève fur une tige unie 5c rameufe, à la
hauteur de huit ou dix pieds ; c’eft un arbriffeau de
ferre , ainfi que l’efpece n°. /j , qui eft aufli originaire
d’Afrique, 5c l’efpece n°. 14 qui croît au cap
de Bonne-Elpérance.
Le cytife n°. i5 s’élève , dans les îles de l’Amérique
, à huit ou dix pieds : fes femences y fervent à
nourrir les pigeons qui en font très-friands ; cette
plante veut être tenue en ferre chaude, 5c plongée
dans des couches de tan.
Le cytife n. 16 croît naturellement dans la France
méridionale & en 'Italie, ce n’eft qu’une plante
vivace 5c traînante; on la femeau printems, 5c
elle fleurit la fécondé année. ( M. le Baron d e
Ts ch o u d i . )
D
> ( Mujîq, ) Cette lettre fignifîe
la même chofe dans la mufique
Françoife que P dans l’Italienne,
c’eft-à-dire, doux. Les Italiens
l’emploient aufli quelquefois de
même pour le mot dolce, & ce
mot dolce n’eft pas feulement
a oppofé à fort, mais à rude. ( S)
Cette lettre majufcule , quand elle fe trouve à
côté ou fur l’enveloppe d’une partie de chant, lignifie
le deffus foit haut, foit bas ; elle lignifie la même
chofe dans une baffe continue. ( F. D . C. )
D A
* DAALDER ou D a e l d e r , f. m. ( Monn.) mon-
noie d’argent qui a cours à Cologne. Il vaut à-peu-
près 50 lois monnoie de France.
Il y a plufieurs autres fortes de daalder, tant en
Allemagne qu’en Hollande, 5c quelques-uns font
diftingués par des noms particuliers. Le daalder
d’Autriche , celui de Bohême, de l’empereur Maximilien
, de Sigifmond, de Ferdinand, roi d’Efpagne,
valent environ 3 liv. 3 f. 5 den. de France.
Le daalder qui fe fabrique en Hollande, & qui
yaut 30 fols du pays, s’évalue à un peu moins que
les précédons.
D A C A PO , ( Mujiq. ) Ces deux mots Italiens fe
trouvent fréquemment écrits à la fin des airs en rondeau
, quelquefois tout au long, 5c fouvent en abrégé
par ces deux lettres, D . C. Ils marquent qu’ayant
fini la fécondé partie de l’air , il en faut reprendre le
commencement jufqu’au point final. Quelquefois il
ne faut pas reprendre tout-à-fait au commencement,
mais à un lieu marqué d’un renvoi. Alors, au lieu
de ces mots da capo, on trouve écrits ceux-ci, al
fegno. ( S )
DACHAU, ( Géogr.) petite ville & jurifdiélion
d’Allemagne, dans la partie fupérieure de l’éleélorat
de Bavière , 5c dans le bailliage de Munich, fur la
riviere d’Ammer, 5c au pied d’un château fort élevé
, qui appartient à l’éleéteur. Cet endroit a eu jadis
des comtes de fon nom, qui defcendoient de la puif-
fante maifon de Scheurn. ( D . G. )
DA CH ZICE, ( Géogr. ) ville du marquifat de
Moravie, dans le cercle d’Iglau, fur la riviere de
Feya : elle eft fans murailles, & n’a de remarquable
qu’un couvent de capucins. ( D . G. )
§ D A CQ S , D a x ou Ac q s , ( Géogr. ) Aquce
Tarbellicce, Aquat Augufce, ville ancienne dans la
Gafcogne fur l’Adour, autrefois capitale des Tar-
belliens, peuples les plus illuftres des Aquitains.
Elle fut ruinée par les Sarrazins en 920, 5c prife
fur les Ânglois par Charles V I I , en 1451.
Elle eft du reffort du parlement de Bordeaux, 5c
fon évêque eft fuffragant d’Auch. Les Barnabites y
ont le college. On y vend des vins, des eaux-de-vie,
du goudron 5c de la réfine , pour charger à Bayonne.
Au milieu de D acqs eft. un baffin large 5c profond,
toujours plein d’une eau fumante 5c prefque bouillante
, formant un ruiffeau qui va fe jetter dans
l’Adour. C’eft cette fontaine qui a fait donner à la
ville le nom d'Aquce Tarbellicce, changé en celui
d’Aquce Augujla.
Ç ’eft à Paule, diocefe de Dacqs, qu’eft né Saint
Vincent de Paule, inftituteur des Lazariftes 5c des
Coeurs de la charité. (C.)
D A G
DACTlLË , ( Mufq. des anc. ) Le daclile compo*
foit avec l’ïambe, la quatrième partie du nôme py*
thien, fuivant Strabon. f^oye^ Pythien. ( Mufique
des anc. ) Suppl. ( F. D . C. )
DACT ILYQU E, ( Mufq. des anc. ) Voye^ D AC*
TILYQUE. ( Littér. ) Dicl. raif des Sciences, &c. On
appelloit aufli daclilyque une forte de nôme ; ce
rhythme étoit fréquemment employé, ttl que le
nôme harmathias, 5c le nôme orthien.
Julius Pollux révoque en doute fi le daclilyque
étoit une forte d’inftrument, ou une forme de chant;
doute qui fe confirme par ce qu’en dit Ariftide Quin*
tilien dans fon fécond livre, 5c qu’on ne peut réfoudre
qu’en fuppofant que lè mot daclilyque fignifioit
à la fois un infiniment 5c un air, comme parmi nous
mufette 5c tambourin. ( S )
Pollux rapporte que la flûte daclilyque étoit propre
à la danle. ( F. D. C. )
D. C. ( Mufique.') Voye^ D a CAPO , ( Mufique. )
Suppl. (A )
* § D ADES , « fête qu’on célébroit à Athènes.. »
» en faveur des noces de Podarlinis » , lifez Podali*
rius. Lettres fur C Encyclopédie.
* § D A F T A D A R ,,... lifez dans cet article au
lieu de Ricant, Ricaut.
DAGOBERT I , onzième roi de France ,(Zô/?. d e
France. ) naquit vers l’an 603 , de Clotaire II ; on ne
fait précifément quelle fut fa m ere, on ne peut affu-
rer que ce fut Bertrude. Fredegaire n’a pas daigné
lever nos doutes à cet égard ; cet écrivain fe contente
de nous dire qu’Aribert, fon puîné, n’étoit pas
du même lit que Dagobert, 5c il eft prefque confiant
qu’Aribert étoit fils de Bertrude : quoi qu’il en foit,
Dagobert n’eut pas le tems de defirer une couronne ;
il avoit à peine fix ans que fon pere lui donna celle
d’Auftrafie , que l ’on craignoit de voir paffer fur 1«
front d’un maire ; la puiffance de cet officier étoit
confidérablement augmentée. Clotaire en plaçant
fon fils fur le trône, fe défia de fon enfance ; ne voulant
pas l’abandonner à lui-même, il lui donna pour
maire & pour confeil Pépin 5c Arnout, dont l’hif-
toire trop complaifante ou trop craintive a exagéré
les vertus. Dagobert enchaîné par ces deux hommes
fameux, moins par eux-mêmes que par l’ufurpateur
Pépin, dont on les regarde comme la tige, ne peut
être refponfable des années de fon régné en Auftra-
fie : on voit peu d’aétions louables de fa part. Le
meurtre de Crodoalde, qu’il fit affaffiner après lui
avoir pardonné, fe rapporte à cette première époque
: ce fut l’an 62.8 qu’il réunit toute la monarchie,
par la mort de Clotaire II. Si l’on avoit écouté les
loix qui avoient été fuivies jufqu’alors, Aribert fon
frere puîné l’atfroit partagée avec lui ; mais Dagobert
s’étoit concilié I’efprit des feïgneurs, dont il avoit
cependant conjuré la ruine en fecret ; 5c ce prince
fut forcé de fe contenter d’une partie de l’Aquitaine
, qu’il gouverna avec une rare fageffe. Les premières
années de ce nouveau régné furent marquées
par des aérions de juftice & de bienfaifance ; mais
on les dut moins à la bonté du coeur du monarque,
qu’aux conjonctures délicates où il fe trouvoit. La
politique exigeoit de fa part une grande circonfpec-
tion 5c de grands ménagemens, dans un tems où il
venoit de dépouiller fon frere contre les loix : ce
frere étoit aimé ; d’ailleurs il paroît qu’il afpiroit à
reprendre fon autorité ufurpée par les grands fous
le dernier régné : il falloit donc flatter le peuple &