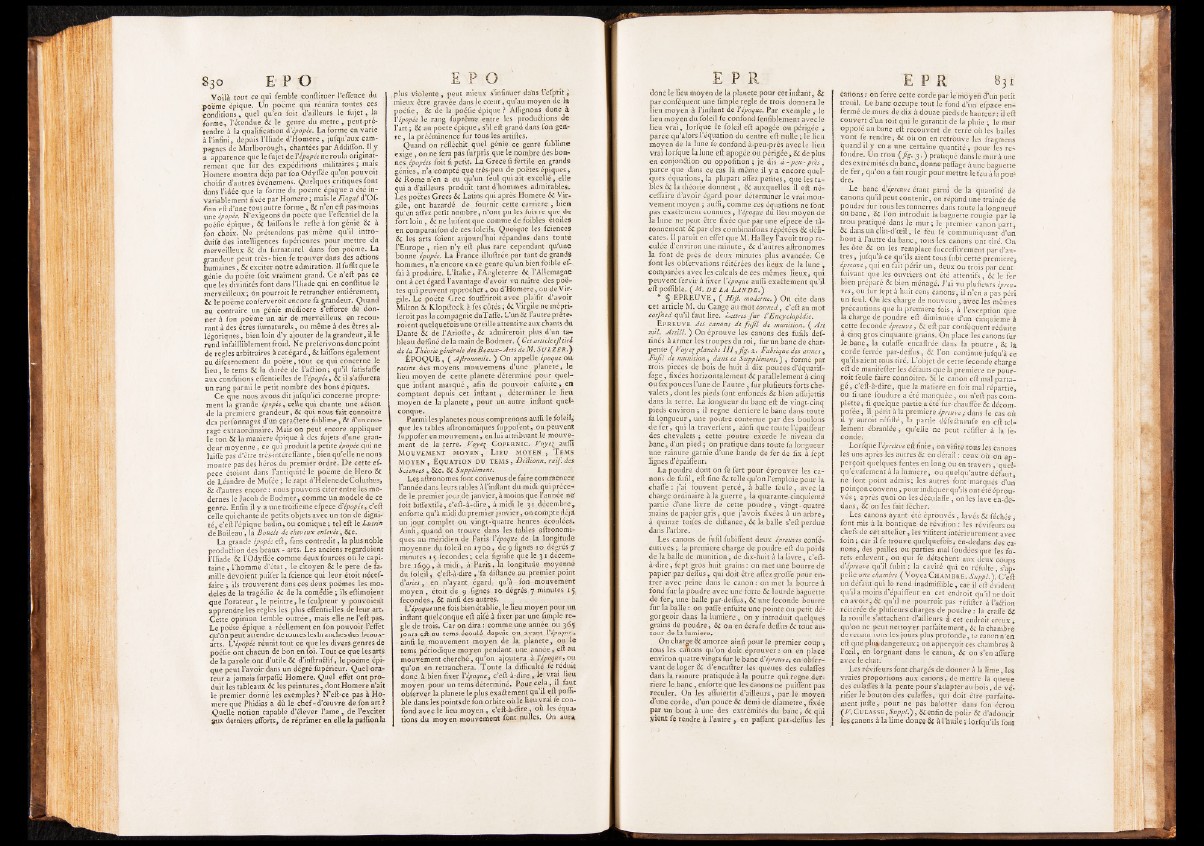
Voilà tout ce qui femble conftituer l’-effence du
:poëme epique. Un poëme qui réunira toutes ces
^conditions, quel qu’en foit d’ailleurs le fujet, la
forme, ï’ëtendue & le genre du métré, peut prétendre
à la qualification Ü épopée. La forme en varie
à l’infini, depuis l’Iliade d’Homere , jufqu’aux campagnes
de Marlborough, chantées par Addiffon» II y
•a apparence quelefujet de Y épopée ne roula originar- :
rement que fur des expéditions militaires ; mais
Homere montra déjà par fon OdylTée qu’on pouvoit ;
choifir d’autres événemens. Quelques critiques font
dans l’ idée que la forme du poëme epique a été invariablement
fixée par Homere ; mais le Fingald’Of-
fian eft d’une tout autre forme, & n’en eft pas-moins
une épopée. N’exigeons du poëte que l’effentiel de la
poéfie épique, & laiffons le refte à fon génie & à
fon choix. Ne prétendons pas- même qu’il i'ritro-
duife des intelligences fupérienres pour mettre du
merveilleux & du furnaturel dans fon poëme. La
grandeur peut très-bien fe trouver dans des aâions
humaines, & exciter notre admiration. II fuffit que le
génie du poëte foit vraiment grand. Ce n’eft pas ce
que les divinités font dans l’Iliade qui en conftitue le
merveilleux; on pourroit le retrancher entièrement*
& le poëme cônferveroit encore fa grandeur. Quand
au contraire un génie médiocre s’efforce de donner
à fon poëme un air de merveilleux en recouvrant
à des êtres furnatureis, ou même à des êtres allégoriques
, bien loin d’y ajouter de la grandeur, il le
rend infailliblement froid. Ne prefcrivons donc point
de réglés arbitraires à cet égara, & laiffons également
au dïfcernement du poëte, tout ce qui concerne le
lieu , le tems & la durée de l’a&ion ; qu’il fatisfaffe
aux conditions effentielles de l'épopée, & il s’affurera
un rang parmi le petit nombre des bons épiques.
Ce que nous avons dit jufqu’iei concerne proprement
la grande épopée, celle qui chante une aftion
de la première grandeur, & qui nous fait connoître
des perfonnages d’un caraâere fublime * & d’un courage
extraordinaire. Mais on peut encore appliquer
le ton & la maniéré épique à des fujets d’une grandeur
moyenne, ce qui produit la petite épopée qui ne
laiffe pas d’être très-intéreffante, bien qu’elle ne nous
montre pas des héros du premier ordre. De cette ef-
pece étoient dans l’antiquité le poëme de Hero &
de Léandre de Mufée ; le rapt d’HelenedeCbiuthùs*
& d’autres encore : nous pouvons citer entre les modernes
le Jacob de Bodmer, comme un modèle de ce
genre. Enfin il y a unetroifieme efpece d'épopée, c’eft
celle qui chante de petits objets avec un ton de digni-
té, c’eftl’épique badin, ou comique ; tel eft le Lutrin
de Boileau, la Boucle de cheveux enlevée, &c.
La grande épopée eft, fans contredit, la plus noble
production des beaux - arts. Les anciens regardoient
l’Iliade & l’Ûdyffée comme deux fources où le capitaine
, l’homme d’etat, le citoyen & le pere de famille
dévoient puifer la fcience qui leur étoit néeef-
faire ; ils trouvèrent dans ces deux poëmes les mo*-
deles de la tragédie & de la comédie ; ils eftimoient
que l’orateur, le peintre, le fculpteur y pouvoierit
apprendre les réglés les plus effentielles de leur art»
Cette opinion femble outrée, mais elle ne l’eft pas.
Le poëte épique a réellement en fon pouvoir l’effet
qu’on peut attendre de toutes les branches des beaux-
arts. Vépopée réunit tout ce que les divers genres de
poéfie ont chacun de bon en foi. Tout ce que les arts,
de la parole ont d’utile & d’inftru&if, le poëme épique
peut l’avoir dans un dégré fupérieur. Quel orateur
a jamais furpaffé Homere. Quel effet ont produit
les tableaux & les peintures, dont Homere n’ait
le premier donné les exemples ? N’eft-ce pas à Homere
que Phidias a dû le chef-d’oeuvre de fon art ?
Quelle notion capable d’élever l’ame, de l’exciter
jpux derniers efforts, de réprimer en elle la paftionla
plus violente , peut mieux s’infinuer dans l ’efptit ,
mieux être gravée dans le coeur , qu’au moyen de la
poéfie, & de la poéfie épique ? Affignons donc à
Vépopée le rang -fuprême entre les productions de
Part ; & au poëte épique, s’il eft grand dans fon genre
, la prééminence fur tous les artiftes.
Quand on réfléchit quel génie ce genrè fublime
ex ig e, on ne fera pas fu'rpris que le nombre des bonnes
épopées foit fi petit. La G rece fi fertile en grands
.génies, n’a compté que très-peu de poëtes épiques,
& Rome n’en a eu qu’un feul qui ait excellé, elle
qui à d’ailleurs produit tant d’hommes admirablesv
Les poëtes Grecs & Latins qui après Homere & Virgile,
ont bazardé de fournir cette carrière , bien
qu’en affez petit nombre, n’ont pu les fifivrè que de
fort loin, & ne.luifent que comme de foibles étoiles
en comparaifon de ces foleils, Quoique les fciences
& les arts foient aujourd’hui répandus, dans toute
l’Europe , rien n’y eft plus rare cependant qu’une
bonne épopée. La France illuftrée par tant de grands
hommes, n’a encore en çe genre qu’un bien foible ef*
fai à produire. L’Italie* ^Angleterre & l’Allemagne
ont à cet égard l’avantage d’avoir vu naître des poètes
qui peuvent approcher «.ou d’Homere* ou de Virgile.
Le poëte Grec fouffriroit avec plaifir d’avoir
Milton & Klopftock à fes côtés ; & Virgile ne mépri-
feroit pas la compagnie duTaffe. L’un & l’autre prête-
roient quelquefois une oreille attentive aux chants du
Dante & de l’Ariofte * & admireroit plus d’un tableau
deffmé de la main de Bodmer. ( Get article ejltiré
de la Théorie générale des Beaux-Arts de M. SuLZER.y
ÉPOQUE, ( Âflronomie. ) On appelle époque ou
racine des moyens nvouvemens d’une planetë* le
lieu moyen de cette planete déterminé pour quelque
inftant marqué, afin de pouvoir enfui t e , en
comptant depuis cet inftant , déterminer le lieu
moyen de la planete, peur un autre ihftant quelconque.
Parmi les planètes nous,comprenons, auffi le foleil*'
que les tables aftronomiques fuppofent, ou peuvent
fuppofer en mouvement *, en lui attrihuantlé mouvement
dé la terre. Voyeq_ .Copernic. Voye£ aufH
Mouvement m o y e n , L ieu moyen , T ems
m o y e n , Équatio n du tems , Dïàionn. raif. des
Sciences , &c. & Supplément;
Les aftronomes font convenus de faire commencer
l’année dans leurs tables àl’inftant du midi qui préce-*
de le premierjour.de janvier, à moins,que l’année ne-
loit biffextile, ç’eft-à-dire, à midi le 31 décembre,
enforte qu’à midi du premier janvier, on compte déjà
un jour complet ou vingt-quatre heures écoulées*.
Ainfi, quand on trouve dans les tables :aftrpnomi-
ques au méridien de Paris Y époque de la longitude
moyenne du foleil.en 1700, de 9 lignes 16 degres 7
minutes 15 fécondés ; cela lignifie que le 31 décem-r
bre 1699, -à midi;, .à ; Paris, la longitude çioyenné
du foleil * c’eft-à-dire , 'fa diftance au premier point
otaries, en n’ayant égard, qu’à f o n mouvement
moyen , étoit de 9 Agnes 10 dégrés 7 minutes 1 j
fécondés, & ainfi des autres.
Vépoqueunz fois bien établie, le lieu moyen pour un
inftant quelconque eft aifé:à fixer par une Ample re*
gle de trois. Caron diraj’comme une année ou 365
jours eft au tems écoulé depuis pu, avant X époque 9
■ ainfi le, mouvement moyen, dé la, planete, ou le
tems périodique moyen pendant prie annee, eft au
mouvement cherché, qu’on ajoutera kX.époque, ou
qu’on en retranchera. Toute la difficulté fe réduit
donc à bien fixer l'époque, c’eft à-dire,,-le■ '■ vrai heu
moyen pour un temsdéterminé. Pour cela , il faut
obferver la planete le plus exaftement qu’il eft poffi-
ble dans les points de fon orbite où le lieu vrai fe confond
avec le lieu moyen, c’eft-à-dire , ou les equa*
tions du moyen mouvement font nulles. On aura.
donc le lieu moyen dé là planete.pour cet inftarit, &
par conféquent une fimple regle de trois donnera le
lieu moyen à l’inftant de l'époque. Par; exemple , le
lieu moyen du foleil fe confond fenfiblement avecle
lieu vrai, lorfque le foleil eft apogée ou périgée *
parce qu’alors l’équation du centre eft nulle ; le lieu
moyen dé la lune fe confond à-peu-près avec le lieu
vrai lorfque la lune eft apogée ou périgée, & de plus
en conjonûion ou oppofition ; je dis à -peu - prés *
parce que dans ce cas là même il y a encore quelques
équations, la plupart afièz petites, que les tables
& la théorie donnent, & auxquelles il eft né-
ceffaire d’avoir égard pour déterminer le vrai mouvement
moyen ; auffi, comme ces équations ne font
pas exàftement connues, Xépoque du lieu moyen dé
la lune ne peut être fixée que par une efpece de tâtonnement
& par des cOmbinaifons répétées & délicates.
Il paroît en effet que M. Halley l’a voit trop reculée
d’environ une minute, & d’autres aftronomes
la font de près de deux minutes plus avancée; Gé
font les obfervations réitérées des lieux de la lune ,
comparées avec les calculs de ces mêmes lieux, qui
peuvent fervir à fixer Xépoque auffi exa&ement qu’il
eft poffible. ( M. d e l a La s d e .')
* § ÉPREUVE, ( Hiß. moderne. ) Ori cite datïs
cet article M. du Cange au mot cormed, c’eft au mot
eorfned qu’il faut lire. Lettres fur ÜEncyclopédie.
Epreuve des canons de fufil de munition. ( Art
nul. Artill. ) On éprouve les canons des fufils def-
tinés à armer les troupes du roi, fur un banc de charpente
( Foyeiplanche 111 Fabrique des armes *
Fujil de munition * dans ce Supplément.) j formé par
trois pièces de bois de huit à dix pouces d’équarif-
fage » fixées horizontalement & parallèlement à cinq
ou fix pouces l’une de l’autre, fur plufieurs forts chevalets
* dont les pieds font enfoncés & bien affujettis
dans la terre. La longueur du banc eft de vingt-cinq
pieds environ ; il regne derrière le banc dans toute
fa longueur, une poutre contenue par des boulons
de fe r , qui la traverfent, ainfi que toute l’épaiffeur
des chevalets ; cette poutre excede le niveau du
banc, d’un pied ; on pratique dans toute fa longueur
une rainure garnie d’une bande de fer de fix 1 fept
lignes d’épaiflèiir;
La poudre dont Öii fe fert pbur éprouvei* les canons
de fufil , eft fine & telle qu’on l’emploie pour la
chaffe : j’ai fouvent percé, à balle feule, avec la
charge Ordinaire à la guerre i la quarante-cinquiemè
partie d’une livre de cette pôùdre, vingt - quatre
mains de papier gris, que j’avois fixées à un arbre,
à quinze toifes de diftance, & la balle s’eft perdue
dans l’arbre.
Les canons de fufil fubiffent deux épreuves confé-
cutives ; la première charge de poudre eft du poids
de la balle de munition, de dix-huit à la livre * c’eft-
à-dire , fept gros huit grains 2 on met une bourre de
papier par deffus, qui doit être affez groffe poiir entrer
avec peine dans le canon : on met la bourre à
fond fur la poudre avec une forte & lourde baguette
de fer, une balle par-deffus, & une fécondé bourre
fur la balle : on paffe enfuite une pointe bu petit dé'1
gorgeoir dans la lumière, on y introduit quelques
grains de-poudre, & on en écrafe deffus & tout autour
de là lumière.
.. On charge & amorce ainfi pour le premier coup,
tous les canons qu’on doit éprouver : on en place
environ quatre-vingts furie banc <Xépreuve, en obfer-
vant de loger & d’encaftrer les queues des culaffes
dans la rainure pratiquée à la poutre qui fegnefder-
riere le banc, enforte que les canonà ne piiiffent pas
reculer. Ôn les affuiéttit d’ailleurs, par le moyen
d’une corde, d’un pouce & demi de diamètre, fixée
par un bout à une des extrémités du banc, & qui
yient fe rendre à l’autre , en paffant par-deffus les
canons : oh ferre cette cordé par iëhiôÿeh <Tuh petit
treuil. Le banc occupe tout lè fond d’ûn efpace enfermé
de murs de dix à douze pieds de hauteur: il eft
couvert d’un toit qui le garantit de la pluie ; le mur
oppofé au banc eft recouvert de terre où les balles
vont fe rendre; &c où on en retrouvé les fragmens
quand il y en a une certaine quantité ; pour les refondre.
Un trou ( fig. 3 ; ) pratiqué dansle mur à une
des extrémités du banc, donne paffage à une baguette
de fer, qu’on a fait rougir pour mettre le feü à la pou*
dre. r
Le banc épreuve étant garni de la quantité dé
canons qu il peut contenir, on répand une traînée de
poudre f ur tous les tonnerres dans toute la longueur
du banc, & l’on introduit la baguette rougie par le
trou pratiqué dans le mur ; le premier canon part,
& dans un clin-d’oe il, le feu fe communiquant d’un
bout a l’autre du banc; tous les canons ont tiré. On
les ote & on les remplace fucceffivement par d’au-
tres, jufqu à ce qu ils aient tous fubi cette première*
épreuve, qui en fait périr un, deux ou trois par cent
fuivant que les ouvriers ont été attentifs, & le fer
bien prépare & bien ménagé. J’ai vu plufieurs épreu-
ves, ou fur fept à huit cens canons, il n’en a pas péri
ùn feul. On les chargé de nouveau ; avec les mêmes
précautions que la première fois, à l’exception que
la charge de poudre eft diminuée d’un cinquième à
cette fécondé épreuve, & eft par conféquent réduite
à cinq gros cinquante grains. On place ies canons fur
le banc, la culaffe encaftrée dans la poutre, & là
corde ferrée par-deffus , & l’on continue jufqu’à ce
qu’ils aient tous tiré. L’objet de cette fécondé charge
eft de manifefter les défauts que la première ne pourroit
feule faire connoître. Si le canon eft mal partag
é , c’eft-à-dire, que la matière en foit mal répartie,
bu fi une foudure a été manquée , ou n’eft pas comp
lexe, fi quelque partie a été fur-chauffée & décom-
pofée, il périt à la première épreuve ; dans le cas où
il y auroit réfifté, la partie défe£hieufe en eft tellement
ébranlée ; qu’elle ne peut réfifter à la fécondé;
Lorfque Xépreuve eft finie, on vifite tous les Canons
les uns après les autres & en détail : ceux où on ap-
perçoit quelques fentes en long ou en travers , quel-
qu’évafement à la lumière; ou quelqu’autre défaut,
ne font point admis; les autres font marqués d’uii
poinçon convenu, pour indiquer qu?ils ont été éprouvés
; après quoi on les dëculaffe , on les lave en-dedans
, & on les fait fécher;
Les canons ayant été éprouvés , iavés & féchés i
font mis à la boutique de rëvifion : les révifeurs ou
chefs de cet attelier, les vifitent intérieurement avec
foin ; car il fe trouve quelquefois; en-dedans des canons,
des pailles ou parties mal fondées que lés forets
enlevent, ou qui fe détachent aux deux coups
d’épreuve qu’il fubit : la cavité qui en réfulte, s’appelle
une chambre ( Voyez Chambre. Suppl.), C ’eft
un défaut qui le rend inadmiffible, car il eft évident
qu’il a moins d’épaiffeur en cet endroit qu’il ne doit
en avoir; & qu’il ne pourroit pas réfifter à l ’àéfioii
réitérée de plufieurs charges de poudre : la craffe &
la rouille.s’attachent d’ailleurs à cet endroit creux *
qu’on ne peut nettoyer parfaitement, & la chambré
devenant tous les jours plus profonde, le Canon n’en
eft que plu* dangereux.} on apperçoit ces chambres à
l’oeil, en lorgnant! dans le canon, & on s’en affure
avec le chat.'
Les révifeurs font chargés de donner à la lime, les
vraies proportions aux canons, de mettre la queue
des culaffes à la pente pour s’adapter au bois, de v érifier
le bouton des culaffëS, qui doit être parfaitement
jufte, pour ne pas balotter dans fon écrou
( F . Culasse, Suppl.), & enfin de polir & d’adoucir
les canons à la lime douce & à l’huile } lorfqu’ils font