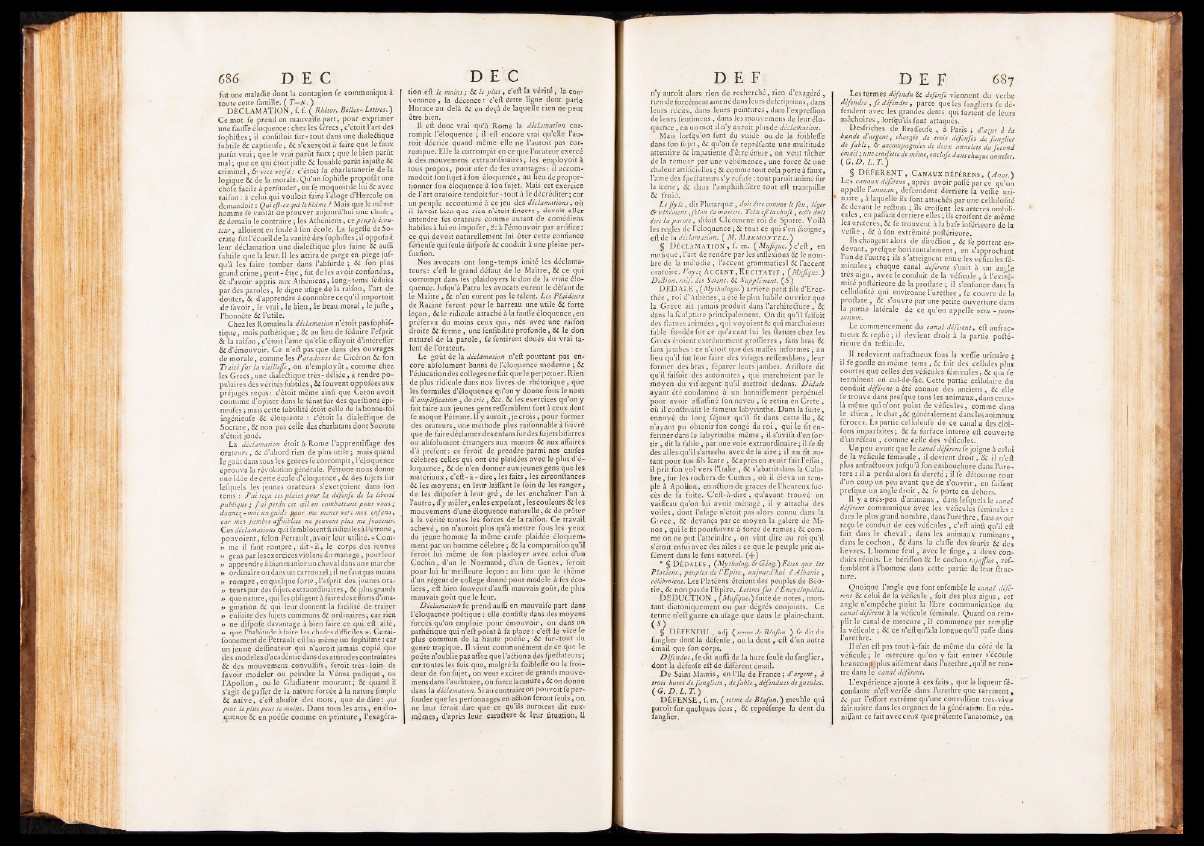
fut une maladie dont la contagion fe communiqua à
toute cette famille, ( T—iï. )
DÉCLAMATION, f. f. ( Rhétor. Belles- Lettres. )
Ce mot fe prend en mauvaife.part, pour exprimer
une faufle éloquence : chez les Grecs, c’étoit l’art des
fophiftes ; il confiftoit fur - tout dans une diateftique
fubtile & captieufe, & s’exerçoit à faire que le faux
parût vrai ; que le vrai parût faux ; que le bien parût
mal ; que ce qui étoit jufte & louable parût injufte &
criminel, 6* vice verfâ: c’étoit la charlatanerie^de la
logique & de la morale. Qu’un fophifte propofat une
chofe facile à perfuader, on fe moquoit de lui & avec
raifon : à celui qui vouloit faire l’éloge d’Hercule on
demandoit : Qui efl-ce qui le blâme ? Mais que le même
homme fe vantât de prouver aujourd’hui une chofe,
& demain le contraire ; les Athéniens, et peuple écouteur,
alloient en foule à fon école. La fageffe de Socrate
fût l’écueil de la vanité des fophiftes ;iloppofaà
leur déclamation une dialeétique plus faine & aufli
fubtile que la leur. Il les attira de piege en piege juf-
qu’à les faire tomber dans l’abfiirde ; & fon plus:
grand crime, peut - ê t fe , fut de les avoir confondus,
& d’avoir appris aux Athéniens, long-tems féduits
par des paroles, le digne ufage de la raifon , l’art de
douter, & d’apprendre à connoître ce qu’il importoit
de favoir, le v ra i, le bien, le beau moral, le jufte,
l’honnête & l’utile.
Chez les Romains la déclamation n’étoit pasfophif-
tique, mais pathétique ; & au lieu de féduire l’efprit
& la raifon, c’étoit l’ame qu’elle effayoit d’intéreffer
& d’émouvoir. Ce n’eft pas que dans des ouvrages
de morale, comme les Paradoxes de Cicéron & fon
Traité fur la vieiïltffe, on n’employât, comme chez
les Grecs, une diale&ique très - déliée, à rendre populaires
des vérités fubtiles, & fouvent oppofees aux
préjugés reçus: c’étoit même ainfi que Caton avoit
coutume d’opiner dans le fénat fur des queftions épi-
neufes ; mais cette fubtilité étoit celle de la bonne-foi
ingénieufe & éloquente : c’étoit la dialeftique de
Socrate, & non pas celle des charlatans dont Socrate
s’étoit joué.
La déclamation étoit à-Rome l’apprentiffage des
orateurs, & d’abord rien de plus utile ; mais quand
le goût dans tous les genres fe corrompit, l’éloquence
éprouva la révolution générale. Pétrone nous donne
une idée de cette école d’éloquence, & des fujets fur
lefquels les jeunes orateurs s’exerçoient dans fon
tems : J'ai reçu ces plaies pour la dèfenfe de la liberté
publique; f ai perdu cet oeil en combattant pour vous ;
donnez-moi un guide p,our me mener vers mes enfans,
car mes jambes affoiblies ne ,peuvent plus me foutenir.
Ges déclamations qui fembloient fi ridicules àPétrone,
pouvoient, félon Perrault,avoir leur utilité> «Com-
>> me il faut rompre, d it - il, le corps des jeunes
» gens par les exercices violens du manege, pour leur
« apprendre à bien manier un cheval dans une marche
»> ordinaire ou dans un carrouzel ; il ne faut pas moins
» rompre, en quelque forte, l’efprit des jeunes ora-
» teurspar des fujets extraordinaires, & plus grands
» que nature, qui les obligent à faire des efforts d’ima-
» gination ôc qui leur donnent la facilité de traiter
« enfuite des fujets communs & ordinaires; car rien
» ne difpofe davantage à bien faire ce qui eft aifé,
» que l’habitude à faire les chofes difficiles ». Cerai-
fonnement de Perrault eftlui-même un fophifme : car
un jeune deflinateur qui n’auroit jamais copié que
des modèles d!académie dans des attitudes contraintes
& des mouvemens convulfifs, feroit très r loin de
favoir modeler ou peindre la Vénus pudique , ou
l’Apollon, ou le Gladiateur mourant; & quand il
s’agit de pafler de la nature forcée à la nature Ample
& naïve, c’eft abufer des mots, que de dire:: qui
peut le plus peut le moins. Dans tous les arts, en éloquence
& en poéfie comme en peinture, l’exagération
eft le moins ; & le plus , c’eft là Vérité, la convenance
, la décence : c’eft dette ligne dont, parle
Horace au delà & en deçà de laquelle rien ne peut
être bien.
. Il eft donc vrai qu’à Rome la déclamation corrompit
l’éloquence ; il eft encore vrai qu’elle l’au-
roit décriée quand même 'elle ne l’auroit pas corrompue.
Elle la corrompit en ce que l’orateur exercé
à des mouvemens extraordinaires, les employoità
tous propos, pour ufer de fes avantages : il accom-
modoit fon fujet à fon éloquence, au lieu de proportionner
fon éloquence à fon fujet. Mais cet exercice
de l’art oratoire tendoit fur - tout à le décréditer ; car
un peuple accoutumé à ce jeu des déclamations, oit
il favoit bien que rien n’étoit fincere, devôit aller
entendre fes orateurs comme autant de comédiens
habiles à lui en imp'ofer, & à Pémouvoir par artifice :
ce. qui devoit naturellement lui ôter cette confiance
férieufe qui feule difpofe & conduit à une pleine per-
fuafion.
Nos avocats ont long-temps imité les déclama-
teurs: c’eft le grand défaut de le Maître, & ce qui
corrompt dans fes plaidoyers le don de la vraie éloquence.
Jufqu’à Patru les avocats eurent le défaut de
le Maître, & n’en eurent pas le talent. Les Plaideurs
de Racine furent pour le barreau une utile & forte
leçon, & le ridicule attaché à la fauffe éloquence, en
préferva du moins ceux qui, nés avec une raifon
droite & ferme , une fenfibilité profonde, & le don
naturel de la parole, fe fentirent doués du vrai talent
de l’orateur.
Le goût de la déclamation n’eft pourtant pas encore
abfolument banni de l’éloquence moderne ; &
l’éducation des colleges ne fait que le perpétuer. Rien
de plus ridicule dans nos livres de rhétorique, que
les formules d’éloquence qu’on y donne fous le nom
d’amplification, décrié , &c. & les exercices qu’o n ÿ
fait faire aux jeunes gens reffemblent fort à ceux dont
fe moque Pétrone. 11 y auroit, je crois, pour former
des orateurs, une méthode plus raifonnable àfuivre
que de faire déclamer des enfans fur des fujets bifarres
ou abfolument étrangers aux moeurs & aux affaires
d’à préfent: ce feroit de prendre parmi nos caufes
célébrés celles qui ont été plaidées avec le plus d’éloquence,
& de n’en donner aux jeunes gens que les
matériaux, c’eft - à - dire, les faits, les circonftances
& les moyens; en leur laiffant le foin de les ranger,
de les dilpofer à leur gré, de les enchaîner l’un à
l’autre, d’y mêler, en les expofant, les couleurs & les
mouvemens d’une éloquence naturelle,& de prêter
à la vérité toutes les forces de la raifon. Ce travail
achevé, on n’auroit plus qu’à mettre fous les yeux
du jeune homme la même caufe plaidée éloquemment
par un homme célébré ; & la comparaifon qu’il
feroit lui même de fon plaidoyer avec celui d’un
Cochin, d’un le Normand, d’un de Genes, feroit
pour lui la’ meilleure leçon : au lieu que le thème
d’un régent de college donné pour modèle à fes écoliers,
eft bien fouvent d’aufli mauvais goût,de plus
mauvais goût que le leur.
Déclamation fe prend aufli en mauvaife part dans
l’éloquence poétique : elle confifte dans des moyens
forcés qu’on emploie pour émouvoir, ou dans un
pathétique qui n’eft point à fa place : c’eft le vice le
plus commun de la haute poéfie, & fur-tout du
genre tragique. Il vient communément de ce que le
poete n’oublie pas affez que l’aftion a des fpe&ateurs ;
car toutes les fois que, malgré la foibleffe ou la froideur
de fon fujet, on veut exciter de grands mouvemens
dans l’auditoire, on force la nature, & on donne
dans la déclamation. Si au contraire on poy voit fe perfuader
que les perfonnages.en aéfion feront feuls, on
ne leur feroit dire que ce qu’ils auroient dit eux-
mêmes, d’après leur cara&ere & leur fituation. U
n’y auroit alors rien de recherché, rien d’exâgéré ,
rien de forcépaent amené dans leurs defcripûons, dans
leurs r.écifs, dans leurs peintures , dans l’expreflion
de leurs fentimeps, dans les mouvemens de leur éloquence
, en un mot il n’y auroit plus dé déclamation. \
Mais lorfqu’pn fent du vuide ou de la foibleffe
.dans fon fujet, & qu’on fe repréfente une multitudp ;
attentive & impatiente d’être émue, on veyt tâcher .
de la remuer par une véhémence, une force & une
chaleur artificielles-; & comme tout cela porte à faux,
l’ame des fpedateurs s’y refufe : tout paroît animé fur
la feene ; éc dans l’amphithéâtre toiit eft tranquille
&C froid. ..
Lejlyle, dir Plutarque , doit être comme le feu , léger .
& véhément,félon la matière. Telleejlla chofe, telle doit
être la parole', difoit Cléômene roi de Sparte. Voilà
les réglés de l’éloquence ; & tout ce qui s’en éloigne ,
eft de la déclamation. ( M. M ARMONT EL. )
§ D éclamation, f. m. (Mujîque.') c’e ft , en
mulique, l’art de rendre par les infléxions & le nombre
de la mélodie , l’accent grammatical & l’accent
oratoire. Voyez Accent,R écitatif , ( Mujîque. )
Diction, raif. des Scienc. & Supplément. (V)
DÉDALE , (Mythologie.) arriéré-petit fils d’Erec-
thée, roi d’Athènes, a été le plus habile ouvrier que
la Greee ait jamais produit dans l’architeéhire , &
dans la fculpturé principalement. On dit qù’il faifoit 1
dés ftatues animées, qui voyoient & qui marchoient: '
fable fondés fur ce qu’avant lui les ftatues chez les
Grecs étôient extrêmement groffieres , fans bras &
fans jambes : ce n’étoit que dés maffes informes , au
lieu qu’il fut leur faire des vifages reffemblans, leur
former des bras, féparer leurs jambes. Ariftote dit
qu’il faifoit des automates , qui marchoient par le
moyen du v i f argent qu’il mettoit dedans. Dédale \
ayant été condamné à un banniffement perpétuel
pour avoir affafîine fon neveu , fe retira en Crete ,
où il conftruifit le fameux labyrinthe. Dans la fuite,
ennuyé du long féjour qu’il fit dans cette î l e , &
n’ayant pu obtenir fon congé du r o i , qui le fit enfermer
dans le labyrinthe même, il s’avifa d’en for-
tir , dit la fable , par une voie extraordinaire ; il fe fit
des aîles-qu’il s’attacha avec de la cire ; il en fit aur
tant pour fon fils Icare , & après en avoir fait l’effai,
il prit fon vol vers l’Italie , & s’abattit dans la Calabre
, fur les rp.chers de Cumes , où il éleva un temple
à Apolèon, en aélion de grâces de l’heureux fuc-
cès de fa fuite. C’eft-à-dire, qu’ayant trouvé un
vaiffeau qu’on lui avoit ménagé, il y attacha des
voiles, dont l’ufage\n’étoit pas alors connu dans la
Grè ce , & devança par ce moyen la galere de Mi-
nos , qui le fit pourfuivre à forcé de rames; & comme
on ne put l’atteindre , pn vint dire au roi qu’il
s’étoit enfui avec des aîles. : ce que le peuple prit ai-
fément dans le fens naturel. ;(+)
* § D édales , {Mytholog. &. Géog.') Fêtes que les
P la tiens, peuples de l'Epire., aujourd'hui l 'Albanie ,
célébroient. Les Platéens étoient des peuples de Béo-
tie, & non pas.de l’Epire. Lettres fur l'Encyclopédie,
DÉDUCTION , \Mùfique.') fyite de notes, montant
diatoniquement ou par dégrés conjoints. Ce
terme n’eft guere en ufage que dans le plain-chant.
(**)
§ DÉFENDU , adj. ( terme de Blafon. ) fe dit du
fanglier dont la défenfe , ou la dent , eft d’un autre
émail que fon corps.
Défendue, fe dit aufli de la hure feulé du fanglier,
dont la défenfe eft de différent émail.
De Saint-Mauris, en l’Iie de France ; d'argent, a
trois hures de fangliers, de fable•, défendues de gueules. ,
( G .D .L .T . )
DÉFENSE, f. m. ( terme de Blafon. ) meuble qui
paroît fur quelques écus, & repréfenje la dent du
fanglier.
^ l e s termes défendu & défenfe viennent du verbe
fdéfpudre, fe défendre: , parce- que fengliérs fe dé-
fendent avec les grandes dents qui fprtent de leurs
•mâchoires , lorfiqu’ils font attaqués.
Desfriches de Braffeufe , à Paris ; â'ayir à la
bande d argent, chargée de trois défenfes de fanglier
de fable, & accompagnées de deux annelets du fécond
email; une croifette de même, enclofe dans chaque annelet.
. ( G .D . L . T . ) ......
§ DÉFÉRENT, Canaux déférens , (dnac.)
Les canaux déférens, après avoir paffé par ce qu’on
appelle Vanneau, defeendent derrière la veftie urinaire
, a laquelle ils font attachés par une céllulofité
& devant le reéhim ; ils croifent les arteres ombilicales
, en paffant.derriere elles ; ils croifent de même
les ujeteres, & fe trouvent à la bafe inférieure de la
veflie , & à fon extrémité poftérieure.
Ils changent alors de direûion , & fe portent en-
devant, prefque horizontalement, en s’approchant
l’un de l’autre; ils s ’atteignent entre les véhicules fé-
minales; chaque canal déférent s’unit à un angle
très-aigu, avec le conduit de la véficule , à l’extrémité
poftérieure de la proftate ; il s’enfonce dans la
céllulofité qui environne l’urethre , fe couvre de la
proftate ; & s’ouvre par une petite ouverture dans
la partie latérale de ce. qu’on appelle yeru - pion- '
tanum.
Le commencement du canal déférent, eft anfractueux
& replié ; il devient droit à la partie poftérieure
du tefticule. • "
Il redevient anfraélùeux fous la veflie urinaire ;
il fe gonfle en même tems , & fait des cellules plus
courtes que celles des véficules féminales, & qui fe
terminent eif cul-de-fac., Cette partie cellulaire du
conduit déférent a été connue des anciens , & elle
fe trouve dans prefque tous les animaux, dans ceux-
là même qui n’ont point de véficules, comme dans
le chien , léchât , & généralement danslesanimaux
féroces. La partie celluléufe de ce canal a des cloi-
foqs imparfaites; & fa furface interne eft couverte
d’un réfeau , comme celle des véficules.
Un peu avant que le canal défèrent fe joigne à celui
de la véficule féminale , il devient droit, & il n’eft
plus anfra&ueux jufqu’à fon embouchure dans l’ure-
tere : il a perdu alors fa dureté ; il fe détourne tout
d’un coup un peu avant que. de s’ouvrir, en faifant
prefque un angle d roit, & fe porte en dehors.
11 y a très-peu d’animaux , dans lefquels le canal
déférent communique avec les véficules féminales :
dans le plus grand nombre, dans l’urethre, fans avoir
reçu le éoïïduit de ces véficules , c’eft ainfi qu’il eft
fait dans le ch eval, dans lés animaux ruminans,
dans le cocKôn, & dans la clafl'e des fôuris & des
lievres. L ’homhé feul, avec le linge, a deux conduits
réunis. Le hériflon & le cochon tajaffua, reffemblent
à l’homme dans cette partie de leur ftruc-
ture.
Quoique l’angle que fQnt enfemble le canal déférent
& celui de la véficule , foit des plus aigiis, cet
angle n’empêche point la libre communication du
canal déférent à la véficule féminale. Quand on remplit
le canal de mercure , il commence par remplir
la véficule ce n’eft qu’à la longue qu’il paffe dans
l’urethre. ,
Il n’en eft pas tout-à-fait de même du côté de la
véficule; le mercure qu’on y fait entrer s’écoule
beaucoupSîplus aifément dans l’urethre, qu’il ne rentre'
dans le canal déférent.
L’expérience ajoute à ces faits, que la liqueur fé-
çondante n’eft verfée dans l’urethre que rarement,
& par l’effort extrême qu’une convulfion très-vive
fait naître dans les organes de la génération. En réu-
nifiant ce fait avec ceux que prélente l’anatomie, on,