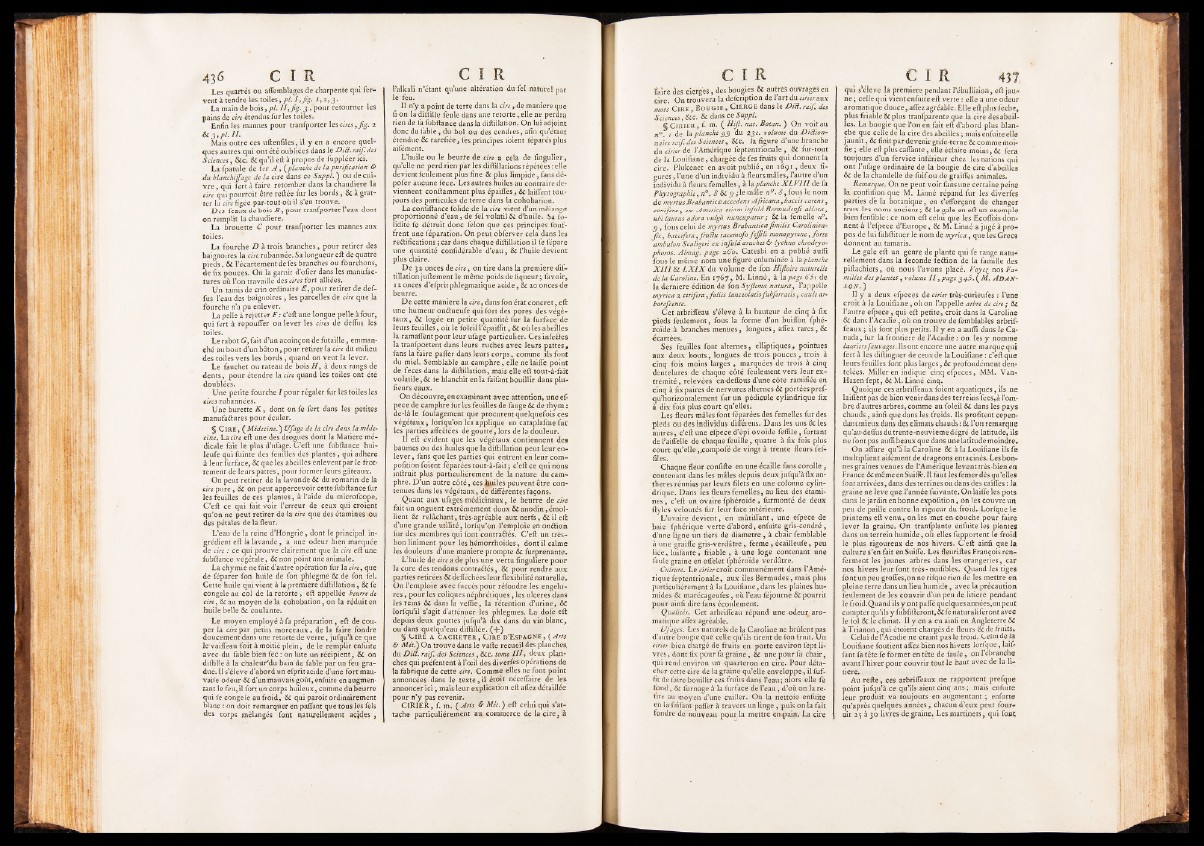
Les quartés ou affemblages de charpente qui ter-
vent à tendre les toiles, pl. I,fig. 1 ,2 ,3 .
La main de bois, pi. II,fig-3 , pour retourner les
pains de cire étendus fur les toiles.
Enfin les mannes pour tranfporter les cires, fig. 2
& 3 , pl. II.
Mais outre ces uftenfiles, il y en a encore quelques
autres qui ont été oubliées dans le Dicl. raif. des
Sciences, 8cc. 8c qu’il eft à propos de fuppléer ici.
La fpatule de fer A , (‘planche de la purification &
du blanchififiage de la cire dans ce Suppl. ) oU de cuivre
, qui fert à faire retomber dans la chaudière la
cire qui pourroit être reftée fur les bords, 8c à gratter
la cite figée par-tout où il s’en trouve.
Des féaux de bois B , pour tranfporter l’eau dont
on remplit la chaudière.
La brouette C pour tranfporter les mannes aux
toiles.
- La fourche D à trois branches, pour retirer des
baignoires la cire rubannée. Sa longueur eft de quatre
pieds, 8c l’écartement de fes branches ou fourchons,
de fix pouces. On la garnit d’ofier dans les manufactures
où l’ on travaille des cires fort alliées.
Un tamis de crin ordinaire E , pour retirer de def-
fus l’eau des baignoires , les parcelles de cire que la
fourche n’a pu enlever.
La pelle à rejetter F : c’eft une longue pelle à four,
qui fert à repouffer ou lever les cires de deffus les
toiles.
Le rabot G, fait d’un acoinçon de futaille, emmanché
au bout d’un bâton, pour retirer la cire du milieu
des toiles vers les bords , quand on veut la lever.
Le fauchet ou rateau de bois H , à deux rangs de
dents, pour étendre la cire quand les toiles ont été
doublées.
Une petite fourche I pour régaler fur les toiles les
tires rubannées.
Une burette K , dont on fe fert dans les petites
manufactures pour éculer.
§ ClRE, ( Médecine.) Ufage de la cire dans la médecine.
La cire eft une des drogues dont la Matière médicale
fait le plus d’ufage. C ’eft une fubftance hui-
leufe qui fuinte des feuilles des plantes, qui adhéré
à leur furface, & que les abeilles enlevent par le frottement
de leurs pattes, pour former leurs gâteaux.
On peut retirer de la lavande & du romarin de la
cire pure, 8c on peut appercevoir cette fubftance fur
les feuilles de ces plantes, à l’aide du microfcope.
C ’eft ce qui fait voir l’erreur de ceux qui croient
qu’on ne peut retirer de la cire que des étamines -ou
des pétales de la fleur.
L’eau de la reine d’Hongrie, dont le principal ingrédient
eft la lavande, a une odeur bien marquée
de cire : ce qui prouve clairement que la cire eft une
fubftance végétale, &non point une animale.
La chymie ne fait d’autre opération fur la cire, que
de féparer fon huile de fon phlegme & de fon fel.
Cette huile qui vient à la première diftillation, & fe
congele au col de la retorte, éft appellée beurre de
cire, 8c au moyen de la cohobation, on la réduit en
huile belle 8c coulante.
Le moyen employé à fa préparation, eft de couper
la cire par petits morceaux, de la faire fondre
doucement dans une retorte de verre, jufqu’à ce que
le-vaiffeau foit à moitié plein, de le remplir enfuite
avec du fable bien fe c : on lute un récipient* 8c on
diftille à la chaleur'du bain de fable par un feu gradué.
Il s’élève d’abord un efpritacide d’une fort mau-
vaile odeur 8c d’un mauvais goût, enfuite en augmentant
le feu, il fort un corps huileux, comme du beurre
qui fe congele au froid, 8c qui paroît ordinairement
blanc : on doit remarquer en paffant que tous les fels
des corps mélangés font naturellement acides ,
Palkaîi n’étant qu’une altération du fel naturel par
le feu.
II n’y a point de terre dans la cire , de maniéré que
fi on la dillille feule dans une retorte, elle ne perdra
rien dé fa fubftance dans la diftillation. On lui adjoint
donc du fable, du bol ou des cendres, afin qu’étant
étendue 8c raréfiée, fes principes loient féparés plus
aifément.
L’huile ou le beurfe de cire a cela de fingülier,
qu’elle ne perd rien par les diftillations répétées : elle
devient feulement plus fine & plus limpide, fans dé-
poler aucune fece. Les autres huiles au contraire de-*
viennent conftamment plus épaiffes, 8c laiffent toujours
des particules de terre dans la cohobation.
La confiftance folide de la cire vient d’un mélange
proportionné d’eau, de fel volatil 8c d’huile. î>a fo-
lidité fe détruit donc félon que ces principes fouf-
frent une féparation. On peut obferver cela dans les
rectifications ; car dans chaque diftillation il fe fépare
une quantité confidérable d’eau, 8c l’huile devient
plus claire.
De 32 onces de cire, on tire dans la première diftillation
juftement le même poids de liqueur ; favoir,
12 onces d’efpritphlegmatique acide, 8c 20 onces de
beurre.
De cette maniéré la cire, dans fon état concret, eft
une humeur onCtueufe qui fort des pores des végétaux
, 8c logée en petite quantité fur la furface de
leurs feuilles, où le foleil l’épaiftit, 8c où les abeilles
la ramaffent pour leur ufage particulier. Ces infeCtes
la tranfportent dans leurs ruches avec leurs pattes »
fans la faire paffer dans leurs corps, comme ils font
du miel. Semblable au camphre, elle ne laiffe point
de feces dans la diftillation, mais elle eft tout-à-fait
volatile, 8c le blanchit en la faifant bouillir dans plu-
fieurs eaux.
On découvre, en examinant avec attention, une ef-
pece de camphre furies feuilles de fauge 8c de thym ;
de-là le loulagement que procurent quelquefois ces
végétaux, loriqu’on les applique en cataplafme fur
les parties affeCtées de goutté, lors de la douleur.
Il eft évident que les végétaux contiennent des
baumes ou des huiles que la diftillation peut leur enlever
, fans que les parties qui entrent en leur com-
pofition foient féparées tout-à-fait ; c’ eft ce qui nous
inftruit plus particuliérement de la nature au camphre.
D’un autre côté, ces feuiles peuvent être contenues
dans les végétaux, de différentes façons.
Quant aux ufages médicinaux, le beurre de cira
fait un onguent extrêmement doux 8c anodin, émollient
8c relâchant, très-agréable aux nerfs, 8c il eft:
d’une grande utilité, lorfqu’on l’ emploie en onCtion
fur des membres qui font contractés. C ’eft un très-
bon liniment pour les hémorrhoïdes, dont il calme
les douleurs d’une maniéré prompte 8c furprenante.
L’huile de cire a de plus une vertu finguliere pour
la cure des tendons contractés, 8c pour rendre aux
parties retirées 8c defféchées leur flexibilité naturelle*
On l’emploie avec fuccès pour réfoudre les engelures
, pour les coliques néphrétiques, les ulcérés dans
les reins 8c dans la veflie, la rétention d’urine, 8c
lorfqu’il s’agit d’atténuer les phlegmes. La dofe eft
depuis deux gouttes jufqu’à dix dans du vin blanc,
ou dans quelqu’eau diftillée. (+ )
§ C ire à c a ch e t e r , C ire d’Espagn e, ( Arts
& Mét.) On trouve dans le vafte recueil des planches,
du Dicl. raif. des Sciences, 8cc. tome I I I , deux planches
qui préfentent à l’oeil des diverfes opérations de
1a fabrique de cette cire. Comme elles ne font point
annoncées dans le texte, il étoit néceffaire de les-
annoncer ici ; mais leur explication eft affez détaillée
pour n’y pas revenir.
CIRIER, f. m. ( Arts & Met.) eft celui qui s’attache
particuliérement au commerce de la cire, 'à
faire des cîergei, des bougies & U ltra ouvragés eii
cire. On trouvera la defcription de l’art du ciritraux
mois Cir e , Bo u g ie , C ierge dans le Di3 .raif. dts
Sciences, Sic. & dans ce Suppl.
§ Girier , f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) On voit au
n ° . i de la planché gg du 23 e. volume du Dictionnaire
raif. des Sciences, 8cc. la figure d’une branche
du cirier de l’Amérique feptentrionale , 8c fur-tout
de la Louifiane, chargée de fes fruits qui donnent la
cire. Plukenet en avoit publié, en 16 9 1 , deux figures,
l’une d’un individu à fleurs mâles, l’autre d’un
individu à fleurs femelles, à la planche X LV 1I I de fa
Phytographie, n°. 8 8c 9 ;le mâle n 9. £,fous le nom
de myrtus Brabanticà accedens Africana , baccis carens,
tonifiera, ex America etiam infiulâ Bermudenfi allata,
ubi laurus odora vulgà nunçupatur ,■ 8c la femelle n°.
o , fous celui de myrtus Brabanticcefimilis Carolinien-
Jîs, baccifera, firuclu racemofio fejjili monopyrene, forte
ambulon Scaligeri ex infiulâ aruchet & lychno chrodryo-
phoros. Almag. page 260. Catesbi en a publié auffi
fous le même nom une figure enluminée à planche
X I I I 8c L X IX du volume de fon Hifioire naturelle
delà Caroline. En 176 7 , M. Linné, à la page 6S1 de
la derniere édition de fon Syfiema natura, l’appelle
myrica % cerifiera, fioliis lanceolatis fiubfierratis, caülear-
boreficente.
Cet arbriffeau s*éleve à la hauteur de cinq à fix
pieds feulement, fous la forme d’un buiffon fphé-
roïde à branches menues, longues, affez rares, 8c
écartées.
Ses feuilles font alternes, elliptiques, pointues
aux deux bouts, longues de trois pouces , trois à
cinq fois moins larges , marquées de trois à cinq
dentelures de chaque côté feulement vers leur extrémité
, relevées en-deffous d’une côte ramifiée en
cinq à fix paires de nervures alternes 8c portées pref-
qu’horizontalement fur un pédicule cylindrique fix
à dix fois plus court qu’elles.
Les fleurs mâles font féparées des femelles fur des
pieds ou des individus différens. Dans les uns 8c les
autres, c’eft une efpece d’épi ovoïde feffile, fortant
de l’aiffelle de chaque feuille, quatre à fix fois plus
court qu’elle ,jcompofé de vingt à trente fleurs fef-
filës. ■ ■■
Chaque fleur confifte en une écaille fans corolle,
contenant dans les mâles depuis deux jufqu’à fix anthères
réunies par leurs filets en une colonne cylindrique.
Dans les fleurs femelles, au lieu des étami^
nés, c’eft un ovaire fphéroïde, furmonté de deux
ftyles veloutés fur leur face intérieure.
L’ovaire devient, en mûriffant, une efpece de
baie fphérique verte d’abord, enfuite gris-cendré ,
d’une ligne un tiers de diamètre, à chair femblable
à une graiffe gris-verdâtre, ferme , écailleufe, peu
liée, luifante, friable , à une loge contenant une
feule graine en offelet fphéroïde verdâtre.
Culture. Le cïrwr croît communément dans l’Amérique
feptentrionale, aux îles Bermudes, mais plus
particuliérement à la Louifiane, dans les plaines humides
8c marécageufes, où l’eau féjournë 8c pourrit
pour ainfi dire fans écoulement.
Qualités. Cet arbriffeau répand une odeur^ aromatique
affez agréable.
Ufages. Les naturels de la Caroline ne brûlent pas
d’autre bougie que celle qu’ils tirent de fon fruit. Un
cirier bien chargé de fruits en porte environ fept livres
, dont f ix pour fa graine, 8c une pour fa chair,
qui rend environ un quarteron en cire. Pour détacher
cette cire de la graine qu’elle enveloppe, il fuf-
fit de faire bouillir ces fruits-dans l’eau; alors elle fe
fond, 8c fumage à la furface de l’eau, d’où on la retire
au moyen d’une cuiller. On la nettoie enfuite
en la faifànt paffer à travers un linge , puis onia fait
fondre de nouveau pour.la mettre en<pain, La cire
ijui s^levé ia première pendant réimtiitioii, eft jau*'
ne ; celle qui vient enfuite eft verte : elle a une odeur
aromatique douce, affez agréable. Elle eft plus feche,
plus friable 8c plus tranfparente que la cire des abeilles.
La bougie que l’on en fait eft d’abord plus blanche
que celle de la cire des abeilles ; mais enfuite elle
jaunit, 8c finit par devenir grife-terne 8c comme moi*
fie ; elle eft plus caffante, elle éclaire moins, 8c fera
toujours d’un fervice inférieur chez les nations qui
ont l’ufage ordinaire de la bougie de cire d’abeilles
8c de la chandelle de füif ou de graiffes animales.
Remarque. On ne peut voir fans une certaine peine
la confufion que M. Linné répand fur les diverfes
parties dé la botanique, en s’efforçant de changer
tous les noms anciens ; 8c le gale en eft un exemple
bien fenfible : ce nom eft celui que les Ecoffois donnent
à l’efpece d’Europe, 8c M. Linné a jugé à propos
de lui fubftituer le nom de myrica, que les Grecs
donnent au tamaris.
Le gale eft un genre de plante qui fe range natu-*
Tellement dans la fécondé îeCtion de la famille des
piftachiers, où nous l’ avons placé. Voye1 nos Familles
des plantes, volume I I , page 34^. ( M. A d AN-
SO N . )
Il y a deux efpeces de cirier très-curieufes : l’une
croît à la Louifiane, où on l’appelle arbre de cire ; 8c
l’autre efpece, qui eft petite, croît dans la Caroline
8c dans l’Acadie, où on trouve de femblables arbrif-
feaux ; ils font plus petits. Il y en a auffi dans le C anada
, fur la frontière de l’Acadie : on les y nomme
lauriersfaüvâges. Ils ont encore une autre marque qui
fert à les diftinguer de ceux de la Louifiane : c’eft que
leurs feuilles font plus larges, 8c profondément dentelées.
Miller en indique cinq efpeces, MM. Van-
Hazen fept, 8c M. Linné cinq.
Quoique ces arbriffeaux foient aquatiques, ils ne
laiffent pas de bien venir dans des terreins fecs,à l’ombre
d’autres arbres, comme au foleil 8c dans les pays
chauds, ainfi que dans les froids. Ils profitent cependant
mieux dans des climats chauds : 8c l’on remarque
qu’au-deffus du trente-neuvième dégré de latitude, ils
ne font pas auffi beaux que dans une latitude moindre.
On affure qu’îf la Caroline 8c à la Louifiane ils fe
multiplient aifément de drageons enracinés. Les bonnes
graines venues de l’Amérique lèvent très-bien en
France 8c même enSuifle. Il faut les femerdès qu’elles
font arrivées, dans des terrines ou dans des caiffes : la
graine ne leve que l’année fuivante. On laiffe les pots
dans le jardin en bonne expofition, on les couvre un
peu de paille contre la rigueur du froid. Lorfque le
printems eft venu, on les met en couche pour faire
lever la graine. On tranfplante enfuite les plantes
dans un terrein humide, où elles fupportent le froid
le plus, rigoureux de nos hivers. C’eft ainfi que la
culture s’en fait en Suiffe. Les fleuriftes François renr
ferment les jeunes arbres dans les orangeries, car
nos hivers leur font très-nuifibles. Quand les.tiges
font un peu groffes,on ne rifque rien de les mettre en
pleine terre dans un lieu humide, avec la précaution
feulement de les couvrir d’un peu de litiere pendant
le froid. Quand ils y ont pafle quelques années,on peut
compter qu’ils y fubfifteront, 8c fe naturaliferont avec
le fol 8c le climat. Il y en a eu ainfi en Angleterre 8c
à T rianon, qui étoient chargés de fleurs 8c de fruits.
, Celui de l’Acadie ne craint pas le froid. Celui de la
Louifiane foutient affez bièn nos hivers lorfque, laifi
fant fa tête fe former en tête de faule, on l’ébranche
avant l ’hiver pour Couvrir tout le haut avec de la litière.
*
Au refte, ces arbriffeaux ne rapportent prefque
point jufqu’à ce qu’ils aient cinq ans ; mais enfuite
leur produit va toujours en augmentant; enforte
qu’après quelques années, chacun d’eux peut four-
uir 25 à 30 livres de graine. Les martinets, qui font