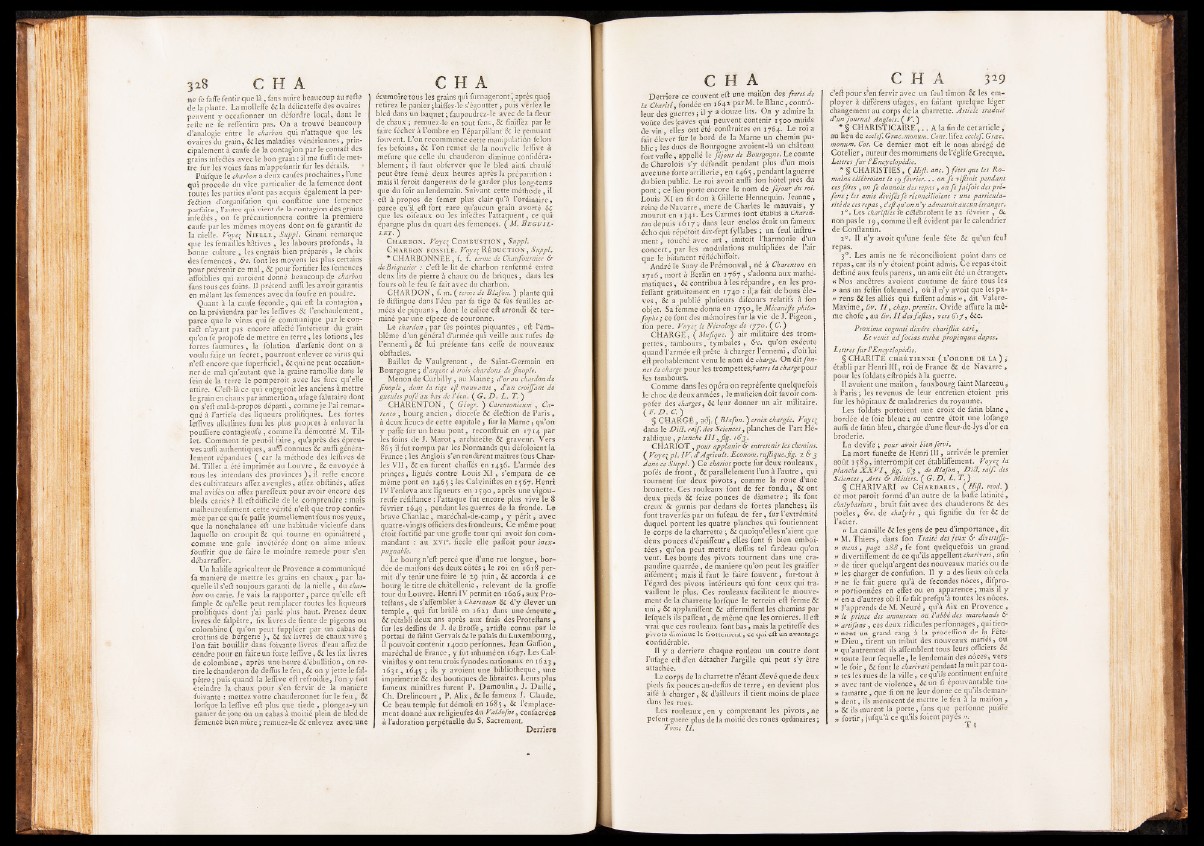
ne fe farte fentir que l à , fans nuire beaucoup au refte
de la plante. La mollefle 8c la délicateffe des ovaires
peuvent y occafionner un défordre local, dont le I
relie ne fe reflentira pas. On a trouvé beaucoup
d’analogie entre le charbon qui n’attaque que les
ovaires du grain, 8c les maladies vénériennes , principalement
à caufe de la contagion par le contaél des
grains infe&és avec le bon grain : il me fuffit de mettre
fur les voies fans m’appefantir fur les details. :
Puifque le charbon a deux caufes prochaines, l’une
qui procédé du vice particulier de la femence dont
toutes les parties n’ont pas acquis également la perfection
d’organifation qui conftitue une femence
parfaite , l’autre qui vient de la contagion des grains
infeClés, on fe précautionnera contre la première
caufe par les mêmes moyens dont on fe garantit de
la nielle. Voye{ Nie l le , Suppl. Ginani remarque
que les femailles hâtives , les labours profonds, la
bonne culture , les engrais bien préparés , le choix
des femences , &c. font les moyens les plus certains
pour prévenir ce mal, 8c pour fortifier les femences
affoiblies qui auroient donné beaucoup d,e charbon
fans tous ces foins. Il prétend auffi les avoir garantis
en mêlant les femences avec du foufre en poudre.
Quant à la caufe fécondé, qui eft la contagion,
on la préviendra par les leflives 8c l’enchaulement,
parce que le virus qui fe communique par le cont
a i n’ayant pas encore affetté l’intérieur du grain
qu’on fe propofe de mettre en terre, les lotions, les
fortes faumures, la folution d’arfenic dont on a
voulu faire un fecret, pourront enlever ce virus qui
n’eft encore que fuperficiel, 8c qui ne peut occafionner
de mal qu’autant que la graine ramollie dans le
fein de la terre le pomperoit avec les fîtes qu’elle
attire. C’eft-làce qui engageoitles anciens à mettre
le grain en chaux par iinmerfion, ufage falutaire dont
on s’eft mal-à-propos départi, comme je l ’ai remarqué
à l’article des liqueurs prolifiques. Les fortes
lelîives alkalines font les plus propres à enlever la
poufîiere contagieufe, comme l’a démontré M. Tillet.
Comment fe peut-il faire, qu’après des épreuves
auffi.authentiques, au® connues 8c auffi généralement
répandues ( car la méthode des leflives de
M. Tillet a été imprimée au Louvre, 8c envoyée à
tous les intendans des provinces ) , il refte encore
des cultivateurs a fiez aveugles, aflez obftinés, aflëz
mal avifés ou aflez parefleux pour avoir encore des
bleds cariés ? Il eft difficile de le comprendre : mais
malheureufement cette vérité n’eft que trop confirmée
parce qui fe pafle journellement fous nos yeux,
que la nonchalance eft une habitude vicieufe dans
laquelle on croupit 8c qui tourne en opiniâtreté,
comme une gale invétérée dont on aime mieux
fouffrir que de faire le moindre remede pour s’en
débarraffer. -
Un habile agriculteur de Provence a communiqué
fa maniéré de mettre les grains en chaux , par laquelle
il s’eft toujours garanti de la nielle , du charbon
ou carie. Je vais la rapporter, parce qu’elle eft
limple 8c qu’elle peut remplacer toutes les liqueurs
prolifiques dont j’ai parlé plus haut. Prenez deux
livres de falpêtre, fix livres de fiente de pigeons ou
colombine ( qu’on peut fuppléer par un cabas de
crottins de bergerie ) , & fix livres de chaux vive ;
l’on fait bouillir dans foixante livres d’eau aflez de
cendre pour en faire un forte leffive, 8c les fix livres
de colombine, après une heure d’ébullition, on retire
lechauderon de deffiis le feu, 8c on y jette le falpêtre
; puis quand la leffive eft refroidie, l’on'y fait
éteindre la chaux pour s’en fervir de la maniéré
fuivante : mettez votre chauderonnet fur le feu , 8c
lorfque la leffive eft plus que tiede , plongez-y un
panier de jonc ou un cabas à moitié plein de bled de
îemence bien mûre ; remuez-le 8c enlevez avec une
écumoire tous les grains qui furnageront \ après quoi
retirez le panier-laiffez-le s’égoutter, puis verfez le
bled dans un baquet ; faupoudrez-le avec de la fleur
de chaux ; remuez-le en tout fens, 8c finiflez par le
faire fécher à l’ombre en l’éparpillanf & le remuant
fouvent. L’on recommence cette manipulatiqn félon
fes befoins, 8c l’on remet de la nouvelle leffive à
mefure que celle du chauderon diminue confidéra-
blement; il faut obferver que le bled ainfi chaulé
peut être femé,deux heures après la préparation:
mais il feroit dangereux de le garder plus long-tems
que du foir au lendemain. Suivant cette méthode , il
■ eft à propos de femer plus clair qu’à l’ordinaire,
parce qu’il eft fort rare qu’aucun grain avorté 8c
que les oifeaux ou les infeétes l’attaquent, ce qui
épargne plus du quart des femences. ( M. B e g u il -
l e t . )
C harbon. Voyc%_ C om bust ion , Suppl.
C harbon fossile. Foye^R éd u c t io n , Suppl.
* CHARBONNÉE, f. f. terme de Chaufournier &
deBriquetier : c’eftle lit de charbon renfermé entre
deux lits de pierre à chaux ou de briques, dans les
fours oh le feu fe fait avec du charbon.
CHARDON, f. m. ( terme de Blafon. ) plante qui
fe diflingue dans l’écu par fa tige 8c fes feuilles armées
de piquans, dont le calice eft arrondi 8c terminé
par une efpece de couronne.
Le chardon, par fes pointes piquantes, eft l’em-
blême d’un général d’armée qui veille aux rufes de
l’ennemi, 8c lui préfente fans celle de nouveaux
obftacles.
Baillet de Vaulgrenant , de Saint-Germain en
Bourgogne ; d'argent à trois chardons de Jinople.
Menon de Cûrbilly, au Maine ; d'or au chardon do
Jinople , dont la tige efl mouvante , d'un croijfant do
gueules poftau bas de l'écu. ( G. D . L. T. )
CHÀRENTON, ( Géogr. ) Carentonicuni , Ca-
rento , bourg ancien , diocefe 8c éle&ion de Paris ,
à deux lieues de cette capitale , fur la Marne, qù’orr
y pafle fur un beau pont, reconftruit en 1714 par
les foins de J. Marot, architecte 8c graveur. Vers
86 5 il fut rompu par les Normands qui défoloient la
France ; les Anglois s’en rendirent maîtres fous Charles
V I I , 8c en furent chafles en 1436. L’armée des
princes, ligués contre Louis XI , s’empara de ce
même pont en 1465 ; les Calviniftesen 1567. Henri
IV l’enleva aux ligueurs en 1590 , après une vigôu-
reufe réfiftance : l’attaque fut encore plus vive le 8
février 1649, pendant les guerres de la fronde. Le
brave Chanlac, maréchal-de-camp, y périt, avec
quatre-vingts officiers des frondeurs. Ce même pont
étoit fortifié par une grofle tour qui avoit fon commandant
: au X V Ie. fiecle elle pafloit pour inexpugnable.
Le bourg n’eft percé que d’une rue longue, bordée
de maifons des deux côtés ; le roi en 1618 permit
d’y tenir une foire le 29 juin, 8c accorda à ce
bourg le titre de châtellenie, relevant de la grofle
tour du Louvre. Henri IV permit en 1606, aux Pro-
teftans, de s’aflembler à Charenton 8c d’y élever un
temple, qui fut brûlé en 1621 dans une émeute,
8c rétabli deux ans après aux frais des Proteftans ,
fur les deffins de J. de Brofle, artifte connu par le
portail de faint Gervais 8c le palais du Luxembourg,
il pouvoit contenir 14000 perfonnes. Jean Gaffion,
maréchal de France, y fut inhumé en 1647. Les Cal-
viniftes y ont tenu trois fynodes nationaux en 1623 ,
16 31, 1645 ; ils y avoient une bibliothèque, une
imprimerie 8c des boutiques de libraires. Leurs plus
fameux miniftres furent P. Dumoulin, J. Daillé,
Ch. Drelincourt, P. A lix, & le fameux J. Claude.
Ce beau temple fut démoli en 1685 , & l’emplacement
donné aux religieufes du Faldofne, confaçrées
à l’adoration perpétuelle du S. Sacrement.
Derrière
Derrière ce couvent eft une maifon des freres de
la Charité, fondée en 1642 par M. le Blanc, contrôleur
des guerres ; il y a douze lits. On y admire la
voûte des (caves qui peuvent contenir 1500 mùids
de v in , elles ont été conftruites en 1764. Le roi a
fait élever fur le bord de la Marne un chemin public
* tes dues de Bourgogne avoient-là un château
fort vaftë, appellé le fèjour de Bourgogne. Lecomte
de Charolois s-’y défendit pendant plus d’un mois
avec .une forte artillerie, en 146 5 » pendant la guerre
du bien publie. Le roi avoit auffi fon hôtel près du
pont ; ce lieu porte encore le nom de féjour du roi.
Louis XI en fit don à Gillette Hennequin. Jeanne ,
reine de Navarre, merë de Chartes le mauvais, y
mourut en 1341. Les Carmes font établis à Charenton.
depuis 1617 ;• dans leur enclos étoit un fameux
écho (fui répétoit dix-fept fyllabes ; un feul inftru-
ment, touché avec art , imitoit l’harmonie d’un
concert, par tes modulations multipliées de l’air
que le bâtiment réfléchifloit.
André 1e Suay de Prémonval, né à Charenton en
3716, mort à Berlin en 1767 , s’adonna aux mathématiques
, 8c contribua à les répandre, en les pro-
feflant gratuitement en 1740 : il; a fait de bons élev
é s , 8c a publié plufieurs difcours relatifs à fon
objet. Sa femme donna en 1750, le Mécanijlephilo-
fophe ; ce font des mémoires fur la vie de J. Pigeon,
fon pere. Voye?^ le Nécrologe de ly jo . ( C. )
CHARGE, ( Mujîque. ) air militaire des trompettes
, tambours, tymbales , &c. qu’on exécute
quand l’armée eft prête à charger l’ennemi, d’où lui
eft probablement venu le nom de charge. On dit fonder
la charge pour les trompettQS-,battre la charge pour
les tambours.
Comme dans les opéra on repréfente quelquefois
le choc de deux armées, le muficien doit favoir com-
pofer des charges. 8c leur donner un air militaire.
( F .D . C .)
§ CH ARGÉ, adj. ( Blafon. ) croix chargée. Foye^
dans le Dicl. raif. des Sciences, planches de l’art Héraldique
, planche I I I , fig. 'S j .
CHARIOT, pour applanir & entretenir les chemins.
( Foye{ pl. IV. ÆAgricult. Econom. rujtique.fig. z
dans ce Suppl. ) Ce chariot porte fur deux rouleaux,
pofés de front, 8c parallèlement l’un à l’autre, qui
tournent fur deux pivots, comme la roue d’une
brouette. Ces rouleaux font de fer fondu, 8c ont
deux pieds 8c feize pouces de diamètre ; iis font
creux & garnis par dedans de fortes planches ; ils
font traverfés par un fufeau de f e r , fur l’extrémité
duquel portent tes quatre planches qui foutiennent
le corps de la charrette ; 8c quoiqu’elles n’aient que
deux pouces d’épaifleur, elles font fi bien emboîtées
, qu’on peut mettre deffiis tel fardeau qu’on
veut. Les bouts des pivots tournent dans une cra-
paudine quarrée, de maniéré qu’on peut les grailler
aifément ; mais il faut 1e faire fouvent, fur-tout à
l’égard des pivots intérieurs qui font ceux qui travaillent
le plus. Ces rouleaux facilitent le mouvement
de la charrette lorfque le terrein eft ferme 8c
uni ,> 8c applaniflent 8c affermiffent tes chemins par
lefquels ils paflent, de même que les ornières. Il eft
vrai que ces rouleaux font bas, mais la petiteflë des
pivots diminue le frottement, ce qui eft un avantage
confidérable.
Il y a derrière chaque rouleau un coutre dont
l’ufage eft d’en détacher l’argille qui peut s’y être
attachée.
Le corps de la charrette n’étant élevé que de deux
pieds fix pouces au-deffus de terre, en devient plus
aife à’ charger, 8c d’ailleurs il tient moins de place
dans lés rues.
Les rouleaux, en y comprenant les pivots, ne
pefent guere plus de la moitié des roues ordinaires ;
Tome II.
c’eft pour s’en fervir avec uti feul timon 8c les employer
à différens ufages, en faifant quelque léger
changement au corps de la charrette. Article traduit
d'un journal Anglois. { F .')
* § CHARISTICAIRE, . . A la fin de cet article,
au lieu de ecclef. Grcec.monum. Cont. lifez ecclef. Grcec'.
monum. Cot. Ce dernier mot eft le nom abrégé dé
Cotelier, auteur des monumens de l’églife Grecque.
Lettres fur C Encyclopédie.
* § CHARISTIES, ( Hiß. anc. ) fêtes que lés Romains
célébroient le ig février. . . on fe vifitoit pendant
ces fêtes ,on fe donnoit des repas , on fejaifoit des prê-
fens ; lés amis divifés fe réconciliaient : une particularité
de ces repas, c'eß qu'on n'y admettoit aucun etranger.
i ° . Les chari/lies fe célébroient le 22 février , 8c
non pas le 19, comme il eft évident par le calendrier
de Conftantin.
20. Il n’y avoit qu’iine feule fête 8c qu’un feuf
repas.
3°. Les amis ne fe reconcilioient point dans cé
repas, car ils n’y étoient point admis. Ce repas étoit
deftiné aux feuls pärens, un ami eût été un étranger.
« Nos ancêtres avoient Coutume de faire tous les
» ans un feftin folemnel, où il n’y avoit que tes pa-
» rens 8c les alliés qui fuflent admis » , dit Valere-
Maxime, liv. I Ï , chap. premier. Ovide affiire la même
ehofe, au liv. I l des fa fies, vers Si y , 8cc.
Proxima cognati dix ère charißia cari,
E t venit ad focias turba propinqua dapes.
Lettres fur VEncyclopédie.
§ CHARITÉ ch rétienn e ( l’ordre de l a ) ;
établi par Henri III, roi de France 8c de Navarre ,
pour tes foldats.eftropiés à la guerre.
Il avoient une maifon, fauxbourg faint Marceau *
à Paris ; les revenus de leur entretien étoient pris
fur les hôpitaux 8c maladreries du royaume.
Les foldats portoient une croix de fatin blanc ,‘
bordée de foie bleue ; au centre étoit une lofange
auffi de fatin bleu, chargée d’une fleur-de-lys d’or en
broderie.
La devife’ ; pour avoir bien fervi.
La mort funefte de Henri III, arrivée le premier
août 1589, interrompit cet établiflement. Voye{ la
planche jCX.FI, fig. .Sj , de Blafon , Dicl, raif. des
Sciences, Arts & Métiers. ( G. D . L .T . j
§ CHARIVARI ou C h a r b a r is , {Hiß. rnod.j
ce mot paroît formé d’un autre de là bafîe latinité,
chalybarium , bruit fait avec des chauderons 8c des
poêles, &c. de chalybs , qui fignifie du fer 8c de
l’acier.
« La canaille 8c les gens de peu d’importance, dit
» M. Thiers, dans fon Traité des jeux & divertijfe-
» mens, page z8 8 , fe font quelquefois un grand
» divertiffement de ce qu’ils appeltenuAariyari, afin
» de tirer quélqu’argent des nouveaux mariés ou de
» tes charger de confufîon. Il y a dés lieux où cela
» ne fe fait guere qu’à de fécondés noces, difpro-
» portionnées en effet Ou en apparence ; mais il y
» en a d’autres où il fe fait prefqu’à toutes les noces.
» J’apprends de M. Neuré, qii’à Aix en Provence ,
» /e prince des amoureux ou l'abbe des marchands <S*
» artifans , ces deux ridicules perfonnages, qui tten-
» nent un grand rang à la proceflion de te Fete-
» D ieu , tirent un tribut des nouveaux mariés, oit
» qu’autrement ils affemblent tous leurs officiers 8c
» toute leur fequelle, 1e lendemain des noces* vers ^
» le foir , 8c font 1e charivari pendant la nuit par tou-
» tes les rues de la ville, ce qu’ils continuent enfuité .
» avec tant de violence, 8c un fi épouvantable tin-*
» tamarre, que fi on ne leur donne ce qu ils deman-
» dent, ils menacent de mettre le feu à la maifon , .
» 8c ils murent la porte, fans que perfonne puiffé
» fortir, jufqu’à ce qu’ils foient payés ».•