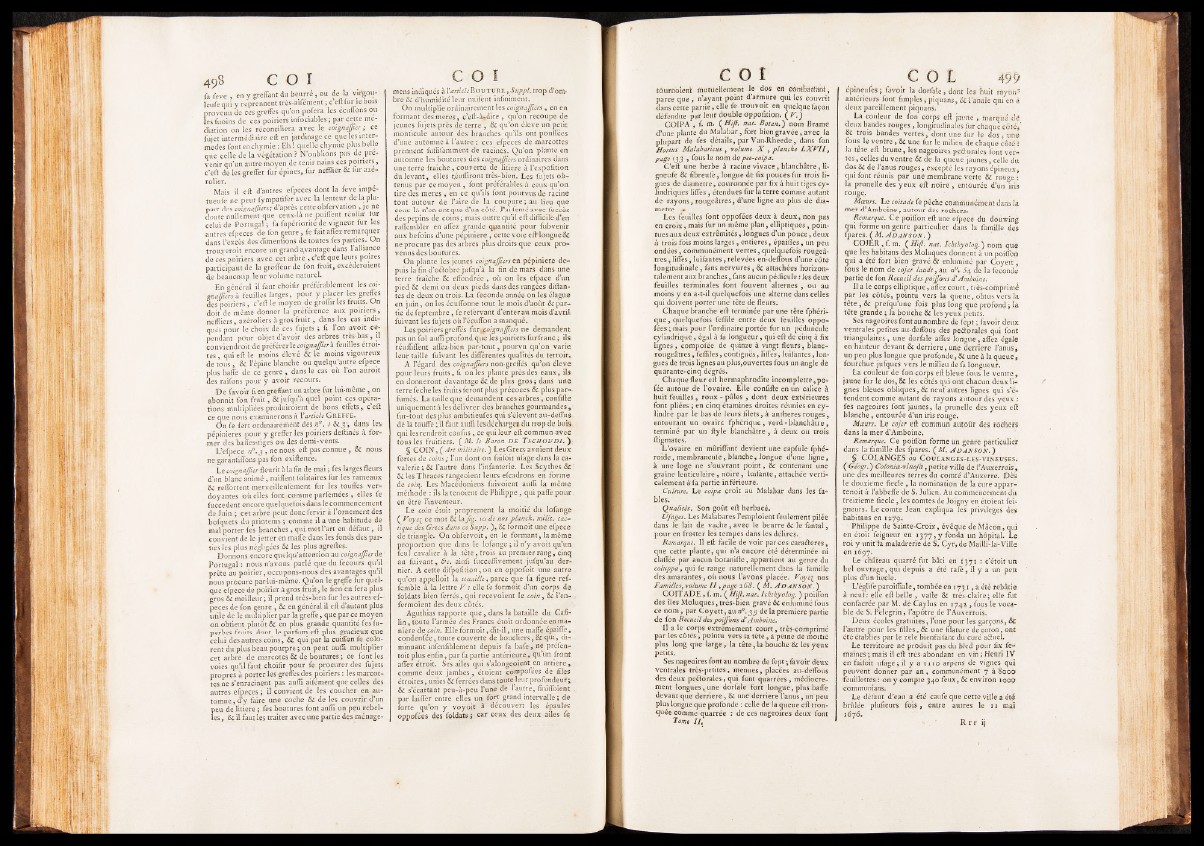
fa feve , en y greffant du beurré , ou de la vifgou-
leufequi y reprennent très-aifénient ; c’eft fur le bois
provenu de ces greffes qu’on pofera les écuffons Olï
les iuoîns de ces poiriers infociables ; par cette médiation
on les réconciliera avec le coignaffur ; ce
fujet intermédiaire eft en jardinage ce que les intermèdes
font en ehymie : Eh ! quelle chymie plus belle
que celle de la végétation ? N’oublions pas de provenir
qu’un autre moyen de tenir nains ces poiriers,
C’ eft de les greffer fur épines, fur neffHer.Stf.;raze-
rolier,
Mais il eft d’autres efpeces dont la feve impé-
tueufe ne peut fympatifèr avec la lenteur de la plfc:J;;
part des eoignajfurs; d’après cette obfervation , je ne
doute nullement que ceux-là ne puiflent réunir fur
celui de Portugal; fa fupérioritc devigueur lui- les
autres efpeces de fon genre , fe fait.affez remarquer
dans l’excès des dimenfions de toutes fesparties. On
trouyeroit encore un grand avantage dans l’alliance
de ces poiriers avec cet arbre c’eft que leurs poires (
participant de la grofléur de fon fruit, excéderaient
de beaucoup leur volume naturel.
En général il faut choifir préférablement les coi-
gnakers à feuilles larges, pour y placer lès greffes
des poiriers , c’eft le moyen de groffir les fruits. On
doit de même donner la préférence aux poiriers ,
néfliers, azéroliers à gros f ru it , dans les cas indiqués
pour le choix de ces fujets ; fi l’on avoit cependant
pour objet d’avoir des arbres trtetas , il
çonviendrqit de préférer le coignajjier à feuilles ét roi-
te s , qui eft le moins élevé & lé moins vigoureux
de tous , & l’épine blanche ou quelqu«àftre efpece
plus baffe de ce genre , dans le cas oit l’on aurait
des raifons pour y avoir recours.
De favoir fi en greffant un arbre fur lui-même, on
abonnit fon fru it, & jufqu’à quel point ces opérations
multipliées produiroient de bons effets, c’efl:
ce que nous examinerons à l’article Greffe.
On fe fert ordinairement des n°. i & 3 ‘, dans les
pépinières pour y greffer les poiriers deflines à former
des baffes-àiges ou des demi-vents.
L’efpece n°. g , ne nous eft pas connue , & nous
ne garantirons pas fon exiftence.
Le coignajjier fleurit à la fin de mai ; fes larges fleurs
d’un blanc animé , naiffent folitaires fur les rameaux
& reflbrtent meryeilleufement fur les touffes verdoyantes
où elles font comme parfemées , elles fe
fuccedent encore quelquefois dans le commencement
de Juin ; cet arbre peut donefervir à l’ornement des
bofquets du printems ; comme il a une habitude de
mal porter fes branches , qui met l’art en défaut, il
convient de le jetter en maffe dans les fonds des parties
les plus négligées & les plus agreftes. ^
Donnons encore quelqu’attention au coignajjier de'
Portugal : nous n’avons parlé que du fecours qu’il
prête au poirier, occupons-nous des avantages qu’il
nous procure parlui-même. Qu’on le greffe fur quelque
efpece de poirier à gros fruit, le fien en fera plus
gros & meilleur; il prend très-bien fur les autres efpeces
de fon genre , & en général il eft d’autant plus
utile de le multiplier par la greffe, que par ce moyen
on obtient plutôt & en plus grande quantité fes fu-
perbes fruits dont le parfum eft plus gracieux que
celui des autres coins, & qui par la cuiffon fe colorent
du plus beau pourpre ; on peut auffi multiplier
cet arbre de marcotes & de boutures ; ce font les
voies qu’il faut choifir pour fe procurer des fujets
propres à porter les greffes des poiriers : les marcottes
ne s’enracinent pas aufli aifément que celles des
autres efpeces ; il convient de les coucher en automne
, d’y faire une coche & de les couvrir d’un
peu de litiere ; fes boutures font aufli un peu rebelles
, & il faut les traiter avec une partie des ménagemens
indiqués à \ article Bouture , Suppl, trop d’ombre
& d’humidité leur nuifent infiniment.
On multiplie ordinairement les coignajjiers, en en
formant des meres, c’eft-àrdire , qu’on recoupe de
jeunes fujets près de terre , & qu’on éleve un petit
monticule autour des branches qu’ils ont pouffées
d’une automne à l ’autre : ces efpeces de marcottes
prennent fuffifamment de racines. Qu’on plante en
automne les boutures des coignajjiers ordinaires dans
une terre fraîche , couverte de litiere à l’expofition
du levant, elles r.éuflîront très-bien. Les fujets obtenus
par ce moyen, font préférables à ceux qu’on
tire des meres , en ce qu’ils font pourvus de racine
tout autour de l’aire de la coupure ; au lieu que
ceux-là n’en ont que d’un côté. J’ai femé avec fuccès
des pépins de coins ; mais outre qu’il eft difficile d’en
raffembler en affez grande quantité pour fubvenir
aux befoins d’une pépinière , cette voie eft*longue &
ne procure pas des arbres plus droits que ceux provenus
des boutures.
On plante les jeunes coignajjiers en pépinière depuis
la fin d’oétobre jufqu’à la fin de mars dans une
terre fraîche & effondrée , oîi on les efpace d’un
pied & demi ou deux pieds dans des rangées diftan-
tes de deux ou trois. La fécondé année on les élague
en juin, on les écuffonne tout le mois d’aout & partie
de feptembre, fe refervant d’enter au mois d’avril
fuivant les fujets oii l’écuffon a manqué.
Les poiriers greffés fur ^.coignajjiers ne demandent
pas un fol aufli profond que les poiriers furfranc ; ils
réuffiffent affez-bien par-tout, pourvu qu’on varie
leur taille fuivant les différentes qualités du terroir.
A l’égard des coignajjiers non-greffés qu’on éleve
pour leurs fruits, fi on les plante près des eaux, ils
en donneront davantage & de plus gros; dans une
terre feche les fruits feront plus précoces & plus parfumés.
La taille que demandent ces arbres, confifte
uniquement à les délivrer des branches gourmandes ,
fur-tout des plus ambitieufes qui s’élèvent au-deffus.
de la touffe ; il faut auffi les décharges du trop de boià
qui les rendroit confus, ce qui leur eft commun avec
tous les fruitiers. ( M. le Baron d e Ts ch o u d i .
§ COIN, ( Art militaire. ) Les Grecs avoient deux
fortes de coins; l’un dont on faifoit ufage dans la cavalerie;
& l’autre dans l’infanterie. Les Scythes & ’
& les Thraces rangeoient leurs efeadrons en forme
de coin,. Les Macédoniens fuivoient aufli la même
méthode : ils la tenoient de Philippe, qui paffe pour,
en être l’inventeur.
Le coin étoit proprement la moitié du lofange
( Voye^ ce mot & la jig. 10 de nos planch. milita tactique
des Grecs dans ce Supp. ) , & formoit une efpece
de triangle. On obfervoit, en le formant, la même
proportion que dans le lofange ; il n’y avoit qu’un
feul cavalier à la tête, trois au premier rang, cinq
au fuivant, &c. ainfi fucceffivement jufqu’au dernier.
A cette difpofition, on en oppofoit une autre
qu’on appelloit la tenaille, parce que fa figure ref-
femble à la lettre V : elle fe formôit d’un corps de
foldats bien ferrés, qui recevoient le coin, & l’en-
fermoient des deux côtés.
Aguthias rapporte que, dans la bataille du Cafi-
lin i toute l’armée des Francs étoit ordonnée en ma-
| niere de coin. Elle formoit, dit-il, une malle épaiflë,
condenfée, toute couverte de boucliers, & qui? diminuant
infenfiblement depuis fa bafe, ne préfen-
toit plus enfin, par fa partie antérieure, qu’un front
affez étroit. Ses ailes qui s’alongeoient en arriéré,
comme deux jambes , étoient compofees de files
| étroites, unies & ferrées dans toute leur profondeur';
& s’écartant peu-à-peu l’une de l’autre, finiffoient
par laiffer entre elles un fort grand intervalle ; de
forte qu’on y voÿoit à découvert les épaules
oppofées des foldats ; car ceux des deux ailes fq
tournoient mutiiellenlent le dos en éômbattâtit,
parce que , n’ayant point d’armure qui les couvrît
dans cette partie* elle fe trouvoit en quelque façon
défendue par leur double ôppofition» ( r . )
COIPA * f. ni* ( Hijl, nat. Botan.') nom Brame
d’une plante du Malabar, fort bien gravée, avec la
plupart de fes détails, par Van-Rheede * dans fon
Hortus Malabaricus * volume X , planche LXV11,
page /j j , fous le nom de pee-coipa.
C’eft une herbe à racine v iv ace , blanchâtre, li-
gneufe & fibreufe, longue de fix pouces fur trois lignes
de diamètre, couronnée par fix à huit tiges cylindriques
liffes , étendues fur la terre comme autant
de rayons, rougeâtres* d’une ligne au plus de diamètre.
»
Les feuilles font oppofées deux à deux, non pas
en croix, mais fur un même plan, elliptiques , pointues
aux deux extrémités, longues d’un pouce, deux
à trois fois moins larges, entières, épaiffes, un peu
ondées* communément vertes, quelquefois rougeâtres
, liffes, luifantes, relevées en-deffous d’une côte
longitudinale, fans nervures, & attachées horizontalement
aux branches, fans aucun pédicule î les deux
feuilles terminales font fouvent alternes , ou au
moins y en a-t-il quelquefois une alterne dans celles
qui doivent porter une tête de fleurs*
Chaque branche eft terminée pat une tête fphéri-
que, quelquefois feffile entre deux feuilles oppofées;
mais pour l’ordinaire portée fur un pédurieule
cylindrique, égal à fa longueur, qui eft de cinq à fix
lignes, compofée de quinze à vingt fleurs-, blane-
rougeâtres, feffiles, contiguës, liffes, luifantes, longues
de trois lignes au plus,ouvertes fous un angle de
quarante-cinq degrés.
Chaque fleur eft hermaphrodite incomplette, po-
fée autour de l’ovaire. Elle confifte en un calice à
huif feuilles * roux - pâles , dont deux extérieures
font pliées * en cinq étamines droites réunies en cy lindre
par le bas de leurs filets, à anfheres rouges,
entourant un ovaire fphérique, verd-blanchâtre ,
terminé par un ftyle blanchâtre * à deux ou trois
ftigmates.
L ’ovaire en mûriffant devient une eapfule fphé-
roïde, membraneufe, blanche, longue dbine ligne,
à une loge ne s’ouvrant point, &c contenant une
graine lenticulaire, noire, luifante, attachée verticalement
à-fa partie inférieure.
Culture* Le coipa croît au Malabar dans les fables.
Qualités. Son goût eft herbacé.
UJ'ages. Les Malabares Remploient feulement pilée
dans te lait de vache, avec le beurre & le tentai,
pour en frotter les tempes dans les délires..
Remarque* Il eft facile de voir par-ces cara&eres,
que cette plante, qui n’a encore été déterminée ni
claffée par aucun botanifte, appartient au genre du
coluppa, qui le range naturellement dans la famille
des amarantes-, oir nous Pavons placée. Voye{ nos
Familles-,volume I I »page 0:68. ( M. A DAN SON. )
CO ITA D E , f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) poiffon
des îles Moluques, très-bien gravé & enluminé fous
ce nom, par Goyett, au^n°-39 de la première partie
de fon Recueil des poijjon's d'Avihoine.
Il a le corps extrêmement court, très-comprimé
par les côtés , pointu vers la tête, à peine de moitié
plus long que large, la tête, la bouche & tes yeux
petits.
Ses nageoires font au nombre de fept ; favoir dèux
ventrales très-petites, menues, placées au-deffou6
dès deux pe&oraies, qui font quarrées , médiocrement
longues , une dorfale fort longue, plus baffe
de vant que derrière, & une derrière l’anus ,.un peu
plus longue que profonde : celte de la queue eft tronquée
comme quarrée : de ces nageoires deiix font
Tome II,
epineufes ; favoir la dorfale, dont les huit raybh3
antérieurs font fimples * piquans, & l’anale qui en à
deux pareillement piquans*
La couleur de fon corps eft jautte , marqué dë
deux bandes rouges, longitudinales fur chaque côté*’
trois bandes vertes, dont une fur te dos * unë
fous le ventre, & une fur ie milieu de chaque côté^
la tête eft brune, les nageoires petlorales font vertes,
celles du ventre & de la queue jaunes, celle dit
dos & de l’anus rouges, excepté les rayons épineux*
qui font réunis par une membrane verte & rouge.i
la prunelle des yeux eft n oire, entourée d’un iris
rouge..
Moeurs. Le coitade fe pêche cômniiinéineiit dans là
mer d’Amboine, autour dès rochers.
Remarqué. Ce poiffon eft une efpece du douwing
qui forme un genre particulier dans la famille des
fpares. (Af. A d a n so n . )
COJER , f. m. (Hijl. nat. îchthyblag.) norii qus
que les habitans des Moluques donnent à un poiffort
qui a été fort bien gravé & enluminé par C oyé tt,
fous le nom de cojer laudt, au ri°v5q. dë la fécondé
partie de fon Recueil des poijfàns d'Amboine.
Il a le corps elliptique, affez court, très-comprimé
par les côtes, pointu vers la qtieüe, obtus vers la
tête , & prefqu’une fois plus long que profond ; la
tête grande ; la bouche & les yeux petits.
Ses nageoires font au nombre de fept ; favoir deux
ventrales petites au-deflbus des peéforales qui font
triangulair.es , une dorfale affez longue, affez égale
en hauteur devant & derrière, une derrière l’anus*
un peu plus longue que profonde, & une à la queue*
fourchue jufques vers 1e milieu de fa longueur.
, La couleur de fon corps eft bleue fous le ventre,
jaune fur le dos* & les côtés qui ont chacun deux lignes
bleues obliques, & neuf autres lignes, qui s’étendent
comme autant de rayons autour des yeux :
fes nageoires font jaunes, la prunelle des yeux eft
blanche,- entourée d’un iris rouge.
Moeurs. Le cojer eft commun autour des rochers
dans la mer d’Amboine.
Remarque. Ce poiffon forrtie ùn génrë pàrtieulieir
dans la famille des fpares* (M . A d a n s o n . )
§ COLANGES ou C o u ian g e s -les-vinéuses;
( Géogr. ) Colonice-vinofoe, petite ville de l’Auxerrois ,
une des meilleures terres du comté d’Auxerre. Dès
le douzième fieele , la nomination de la cure appar-
tenoit à l’abbeffe de S. Julien. Au commencement du
treizième fieclè, les comtes de Joigny en étoient fei-
gneurs* Le comte Jean expliqua les privilèges des
habitans en 1279.
Philippe de Sainte-Croix, évêque de Mâcon, qui
en étoit (eigneur en 1377 , y fonda un hôpital. Le
roi y unifia maladrerie de S. Cyr, de Mailli-la-Ville
en 1697;
Le château quarré fut bâti en 1371 : e’étoit uni
bel ouvrage, qui depuis a été rafé * il y a un peu,
plus d’un fieele.
L’églife paroifliale, tombée en 17 3 1 , à été rebâtie
à neuf: elle eft belle , vafte & très-claire; elle fut
confaerée par M. dé Cayltis en 1742 , fous 1e vocable
de S. Pelegrin, l’apôtre de rAuxerrois.
Deux écoles gratuites, l’une pour les garçons, &
l’autre pour les filles, & une filature de coton, ont
été établies par 1e zele biènfaifant du curé afruel.
Le territoire ne produit pas du bled pour fix fe->;
maines ; mais il eft très-abondant en. vin ; Heiïri IV
en faifoit ufage ; il y a 1110 arpèns dë vignes qui
peuvent donner par an , communément 7 à 8000
'feuillettes : on y compte 340 feux, & environ 1000
•eommunians.
Le défaut d’eau a été caufe que cette ville a été
brûlée plufieurs fois , entre autres te 11 mai
1676.
R r r ij