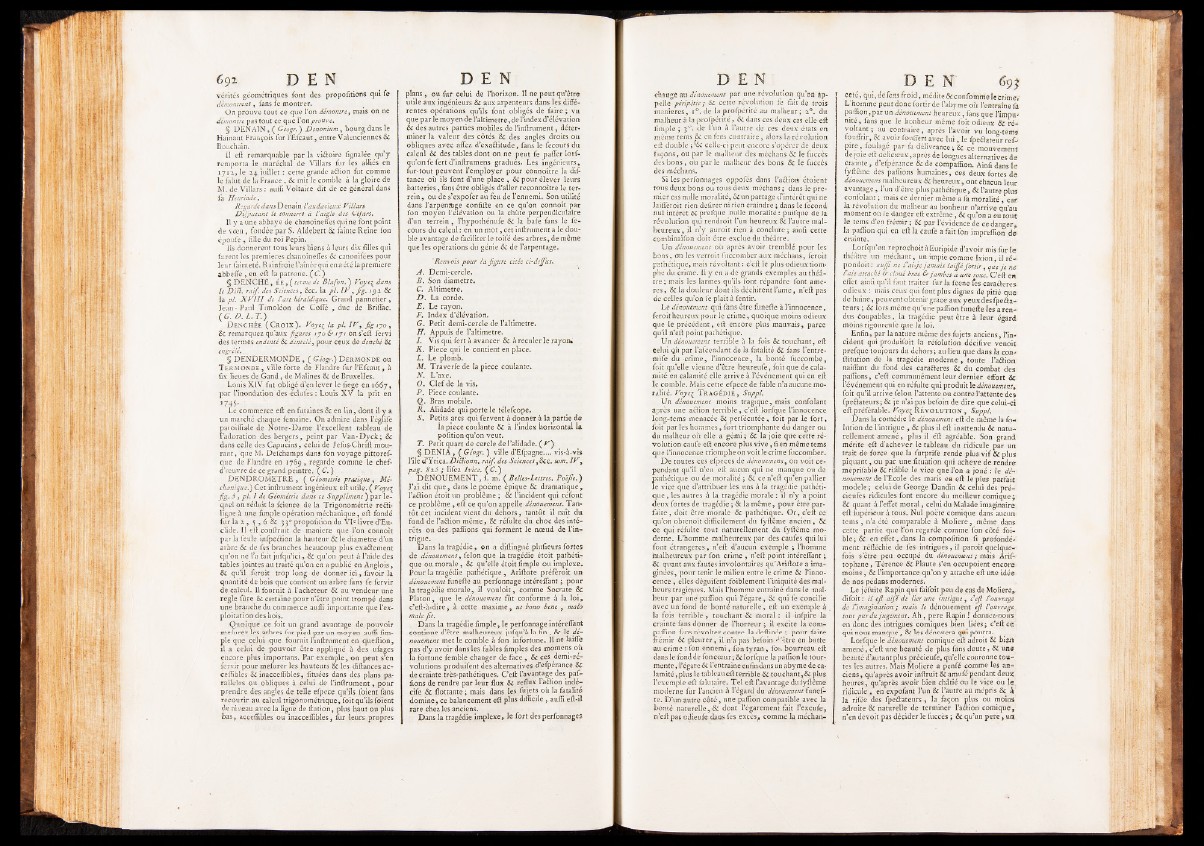
vérités géométriques font des proportions qui fe
démontrent, fans fe montrer.
On prouve tout ce que l’on démontre, mais on ne
démontre, pas tout ce que l’on prouve.
§ DENA1N , ( Géogr. ) Denonium, bourg dans le
Hainaut François fur l’Elcaut, entre Valenciennes 6c
Bouchain.
Il eft remarquable par la viéloire fignalée qu’y
remporta le maréchal de Villars fur les aUiés en
1 7 1 1 , le 24 iuillet : cette grande aélion fut comme
le falut de la France , & mit le comble à la gloire de
M. de Villars : auffi Voltaire dit de ce général dans
l'a Henriade,
Regarde dans Denain l'audacieux Villars
Difputant le tonnerre a Vaigle des Cèfars.
Il y a une abbaye de chanoineffes qui ne font point
de voeu, fondée par S. Aldebert 6c fainte Reine fon
époufe , fille du roi Pépin.
Ils donnèrent tous leurs biens à leurs dix filles qui
furent les premières chanoineffes 6c canonifées pour
leur fainteté. Rainfroie l’aînée qui en a été la première
abbeffe , en eft la patrone. (C .)
§ DENCHÉ, ÉE, ( terme de Blafon. ) Voyez dans
le Dicl. raif des Sciences, 6cc. la pi. I V , jig. IC)Z 6c
la pi. X V I I I de Fart héraldique. Grand pannetier,
Jean - Paul Timoléon de Coffé , duc de Briffac.
( G .D .L .T . )
D enchée (C roix). Voyez la pl. IV , fig iy o,
6c remarquez qu’aux figures 170& lyi ons’eft fervi
des termes endentè 6c dentelé, pour ceux de denché 6c
engrêlè. .
§ DENDERMONDE, ( Géogr.) D ermonde ou
T ermonde, ville forte de Flandre fur l’Efcaut, à
lix lieues de Gand, de Malines 6c de Bruxelles.
Louis X IV fut obligé d’en lever le fiege en 1667,
P"ar l'inondation des édufés : Louis X V la prit en
1745.-ri r : .S . ' ' ' *Jl ) ' i A . i;
Le commerce eft en futaines 6c en lin, dont il y a
un marché chaque femaine. On admire dans l’églife
paroiffiale de Notre-Dame l’excellent tableau de
l ’adoration des bergers, peint par Van-Dyck; &
dans celle des Capucins, celui de Jefus-Chrift mourant,
que M. Delchamps dans fon voyage pittoref-
que de Flandre en 1769, regarde comme le chef-
d’oeuvre de ce grand peintre. ( C. ) ,
DENDROMETRE , ( Géométrie pratique , Mé-
chanique.) Cet inftrument ingénieux eft utile. ( Voyez
fig. 5 , pl. I de Géométrie dans ce Supplément ) par lequel
on réduit la fcience de la Trigonométrie refti-
ligne à une fimple opération méchanique, eft fondé
fur la 2 , 5 ,6 6c 33e propofiîion du VIe livre d’Eu-
clide. Il eft conftruit de maniéré que l’on connoît
par la feule infpeclion la hauteur & le diamètre d’un
arbre & de fes branches beaucoup plus exaéiement
qu’on ne l’a fait jufqû’ ic i, & qu’on peut à l’aide des
tables jointes au traité qu’on en a publié en Anglois,
6c qu’il feroit trop long de donner ic i, favoir la
quantité de bois que contient un arbre fans fe fervir
de calcul. 11 fournit à l’acheteur & au vendeur une
réglé fûre 6c certaine pour n’être point trompé dans
une branche du commerce auffi importante que l’exploitation
des bois.
Quoique ce foit un grand avantage de pouvoir
mefurer les arbres fur pied par un moyen auffi fimple
que celui que fournit l’inftrument en queftion,
il a celui de pouvoir être appliqué à des ufages
ehcore plus importans. Par exemple,on peut s’en
fervir pour mefurer les hauteurs 6c les diftances ac-
ceffibles 6c inaçceffibles, fituées dans des plans parallèles
ou obliques à celui de l’inftrument, pour
prendre dés angles de telle efpece qu’ils foient fans
recourir au calcul trigonométrique, foit qu’ils foient
de niveau avec la ligne de ftation, plus haut ou plus
bas, acceffibles ou inacceffibles, fur leurs propres
plans, ou fur celui de l’horizon. Il ne. peut qu’être
utile aux ingénieurs & aux arpenteurs dans les différentes
opérations qu’ils font obligés de faire ; vu
que par le moyen de l’altimetre, de l’index d’élévation
6c des autres parties mobiles de l’inftrument, déterminer
la valeur des côtés & des angles droits ou
obliques avec affez d’exaâitude, fans le fecours du
calcul 6c des tables dont on ne peut fe paffer lorf-
qu’onfe fert d’inftrumens gradués. Les ingénieurs,
fur-tout peuvent l’employer pour connoître la difi
tance oii ils font d’une place , 6c pour élever leurs
batteries, fans être obligés d’aller reconnoître le ter-
rein , ou de s’expofer au feu de l’ennemi. Son utilité
dans l’arpentfege confifte en ce qu’on connoît par
fon moyen l’élévation ou la chûte perpendiculaire
d’un terrein, l’hypothénufe 6c la bafe fans le fecours
du calcul : en un m ot, cet inftrument a le double
avantage de faciliter le toifé des arbres, de même
que les opérations du génie 6c de l’arpentage.
'Renvois pour la figure citée ci-deffus.
X. Demi-cercle.
B. Son diamètre.
C. Altimètre.
D . La corde.
E. Le rayon.
F. Index d’élévation.
G. Petit demi-cercle de l’altimetre.
H. Appuis de l’altimetre.
I. Vis qui fert à avancer & à reculer le rayon.
K . Piece qui le contient en place.
L. Le plomb.
M. Traverfe de la piece coulante.
N. L ’axe.
O. Clef de la vis.
P. Piece coulante.
Q. Bras mobile.
R. Alidade qui porte le télefcope.
S. Petits arcs qui fervent à donner à la partie de
la piece coulante 6c à l’index horizontal la
pofition qu’on veut.
T. Petit quart de cercle de l’alidade. ( V')
§ DENIA, ( Géogr. ) ville d’Efpagne.... vis-à-vis
l’île d’Yrica. Dictionn. raif. des Sciences, 6cc. tom. IV ,
pag. 826 ; lifez Ivice. ( C. )
DÉNOUEMENT, f. m. ( B elles-Lettres. Poëfie.)
J’ai dit que, dans le poëme épique & dramatique,
l’aâion étoit un problème ; & l’incident qui réfout
ce problème, eft ce qu’on appelle dénouement. Tantôt
cet incident vient du dehors, tantôt il naît du
fond de l’a&ion même, & réfulte du choc des intérêts
ou des pallions qui forment le noeud de l’intrigue.
Dans la tragédie , on a diftingué plufieurs fortes
de dénouemens, {$Ion que la tragédie étoit pathétique
ou morale, 6c qu’elle étoit fimple ou implexe.
Pour la tragédie pathétique, Ariftote préféroit un
dénouement funefte au perfonnage intéreffant ; pour
la tragédie morale, il vouloit, comme Socrate 6c
Platon, que le dénouement fût conforme à la lo i,
c’eft-à-dire, à cette maxime, ut bono bene , malo
male fit.
Dans la tragédie fimple, le perfonnage intéreffant
continue d’être malheureux jufqu’à la fin, & le dénouement
met le comble à fon infortune. Il ne lame
pas d’y avoir dans les fables fimples des momens où
la fortune femble changer de face , & ces demi-révolutions
produifent des alternatives d’efpérance 6c
de crainte très-pathétiques. C’eft l’avantage des paf-
fions de rendre par leur flux & reflux l’aâion indé-
cife & flottante ; mais dans les fujets où la fatalité
domine, ce balancement eft plus difficile, auffi eft-il
rare chez les anciens.
Dans la tragédie implexe, le fort des perfonnages
changé au âénàuement par une révolution qu’on appelle
péripétie ; & cette révolution fe fait de trois
maniérés, i° . de la profpérité au malheur; 20. du
malheur à la profpérité, 6c dans ces deux cas elle eft
fimple; 3^. de l’un à l’autre de c es deux états en
même tems 6c en fens contraire, alors la révolution
eft double ;•& celle-ci peut encore s’opérer de deux
façons, ou par le malheur des médians;& le fuccès
des bons, oü parle malheur des bons 6c le fuccès
des méchant.
Si les perfonnages oppofés dans l’aélio» étoient
tous deux bons ou tous deux médians ; dans le premier
cas nulle moralité, 6c un partage d’intérêt qui ne
laifi'eroit rien defirer ni rien craindre ; dans le fécond
nul intérêt 6c prefque nulle moralité : puifque de la
révolution qui rendroit l’un heureux 6c l’autre mafe
heureux, il n’y auroit rien à conclure ; ainfi cette
combinaifon doit être exclue du théâtre.
Un dénouement oit après avoir tremblé pour les
bons, on les verroit fuccomber aux médians, feroit
pathétique, mais révoltant : c’eft le plus odieux tiom-
phe du crime. II y en a de grands exemples au théâtre
; mais les larmes qu’ils font répandre font ame-
res , 6c la douleur dont ils déchirent l’ame, n’eft pas
de celles qu’on fe plaît à fentir.
Le dénouement qui fans être funefte à l’innocence,
feroit heureux pour le crime, quoique moins odieux
que le précédent, eft encore plus mauvais, parce
qu’il n’eft point pathétique.
Un dénouement terrible à la fois & touchant, eft
celui gù par l’afcendant de la fatalité 6c fans l’entre-
mife du -crime, l’innocence, la bonté fuccombe,
foit qu’elle vienne d’être heureufe, foit que de calamité
en calamité elle arrive à l’événement qui en eft
le comble. Mais cette efpece de fable n’a aucune moralité.
Voye^ T r a g éd ie , Suppl.
Un dénouement moins tragique, mais confolant
après une a&ion terrible, c’eft lorfque l’innocence
long-tems menacée & perfécutée, foit par le fort,
foit par les hommes, fort triomphante du danger ou
du malheur où elle a gémi ; 6c la joie qite cette révolution
caufe eft encore plus v iv e , fi en même tems
que l’innocence triomphe on voit le crime fuccomber.
De toutes ces efp.eees.de dénouemens, on voit cependant
qu’il n’en eft aucun qui ne manque ou de
pathétique ou de moralité ; 6c ce n’eft qu’en pallier
le vice que d’attribuer les uns à la tragédie pathétique
, les autres à la tragédie morale : il n’y a point
deux fortes de tragédie ; & la même, pour être parfaite,
doit être morale 6c pathétique. O r , c’eft ce
qu’on obienoit difficilement du fyftême ancien, &
ce qui réfulte tout naturellement du fyftême moderne.
L’homme malheureux par des caufes qui lui
font étrangères, n’eft d’aucun exemple ; l’homme
hialheureux par fon crime , n’eft point intéreffant ;
& quant aux fautes involontaires qu’Ariftote a imaginées,
pour tenir le milieu entre le crime & l’innocence
, elles déguifent foiblement l’iniquité des’malheurs
tragiques. Mais l’homme entraîné dans le malheur
par unépaffion qui l’égare, Sc qui fe concilie
avec un fond de bonté naturelle, eft un exemple à
la fois terrible, touchant 6c moral : il infpire la
crainte fans donner de l’horreur ; il excite la com-
paffion fans révolter contre la deftinée ; pour faire
frémir & pleurer, il n’a pas befoin ^’être en butte
au crime : fon ennemi, fon tyran , foi* bourreau eft
dans le fond de fon coeur ;& lorfque la paffion le tourmente
, l’égare & l’entraîne enfin dans un aby me de calamité
, plus le tableau eft terrible 6c touchant, 6c plus
l’exemple eft falutaire. Tel eft l’avantage du fyftême
moderne fur l’ancien à l’égard du dénouement funefte.
D’un autre côté, une paffion compatible avec la
bonté naturelle, & dont l’égarement fait i’exçufe,
n’eft pas odieufe dans fes excès,, comme la méchanceté,
qui, dé fens froid, médite & confoirihïe îe trime*
L ’homme peut donc fortir de l’abyme où l’entraîne fa
paffion,par un dénouement heureux, fans que I'impu-
nite, fans que le bonheur même foit odieux 6c ré-
voltant ; au contraire, après l’avoir vu long-tems
fouffrir, & avoir fouffert avec lu i, le fpeélateur ref-*
pire, foulage par- fa délivrance ; & ce mouvement-
de joie eft délicieux, après de longues alternatives de
crainte, d’efpérance 6c de compaffion. Ainfi dans le
fyftême des pallions humaines, des deux fortes de
dénouemens malheureux 6c heureux, ont chacun leur
avantage, l’un d’être plus pathétique, & l’autre plus
confolant ; mais ce dernier même a fa moralité , car
la révolution du malheur au bonheur n’arrive qu’au
moment où le danger eft extrême, 6c qu’on a eu tout
le tems d en frémir ; 6c par l’evidence de ce danger^
la paffion qui en eft la caufe a fait fon impreffion de
crainte.
Lorfqu’on reprochoit à Euripide d’avoir mis fur le
théâtre un méchant, un impie comme Ixion, il ré-
pondoit : auffi ne l'ai-jè jamais laijfé fottir , que je ne
l'aie attaché & cloué bras & jambes à une roue. C’eft en
effet ainfi qu’il faut traiter fur la fcene fes cara&eres
odieux : mais ceux qui font plus dignes de pitié que
de haine, peu vent obtenir grâce aux yeux des fpeéta-
teurs ; 6c lors même qu’une paffion funefte les a rendus
Coupables, la tragédie peut être à leur égard
moins rigoureufe que la loi.
Enfin, par la nature même des fujets anciens , l’incident
qui produifoit la réfolution décifive venoit
prefque toujours du dehors ; au lieu que dans la con-
ftitution de la tragédie moderne , toute l’aélion
naiffant du fond des caraéteres 6c du combat des
pallions, c’eft communément leur dernier effort &
l’événement qui en réfulte qui produit le dénouement,
foit qu’il arrive félon l’attente ou contre l’attente des
fpeâateurs; 6c je n’ai pas befoin de dire que celui-ci
eft préférable. Voyez Révolution , Suppl.
Dans la comédie le dénouement eft de même la fo-
lution de l ’intrigue , 6c plus il eft inattendu & naturellement
amené, plus il e‘ft agréable. Son grand
mérite eft d’achever le rableau du ridicule par un
trait de force que la furprife rende plus v if 6c plus
piquant, ou par une fituation qui achevé de rendre
méprifable 6c rifible le vice que l’on a joué : le dénouement
de l’Ecole des maris en eft le plus parfait
modèle ; celui de George Dandin 6c celui des pré-
cieufes ridicules font encore du meilleur comique ;
6c quant à l’effet moral, celui du Malade imaginaire
eft fupérieur à tous. Nul poète comique dans aucun
tems , n’a été comparable à Moliere, même dans
cette partie que l’on regarde comme fon coté foi-
ble ; 6c en effet, dans la compofition fi profondément
réfléchie de fes intrigues , il paroît quelquefois
s’être peu occupé du dénouement ; mais A r is tophane
, Térence 6c Plaute s’en occupoient encore
moins, 6c l’importance qu’on y attache eft une idée
de nos pédans modernes.
Le jéfuite Rapin qui failbit peu de cas de Moliere*-
difoit : il efi aifé de lier une intrigue, défi l'ouvrage
de l'imagination ; mais le dénouement efi l'ouvrage
tout pur du jugement. Ah , pere Rapin ! donnez-nous ;
en donc des intrigues comiques bien liées ; c’eft ce
qui nous manque, & les dénouerâ qui pourra.
Lorfque le dénouement comique eft adroit 6t bien
amené, c’eft une beauté de plus fans doute, 6c un«
beauté d’autant plus précieufe, qu’elle couronne toutes
les autres. Mais Moliere a penfé comme les anciens
, qu’après avoir inftruit & ariiufé pendant deux
heures, qu’après. avoir bien châtié ou le vice ou le.
ridicule , en expofant l’un & l’autfe au mépris 6c à
la rifée des fpeâateurs , la façon plus oü moins
adroite & naturelle de terminer l’aftion comique,
n’en devoit pas décider le fuccès ; 6c qu’un pere, un