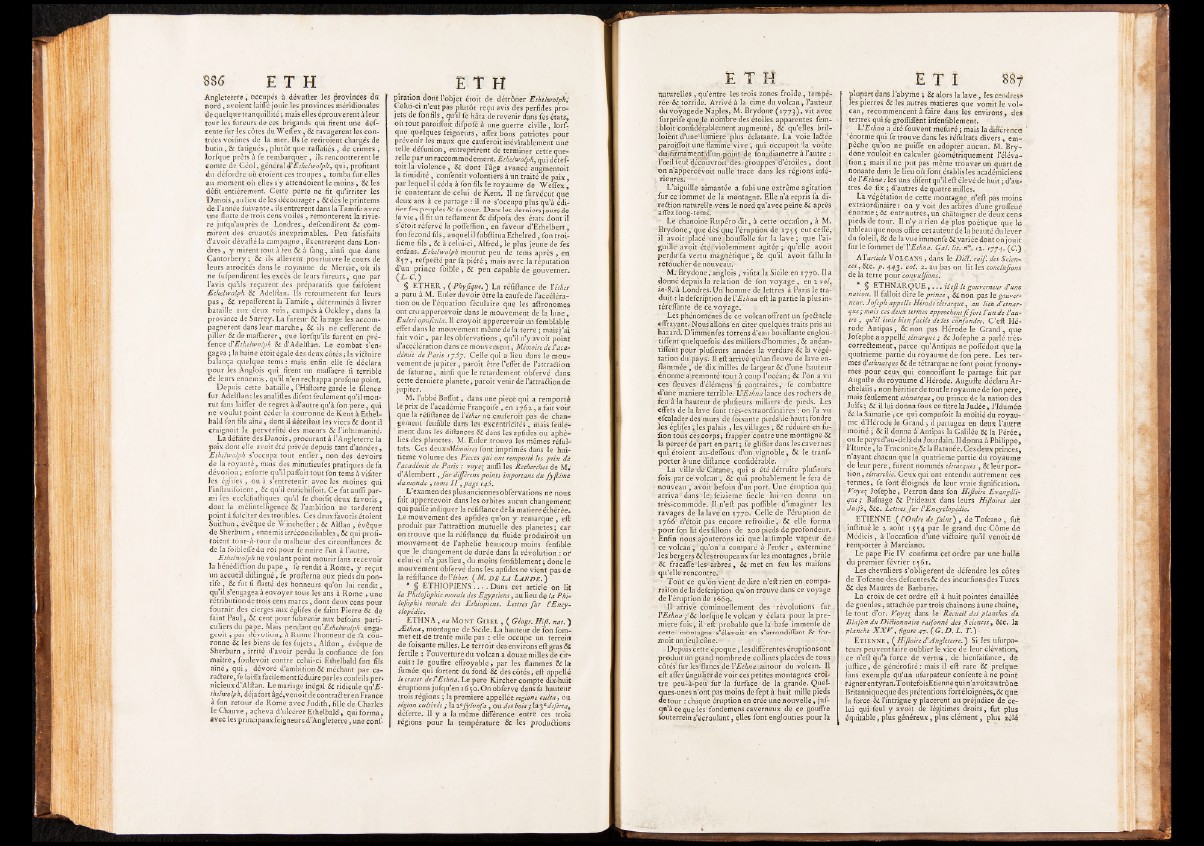
Angletefrfebccupés à dévafter le$ jjirovindes du
nord, avoient laiffé jouir les provinces méridionales
de quelque tranquillité ; mais elles éprouvèrent à leur
tour les fureurs de ces brigands qui firent une def-
eente fur les côtes du Weflex, & ravagèrent les contrées
voifines de la mer. Ils fe retiroient chargés de
butin, & fatigués, plutôt que raffafiés , de crimes ,
lorfque prêts à fe rembarquer , ils rencontrèrent le
comte de Céol, généralà'Etkelwolp/t^ qui, profitant
du défordre oîi étoient ces troupes , tomba fur elles
au moment ©îi elles s’y attendoient le moins , & les
défit entièrement. Gette perte ne fit qu’irriter les
Danois, au lieu de les décourager, & dès le printems
de l’année fuivante, ils entrèrent dans la Tamife avec
tine flotte de trois cens voiles , remontèrent la rivière
jufqu’auprès de Londres, defcendirent & commirent
des cruautés inexprimables. Peu fatisfaits
d’avoir dévaftéla campagne, ils entrèrent dans Lond
re s , ÿ mirent tout à feu & à fang, ainfi que dans
Çantorbery; & ils allèrent pourfuivre le cours de
leurs atrocités dans le royaume de Mercie, oit ils
ne fufpendirent les excès de leurs fureurs, que pat
l’avis qu’ils reçurent des préparatifs que faifoient
Ethelwolph & Adelflan. Ils retournèrent fut leurs
pa s, & repaffe'rent la Tamife , déterminés à livrer
bataille aux deux rois, campés à O ckley, dans la
province de Surrey. La fureur & là rage des accompagnèrent
dans leur marche, & ils ne cefferent de
piller &demaffacrer, que lorfqu’ils furent en pré-
iehee d'Ethelwolph & d’Adelftan. Le combat s’engagea
; la haine étoit égale des deux côtés ; la v iûoire
balança quelque tems: mais enfin ellè fe déclara
-pour les Anglois qui firent un ma fiacre fi terrible
de leurs ennemis, qu’il n’en réchappa prefque point.
Depuis cette bataille, l’Hiftoire garde le filence
fur Adelflan : les analiftes difent feulement qu’il mourut
fans laiffer de regret à d’autre qu’à fon pere, qui
ne voulut point Céder la couronne de Kent à Ethel-
bald fon fils aîné, dont il déteftoit les vices & dont il
craignoit la perverfiré des moeurs & l’inhumanité»
La défaite des Danois, procurant à l’Angleterre la
paix dont elle avoit été privée depuis tant d’années,
Ethelwolph s’occupa tout entier, non des devoirs
de la royauté, mais des minutieufes pratiques de fa
dévotion ; en forte qu’il paffoit tout fon tems à vifiter
les églifes , ou à s’entretenir avec les moines qui
l’inftruifoient, & qu’il enrichiffoit. Ce fut auffi parmi
les eccléfiafliques qu’il fe choifit deux favoris ,
dont la méfintelligence & l’ambition ne tardèrent
point â fufeiter des troubles» Ces deux favoris étoient
Suithun, évêque de Vinchefter ; & Alftan , évêque
de Sherburn, ennemis irréconciliables, & qui profitaient
tour-à-tpur du malheur des circonftances &
de la foibleffe du roi pour fe nuire l’un à l’autre.
Ethelwolph ne voulant point mourir fans recevoir
la bénédiûion du pape , fe rendit à Rome, y reçut
un accueil diftingué, fe profterna aux pieds du pontife
, & fut fi flatté des honneurs qu’on lui rendit,
qu’il s’engagea à envoyer tous les ans à Rome , une
rétribution de trois cens marcs, dont deux cens pour
fournir des cierges aux églifes de faint Pierre & de
faint Paul, & cent pour (ubvenir aux befoins particuliers
du pape. Mais pendant oyt Ethelwolph enga-
g eo it, par dévotion, à Rome l’honneur de fa couronne
& les biens de fes fujets, Alflon, évêque de
Sherburn, irrité d’avoir perdu la confiance de fon
maître, foulevoit contre celui-ci Ethelbald fon fils
aîné, qui, dévoré d’ambition & méchant par ca-
raûere,fe lajffa facilement féduire par les confeils per»
nicieuxd’Alftan. Le mariage inégal & ridicule qu’Æ-
thdwolph, déjà for t âgé, venoit de contrarier en France
à fon retour de Rome avec Judith, fille de Charles
le Chauve, acheva d’ulcérer Ethelbald, qui forma,
avec les principauxfeigneursd’Angleterre, une confpiratiôn
dont l’objet étoit de détrôner Ethelwolpkl
Celui-ci n’eut pas plutôt reçu avis des perfides projets
de fon fils, qu’il fe hâta de revenir dans fes états j
ou tout paroiflbit difpôfé à une guerre civile, lorfque
quelques feigneurs, allez bons patriotes pouf
prévenir les maux que cauferoit inévitablement une
telle défunion, entreprirent de terminer xette querelle
par un raccommodement. Ethelwolph, qui detef-
toit la violence, & dont l’âge avancé augmentait
la timidité, confentit volontiers à un traité de paix ,
par lequel il céda à fon fils le royaume de Weffex ,
fe contentant de celui de Kent. Il ne furvécut que
deux ans à ce partage : il ne s’occupa plus qu’à édifier
fes peuples & fa cour. Dans les derniers jours de
fa v ie , il fit Un teftament & difpofa des états dont il
s’étoit réfervé la poffeflion, en faveur d’Ethelbert,
fon fécond fils, auquel il fubftitua Ethelred, fon troi-
fieme fils , & à celui-ci, Alfred, le plus jeune de fes
enfans. Ethdwolph mourut peu de tems après , en
857, refpeûé par fa piété ; mais avec la réputation
d’un prince foible , & peu capable de gouverner.
(L .C.)
§ ETHER , ( Phyfique. ) La réfiftance de Véther
a paru à M. Euler devoir être la caufede l’accélération
ou de l’équation féculaire que les aftronomes
ont cru apperceVoir dans le mouvement de la lune,
Euleri opufcula. Il croyoit appercevoirun femblable
effet dans le mouvement même delà terre ; mais j ’ai
fait v o ir , par les obfervations , qu’il n’y avoit point
d’accélération dans ce mouvement, Mémoire de Paca*
démie de Paris r)5j . Celle qui a lieu dans fe mouvement
de jupiter, paroît être l’effet de l’attraÛion
de faturne, ainfi que le retardement obfervé dans
cette derniere planete, paroît venir de l’attraÛion de
jupiter.
M. l’abbe Boflut, dans une piecè qui a remporté
le prix de l’académie Françoife , en 1762, a fait voir
que la réfiftance de Véther ne .cauferoit pas de changement
fenfible dans les excentricités , mais feulé*-
ment dans les diftances & dans les apfides ou aphélies
des planètes. M. Euler trouva les mêmes réful-
tats. Ces deux*Mémoires font imprimés dans le huitième
volume des Pièces qui ont remporté les prix de
tacadémie de Paris : voyei aufli les Recherches de M*
d’Alembert, fur différens points importuns du fyfiêmc
du monde , tome I I ,page iqS.
L’examen des plus anciennes Obfervations ne nous
fait appercevoir dans les orbites aucun changement
qui puiffe indiquer la réfiftance de la matière éthérée*
Le mouvement des apfides qu’on y remarque, eft
produit par l’attraÛion mutuelle des planètes ; car
on trouve que la réfiftance du fluide prôduiroit un
mouvement de l’aphelié beaucoup moins fenfiblë
que le changement de durée dans la révolution : or
celui-ci n’a pas lieu, du moins fenfiblement ; donc le
mouvement obfervé dans les apfides ne vient pas de
la réfiftance de Véther. ( Af. d e l a La n d e . )
* § ETHIOPIENS. . . . Dans cet article on lit
la Philofophie morale des Égyptiens, au lieu de la Phi*
lofophit morale des Ethiopiens. Lettres fu t tEncyclopédie.
ETHNA, ou Mont Gibel , ( Giogr. Hiß. nat. )
Æthna, montagne de Sicile. La hauteur de fön fom-
met eft de trente mille pas : elle occupe un terrein
de foixante milles. Le terroir des environs eft gras
fertile : l’ouverture du volcan a douze milles de circuit':
le gouffre effroyable, par les flammes & la
fumée qui fortent du fond & des côtés, eft âppellé
lecrater dePEthna.Le pere Kircher compte dix-huit
éruptions jufqu’en 1650. On obferve dans fa hauteur
trois régions ; la première appellée regione culta, ou
région cultivée ; la itfylvofa, ou des bois ; la 3 *defena9-
déferre. Il y a la même différence entre ces trois
régions pour la température & les produûions
naturelles , qu’entre les trois zones Froide, lèmpé-
ïée^& torride. Arrivé à la cime du volcan, l’auteur
du voÿàgede Naples, M. Brydone ( 17 73 ) , vit avec
fiirprifé quelle nombre des'étoiles apparentes fem-
'bloifconfiderablement augmenté, & qu’elles bril-
loiérit d’uned11m i er e plus éclatante. La voie laûee
paroiflbit une flamme1 vive j qui occupoit'la voûte.
' dujfirmamentM’ùn»pbintfde fon.idiametre à l’autre :
l’oeil féul decoiîvroit!'dèsrgrouppes'd’étoiles , dont
■ on n’àppercévoit nulle'trace dans les régions inférieures.’
- '
L’aigüille aimantée à fubi une extrême àgitatiôfi
fur ce fommet de la montagne. Elle n’a repris fa di-
teûi.on naturelle/vers le nord qu’avec peirie & après
àffez long-tems.' •
• Lé chatioinè Rupérodit, à cette'bccafion,''à M.
Brydone , que dès que l’éruption de 1755 eut cefle,1
il avoit-placé‘uneibouflolle fur la lave ; que l’ai-
guillè^avçit été^violemment agitée qu’elle avoit
perdu'fà vertu magnétique , & qu’il avoit fallu la
retoucher de nouveau; •
M."Brydone Langlois /vifita Ja Sicile en 1770. Il a
donné depuis la relation dé fon voyage , en 2 voL
i/2-8.-à Londres.Ün homme de lettres à Paris.le tra**
duit: la defeription de VÊthna eft la partie la plus in-
téreflante de ce.voyage.
Les phénomènes de ce volcan offrent un fpeûacle
effr.ayantriNo.usàllOns en citer quelques traits pris au
hazard'.D’immenfes tOrrens d’eau bouillante engloü-:«
tiflenr quelquefois des milliers d’hommes anéan-,
tiflent pour’ plufietirs années’la verdure & là végétation
diijpâysï II eft arrivé’-qu’un fleuve dé lave enflammée
\ devdix milles de largeur & d’utié hauteur
énorme aitemonté’tout à coup l’océan; & l’on à vit
ces fleuves d’elémens'- fi contraires,' fe combattre
d’une maniéré terrible. UEthriaXance des rochers de
feu à la hauteur de piufieurs milliers de pieds. Les
effets de la lave font très-extraordinaires : On l’a vu
efcalader des murs ' de foixante pieds6de»haut fondre
les églifesTles palais., les villages ; & réduire eh fu-J
ïion tous ces corps; Frapper contre une'montagne &
la percer dé part en part ; fe gliiier dans les cavernes i
quf étoient au-defîbus d’un .vignoble , & le traiif-
porter à -une diftance confidérable.
La villé,,dë'Càtane‘, qui a été détruite plufieiirs
fois par ce .volcan1, • Ôc qui probablement le fera dé
nouveau avoit'’b e foin d’un port. Une éruption qui.
arriva^ danplé^feizieme fiecle lui >en donna un
très-commode. ,11 .n’eft pas poflible- d’imaginer les.
ravages de la lavé en 1770.' Celle de l’ériiption de ,
1766 n’étbit pas encore refroidie , & elle forma
pour fon lif des filions de zoo pieds de profondeur. •
Enfin nous'yajouterons ici que îaïfimple vapeur dé j
ce volcan i*- qu’on a comparé à l’enfer , extermine'
'les bergers & lès troupeaux fur les montagnes, brûle
& fracafte'les*,arbres, & met eh feu les maifons
qu’elle1 rencontre».*' ''
Tout ce qu’on vient de dire n’eft rien eh compà-
raifon dedaTlefcription qu’on trpuve dans ce voyagé
de l’éruption de 1669.
. ?I1 arrive continuellement des ’ révolutions fui*
ŸEthna p&t lorfque le volcan y éclata pour la pre- :
miere fois'i il'eft probable que la bafe immenfe dè .
cette- montagne's’élevoit en s’arrondiflant & for-
moit un feubeône."
Depu'is'cettè’iépoque, les differentes éruptions ont
produit un grandi nombre de collines placées de tous :
côtés¥fur les’flancs de VEthna.autour du volcan. Il
eft aflez fingulier de voir ces petités montagnes'croître
peu-à-peu"fur la furface de la grande. Quelques
unes n’ônt pas moins defept à huit mille pieds
détour : chaque éruption en crée une nouvelle, juf-
qu’à ce que les'fondemens caverneux de ce gouffre
fouterrein s’écroulant, elles font englouties pour là
plupart dans 1,’abyme ; & alors la la v e , les cendres*
lès pierres & les autres, matières que vomit le volcan
, recommencent à fairë dans les environs, des
tertres qui fe grofliffent infenfiblement.
VEthnà'a été fôuvènt mefuré ; mais la différence 1
‘énorme qui fe trouve dans les réfultàts divers, em-,
peche qu’ôn né puiffé en adopter aucun. M. Bry-
■ done voulojt en calculer géométriquement l’éiéva-
*.ti°n » mais il ne put pas même trouver un quart dé
rtonante daris le lieu oit font établis les académiciens
de VEthna ; les uns difent qu’il eft élevé de huit ; d’autres
dé fix ; d’autres de quatre millés, \
La végétation de cette montagne^ n’eft pas moins
extraordinaire : on ÿ voit des arbres d’une groffeuc
enorme ;& entr’àutrès,un châtàigner dé deux cens
pieds de tour. Il n’y a'rien dé plus poétique que lé
; tableau que nous offre cet auteur de la beauté du lever
du foleil, & de là vue immenfe & variéé dont on jouit
fur le fommet AfVÉthnà. Gal. lu.-ri°. 12. 17jq . (C.)
A'1'article VOLCANS > dans le D ic l.ra fd e s S rien-. ;>
4?fs 9 & c/p . 443 fcol. z . au-bas on lit les concluions
de la terre pour"convuljionsi 'rt
ï . * § ETHNÂRQÜE, . ilefl le gouverneur d'une
:i nation, Il falloit dire le prince , & non pas \e gouverneur.
Jofepk appelle Hérode tétrarque, au lieu d ’etnar- .
que*; mais ces deux ter nus approchentfi for il'un de L'autre
, qidilétoit bien facile de les confondre. C ’eft Hé-
rode Antipas ; & non pas Hétode le Grand , que
. Jofephe a a^oWèjétrarque ; & Jofephe a parlé très*
correûement, parce qu’Antipas nepoffédoit que la
• quatrième partie du royaume.de fon pere. Les termes
d'etknarque & dè tétrarquene font point fynony-
mes pour ceux, qui conhoiffent le partage'fait par
Augufte du royaume d’Hérode. Augufte déclara Ar-
chelaiis , non héritier de tout le royaume de fon pere^
mais feulement etkharque, ou prince de la nation des
..Juifs ; & il lui donna fous ce titre la Judée ; l’Iduméé
& la Sàmarie » ce qui compofoit la moitié du royau-*
me d’Hérode le Grand, il partagea èn deux l ’autre
moitié ; & il donna à Antipas la Galilée ôc la Pérée*
^ ou le pays d’au-delà du Jourdain. il donna à Philippe*
l’ Iturée, la Traconit^^ la Batanée. Ces deux princes*
; n’âyant ehacun.quela quatrième partie du royaume
de leur pere, furent nommés tétrarques , &leü r portion
, tétrarchië. Ceux qui ont entendu autrement ces
termes * fe font éloignés de leur vraie lignification.»
Voye^ Jofephe, Pezron dans fon Hijloire Eyangéli*- ■
que ; Bafnage & Prideaux dans leurs Hijloires des
iJuifs, & c . Lettres fu r P Encyclopédie.
ETIENNE .( P Ordre de faint') , déTofcane, fut
inftituéle 2 août 15Ç4 par le grand du cC ômedé
Médicis ,.à l’occafion d’utlé viûoire qu’il venoit dé
remporter à Marciano;
Le pape Pie IV confirma cet Ordre par une bullé
du premier février 1-561.
Les chevaliers s’obligef'ent ae déifèndre les côtes
de Tofcahe des defcentes& des incurfions des Turcs
& des Maures de Barbarie»
La croix de cet ordre eft à huit pointes émailléè
de gueules ; attachée par trois chaînons à une chaîne,
le tout d’or» Voye^ dans le Recueil des planches d&
Blafon du Dictionnaire taifonné des Sciences , & c . la
planche X X V 9 figure 47. ( G .D . L. T.)
Etienn e, ( Hijloire d’Angleterre. ) Si I es ùftirpa-
téurs peuvent faire oublier le vice dé leur élévation,
: ce ri’eft qu’à force de vértus, de bienfaifance, de
juftîce, de générofité : mais il eft rare & prefque
fans exemple qu’un ufurpateur confente à ne point
f ignër en tyran.ToutefoisEtiènne qui n’a voit au trône
Britannique que des prétentions fort éloignées, & que
ia forée &L l’ihtrlgue y placèrent au préjudice de celui
qiii feul y aVoit de légitimes droits, fut plus
équitable, plus généreux, plus clément, plus zélé.