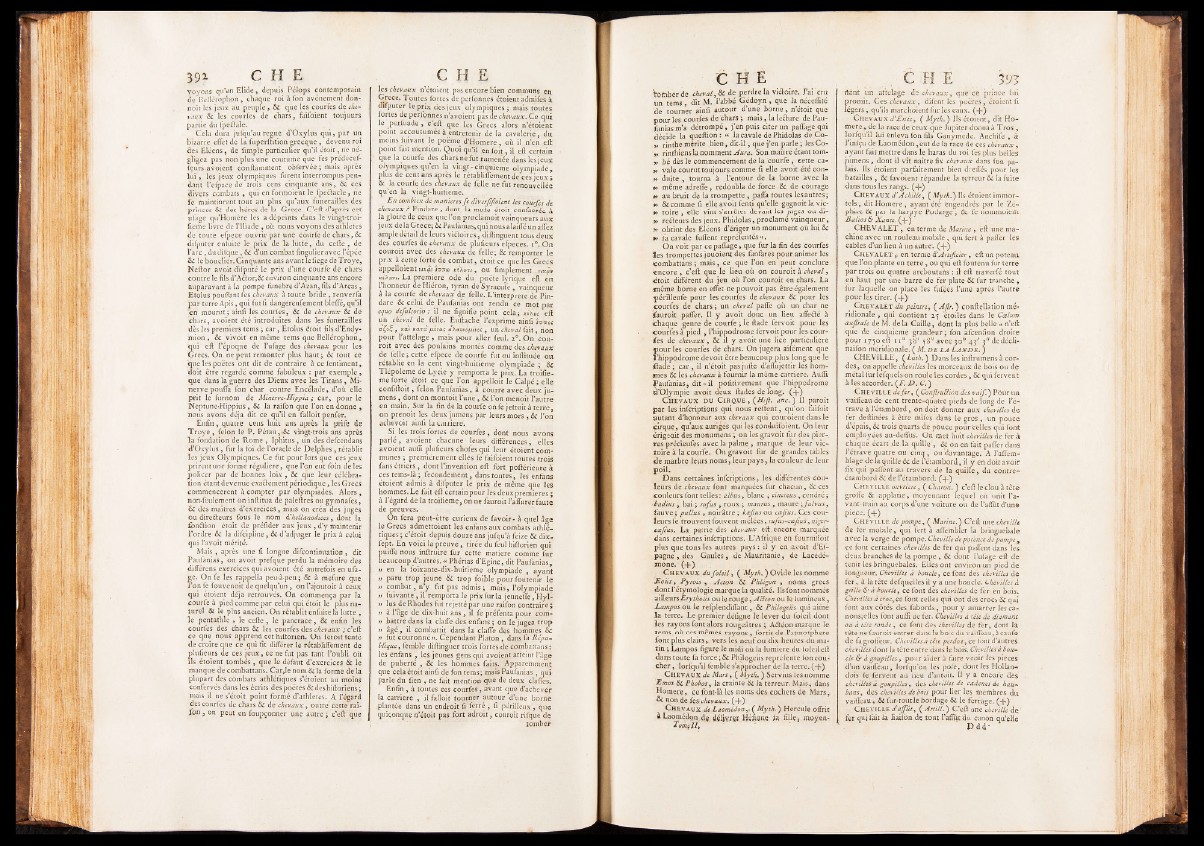
voyons qu’en Elidé, depuis Pélops contemporain
de Bellérophonchaque roi à Ton avènement don-
noir les .jeux au peuple, & que les courtes de chevaux
& les courtes de chars, faifoient toujours
partie du fpeôale.
Cela dura jufqu’au régné d’Oxylus qui, par un
bizarre effet de la fuperftition grecque, devenu roi
des Eléens, de temple particulier qu’il étoit, ne négligea
pas non plus une coutume que fes prédécef-
lèu'rs avoient confiamment obferyée ; mais après
lui , les jeux olympiques furent interrompus pendant
l ’efpace de trois cens cinquante ans, &; ces
divers combats , qui en formoient le fpettacle, ne
fe maintinrent tout au plus qu’aux funérailles des
princes & des héros de la Grece. C’eût d’après cet
ufage qu’Homèfe les a dépeints dans le vingt-troi-
te.eme livre de l’Iliade , où nous voyons des athlètes
de toute efpece ouvrir par une courte de chars , &
difputer entente le prix de la lutte, du cefle , de
l’a rc , du difque, & d’un combat fingulier avec l’épée
& le bouclier. Cinquante ans avant leteege deTroye,
Neftor avoit difputé le prix d’une courte de chars
contre le fils d’A∨&environ cinquante ans encore
auparavant à la pompe funebre d’Azan, fils d’Arcas,
Etolus pondant fes chevaux à toute bride , renverfa
par terre Apis, qui fut fi dangereufement blefle, qu’il
en mourut; ainfi les courtes, & de chevaux & de
chars, avoient été introduites dans les funérailles
dès les premiers tems ; ca r, Etolus étoit fils d’Endy-
mion, & vivoit en même tems que Bellérophon,
qui eft l’époque de l’ufage des chevaux pour les
Grecs. On, ne peut remonter plus haut ; & tout ce
"que les poètes ont dit de contraire à ce fentiment,
doit être regardé comme fabuleux : par exempte,
que dans la guerre des Dieux avec tes Titans , Minerve
pouffa fon char contre Encélade, d’où elle
prit 1e furnom de Minerve-Hippia ; car, pour 1e
Neptune-Hippius , & la raifon que l’on en donne ,
nous avons déjà dit ce qu’il en falloit penfer.
Enfin, quatre cens huit ans après la prife de
T r o y e , félon le P. Pétau,*& vingt-trois ans après
la fondation de Rome , Iphitus, un des defcendans
d’Oxylus, fur la foi de l’oracle de Delphes , rétablit
les jeux Olympiques. Ce fut pour lors que ces jeux
prirent une forme régulière, que l’on eut foin de tes
policer par de bonnes lo ix , & que leur célébration
étant devenue exactement périodique, les Grecs
commencèrent à compter par olympiades. Alors ,
non-feulement on inftitua de paleftres ougÿmnafes,
& des maîtres d’exercices, mais on créa des jugés
ou directeurs fous 1e nom à’hellanodices, dont la
fonction étoit de préfider aux jeux, d’y maintenir
l ’ordre & la difcipline, & d’adjuger le prix à celui
qui l’avoit mérité.
Mais , après une te longue difcontinuation, dit
Paufanias, on avoit prefque perdu la mémoire des
différens exercices qui avoient été autrefois en ufage.
On fe les rappella peu;à-peu; & à mefure que
l ’on fe fouvenoit de quelqu’un , on Pâjoutoit à ceux
qui étoient déjà retrouvés. On commença par la
courte à pied comme par celui qui étoit 1e plus naturel
& le plus ancien. On rétablit enfuitela lutte ,
le pentathle , 1e celle , te pancrace, & enfin les
courtes des chars & les courtes des chevaux ; c’eft
ce que nous apprend cet hiftorien. On feroit tenté
de croire que ce qui fit différer 1e rétabliffement de
pîufieurs de ces jeux, ce ne fut pas tant l’oubli où
ils étoient tombés , que 1e défaut d’exercices & le
manque de combattans. Car,le nom & la forme de la
plupart des combats athlétiques s’ étoient au moins
confervés dans les écrits des poètes & des hiftoriens;
mais il ne s’étoit point formé d’athletes. A l’égard
des courtes de chars & de chevaux;, outre cette raifon
, on peut en foupçonner une autre ; ç’ëft que
les chevaux n’étoient pas encore bien communs en
Grece. Toutes fortes de perfonnes étoient admîtes à
difputer le prix des jeux olympiques; mais toutes
fortes de perfonnes n’avoient pas de chevaux. C e qui
1e perfuade , c’eft que les Grecs alors n’étoient
point accoutumés à entretenir de la cavalerie, du
moins fuivant le poëmè d’Homere, où il.,n’en eft
point fait mention. Quoi qu’il en foit, il eft certain
que la courte des chars ne fut ramenée danslesjeux
olympiques qu’en la vingt - cinquième olympiade,
plus de cent ans après 1e rétabliffement de ces jeux ;
& la courte des chevaux de telle ne fut renouvellée
qu’en la vingt-huitiemè.
En combien de maniérés Je divèrjifioient les courfes de
chevaux ? Pindare , dont la mute étoit confacrèe à
la gloire de ceux que l’on prodâmoit vainqueurs aux
jeux delà Grece; & Paufanias, qui nous a Iaiffé un affez
ample détail de leurs victoires., diftinguent tous deux
des courfes de chevaux de pliîfiëurs efpeces. i°. On
couroit avec des chevaux de telle; & remporter le
prix à cette forte de combat, étoit ce que les Grecs
appelloient m^y Î7T77» vAxmi, ou Amplement ..v/xar
jcîXxt/. La première ode du : pôëte lyrique eft en
l’honneur de Hiéron, tyran de Syracufe , vainqueur
à la courte de chevaux de telle.,L’interprete de Pindare
& celui de Paufanias ont rendu ce mot par
equo defultorio; il ne fignifîè point cela; eft
un .cheval de telle. Euftache l’exprime ainfi ntwc
» k«i nard /xôvaç ahavvo/j.tvoç., lin cheval fait , non
pour l’attelage , mais pour aller feul. z°. On çoù-
roit avec des poulains mçntés comme des chevaux
de telle; cette efpece de courte fut oii inftituéè ou
rétablie en la cent vingt-huitieme olympiade ; &
Tlépoleme de Lycie y remporta le prix. La troifie-
me forte étoit ce que l’on appélloit le Calpé; elle
confiftoit, félon Paufanias, à courre avec deux ju-
mens , dont on montoit l’une , & l’on menoit l’autre
en main. Sur la fin de la courte on te jettoit à terre,
on prenoit les deux jumêns par leurs mors , & l’on
achevoit ainfi la carrière.
Si les trois fortes dé courtes, dont nous avons
parlé, avoient chacune leurs différences, elles
avoient auffi plufieurs chofes qui leur étoient communes
; premièrement elles te faifoient toutes trois
fans étriers , dont l’invention eft fort poftérieure à
ces tems-là ; fecondement, danstoutes, les enfans
etoient admis à difputer le prix de même que les
hommes. Le fait èft certain pour les deux premières ;
à l’égard de la troifieme, on ne fauroit l’affurer faute
de preuves.
On fera peut-être curieux de favoir - à quel âge
le Grecs admettaient les enfans aux combats athlétiques;
c’étoit depuis douze ans jufqu’à feize & dix-
fept. En voici la p reuve, tirée du feul hiftorien qui
puiffe nous inftruire fur cette matière comme fur
beaucoup d]autres. « Phérias d’Egine, dit Paufanias,
» en la foixante-dix-huitieme olympiade , ayant
» paru trop jeune & trop foible pour foütenir le
» combat, n’y fut pas admis; mais, l’olympiade
» fuivante , il remporta le prix fur la jeuneffe,Hyl-
» lus de Rhodes fut rejetté par une raifon contraire ;
» à l’âge de dix-huit ans , il fe préfenta pour, com-
» battre dans la claffe des enfans ; on le jugea trop
» â g é , il combattit dans la claffe des hommes &
» fut couronné». Cependant Platon , dans fa République
, femble diftinguer trois fortes>de combattans:
les enfans , les jeunes gens qui avoient atteint l’âge
de puberté , & les hommes faits. Apparemment
que cela étoit ainfi de fon tems; mais Paufanias, qui
parle du fien , ne fait mention que de deux clafl'es.
Enfin , à toutes ces courtes, avant que d’achever
la carrière , il falloit tourner autour d’une borne
plantée dans un endroit fi terré, fi périlleux , que
quiconque n’étoit pas fort adroit, couroit rilque de
tomber
Vofhber de cheval, & dé perdre la victoire. J’ai cru
un tems , dit M.. I’abbé Gédoyn , que la néceffité
de tourner ainfi autour d’une borne, n’étoit que
pour les courfes de chats ; mais, la leCture de Paufanias
m’a détrompé, j’en puis citer un paffage qui
décide la queftion : « la càvüle de Phidcüas de.Co-
» rinthe mçrite .bien , dit-il ; que j ’en parle ; lesCo-
,, rinthiens la nomment Aura. Son maître étant tom-
■ » bé dès le commencement de la 'courte, cette ca-
9> vale courut toujours comme fi elle avoit été con-
» duite -, ton.rna à l’entour de la borne avec la
même adreffe, redoubla de force & de côurage
w au bruit de la trompette , paffa toutes les autres;
» & comme fi elle avoit fentji qu’elle <gagnoitla vic-
» toire , elle vint s’arrêter devant les juges ou di-
» reéteurs des jeux. Phidolas, proclamé vainqueur,
» obtint des Eléens d’ériger un monument où lui &c
»> la cavale fuffeat repréfentés *>.
On voit par ce paffage -, que fur la fin des courtes
le s trompettes jouoient des fanfhres pour animer les
tombattans ; mais, ce que l’on en peut conclure
«ncore , c’eft que le lieu où on couroit à cheval,
«toit différent au jeu où l’on couroit en chars. La
•même borne en effet ne pouvoit pas être également
périlleufe pour les courtes de chevaux & pour les
courfes de chars; un cheval paffe où un char ne
fauroit paffer. ,11 y avoit donc un lieu affeété à
chaque genre de courte ; le ftade fervoit pour les
courtes à pied , l’hippodrome fervoit pour les côur-
fes de chevaux, & il y avoit une lice particulière
pour les courfes de chars. On jugera aifément que
l ’hippodrome devoit être beaucoup plus long que le
ftade ; car , il n’étpit pas jufte d’affujettir les hom-
pnes & les chevaux à. fournir la même carrière. Aufti
Paufanias; d i t - il pofitivement que l’hippodrome
id’Ôlympie avoit deux ftades de long. (+ )
C h e v a u x d u C i r q .u e , (Hijl. anc. ) Il paroît
par les infcriptions qui nous relient, qu’on faifoit
autant d’honneur aux chevaux qui couroient dans le
cirque, qu’aux aurigés qui lés conduifoient. On leur
•érigeait des monumens ; on les gravoit fur des pierres
précieutes avec la palme , marque de leur vic-
loire à la courte. On gravoit fur de grandes tables
de marbre leurs noms, leur pays, la couleur de leur
poil.
Dans certaines infcriptioùs, les différentes cou-
leürs dé chevaux font marquées fur chacun, & ces
couleurs font telles: àlbus, blanc ; cinereus, cendré ;
badius , bai \ rufus , roux ; mqurus , maure ;fulvus,
fauve ; pullus , noirâtre ; kcejius ou coejîus. Ces couleurs
fe trouvent fouyent mêlées, rufus-coejius, niger-
cæjius. La patrie des chevaux eft,encore marquée
dans certaines infcriptions, L’Afrique en fourniffoit
plus que tous les autres pays : il y en avoit d’Ef-
pagne, des Gaules, de Mauritanie, de Lacédémone.
( - f )
C h e v a u x dufoléil-, ( Myth. ) Ovide les nomme
Eoiis, Pyroïs , A et on & Phlégon , noms grecs
dont l’étymologie marque la qualité. Ils font nommés
ailleurs Erythoïis ou le rouge, Acteon ou le lumineux,
Lampos o u le refplendiflant, & Philogeüs qui aimé
la terre. Le premier défigne le lever du foleil dont
les rayons font alors rougeâtres ; Aéléon marque le
tems où ces mêmes rayons, fortis dé l’atmofphere
font plus clairs, vers les neuf ou dix heures da-ma-
îin ; Lampos figure le midi où la lumiere du foleil eft
daps toute fa force ; & Philogeüs repréfente fon.cou-
ch er, lorsqu’il femble s’approcher de'la terre, ( - f)
C h e v a u x de Mars, ( Myth. ) Servius les nomme
Emo's & Phobos, la crainte & la terreur. Mais, dans
Homere, ce font-là les noms des cochers de Mars,
& non de {es chevaux..(+)
C h e v a u x de Laomédon,*( Myth y Hercule offrit
à Laomédop dç délivrer Héfioue. fa fillç, moyenhânt
un attelage de chevaux, que ce prince lui
promit. Ces chevaux ; difent les poètes, étoient li
légers qu’ils rUarchoient fur les eaux. (-{-)
C hevaux d'Ehée, ( Myth.) Ils étoient, dit Homere
, de la race de ceux, que Jupiter donna à Tros.,
lorfqu’il lui enleva fon fils Ganymede. Anchife , à
l’infçu de Laomédon, eut de la race de ces chevaux,
ayant fait mettre dans le haras du roi fes plus bellès
jumens, dont il vit naître fix chevaux dans fon palais,
Ils étoient parfaitement bien dreffés., pour les
batailles , & favoient répandre la terreur ôl ta fuite
.dans tous les rangs. (-+-) .
Chev au x d'Achille, (Myth.) Ils étoient immortels;,
dit Homere, ayant été èngendrés par le Zé-
phire & par la harpye Podarge \ ÔC te nommoièrît.
Balios & Xante. (+ )
. CHË VALET , en terme de Marine, eft une machine
avec un rouleau mobile , qui fert à pâffer les
cables d’un lieu à un autre; (-{-)
C hev alet ,i en terme d'Artificier, eft un poteait
que l’on plante en terre, ou qui eft foutenu fur terre
par trois ou quatre arcboutaiîs : il eft traverfé tout
en haut par une barre de fer plate & fur tranche,
fur laquelle on place les fuféés l’une après l’autre
pour les tirer. (+ )
Ch e v al e t du peintre', ( AJlr. ) conftellation méridionale
, qui contient 25 étoiles dans le Coelum
aujlrale de M. delà Caille, dont la plus belie <* n’eft
que de cinquième grandeur ; fon afcèrilîon droite
pour 1750 eft i i ° 38' 58" avec 30° 43' 3" dedéclin
naifon méridionale. ( M. d e l a La n d e . )
CHEVILLE, ( Luth. ) Dans les inftrumèns à cordes,
on appelle chevilles les morceaux de bois ou de
métal fur lefquels on roule les cordes, ôc qui fervent
à les accorder. {F. D . C.)
C heville de fer, ( Conjlruclion des vaif. ) Pour un
vaiffeau de cent trente-quatre pieds de long de l’étrave
à l’étambord, on doit donner aux chevilles de
fer deftinées à être mites dans le gros , un pouce
d’épais, & trois quarts de pouce pour celles qui font
employées au-deffus. On met huit chevilles de fer à
chaque écart de la quille , & on en fait paffer dans
l’étrave quatre ou cinq , ou davantage. A l’affem-
blage de la quille & de l’étambord, il y en doit avoir
fix qui paffent au travers de la quille, du contre-
érambord 6c de l’étambord. (-{-)
CHEVILLÉ ouvrière, ( Charon. ) c’eft le clou à têté
greffe & applatie, moyennant lequel oh unit l’avant
train au corps d’une voiture, ou de l’affût d’une
piece. (-h) • •
C heville de pompe, ( Marine.) C’eft une cheville
de fer mobile, qui fert à aflembler la bringuebale
avec la verge de pompe. Cheville de potence de pompe ,
ce font certaines chevilles de fer qui paffent dans les
deux branches de la pompe , & dont I’ufage eft de
tenir les bringuebales. Elles ont environ un pied de
longueur1. Chevilles à boucle, ce font des chevilles de
fer, là tête defquelles il y a une boucle. Chevilles a
grille.& à boucle, ce font des chevilles de fer en bois.
Chevilles à croc, ce font celles qui ont des crocs & qui
font aux côtés des. fabords, pour y amarfer les câ-
nons;elles font auflî de fer. Chevilles à tête de diamant
ou a tête ronde , ce font dés chevilles de fer, dont la
tête ne fauroit entrer dans le bois du vâîffeau, à Caufè
de fagroffeur. Chevilles à tête perdue, ce font d’autres
chevilles dont la tête entre dans le bois. Chevillés'à boucle
& d goupilles, pour aider à faire venir lés pièces
d’un vaiffeau, lorfqu’ôn les pote, dont les Hollan*
dois fie fervent au lieu d’antoit. Il y a encore dès
chevilles à goupilles, des chevilles de cadenes de haubans,
des chevilles'de bois pour lier les membres du
vaiffeau , & fiur-toutle bordage & le ferrage. (+ )
C heville dé affût, ( Artill. ) C ’eft une cheville de'
fer qui fait la iiaifôn de tout l’affût du canon qu’elle
D d d -