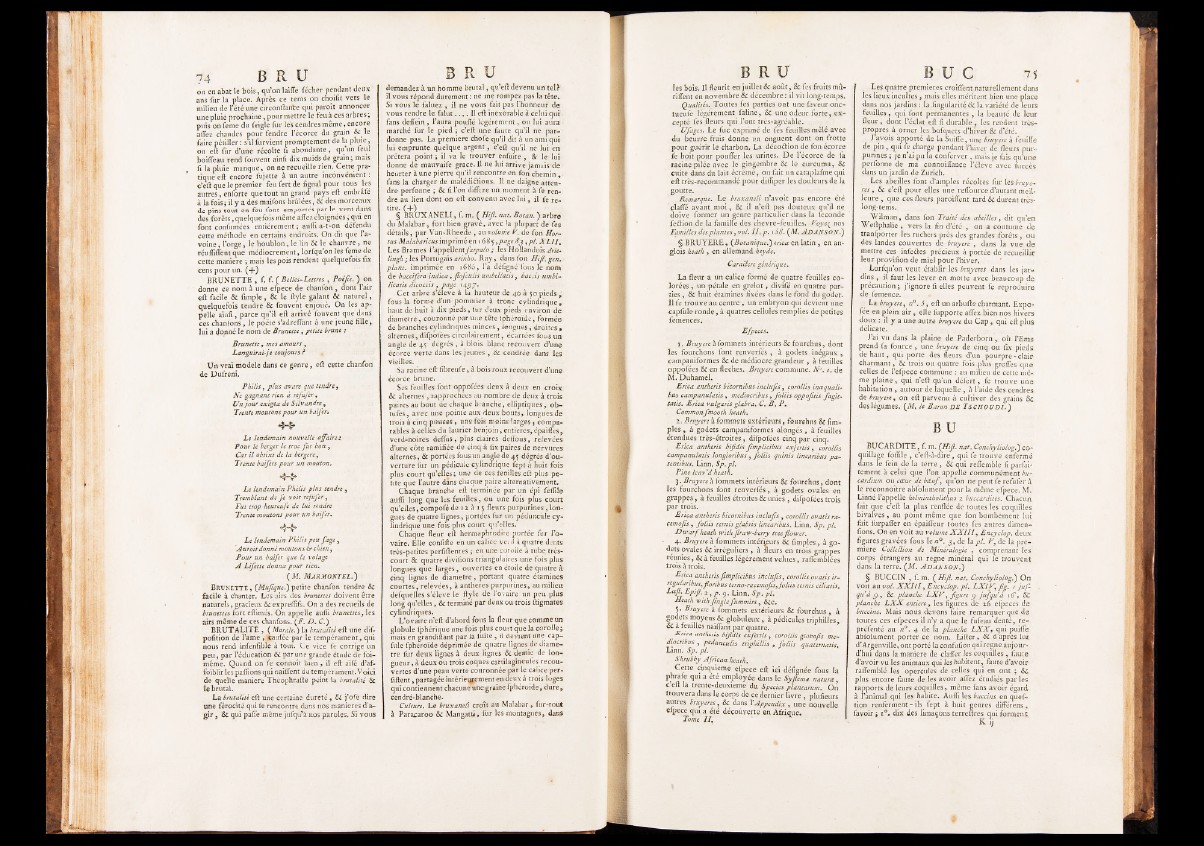
on en abat le bois, qu’on laiffe fécher pendant deux,
ans fur la place. Après ce teins on choilit vers le
milieu de l’été une circonftatlte qui paroit annoncer
une pluie prochaine, pour mettre le feu a ces arbres ;
puis onfeme du ieigle fur lés cendres même, encore
alfez chaudes pour fendre l’écorce du grain & le
faire pétiller : s’il furvient promptement de la pluie,
on eft fur d’une récolte fi abondante, qu’un feul
boiffeau rend fouvent ainfi dix muids de grain ; mais
fi la pluie manque, on ne recueille rien. Cette pratique
eft encore fujette à un autre inconvénient :
c’eft que le premier feu fert de fignal pour tous les
autres, enforte que tout un grand pays eft embrâfé
à la fois; il y a des maifons brûlées, 6c des morceaux
de pins tout en feu font emportés par le vent dans
des forêts, quelquefois même affez éloignées, qui en
font confumées entièrement ; aufli a-t-on défendu
cette méthode en certains endroits; On dit que l’avoine,
l’orge, le houblon, le lin 6c le chanvre, ne
réulfiffent que médiocrement, lorfqu’on les feme de
cette maniéré ; mais les pois rendent quelquefois fix
cens pour un. (-{-)
BRUNETTE , f. f. ( B elles-Lettres , Poéjie. ) on
donne ce nom à une efpece de chanfon , dont l’air
eft facile & fimple, 6c le ftyle galant & naturel,
quelquefois tendre 6c fouvent enjoué. On les appelle
ainfi, parce qu’il eft arrivé fouvent que dans
ces chantons , le poète s’adreffant à une jeune fille,
lui a donné le nom de Brunettey petite brune :
Brunet te, mes amours,.
Languir ai-je toujours ?
Un vrai modèle dans ce genre, eft cette chanfon’
de Dufreni.
Philis, plus avare que tendre ,
Ne gagnant rien à refufer,
Un jour exigea de Silvandre ,
Trente moutons pour un baifen
4 4 *
Le lendemain nouvelle affaire :
Pour le berger le troc fut bon ,
Car il obtint de la bergere,
Trente baifers pour un mouton.
4 4 »
Le lendemain Philis plus tendre ,
Tremblant de fe voir refufer,
Fut trop heureufe de lui rendre
Trente moutons pour un baifer.
•H *
Le lendemain Philis peu fage ,
Auroit donné moutons & chien ,
Pour un baifer que le volage
A Lifette donna pour rien.
(M. Ma RMONTEL.)
Brunette , (Mujique.) petite chanfon tendre &
facile à chanter. Les airs des brunettes doivent être
naturels, gracieux 8c exprelfifs. On a des recueils de
brunettes forteftimés. On appelle aufli brunettes, les
airs même de ces chantons. ('F. D. C.)
BRUTALITÉ , ( Morale, j la brutalité eft une dif-
pofition de l’ame , «aufée par le tempérament, qui
nous rend infenfible à tout. Ce vice fe corrige un
peu, par l’éducation 6c par une grande étude de foi-
même. Quand on fe connoît bien , il eft aifé d’af-
foiblir les paflions qui naiffent du tempérament. Voici
de quelle maniéré Théophralte peint la brutalité 6c
le brutal.
La brutalité eft une certaine dureté, 6c j’ofe dire
une férocité qui le rencontre dans nos maniérés d’ar-
g i r , 6c qui paffe même jufqu’à nos paroles. Si vous
demandez à un homme brutal, qu’eft devenu un tel?
il vous répond durement : ne me rompez pas la tête.
Si vous le faluez , il ne vous fait pas l'honneur de
vous rendre le falut. . . . Il eft inexorable à celui qui
fans deffein , l’aura pouffé légèrement, ou lui aura
marché fur le pied ; c’eft une faute qu’il ne pardonne
pas. La première chofe,qu’il dit à un ami qui
lui emprunte quelque argent, c’eft qu’il ne lui en
prêtera point ; il va le trouver enfuite , & le lui
donne de mauvaife grâce. Il ne lui arrive jamais de
heurter à une pierre qu’il rencontre en ton chemin ,
fans la charger de malédiâions. Il ne daigne attendre
perfonne ; & fi l’on différé un moment à fe rendre
au lieu dont on eft convenu avec lu i, il fe retire.
(+ )
§ BRUXANELI, f. m. ( Hiß. nat. Botan. ) arbre
du Malabar, fort bien gravé, avec la plupart de fes
détails; par Van-Rheede , au volume V, de ton Hor-
tus Malabaricus imprimé en 168 5, page 83, pi. X L I I .
Les Brames l’appellentfarpalo; les Hollandois
lingh ; les Portugais arinho. Ray, dans ton Hift.gen.
plant, imprimée en 1686, l’a défignéfous le nom
de baccifera indica, flofeulis umbellatis , baeùs umbilicalis
dicoccis , page iq£)p.
Cet arbre s?éleve à la hauteur de 40 à 50 pieds
fous la forme d’un pommier à tronc cylindrique,
haut de huit à dix pieds, fur deux pieds environ de
diamètre, couronné par une tête lphéroïde, formée
de branches cylindriques minces, longues, droites ,
alternes, dîfpofées circulairement, écartées fous un
angle de 45 dégrés , à blois bfenc recouvert d’une
écorce verte dans les jeunes , 6c cendrée dans les
vieilles.
Sa racine eft fibreufe, à bois roux recouvert d’une
écorCe brune.
Ses feuilles font oppofées deux à deux en croix
& alternes ,rapprochées au nombre de deux à trois
paires au bout de chaque branche, elliptiques, ob-
tufes, avec une pointe aux deux bouts, longuésde
trois à cinq pouces, une fois moins larges ; comparables
à celles du laurier benjoin, entières, épaiffes,
verd-noires deffus, plus claires deflbus, relevées
d’une côte ramifiée de cinq à fix paires de nervures
alternes, & portées fous un angle de 45 dégrés d’ouverture
fur un pédicule cylindrique fept à huit fois
plus court qu’elles ; une de ces feuilles eft plus petite
que l’autre dans chaque paire alternativement.
Chaque branche eft terminée par un épi feflîle
aufli long que les feuilles, ou une fois plus court
qu’elles, compofé de 12 à 15 fleurs purpurines, longues
de quatre lignes, portées fur un pédunciile cylindrique
une fois plus court qu’elles.
Chaque fleur eft hermaphrodire portée fur l’ovaire.
Elle confifte en un calice verd à quatre dents
très-petites perfiftentes ; en une corolle à tube très-
court & quatre divifions triangulaires une fois plus
longues que larges, ouvertes en étoile de quatre à
cinq lignes de diamètre, portant quatre étamines
courtes, relevées, à anthères purpurines, au milieu
defquelles s ’élève le ftyle de l’ovaire un peu plus
long qu’elles, 6c terminé par deux ou trois ftigmates
cylindriques.
L’ovaire n’eft d’abord fous la fleur que comme un
globule fphérique une fois plus court que la corolle;
mais en grandiffant par la fuite, il devient une cap-
fule fphéroïde déprimée de quatre lignes de diamètre
fur deux lignes à deux lignes 6c demie de longueur
, à deux ou trois coques cartilagineufes recouvertes
d’une peau verte couronnée par le calice per-
fiftent, partagée intérieurement en deux à trois loges
qui contiennent chacunëune graine fphéroïde, dure,
cëndré-blanche.
Culture. Le bruxaneli croît au Malabar, fur-tout
à Paracaroo 6c Mangatti, fur les montagnes, dans
les bois. Il fleurit en juillet 6c août, & fes fruits mû-
riffent en novembre 6c décembre : il vit long-temps.
Qualités. Toutes (es parties ont une faveur onc-
tueufe légèrement faline, 6c une odeur forte, excepté
fes fleurs qui l’ont très-agréable.
Ufages. Le fuc exprimé de fes feuilles mêlé avec
du beun*e frais donne un onguent dont on frotte
pour guérir le charbon. La décoâion de ton écorce
fe boit pour pouffer les urines. De l’écorce de fa
racine pilée avec le gingembre 6c le curcuma, 6c
cuite dans du lait écrémé, on fait un cataplafme qui
eft très-recommandé pour diflïper les douleurs de la
goutte.
Remarque. Le bruxaneli n’avoit pas encore été
clafle avant,moi, & il n’eft pas douteux qu’il ne
doive former un genre particulier dans la fécondé
fefHon.de la famille des chevre-feuilles. Foye^ nos
Familles des plantes, vol. II. p. ÎS8. (M. A d a n so n .')
§ BRUYERE, ( Botanique.) erica en latin , en an-
glois heath , en allemand.heyde.
Caractère générique.
La fleur a un calice formé de quatre feuilles co*
lorées, un pétale en grelot, divifé en quatre parties
, 6c huit étamines fixées dans le fond du godet.
Il fe trouve au centre , un embryon qui devient une
capfule ronde, à quatres cellules remplies de petites
femences.
Efpeces.
1. Bruyere à fommets intérieurs 6c fourchus, dont
les fourchons font renverfés , à godets inégaux ,
campaniformes 6c de médiocre grandeur , à feuilles
oppofées 6c en fléchés. Bruyere commune. N°. /. de
M. Duhamel.
Erica antheris bicornibus inclujis, corollis incequali-
bus campanulatis, mediocribus, foliis oppojîtis fagit-
tatis. Erica vulgaris glabra. C. B. P.
Commonfmootk heath.
2. Bruyere à fommets extérieurs, fourchus & fim-
ples , à godets campaniformes alongés , à feuilles
étendues très-étroites, difpofées cinq par cinq.
, Erica antheris bifidis Jimplicibus exfertis, corollis
campanulatis longioribus , foliis quinis linearibus pa-
tentibus. Linn. Sp.pl.
Pine leav’d heath.
3. Bruyere à fommets intérieurs 6c fourchus, dont,
les fourchons font renverfés, à godets ovales en
grappes, à feuilles étroites 6c unies, difpofées trois
par trois.
Erica antheris bicornibus inclujis, corollis ovatis ra-
cemojis, foliis ternis glabris linearibus. Linn. Sp. p l.
Dwarf heath with Jtraw-berry tree flower.
4. Bruyère à fommets intérieurs 6c Amples, à godets
ovales 6c irréguliers , à fleurs en trois grappes
réunies, 6c à feuilles légèrement velues, raffemblées
trois à trois.
Tegulanbus, fioribus terno-racemojis, foliis ternis ciliatis,
Lcefi. Epiji. z , p. c). Linn, Sp. p l.
Heath with Jingle fummits, 6cc.
5. Bruyere à fommets extérieurs 6c fourchus , à
moyens 8c globuleux, à pédicules triphilles,
& a feuilles naiffant par quatre.
Erica antheris bifidis exfertis, corollis globojîs mediocribus
, pedunculis triphillis , foliis quaternatis.
Linn. Sp. pl.
, Shrubby African heath.
Cette , cinquième efpece eft ici défignée fous la
phrafe qui a ete employée dans le Syficm* nalum,
c eft la trente-deuxieme du Species plantarum. On
trouvera dans le c o t a de ce dernier liv re, plufieurs
autres bruytrts, & dans TAppendix , une nouvelle
elpece qui a été découverte en Afrique,
Tome IL,
Les quatre premières croiffent naturellement dans
les lieux incultes, mais elles méritent bien une place
dans nos jardins : la Angularité & la. variété de leurs
feuilles, qui font permanentes , la beauté de ieur
.fleur , dont l’éclat eft fi durable , les rendent très-
propres à orner les bofquets d’hiver 6c d’été.
j avois apporte de la Suiffe, une bruyère à feuille
de pin , qui fe charge pendant l’hiver de fleurs purpurines
; je n’ai pu la conferver , mais je fais qu’une
perfonne de ma connoiffance l’éleve avec fuccès
dans un jardin de Zurich.
Les abeilles font d’amples récoltes fur les-bruye-
rcs , 6c c’eft pour elles une,reffource d’autant meilleure
, que ces fleurs paroiflent tard 6c durent très-
long-tems.
Wilman, dans ton Traité des abeilles, dit qu’en
Weftphalie , vêts la fin d’été , on a coutume de
tranfporter les ruchers près des grandes forêts, ou
des landes couvertes de bruyere , dans la vue de
mettre ces infe&es précieux à portée de recueillir
leur provifion de miel pour l’hiver.
Lorfqu’on veut.établir les bruyères dans les jar-*
dins , il faut les lever en motte avec beaucoup de
précaution ; j’ignore fi elles peuvent fe reproduire
de femence.
La btuyerey n°. 5 , eft un arbufte charmant. Expo-
fée en plein air , elle fupporte affez bien nos hivers
doux : il y a une autre bruyere du Cap , qui eft plus
délicate.
J’ai vu dans la plaine de Paderborn, où l’Ems
prend fa fource , une bruyere de cinq ou fix pieds
de haut, qui porte des fleurs d’un pourpre - clair
charmant, 6c trois ou quatre fois-plus greffes'que
celles de l’efpece commune : au milieu de cette mê-
■ me plaine, qui n’eft qu’un défert, fe trouve une
habitation , autour de laquelle , à l’aide des cendres
de bruyere, on eft parvenu à cultiver des grains 6c
des légumes. (M. le Baron de Tsch o ü d i. )
B U
BUCARDITE, f. m. (Hijl. nat. Conchyliolog.) coquillage
foflile , c’eft-à-dire, qui fe .trouve enfermé
dans le fein de la terre, 6c qui reffemble fi parfaitement
à celui que l’on appelle communément bu-
edrdium ou coeur dé boeuf, qu’on rte peut fe refufer à
le reconnoître abfolument pour la même efpece. M.
Linné l’appelle helmintholithus 2 buccardites. .Chacun
fait que c’eft la plus renflée de toutes les coquilles
bivalves, au point même que ton bombement lui
fait furpaffer en épaiffeur toutes fes autres dimen-
fions. On eii voit au volume X X I I I , Encyclop. deux
figures gravées fous le nQ. 3 , de la pl. V, de la première
Collection de Minéralogie , comprenant les
corps étrangers au régné minéral qui fe trouvent
dans la terre. (M. ADAtiSoiïi)
§ BUCCIN , f. m. ( Hijl. nat. Conchyliolog.) On
voit au vol. X X I I I , Encyclop. p l. LXljffy fig. 1 juf- .
qu a g y & planche L X V , figure 0 jufqu à id , Sc
planche L X X entière, les figures dë 26 efpeces de
buccins. Mais no,us devons faire remarquer que de
toutes ces efpeces il n’y a que le fufeau denté, re-
préfenté au n°. 4 de la planche L X X , qui puifle
abfolument porter ce nom. Lifter, & d’après lui
d’Argenville, ont porté lacqnfufion qui régné aujourd’hui
dans la maniéré de claffer les coquilles , faute
d’avoir vu les animaux qui les habitent, faute d’avoir
raffemblé les opercules de celles qui en ont ; 6c
plus encore faute de les avoir affez étudiés par les
rapports de leurs coquilles, même fans avoir égard
à l’animal qui les habite. Aufli les buccins en quef*»
tion renferment - ils fept à huit genres différens ,
fa voir; i° . dix des limaçons terreftres qui forment
K ij