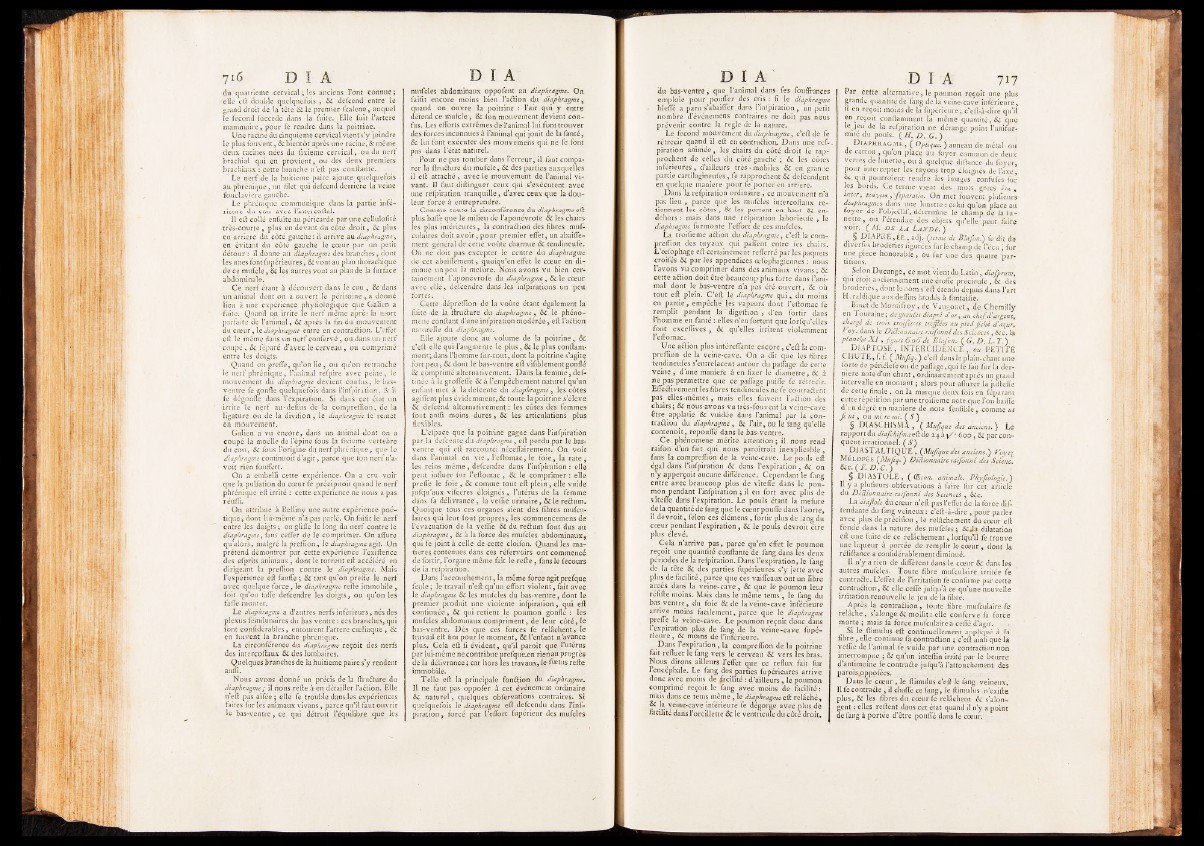
du quatrième cervical ; les anciens l’ont connue ;
«lie efl double quelquefois , 8c defcend entre le
grand droit de 1a tête 8c le premier fcalene, auquel
le fécond fuccede dans la fuite. Elle fuit l’artere
mammaire, pour fe rendre dans la poitrine.
Une racine du cinquième cervical vient s’y joindre
le plus fouvent, & bientôt après une racine, & même
deux racines nées du fixieme cervical, ou du nerf
brachial qui en provient, ou des deux premiers
brachiaux : cette branche n’efl pas confiante.
Le nerf de la huitième paire ajoute quelquefois
au phrénique, un filet qui defcend derrière la veine
fouclaviere gauche.
Le phrénique communique dans la partie infé^
rieure du cou avec l’intercoflal.
Il efl collé enfuite au péricarde par une cellulofité
très-courte , plus en devant du côté droit, 8c plus
en arriéré du côté gauche : il arrive au diaphragme,
en évitant du côté gauche le coeur par un petit
détour : il donne au diaphragme des branches, dont
les unes font fupérieures, & vont au plan thorachique
de ce mufcle, 8c les autres vont au plan de la furface
abdominale.
Ce nerf étant à découvert dans le cou , 8c dans
un animal dont on a ouvert le péritoine , a donné
lieu à une expérience phyfiologique que Galien a
Faite. Quand on irrite le nerf même après la mort
parfaite de l’animal, 8c après la fin du mouvement
du coeur, le diaphragme entre en contraflion. L’effet
efl le même dans un nerf confervé, ou dans un nerf
coupé, 8c féparé d’avec le cerveau , ou comprimé
entre les doigts.
Quand on preffe, qu’on lie , ou qu’on -retranche
le nerf phrénique, l’animal refpire avec peine, le
mouvement du diaphragme devient confus, le bas^ ,
ventre fe gonfle quelquefois dans l’infpiration, & il
fe dégonfle dans l’expiration. Si dans cet état on
irrite le nerf au-deffus de la compreflion, de la
ligature ou de la divifion, le diaphragme fe remet
en mouvement.
Galien a vu èncore, dans un animal dont on a
coupé la moelle de l’épine fous la fixieme vertebre
du cou, 8c fous l’origine du nerf phrénique, que le
diaphragme continuoit d’agir, parce que ion nerf n’a-
voit rien fouffert.
On a embelli cette expérience. On a cru voir
que la pulfation du coeur fe précipitoit quand le nerf
phrénique efl irrité : cette expérience ne nous a pas
réufli.
On attribue à Belliny une autre expérience poétique,
dont lui-même n’a pas parlé. On faifit le nerf
entre les doigts ; on gliffe le long du nerf contre le
diaphragme, fans ceffer de le comprimer. On allure
qu’alors, malgré la preffion, le diaphragme agit. On
prétend démontrer par cette expérience l’exiflence
des efprits animaux, dont le torrent efl accéléré en
dirigeant la preffion contre le diaphragme. Mais
l’expérience efl fauffe ; 8c tant qu’on preffe le nerf
avec quelque force, le diaphragme refie immobile ,
foit qu’on faffe defcendre les doigts, ou qu’on les
fa fie monter.
Le diaphragme a d’autres nerfs inférieurs, nés des
plexus femilunaires du bas ventre: ces branches, qui
font confidérables, entourent l’artere coeliaque, 8c
en fuivent la branche phrénique.
La circonférence du diaphragme reçoit des nerfs
des intercoflaux 8c des lombaires.
Quelques branches de la huitième paire s’y rendent
auffi. .
Nous avons donné un précis de la flruélure. du
diaphragme ; il nous refie à en détailler l’a dion. Elle
n’efl pas aiféé ; elle fe trouble dans les expériences
faites fur les animaux vivans, parce qu’il faut ouvrir
le bas-ventre, ce qui détruit l’équilibre que les
mufcles abdominaux oppofent au diaphragme. On
faifit encore moins bien l’a&ion du diaphragme,
quand on ouvre la poitrine : l’air qui y entre
détend ce mufcle, 8c fon.mouvement devient confus.
Les efforts extrêmes de l’animal lui font trouver
des forces inconnues à l’animal qui jouit de la fanté,
8c lui font exécuter des mottvemens qui ne fe font
pas dans l’état naturel.
Pour ne pas tomber dans l’erreur, il faut comparer
la flrudure du mufcle, & des parties auxquelles
il efl attaché , avec le mouvement de l’animal vivant.
Il faut diflinguer ceux qui s’exécutent « avec
une refpiration tranquille, d’avec ceux que la douleur
force à entreprendre.
Comme toute la circonférence du diaphragme efl
plus baffe que le milieu de l’aponévrofe & les'chairs
les plus intérieures, la contraction des fibres muf-
culaires doit avoir, pour premier effet, un abaiffe-
ment général de cette voûte charnue 8c tendineufe.
On ne doit pas excepter le centre du diaphragme
de cet abaiffement, quoiqu’en effet le coeur en diminue
un peu la mefure. Nous avons vu bien certainement
l’aponévrofe du diaphragme, 8c le coeur
avec elle , defcendre dans les infpirations un peu
fortes. ,
Cette dépreffion de là voûte étant également la
fuite de la ftruCture du diaphragme, 8c le phénomène
confiant d’une infpiration modérée, efl l’aétion
naturelle du diaphragme.
Elle ajoute donc au volume de la poitrine, 8c
c’efl elle qui l’augmente le plus, 8c le plus confiant*
ment; dans l’homme fur-tout, dont la poitrine s’agitç
fort peu, 8c dont le:bas-ventre eflviliblementgonflé
8c comprimé alternativement. Dans la femme, def-
tinée à la groffeffe 8c à l’empêchement naturel qu’un
enfant met à la defcente du diaphragme, les côtes
agiffent plus évidemment, 8c toute la poitrine s’élève
8c defcend alternativement : les côtes des femmes
font auffi moins dures , 8c les articulation^ plus
flexibles.-.
L’efpace que la ‘poitrine gagne dans l’infpiration
par la defcente du diaphragme, efl perdu par le bas-
ventre qui efl raccourci néceffairement. On voit
dans l’animal en v ie , l’eflomac, le foie, la ra te ,
les reins même, defcendre dans l’infpiration : elle
peut influer fur l’eflomac , 8c le comprimer : elle
preffe le foie , 8c comme tout efl plein, elle vuide
jufqu’aux vifceres éloignés , l’utérus de la femme
dans fa délivrance , la veffie urinaire, 8c lereCtum.
Quoique tous ces organes aient des fibres mufcur
laires qui leur font propres, les commencemens de
l’évacuation de la veffie 8c du reCtum font dus au
diaphragme, 8c à la force des mufcles abdominaux f
qui fe joint à celle de cette cloifon. Quand les ma-
-tiere^ contenues dans ces réfervoirs ont commencé
de fortir, l’organe même fait le refie , fans le fecours
de ia. refpiration.
Dans l’accouchement, la même force agit prefque
feule; le travail n’efl qu’un effort violent, fait avec
le diaphragme 8c les mufcles du bas-ventre, dont le
premier produit une violente infpiration, qui efl
continuée, 8c qui retient le poumon gonfle : les
mufcles abdominaux compriment,de leur côté, le
bas-ventre. Dès que ces forces fe relâchent, le
travail efl fini pour le moment, 8c l’enfant n’avance
plus; Cela efl fi évident, qu’il paroît que l’utérus
par lui-même ne contribue prefqueoen rien au progrès
de la délivrance ; car hors les travaux, le foetus refie
immobile.
Telle efl la principale fonCtion du diaphragme.
Il ne faut pas oppofer à cet événement ordinaire
8c naturel, quelques obfervations contraires. Si
quelquefois le diaphragme efl descendu dans l’in fpiration
, forcé par l’effort fupérieur des mufcles
idu bas-ventre, que l’animal dans fes fouffrances
emploie pour pouffer des cris : fî le diaphragme
, bleffé.a paru s’abaiffer dans l’infpiration , un petit
nombre d’événemens contraires ne doit pas nous
prévenir contre la réglé de la nature.
Le fécond mouvement du diaphragme, c’efl de fe
rétrécir quand il efl en contraClioq, Dans une ref-,
piratiôn animée, les chairs du côté droit fe rapprochent
de celles du côté gauche* ; & les côtes
inférieures , d’ailleurs très- mobiles & en grande
partie càrtilagineufes, fe rapprochent 8c defcendent
.en quelque maniéré pourfe porter en arriéré.
Dans la refpiration ordinaire , ce mouvement n’a
pas lieu » parce que les mufcles intercoflaux retiennent
les côtes, & les portent en-haut 8c en-
dehors : mais dans une refpiration laborieufe , le
diaphragme furmontë l ’effort de ces mufcles.
La troifieme aCtion du diaphragme, c’efl la çom-
preffion des tuyaux qui paffent entre fes chairs.
L ’oefophage efl certainement refferré par les paquets
croifés 8c par les appendices oefophagiennes : nous
l’avons vu comprimer dans des animaux vivans ; &
cette aCtion doit être beaucoup plus forte dans l’animal
dont le bas-ventre n’a pas été ouvert, 8c où
tout efl plein. C’efJ le diaphragme q u i, du moins
en partie, empêcqk les vapeurs dont Peflomac fe
remplit pendant Ia*'digeflion , d’en fortir dans
l’homme en fanté : elles n’en fortent que lorfqu’elles
font excefîives , 8c qu’elles irritent violemment
l’eftomac.
Une aCtion plus intéreffante encore, c’efl la com-
preffion de la veine-cave. On a dit que les fibres
tendineufes s’entrelacent autour du paffage de cette
veine , d’une maniéré à en fixer le diamètre, 8c à
ne pas permettre que ce paffage puiffe fe rétrécir.
Effectivement les fibres tendineufes.ne fe contrarient
pas elles-mêmes, mais elles fuivent 1’aCtion des
chairs; 8c nous-avons vu très-fouvent la veine-cave
être applatie 8c vuidée dans l’animal par la contraction
du diaphragme y 8c l’air, ou le fang qu’elle
contenoit, repouffé dans le bas-ventre.
Ce phénomène mérite attention ; il nous rend
raifon d’un fait qui nous paroîrroit inexplicable,
fans la compreflion de la veine-cave. Le pouls efl
égal dans l’infpiration 8c dans l’expiration, 8c on
n’y apperçoit aucune différence. Cependant le fang
entre avec beaucoup plus de vîteffe dans le poumon
pendant l’infpiration ; il en fort avec plus de
vîteffe dans l’expiration. Le pouls étant la mefure
de la quantité de fang que le coeur pouffe dans l’aorte,
il devroit, félon ces élémens , fortir plus de fang du
coeur pendant l’expiration, & ie pouls devroit être
plus, élevé.
Cela n’arrive pas, parce qu’en effet le poumon
reçoit une quantité confiante de fang dans les deux
périodes de la refpiration. Dans l’expiration, le fang
de la tête 8c des parties fupérieures s’y jette avec
plus de facilité, parce que ces vaiffeaux ont un libre
accès dàns la veine-cave, & que Iè poumon leur
rélifte moins. Mais dans le même tems , le fang du
bas-ventre, du foie 8c de la veine-cave inférieure
arrive moins facilement, parce que le diaphragme
preffe la veine-cave. Le poumon reçoit donc dans
l’expiration plus de fang de la veine-cave fupé-
rieure, & moins de l’inférieure.
Dans l’expiration, la compreflion de la poitrine
fait refîner le fang vers le cerveau 8c vers les bras.
Nous dirons ailleurs l’effet que ce reflux fait fur
l’encéphale. Le fang des parties fupérieures arrive
donc avec moins de facilité : d ’ailleurs, le poumon
comprimé reçoit le fang avec moins de facilité':
mais dans ce tems même, le diaphragme efl relâché,
oc la veine-cave inférieure fe dégorge avec plus de
facilité dans l’oreillette & le ventricule dit côté droit.
Par cette alternative , le poumon reçoit une plus
grande quantité de fang de la veine-cave inférieure,
i ^ en reçoit moins de la fupérieure ; c’eft-à-dire qu’il
en reçoit conflamment la même quantité, & que
le jeu de la refpiration ne dérange point l’unifor-
mite du pouls.. ( H. D . G .)
D iaphragme, ( Optique. ) anneau de métal ou
de carton , qu’on place au foyer commun de deux
verres de lunette, ou à quelque diftance du foyer,
pour intercepter les rayons trop éloignés de l’axe,
8c qui pourroîent rendre les images confufes fur
l.es bords,-Ce terme vient des- mots grecs fia. ,
inter 1 rp^dy/aa. ffeparatio. On met .fouvent plùfîeurs
diaphragmes dans une lunette : celui qu’on place au
foyer de l’objeCtjf,détermine le champ de la lunette
, ou l’étendue des objets qu’elle peut faire
voir. ( M . d e l a La n d e . ) J
§ DIAPRÉ,ÉE , adj. (terme de Blafon.) fe dit de
diverfes broderies figurées furie champ de -l’écu j fur
une pièce honorable, ou fur une des quatre par»
titionsï. r
Selon Ducange, ce mot vient du Latin , diafprum,
qui étoit anciennement une étoffe précieufe , 8c des
broderies, dont le noms’efl étendu depuis dans l’art
Héraldique auxdeffins brodés à fantaifie.
Binet de Montifroy, de Vaugonet', de Çhemilly
en Touraine; de gueules diapré d'or, au chef d'argent,
chargé de trois croifettes tréfilées au pied, fiché d'azur.
Voy. dans le Dictionnaire raifonné des Sciences, 8 cc. la
planche X I , figure 6 o fd e Blafon. ( G. D. L. T. )
DIAPTOSE, INTERCIDENCE , 0«. PETITE
CHUTE, f. f. ( Mujiq.fi) c’efl dans le plain-chant une
forte de perielefe.ou de paffage,qui fe fait fur la dernière
note d’unchant, ordinairement après un grand
intervalle en montant ; alors pour affurer la julleffe
de cette finale , on la marque deux fois en féparant
cette répétition par une troifieme note que l’on baiffe
d’un dégré en maniéré de note fenfible, comme ut
Ji.ut, ou mi re mi. ( S )
§ DIASCHISMA , ( Mufique des anciens. ) Le
rapport du diafchijmaeiIde 24 à \/- 600, 8c par con-
quent irrationnel.; ( S)
D 1ASTAL TIQUE, (Mujiq ue des anciens.) Voyeq_
MÉLOPÉE (Mùjiq. ) DiHionnaire raifonné des Scierie.
8 cc. ( F D.C. )
§ DIASTOLE , ( QEcon. animale. Phyfiologie.fi
Il y a plufieurs obfervations à faire fur cet article
du Dictionnaire raifonné des Sciences , 8 cc.
La diaflole du coeur n’efl pas l’effet de la force distendante
du fang veineux : c’efl-à-dire , pour parler
avec plus de précifion , le relâchement du coeur efl
fondé dans la nature des mufcles ; 8c Ja dilatation
efl une fuite de ce-relâchement, lprfqu’il fe trouve
une liqueur à portée de remplir le coeur , dont la
réfiflance a confidérablementdiminué.
Il n’y a rien de différent dans le coeur & dans les
autres mufcles. Toute fibre mufculaire irritée fe
contraâe. L’effet de l’irritation fe confume par cette
contr^âion, 8c elle ceffe jufqu’à ce qu’une nouvelle
irritation renouvelle le jeu. de la fibre.
Apres la confraélion, .toute fibre mufculaire fe
relâche,- .s’alonge & mollit : elle conferve fa force
morte ; mais fa force mufculaire a eeffé d’agir.
. Si le (limulus efl continuellement appliqué à la
fibre; ,.elle continue facontraûion ; c’efl ainfi que la
veffie de l’animal fe vuide par une contraction non
interrompue ; & qu’un inteflin irrité par le beurre
d’antimoine fe contracte jufqu’à l’attouchement des
parois^oppçfées;
Dans ,1e coeur , le flimulus c’efl Je fang veineux.
Il fe contracte , il chaffe çe fang, le flimulus m’exifle
plus, 8c les fibres du coeur fe relâchent 8c s’alon-.
gent : elles refient dans ce:t état quand il n’y a point
de fang à portée d’être 'pouffé dans lg coeur.: