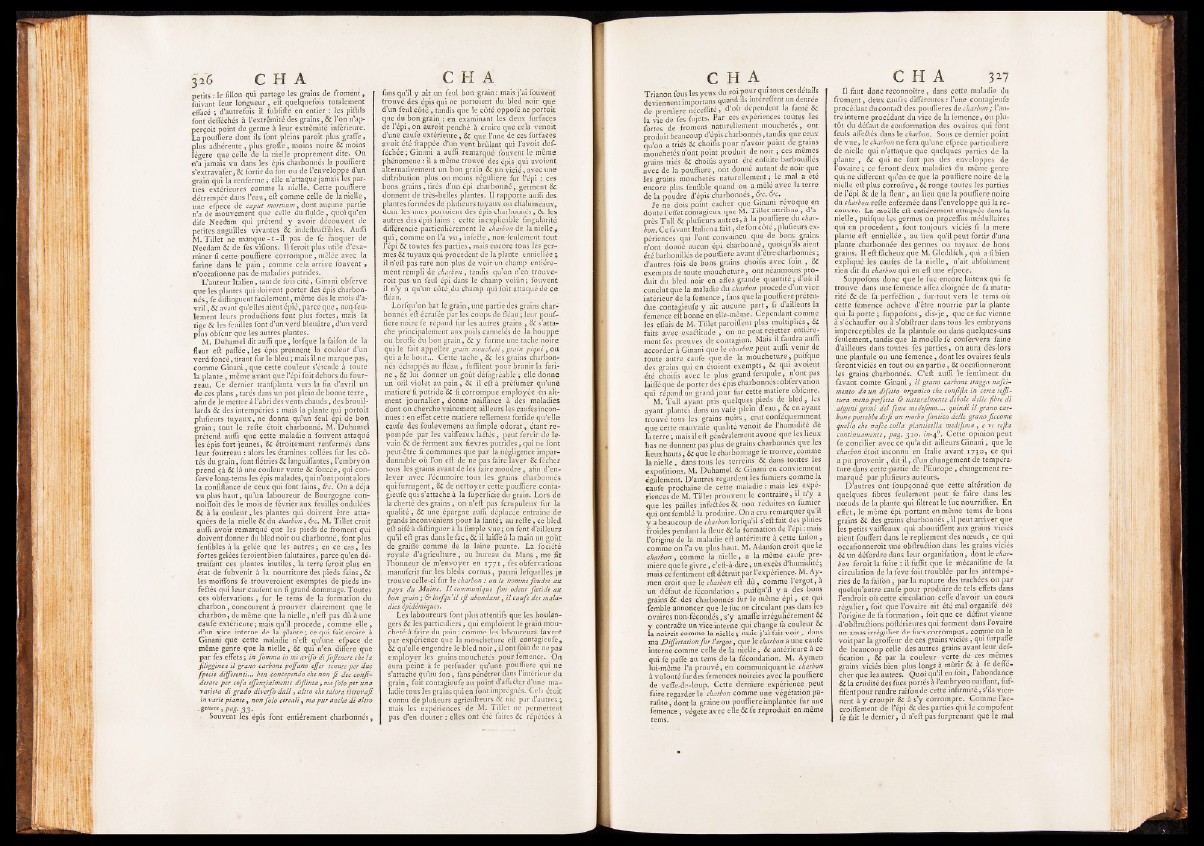
petits : le fillon qui partage les grains de froment,
luivant leur longueur, eft quelquefois totalement
effacé ; d’autrefois il fubfifte en entier : les piftils
font defféchés à l’extrémité des grains, 6c l’on n’ap-
perçoit point de germe à leur extrémité inférieure.
La poùffiere dont ils font pleins paroît plus grafle,
plus adhérente, plus grofl'e, moins noire 6c moins
légère que celle de la nielle proprement dite. On
n’a jamais vu dans les épis charbonnés la poufliere
s’extravafer, 6c fortir du fon ou de l’enveloppe d un
grain qui la renferme ; elle n’attaque jamais les parties
extérieures comme la nielle. Cette poufliere
détrempée dans l’eau, efl comme celle de la n ielle,
une efpece de caput mortuum, dont aucune partie
n’a de mouvement que celle du fluide, quoi qu’en
dife Needam qui prétend y avoir découvert de
petites anguilles vivantes 6c indeftruûibles. Aufli
M. Tillet ne manque - t - i l pas de fe moquer de
Needam 6c de fes vifions. Ilferoitplus utile d’examiner
fi cette poufliere corrompue, mêlée avec la
farine dans le pain, comme cela arrive fouvent >
n’occafionne pas de maladies putrides.^
L’auteur Italien, tant de fois cit'é, Ginani obferve
que les plantes qui doivent porter des épis charbon-
nés, fe diftinguent facilement, même dès le mois d’avril
, 6c avant quelles aient épié, parce que, non-feulement
leurs produûions font plus fortes, mais la
tige & les feuilles font d’un verd bleuâtre, d’un verd
plus obfcur que les autres plantes.
M. Duhamel dit aufli que, lorfque la faifon de la
fleur eft paffée,les épis prennent la couleur d’un
verd foncé, tirant fur le bleu ; mais il ne marque pas,
comme Ginani, que cette couleur s’étende à toute
la plante, même avant que l’épi foit dehors du fourreau.
Ce dernier tranfplanta vers la fin d’avril un
de ces plans , tarés dans un pot plein de bonne terre,
afin de le mettre à l’abri des vents chauds , des brouillards
6c des intempéries : mais la plante qui portoit
plufieurs tuyaux, ne donna qu’un feul epi de bon
grain ; tout le refte étoit charbonné. M. Duhamel
prétend aufli que cette maladie a fouvent attaqué
les épis fort jeunes, 6c étroitement renfermés dans
leur fourreau : alors les étamines collées fur les côtés
du grain, font flétries & languiflantes, l’embryon
prend çà 6c là une couleur verte & foncée, qui conserve
long-tems les épis malades, qui n’ont point alors
la confiftance de ceux qui font fains, &c. On a déjà
vu plus haut, qu’un laboureur de Bourgogne con-
noiflbit dès le mois de février aux feuilles ondulées
& à la couleur, les plantes qui doivent être attaquées
de la nielle 6c du charbon, &c. M. Tillet croit
aufli avoir remarqué que les pieds de froment qui
doivent donner du bled noir ou charbonné, font plus
fenfibles à la gelée que les autres ; en ce cas, les
fortes gelées feroientbien falutaires, parce qu’en dé-
truifant ces plantes inutiles, la terre feroit plus en
état de fubvenir à la nourriture des pieds fains, 6c
les moiflons fe trouveroient exemptes de pieds in-
fe&és qui leur caufent un fi grand dommage. Toutes
ces obfervations, fur le tems de la formation du
charbon, concourent à prouver clairement que le
charbon, de même que la nielle, n’efi pas dû à une
caufe extérieure ; mais qu’il procédé, comme elle ,
d’un vice interne de la plante; ce qui fait croire à
Ginani que cette maladie n’eft qu’une efpece de
même genre que la nielle, 6c qui n’en différé que
par fes effets ; in fomma io mi avifo di foflenere chc La
filigginee il grano carbone poffano effer tenute per due
fpecie différend... ben concependo che non (i dee confi-
derare per cofa effenfialmente difiinta , ma folo per una
varieta di grado diverfo dall, altro che talora ritrovaji
in varie piante, non Jolp cereali, ma pur anche di altro
.généré, pag. 33^ _
Souvent les épis font entièrement charbonnés,
fans qu’il y ait un feul bon grain : mais j’ai fouvent
trouvé des épis qui ne portoient du bled noir que
d’un feul c ô té , tandis que le côté oppofé ne portoit
que du bon grain : en examinant les deux furfaces
de l’épi, on auroit penché à croire que cela venoit
d’une caufe extérieure, 6c que l’une de ces furfaces
avoit été frappée d’un vent brûlant qui l’avoit def-
féchée ; Ginani a aufli remarqué fouvent le même
phénomène : il a même trouvé des épis ;qui avoient
alternativement un bon grain 6c un vicie, avec une
diftribution plus ou moins régulière fur l’épi : ces
bons grains, tirés d’un épi charbonné, germent 6c
donnent de très-belles plantes. Il rapporte aufli des
plantes formées de plufieurs tuyaux ou chalumeaux,
dont les unes portoient des épis charbonnés, 6c les
autres des épis fains : cette inexplicable fingularité
différencie particuliérement le charbon de la nielle ^
qui, comme on l’a v u , infefte, non-feulement tout
l’épi & toutes fes parties, mais èncore tous lés germes
& tuyaux qui procèdent de la plante enniellée ;
il n’eft pas rare non plus de voir un champ entièrement
rempli de charbon, tandis qu’on n’en trouve-
roit pas un feul épi dans le champ voifin ; fouvent
il n’y a qu’un côté,du champ qui foit attaqué de ce
■ fléau.
Lorfqu’on bat le grain, une partie des grains charbonnés
eft écrafée par les coups de fléau ; leur pouf-
fiere noire fe répand fur les autres grains , 6c s’attache
principalement aux poils cannelés de la houppe
ou broffe du bon grain, 6c y forme une tache noire
qui le fait appeller grain moucheté, grain piqué, ou
qui a le bout... Cette tache , 6c les grains charbon-,
nés échappés au fléau, fuflîfent pour brunir la farin
e , 6c lui donner un goût défagréable ; elle donne
un oeil violet au pain, & il efl; à préfumer qu’une
matière'fi putride 6c fi corrompue employée en aliment
journalier, donne naiffance à des maladies
dont on cherche vainement ailleurs les caufes inconnues
: en effet cette matière tellement foetide qu’elle
caufe des foulevemens au fimple odorat,' étant re-
pompée par les vaifleaux laftés, peut fervir de levain
6c de ferment aux fievres putrides, qui ne font
peut-être fi communes que par la négligence impardonnable
oû l’on efl de ne pas faire laver 6c fécher
tous les grains avant de les faire moudre , afin d’enlever
avec l’écumoire tous les grains charbonnés
qui furnagent, 6c de nettoyer cette poufliere conta-
gieufe qui s’attache à la fuperficie du grain. Lors de
la cherté des grains , on n’eft pas fcrupuleux fur la
qualité, & une épargne aufli déplacée entraîne de
grands inconvéniens pour la fanté; au refte, ce bled
eft aifé à diftinguer à la fimple vue ; on fent d’ailleurs
qu’il eft gras dans le fac, 6c il laiffe à la main un goût
de graillé comme de la laine puante. La fociété
royale d’agriculture , au bureau du Mans , me fit
l’honneur de m’envoyer en 1 7 7 1 , fes obfervations
. manuferit fur, les bleds cornus, parmi lefquelles je
trouve celle-ci fur le charbon : on le nomme foudre au
pays du Maine. I l communique fon odeur foetide au
bon grain ; & lorfqiiil efl abondant, il caufe des maladies
épidémiques.
Les laboureurs font plus attentifs que les boulangers
& les particuliers, qui emploient le grain moucheté
à faire du pain; comme les laboureurs favent
par expérience que la moucheture eft contagieufe,
6c qu’elle engendre le bled noir, il ont foin de ne pas
employer les grains mouchetés pour femence. On
aura peine à fe perfuader qu’une poufliere qui ne
s’attache qu’au fon , fans pénétrer dans l’intérieur du
grain, foit contagieufe au point d’affeder d’une maladie
tous les grains qui en font imprégnés. Cela étoit
connu de plufieurs agriculteurs & nié par d’autres ;
mais les expériences de M. Tillet ne permettent
pas d’en douter : elles ont été faites 6c répétées à
Trianon fous les yeux du toi pour qui tous
deviennent importuns quand ils mtereflent un denree
de première uiceffité, dou dépendent la faute &
la vie de fes fujets. Par ces expériences toütes les
fortes de fromens naturellement mouchetés, ont
produit beaucoup d’épis charbonnés, tandis que ceux
qu’on a triés & choifis pour n’avoir point de grains
mouchetés n’ont point produit de noir ; ces mêmes
grains triés 6c choifis ayant été enfuite barbouilles
avec de la poufliere, ont donne autant de noir que
les grains mouchetés naturellement le mal a ete
encore plus fenfible quand on a mele avec la terre
de la poudre d’épis charbonnés,, &c. &c.
Je ne dois point cacher que Ginani révoque en
doute l’effet contagieux que M. Tillet attribue , d’après
Tull & plufieurs autres, à la poufliere du charbon.
Ce favant Italien a fait, de fon côte, plufieurs expériences
qui l’ont convaincu que -de bons grains
n’ont donné aucun épi charbonné quoiqu ils aient
été barbouillés de poufliere avant d etre charbonnés ;
d’autres fois de bons grains choifis avec foin , 6c
exempts de toute moucheture, ont néanmoins produit
du bled noir en affez grande quantité ; d’où il
conclut que la maladie du charbon procédé d un vice
intérieur de la femence, fans que la poufliere prétendue
contagieufe y ait aucune part, fi d ailleurs la
femence eft bonne en elle-même. Cependant comme
les effais.de M. Tillet paroiffent plus multipliés , 6c
faits avec exaditude , on ne peut rejetter entièrement
fes preuves de contagion. Mais il faudra aufli
accorder à Ginani que le charbon peut aufli venir de
toute autre caufe que de la moucheture , puilque
des grains qui en étoient exempts, 6c qui avoient
été choifis avec le plus grand fcrupule, n ont pas
laiffé que de porter des épis charbonnés : obfervation
qui répand un grand jour fur cette matière obfcure.
M. Tull ayant pris quelques pieds de bled, les
ayant plantés dans un vafe plein d’eau, 6c en ayant
trouvé toits les grains noirs., crut confequemment
que cette mauvaife qualité venoit de l’humidite de
la terre ; mais il eft généralement avoué que les lieux
bas ne donnent pas plus de grains charbonnés que les
lieux hauts, 6c que le charbonnage fe trouve, comme
la nielle, dans tous les terreins 6c dans toutes les
expofitions. M. Duhamel 6c Ginani en conviennent
également. D’autres regardent les fumiers comme la
caufe prochaine de cette maladie : mais les expériences
de M. Tillet prouvent le contraire, il n y a
que les pailles infedées 6c non réduites en fumier
qui ont femblé la produire. On a cru remarquer qu il
y a beaucoup de ch.aibon lorfqu’il s’eft fait des pluies
froides pendant la fleur 6c la formation de 1 épi • ipais
l’origine de la maladie eft antérieure à cette faifon,
comme on l’a vu plus haut. M. Adanfon croit que le
charbon, comme la nielle, a la même caufe première
que le g ivre, c’eft-à-dire, un exces d’humidite;
mais ce fentiment eft détruit par l’expérience. M. Ay-
men croit que 1 e charbon eft. dû , comme l’ergot, à
un défaut de fécondation , puifqu’il y a des bons
grains 6c des charbonnés fur le même é p i, ce qui
Semble annoncer que le fuc ne circulant pas dans les
ovaires non-fécondés, s’y amaffe irrégulièrement 6c
y contrade un vice interne qui change fa couleur 6c
la noircit comme la nielle ; mais j’ai fait v o ir , dans
ma Differtadon fur C ergot, que le charbon a une caufe
interne comme celle de la nielle, 6c antérieure à ce
qui fe paffe au tems de la fécondation. M. Aymeii
lui-même l’a prouvé, en communiquant le charbon
à volonté fur des femences noircies avec la poufliere
de veffe-de-loup. Cette derniere expérience peut
faire regarder le charbon comme une végétation pa-
rafite, dont la graine ou poufliere implantée fur une
femence, végété avec elle 6c fe reproduit en meme
tems.
Il faut donc reconnoître , dans dette maladie du
froment, deux caufes différentes ; l’une contagieufe
procédant du conta# des pouflieres de charbon ; l’autre
interne procédant du vice de la femence, ou plutôt
du défaut de conformation des ovaires qui font
feuls affedés dans le charbon. Sous ce dernier point
de vue, le charbon ne fera qu’une efpece particulière
de nielle qui n’attaque que quelques parties de la
.plante , 6c qui ne fort pas des enveloppes de
l’ovaire ; ce feront deux maladies du même genre
qui ne different qu’en ce que la poufliere noire de la
nielle eft plus corrofive, 6c ronge toutes les parties
de l’épi 6c de la fleur, au lieu que la poufliere noire
du charbon refte enfermée dans l’enveloppe qui la recouvre.
La moelle eft entièrement attaquée dans la
nielle, puifque les germe's ou proceffus médullaires
qui en procèdent, font toujours viciés fi la mere
plante eft enniellée , au lieu qu’il peut fortir d’une
plante charbonnée des germes ou tuyaux de bons
grains. Il eft fâcheux que M. Gledilfch, qui a fi bien
expliqué les caufes de la nielle, n’ait abfolûment
rien dit du charbon qui en eft une efpece.
Suppofons donc que le fuc encore laiteux qui fe
trouve dans une femence affez éloignée de fa maturité
6c de fa perfedion , fur-tout vers le tems où
cette femence achevé d’être nourrie par la plante
qui la porte ; fuppofons , dis-je, que ce fuc vienne
à s’échauffer ou à s’obftruer dans tous les embryons
imperceptibles de la plantule ou dans quelques-uns
feulement, tandis que la moelle fe confervera faine
d’ailleurs dans toutes fes parties, on aura dès-lors
une plantule ou une femence, dont les ovaires feuls
feront viciés en tout ou en partie, 6c occafionneront
• les grains charbonnés. C ’eft aufli le fentiment du
favant comte Ginani, il grano carbone tragga nafci-
mento da un difetto organico che conjifla in certa tefji-
tura me no perfetta & naturalmente debole delle fibre di
alguni germi del feme medçfimo.... quindi i l grano carbone
potrebbe dirji un inorbo fondco delle grano Jiccome
quello che nafee colla pianticella medijima , e vi rejla
condnuamcnte, pag. 320, in-40. Cette opinion peut
fe .concilier avec Ce qu’a dit ailleurs Ginani, que le
charbon étoit inconnu en Italie avant 1730, ce qui
a pu provenir, dit-il, d’un changement de température
dans cette partie de l’Europe, changement remarqué
par plufieurs auteurs.
D ’autres ont foupçonné que cette altération de
quelques fibres feulement peut fe faire dans les
noeuds de la plante qui filtrent le fuc nourriflier. En
effet, le même épi portant en même tems de bons
grains 6c des grains charbonnés , il peut arriver que
les petits vaifleaux qui aboutiffent aux grains viciés
aient fouffert dans le repliement des noeuds, ce qui
occafionneroit une obftrudion dans les grains viciés
6c un défordre dans leur organifation, dont le charbon
feroit la fuite : il fuffit que le mécanifme de la
circulation de la feve foit troublée par les intempéries
de la faifon, par la rupture des trachées ou par
quelqu’autre caufe pour produire de tels effets dans
l’endroit oit cette circulation ceffe d’avoir un cours
régulier, foit que l’ovaire ait été mal organifé dès
l’origine de fa formation , foit que ce défaut vienne
vd’obftruftions poftérieures qui forment dans l’ovaire
un amas irrégulier de fucs corrompus, comme on le
voit par la groffeur de ces grains viciés, qui furpaffe
de beaucoup celle des autres grains avant leur^def-
fication , 6c par la couleur verte^ de ces memes
grains viciés bien plus longs à mûrir & à fë deffé-
cher que les autres. Quoi qu’il en foit, 1 abondance
& la crudité des fucs portés à l’embryon naiffant, fuf-
fifent pour rendre raifon de cette infirmité, s’ ils viennent
à y croupir & à s’y corrompre. Comme l’ac-
Icroiffement de l’épi & des parties qui le compofent
fe fait le dernier, il n’eft pas furprenant que le mal