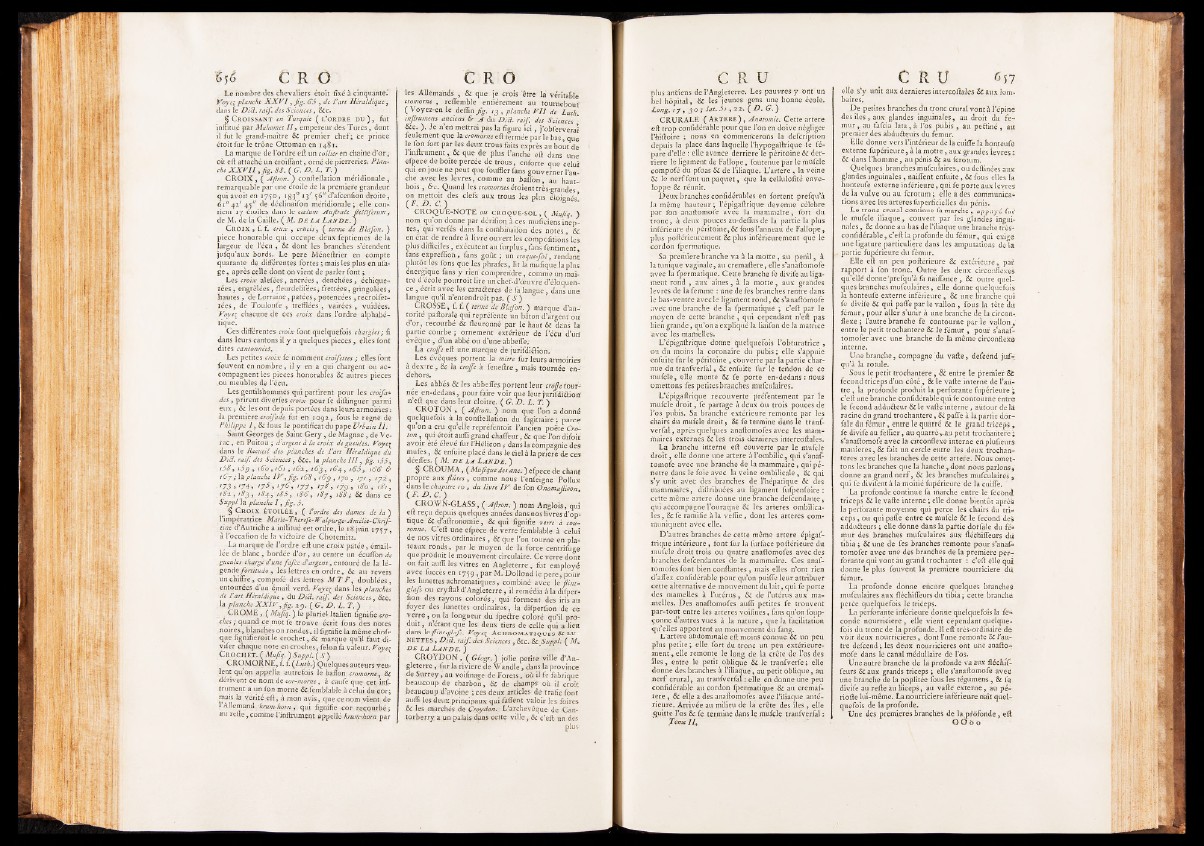
Le nombre des. chevaliers étoit fixé à cinquante,'
ffoye[ planche X X V I , fig. 65 , de l ’arc Héraldique ;
dans le Dicl. raif. des Sciences, 8cc.
§ C r o i s s a n t en Turquie ( l ’ o r d r e d u ) , fut
inftitué par Mahomet //, empereur des Turcs, dont
il fut le grand-maître 8c premier chef ; ce prince
étoit fur le trône Ottoman en 1481.
. La marque de l’ordre eft un collier en chaîne d’or ;
oh eft attaché un croiffant * orné dè pierreries; Planche
X X V U , fig. 88. ( G. D . L. T. )
C R O IX , ( Aftrôn. ) conftellarion méridionale j
remarquable par une étoile de la première grandeur
qui avoir en 1750, 183° *3^ 56" d’afcenfiôn droite,
6 i ° 4X/ 45,/ de déelinaifon méridionale elle contient
17 étoiles dans le coelum Aufirale fiellïferumf
de M. de la Caille. ( M. d e l à La n d e . )
C r o i x , f. f. crux , crucis, ( terme de Blafion. )
piece honorable qui occupe deux feptiemes de la
largeur de l’écu , 8c dont les branches s’étendent
jufqu’aux bords. Le pere Méneftrier en compte
quarante de différentes fortes ; mais les plus eh ufà-
g e , après celle dont on vient de parler font ; .
. Les croix alefées, ancrées, denchées, .échique-
té e s, engrêlées, fleurdelifées,- frettées, gringolées ,
hautes , de Lorraine, pâtées, potencées , recroifet-
tées, de Toulonfe , tréfilées , vairées , vuidées.
Voye^ chacune de ces croix dans l’ordre alphabétique.
Ces différentes croix font quelquefois chargées; fi
dans leurs cantons il y a quelques pièces, elles font
dites cantonnées.
Les petites croix fe nomment croifettes ; elles font
fouvent en nombre, il y en a qui chargent ou ac-r
compagnent les pi'eees honorables 8c autres pièces
.ou meubles de l’éeu.
Les gentilshommes qui partirent pour les croifa-
des, prirent diverfes croix pour fe diftinguer parmi
eu x , & les Ont depuis portées dans leurs armoiries :
la première croifq.de, fût en .1091, fous le régné' de
Philippe ƒ, 8c fous le pontificat du pape Urbain II:
Saint Georges de Saint G e ry , de Magnac, dé Ve-
ia c , eri Poitou ; d’argent à la croix de gueules. Voyer
dans le Recueil des planches de l ’art Héraldique du
Dicl. raif. des Sciences, 8cc. la planche I I f fig. i55:,
/5 8 , i5 () , i6o'yi&i i 16 4, t6 5 , 166 &
167 ; la planche I V , fig. 168, 16g , 170 , 17.1, 172 ,
•73 » '7.4, 17^'y l7 ^-> '77 ■> ‘ 7$ > >7S>, >80 , 181,
^ /8z i 183, 184 , 18 3 ,- 186, 187, 188 j 8c dans ce
Suppl la planche 1 , fig. 5.
§ C r o i x é t o i l é e , ( C ordre des dames dé ta }
l’impératrice Marie-Thenfc-JValpurge-Amélie-Chrïf-
tine d’Autriche a inftitué eet ordre, le r8 juin 175 7 ,
à Tôccafiori de la vi&oire de Chotemitz.
La marque de l’ordre eft une croix pâtée , émaillée
de blanc , bordée d’o r , au centre un éeuffon de
. gueules chargé çCune fafee d’argent, entouré de la. légende
fprtitudo, les lettres en ordre, 8c au revers
un chiffre., compofé des lettres M T P , doublées ,
entourées d’un émail verd. Voye^ dansdes planches
de l art Héraldique , du Dicl. raif. des Sciences , ÔCc.
la planche X X IV , fig. 2$. ( G. D . L. T. ) ' r.
CROME ,, ( Mufiq. ) le pluriel Italien lignifie cro-
ches quand ce mot fe trouve écrit fous des notes
noires, blanches ou rondes,- il lignifie la même chofe
que fignifieroitle crochet, & marque qu’il faut di-
vifer chaque note en croches, félon fa valeur. Voyer
C r o c h e t . ( Mufiq. ) Suppl. ( S )
CROMORNE, f. f. ^Luth.) Quelques auteurs veulent
qu’on appel la autrefois le baffon cromornê, 8c
dérivent ce nom de cor-morne, à caufe que cet instrument
a un fon morne &>femblable à Celui du ,qor ;
mais la vérité eft, à mon avis, que ce nom vient, de
1 Allemand,firum-horn f qui lignifie cor recourbé;
au refte,comme rinftrument appellé kmm-kprn par
les Allemands , & que je crois être lai véritable
cromornê , reffemble entièrement au tournebouf
( Vôyez-en le delîin fig. ,3 , planche V i l de Luth,
infirümens anciens & A du Dicl. raif. des Sciences g
&e. ). Je n en mettrai pas la figure ic i , j’obferveraî
feulement que la cromornê eft fermée par le bas, que
le fon fort par les deux trous faits exprès au bout de
rinftrument & que de plus l’anche eft dans une
efpece de boîte percée de trous, enforte que celui
qui en joue ne peut que fouffler fans gouverner Tanche
avec lés levres, comme au baffon, au hautb
o is , &c. Quand les cromornes étoient très-grandes
on mpttoit des clefs aux trous les plus éloignée’
( F. D . C. ) t ë e \
CROQUE-NOTE ou Croqùè-sol , ( Mufiq. )
nom T 1’011 donne par dérifion à ces muficiens ineptes,
qui verfés dans la Combihaifon des notes, 8c
en état de rendre à livre ouvert les compolitions les.
plus difficiles, exécutent au furplus, fans fentiment,
fans éxpreflioii, fans goût ; un croque-fol, fendant
plutôt lés fons que les phrafes, lit la mufique la plus
énergique fans y rien comprendre, comme un maître
d’école pourroit lire un chef-d’deuvre d’éloquence
, écrit avec les cataétëres dé fa langue, dans une
langue qu’il n’eritendroit pas. ( S )
CROSSE, f. f. ( terme de Blafon. ) marque d'autorité
paftorale qui repréfente un bâton d’argent ou
d’or, recourbé 8c fleuronné par le haut 8c dans la
partie courbe ; ornement extérieur de ï ’éèü d’uiï
évêque, d’un abbé ou d’une abbeffe.'
La croffe eft une marque de jurifdi&ioh.
Les évêques portent la mitre fur leurs armoiries
à dextre, & la croffe à feneftre, mais tournée en-
dehors.
Les abbés & les abbeffes portent leur^crâfie^tour-’
née en-dedans,. pour faire voir que leur junfdiâion'
n’eft.que dans leur cloître. ( G. D . L. T. )
GROTON , ( Afiroh. ) nom que Ton a donné'
quelquefois à la conftellation du fagittaire ; parcé
qu’on a cru qu’elle repréfentoit l ’ancien poète CrcP-
ton, qui-étoit auflï grand chaffeur, & qae l’on' difoit
avoir été élevé fur l’H élieondans la compagnie des
mufes, & enfuite placé dans le ciel à la prière de ces
déeffes. ( Mi d e l a L a n d e . )
§ CROUMA, ( Mufique des anc. ) efpece de chant
propre aux flû tes, comme nous Tenfeigne Poilus*
dans le chapitre 10 » du livre I V de fon Onomaflicom
( F. D . C. ) - J
CROWN-GLASS, ( Ajlron: ) hom Anglois, qui
eft reçu depuis quelques années dans nos livres d’optique
& d’aftronomie, & qui fignifte verre à couronna
C ’eft une efpecé de verre femblable à celui
de nos vitres ordinaires , & que Ton tourne en pla±
téaux ronds, par le hioyen de la force centrifuge
que produit le mouvement circulaire. Ce verre dont
on fait aufli les vitres en Angleterre, fut employé
avec fuccès en 1759, par M. Dollond le pere; pour
les lunettes achromatiquescombiné avec le fiint-
glafs ou cryftal d’Angleterre, il remédia à la difper-
fion des rayons colorés,: qui forment des irisait
foyer des.funett.es ordinaires, la difperfion de ce
verre, ou la longueur du fpeftre coloré qu’il pro-
.duit , n’étant que les deux tiers de celle qui a lieu
dans le flintfilafs. Voyt{ Achromatiques & lunettes
, Dicl. raif. des Sciences ,-ÔSC. &C Suppl- ( M*
d e l a L a n d e . )
CROYDON , ,( Géogr. ) jolie petite ville d’Angleterre,
fur la riviere de Wandle, dans la province
de Surrey, au voifinage de Forets, oii il fe fabrique
beaucoup de charbon, & de champs’ où il croît
beaucoup d’avoine ces deux articles de trafic font
aufli lés deux principaux qui faffent valoir les foires
.& les marchés de Croydon. L’archevêque, de Can-
torberry a un palais dans cette ville , & c’eft- un des
plus'
plus anciens de T Angleterre. Les pauvres y ont urt
bel hôpital , & les jeunes gens une bonne ë<roIe>
Long. 1 7 , 30 ■; lat. St ^ 2.2\ ( D . G. )
C R U R A L E ( A r t è r e ) , Anatomie. Cette artere
eft trop confidérable pour que Ton en doive négliger
l’hiftoire ; nous en commencerons la defeription
depuis la place dans laquelle Phypogaftrique fe fé-
pare d’elle : elle avance derrière le péritoine & derrière
le ligament de Fallope, foûtenue par le mtifcle
compofé du pfoas & de l’iliaque. L’artere , la veine
& le nerf font un paquet, que la tellulolité enveloppe
& réunit.
Deux branchés confidérables ên fôrtent prefqu’à
la même hauteur ; l’épigaftrique devenue célébré
par fon anaftomofe avec la manihiaire, fort du
tronc, à deux pouces au-deflirs de la partie la plus
inférieure du péritoine, & fous l’anneau de Fallope,
plus poftérieurement & plus inférieurement que le
cordon fpermatique»
Sa première branche va à la motte, ait penil, à
la tunique vaginale, au cremaftefe, elle s’anaftortiofe
avec la fpermatique. Cette branché fe divife 'au ligament
rond , aux aînés, à la motte, aux grandes
levres de la femme : une de fes branches rentre dans
le bas-ventfe avec le ligament rond, & s’anaftoniofè
avec une branche de la fpermatique ; c’eft par le
moyen de cette branche, qui cependant n’eft pas
bien grande, qu’on a expliqué la liaifon de la matrice
avec les mamelles.
L’épigaftrique donne quelquefois l’obturatrice ,
ou du moins la coronaire du pubis ; elle s’appuie
enfuite fur le péritoine, couverte par la partie charnue
du tranfverfal, & enfuitfe flir le tertdon de Ce
mufclè, elle monte & fe porte ert-dedaris : nous
omettons fes petites branches mufeuiaires.
L’épigaftrique recouverte préfentement par le
mùfcle droit, fe partage à déux ou trois pouces de
Fos pubis. Sa branche extérieure remonte par les
chairs du mufcle droit, & fe termine dans le ttanf-
verfa l, après quelques anaftomofes avec les mammaires
externes & les trois dernières intercoftales.
La branche interne eft couverte par le mufcle
droit, elle donne une artere à l’ombilic, qui s^naf-
tomofe avec une branche de la mammaire, qui pénétré
dans le foie avec la veine ombilicale , & qui
s’y unit aVet des branches de l’hépatique & des
mammaires, diftribuées au ligament fufpenfoire :
cettë même artere donne Une branche defeendante,
qui accompagne l’ôuraquè 8c les arieres ombilicales
, 8c fe ramifie à la veflie, dont les arteres communiquent
avec elle.
D ’autres branches de cette même artere épigaf-
îrique intérieure, font fur la furface poftérieure du
mufcle droit trois ou quatre anaftomofes avec des
branches defeendantes de la mammaire. Ces anaftomofes
font bien confiantes , mais elles n’ont rien
d’affez confidérable pour qu’on puiffe leur attribuer
cette alternative de mouvement du lait, qui fe porte
des mamelles à l’utérus, 8c de l’utérus aux mamelles.
Des anaftomofes aufli petites fe trouvent
par-tout entre les arteres voifines, fans qu’on foup-
çonne d’autres vues à la nature, que Ja facilitation
qu’elles apportent au mouvement du fang.
L’artere abdominale eft mojns connue 8c un peii
plus petite ; elle fort du tronc un peu extérieurement
, elle remonte le long de ia crête de l’os des
île s , entre le petit oblique 8c le tranfverfe; elle
donne des branches à Tiliaq'uè, au petit oblique, au
nerf crural, au tranfverfal : elle en donne une peu
confidérable au cordon fpermatique 8c au cremaf-
tere, 8c elle a des anaftomofes avec l ’iliaque antérieure.
Arrivée au milieu de la crête des îles , elle
quitte l’os 8c fe termine dans le mufcle tranfverfal ;
Terne II,
elle s*y unit aux dernieres intercoftales 8c aux lombaires.
De petites branches dii tronc crural vont à l’épine
des île s , aux glandes inguinales, au droit du fémur
, au fafeia lata, à l’os piitis , au peàiné , au
premier des abduàeurs du fémur.
Elle donne vers l’intérieur de là cuifle ia hon,téufé
externe fupérieure, à la motte, aux grandes levres :
8c dans l’homme, au pénis 8c au ferotum.
Quelques branches mufeuiaires, ou deftinées aux
glandes inguinales , naiflent enfuite, 8c fous elles la
honteufe externe inférieure, qui fe porte aux Ievreâ
de la vulve ou au ferotum ; elle a dés communications
avec les arteres fuperficielies du périls.
Le tronc crural continue fa marché, appuyé fur1
le mufcle iliaque, couvert par les glande^ inguinales
, 8c donne au bas de l’iliaque une branche très-
confidérable, c’eft: la profonde du fémur, qui exigé
une ligature particuliere dans les amputations de ia
partie fupérieure du fémur.
Elle eft un peu poftérieure 8c extériêuré, pà£
rappçrt à fon tronc. Outré les deux circonflexes
qu’ellé donne’prefqu’à fa naiffanee , 8c outre quelques
branches mufeuiaires, elle donne quelquefois
ia honteufe externe inférieure , 8c une branche qui
fe divife 8c qui paffe par le vallon , fous la tête du
fémur, pour aller s'unir à une branche de la circonflexe
; l’autre branche fe contourne par le vallon,
entre le petit trochantere 8c le fémur , pour s’anaf-
tomofer avec une branche de la même circonflexe
interne.
Une branche, compagne ‘du vafte > defcérid juf~
qu’à la rotule.
Sous le petit trochantefe, 8c entré le premier 8fc
fécond triceps d’un cô te, 8c ie vafte interne de l’aù-
t re , la profonde produit la perforante fupérieiire ;
c’ eft une branche Confidérable qui fe contourne entre
le fécond adduêieur 8c le vafte interne, autour de là
racine du grand trochantere, 8c pafte à là partie dor-
fâle du fémur, entre le quâfré 8c le grand tricéps ,
fe divife au feflier, au quarré^au petit trochantere ;
s’anaftomofe avec la circonflexe interne eri plufieurs
maniérés, 8c fait un cercle entre les deiix t’rochari-
teres avec les branches de cette artere. Nous omettons
les branches que là hanche, dont nôus parlons 9
donne au grand nerf, 8c les branches mufculairé^ ,
qui fe divifent à la moitié fupérieure de la cuifle.
La profonde continue fâ marche entre le fécond
triceps 8c le vafte interne ; elle donne bientôt àprès
ia perforante moyenne qui perce les chairs du triceps
, ou qui paffe éntre ce mufcle 8c le fécond des
adduûeurS ; elle donne dans la partie dôffâle du fé*
mur des branches mufeuiaires àiix néchiffeurs dii
tibia ; 8c une de fes branches rériionte pour s’ârtaf-
tomofer avec une des branchés de la première per-
foraritequi vont àu grand trochanter : c’eft élle qui
donne le plus fouvent la première nourricierë dû
fémur.
La proforide donne ericôrë quelqués brancheà
mufeuiaires aux fléchiffeurs du tibia ; cèlte branché,
perèe quelquefois lé triceps.
La perforante inférieure doririe quelquefois la féconde
nourricière , élle vient céperidant quelquefois
du tronc de la profonde. Il eft trèS-ordiriâire de
voir deux nourricières, dont Tune remonte Sc l’autre
defeend ; les deux nourricières ont ùrië anafto-
rriofe dans le canal médullaire dè l’os.
Une autre branche de là profonde và aux flécnif-
feurs Seaux grands triceps ; elle s’anâftomofe avec
urie branche de la poplitée fóuS lés tégumens, 8c fe
divife àu refte àu biceps, au vafté externe, aû période
lui-même. La noutriciete iriférieure naît quel-;
quefois de la profonde.
Une des premières branchés de la jrfofonde, eft
O O 0 O