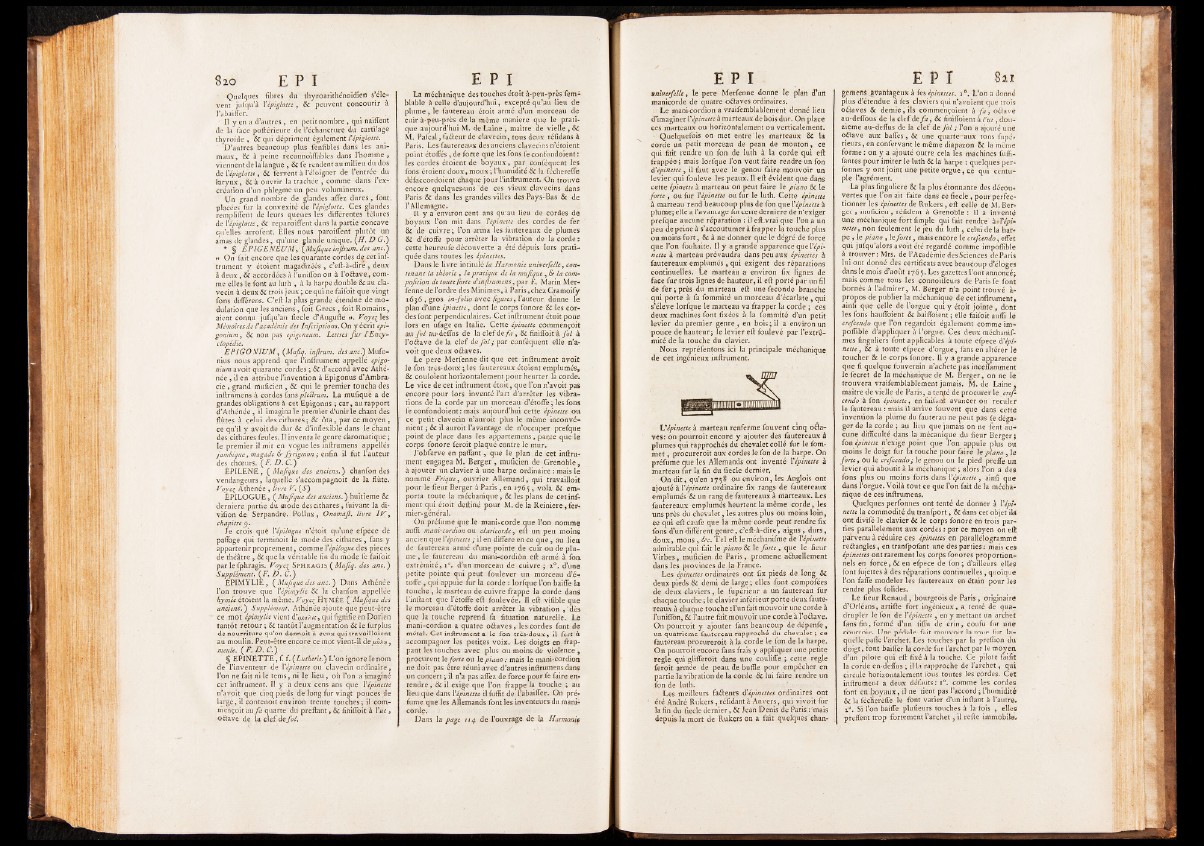
Quelques fibres du thyroarithénoïdien s’élèvent
jufqu’à Vépiglotte , & peuvent concourir à
l’abaiffer. _ ; ,
Il y en a d’autres , en petit nombre, qui naiffent
de la face poftérieure de l’échancrure du cartilage
thyroïde , &c qui dépriment également Cépiglotte.
' D’autres beaucoup plus fenfibles dans les animaux,
6c à peine reconnoiffables dans l’homme ,
viennent de la langue , 6c fe rendent au milieu du dos
d e l"épiglotte y 6c fervent à l’éloigner de l’entrée du
larynx, 6c à ouvrir la trachée , comme dans l’excréation
d’un phlegme un peu volumineux.
Un grand nombre de glandes affez dures, font,
placées fur la convexité de l'épiglotte. Ces glandes
rempüffent de leurs queues les différentes fêlures
de Pépiglotte, 6c reparoiffent dans lapartie concave
qu’elles arrofent. Elles nous paroifient plutôt un
amas de glandes, qu’une glande unique. (H. D G.)
* § E P IG E N E U M ,f Mufique inflrum. des anc.)
« On fait encore que les quarante cordes de cet inf-
trument y étoient magadizéés , c’eft-à-dire, deux
â deux, 6c accordées à l’uniffon ou à l’oftave., comme
elles le font au luth , à la harpe double & au clavecin
à deux 6c trois jeux ; ce qui ne faifoit que vingt
fons différens. C’eft la plus grande étendue de modulation
que les anciens, foit Gre cs, foit Romains,
aient connu jufqu’an fiecle d’Augufte ». Voye[ les
Mémoires de Ü académie des Infcriptions. On y écrit epi-
gonium, & non pas epigeneum. Lettres fur £ Encyclopédie.
EPIG O NIUM, (Mufiq. inßrurn. desanc.') Mufc-
nius nous apprend que l’inftrument appellé epigo-
nium avoit quarante cordes ; 6c d’accord avec Athénée
, il en attribue l’invention à Epigonus d’Ambra-
cie , grand muficien , 6c qui le premier toucha des
inftrumens à cordes fans pleclrum. La mufique a de
grandes obligations à cet Epigonus ; car, au rapport
d’Athénée, il imagina le premier d’unir le chant des
flûtes à celui des cithares; 6c ôta, par ce moyen,
ce qu’il y avoit de dur 6c d’inflexible dans le chant
des cithares feules. Il inventa le genre chromatique ;
le premier il mit en vogue les inftrumens appellés
jambique, magade & fyrigmon ; enfin il fut l’auteur
des choeurs. (F. D. C.)
ÉPILENE, ( Mufique des anciens.') chanfon des
vendangeurs, laquelle s’accompagnoit de la flûte.
Voye^_ Athenée , livre V. (fis)
ÉPILOGUE, ( Mufique des anciens. ) huitième 6c
derniere partie du mode des cithares, luivant la di-
vifion de Serpandre. Pollux, Onomafi. livre l y ,
chapitre g.
Je crois què Pépilogue n’étoit qu’une efpece de
paffage qui terminoit le mode des cithares, fans y
appartenir proprement, comme Y épilogue des pièces
de théâtre , & que la véritable fin du mode fe faifoit
par le fphragis. Voye£ Sphragi§ (Mufiq. des anc.')
Supplément. (F. D . C. )
ÉPIMYLIE , (Mufique des anc.) Dans Athénée
l’on trouve que l'épimylie 6c la chanfon appellée
hymée étoient la même. Voye7K HymÉE ( Mufique des
anciens'.) Supplément. Athénée ajoute que peut-être
ce mot épimylie vient d’^aX/ç, qui fignifie en Dorien
tantôt retour ; 6c tantôt l’augmentation 6c le furplus
de nourriture qu’on donnoh à ceux quitravâilloient
au moulin. Peut-être encore ce mot vient-il de fivx»,
meule. (F . D . C.)
§ EPINETTE, f. f. (Lutherie!) L’on ignoré le nom
de l’inventeur de Y épinette ou clavecin ordinaire,
l’on ne fait ni le tems, ni le lieu, où l’on a imaginé
cet inftrument. Il y a deux cens ans que Yépinette
n’avpit que cinq pieds de long fur vingt pouces de
large, il contenoit environ trente touches; il com-
mefiçoitau fa quarte du preftant, 6c finifloit à l'u t ,
octave de la c lef de fol.
La méchanique des touches étoit à-peu-près fem*
blable à celle d’aujourd’hui, excepté qu’au lieu de
plume, le fautereau étoit armé id’un morceau de
cuir à-peu-près de la même maniéré que le pratique
aujourd’hui M. de Laine , maître de v ielle, 6c
M. Pafcal, fatteur de clavecin, tous deux réfidans à
Paris. Les fautereaux des anciens clavecins n’étoient
point étoffés , de forte que les fons fe confondoient:
les cordes étoient de boyaux, par conféquent les
fons étoient doux, moux ; l’humidité 6c la féchereffe
défaccordoient chaque jour l’inftrument. On trouve
encore quelques-uns “de ces vieux clavecins dans
Paris 6t dans les grandes villes des Pays-Bas & de
l’ Allemagne.
Il y a environ cent ans qu’au lieu de cordes de
boyaux l’on mit dans Y épinette des cordes de fer
6c de cuivre ; l’on arma les fautereaux de plumes
& d’étoffe pour arrêter la vibration de la corde :
cette heureufe découverte a été dépuis lors pratiquée
dans toutes les épinettes.
Dans le livre intitulé la Harmonie univerfelle, contenant
la théorie , la pratique de la mufique, & la com-
pofition de toute forte cTtnflrumens, par F. Marin Mer-
fenne de l’ordre des Minimes, à Paris, chez Cramoify
1636, gros in-folio avec figures, l’auteur, donne le
plan d’une épinette, dont le corps fonore 6c les cordes
font perpendiculaires. Cet inftrument étoit pour
lors en ufage en Italie. Cette épinette commençoit
au fo l au-deffus de la clef de ƒ ? , & finifloit à fo l à
l’oôave de la clef de fo l; par conféquent elle n’a-
voit que deux o&aves.
Le pere Merfenne dit que cet inftrument avoit
le fon très-doux ; les fautereaux étoient emplumés,
& couloient horizontalement pour heurter la corde.
Le vice de cet inftrument étoit, que l’on n’avoit pas
encore pour lors inventé l’art d’arrêter les vibrations
de la corde par un morceau d’étoffe ; les fons
fe confondoient : mais aujourd’hui cette épinette ou
ce petit clavecin n’auroit plus le même inconvénient
; 6c il auroit l’avantage de ffoccuper prefque
point de place dans les appartemens, parce que le
corps fonore feroit plaqué contre le mur.
J’obferve en paffant, que le plan de cet infiniment
engagea M. Berger , muficien de Grenoble,
à ajouter ùn clavier à une harpe ordinaire : mais le
nommé Frique, ouvrier Allemand, qui travailloit
pour le fieur Berger à Paris, en 1765 * -vola 6c emporta
toute la méchanique, 6c les plans de cetinf«
ment qui étoit deftiné pour M. de la Reiniere,fermier
général.
On préfume que le mani-corde que l’on nomme
aufli mani-cordion ou claricorde, eft un peu moins
ancien que l’épinette ; il en différé en ce que, au lieu
de fautereau armé d’une pointe de cuir ou de plume
, le fautereau du mani-cordion eft armé, à fon.
extrémité, i°. d’un.morceau de cuivre ; z°. d’une
petite pointe qui peut foulever un morceau d’étoffe
j qui appuie fur ia corde : lorfque l’on baille la
touche , le marteau de cuivre frappe la corde dans
l’inftant que l’étoffe eft foulevée. Il eft vifible que
le morceau d’étoffe doit arrêter la vibration , ‘dès
que la touche reprend fa fituation naturelle. Lé
mani-cordion a quatre oélaves ; les cordes font de
métal. Cet inftrument a le fon très-doux, il fert à
accompagner les petites voix. Les doigts en frappant
les touches avec plus ou moins de violence ,
procurent le forte ou le piano : mais le mani-cordion
ne; doit pas être réuni avec d’autres inftrumens dans
.un concert ; il n’a pas affez de force pourfe faire entendre
, & il exige que l’on frappe la touche ; au
lieu que dans Y épinette il fuflit de l’abaiffer. Qn préfume
que les Allemands font les inventeurs du mani-
cordç.
Dans la page u q de l’ouvrage de U Harrnonif
univerfelle, le pere Merfenne donne le plan d*urt
manicorde de quatre oûaves ordinaires.
Le mani-cordion a vraifemblablemént donné lieu
d’imaginer Y épinette à marteaux de bois dur. On place
ces marteaux ou horizontalement ou verticalement.
- Quelquefois on met entfe le s marteaux & la
corde un petit morceau de peau de mouton, ce
qui fait rendre un fon de luth à la Corde qui eft
frappéei; mais lorfque l’on veut faire rendre un fon
d'épinette , il faut avec le genou faire mouvoir un
levier qui fouleve les peaux. Il eft évident que dans
cette épinette à marteau on peut faire le piano 6c le
forte , oii fur Yépinette où fur le luth. Cette épinette
à marteau rend beaucoup plus de fon que Yépinette à
plume; elle a l’avantage fur cette derniere de n’exiger
prefque aucune réparation : il eft.vrai que l’on a un
peu de peine à s’accoutumer à frapper la touche plus
ou moins fort, & à ne donner que le dégré de force
que l’on fouhaite. Il y a grande apparence que Y épinette
à marteau prévaudra dans peu aux épinettes à
fautereaux emplumés, qui exigent des réparations
continuelles. Le marteau a environ fix lignes de
face fur trois lignes de hauteur, il eft porté par un fil
de fer ; près du marteau eft une fécondé branche
qui porte à fa fommité un morceau d’écarlate , qui
s’élève lorfque le marteau va frapper la corde ; ces
deux machines font fixées à la fommité d’un petit
levier du premier genre , en bois; il a environ un
pouce de hauteur; le levier eft foulevé par l’extrémité
de la touche du clavier.
Nous repréfentons ici la principale méchanique
de cet ingénieux inftrument.
Vépinette à marteau renferme fouvent cinq Graves:
on pourroit encore y ajouter des fautereaux à
plumes qui rapprochés du chevalet collé fur le fom-
m e t , procureroit aux cordes le fon de la harpe. On
préfume que les Allemands ont inventé Y épinette .à
marteau fur la fin du fiecle dernier.
On d it, qu’en 1758 ou environ, les Anglois ont
ajouté à Y épinette ordinaire fix rangs de fautereaux
emplumés & un rang de fautereaux à marteaux. Les
fautereaux emplumes heurtent la même corde, les
uns près du chevalet, les autres plus ou moins loin,
ce qui eft caufe que la même corde peut rendre fix
fons d’un différent genre, c’eft-à-dire, aigus , durs,
doux, mous , &c. T e l eft leméchanifme de Y épinette
admirable qui fait le piano 6c le forte , que le fieur
Virbes, muficien de Paris, promene actuellement
dans les provinces de la France.
Les épinettes ordinaires ont fix pieds de long &
deux pieds 6c demi de large ; elles font compofées
de deux claviers, le fupérieur a un fautereau fur
chaque touche ; le clavier inférieur porte deux fautereaux
à chaque touche :l’un fait mouvoir une corde à
l’uniffôn, & l’autre fait mouvoir une corde à l’oCtave.
On pourroit y ajouter fans beaucoup de dépenfe,
un quatrième fautereau rapproché du chevalet ; ce
fautereau procureroit à la corde le fon de la harpe.
On pourroit encore fans frais y appliquer une petite
règle qui’glifferoit dans une çouliffe ; cette réglé
feroit armée de peau de. buffle pour empêcher en
partie la vibration de la corde & lui faire rendre un
fon de luth.
Les meilleurs fadeurs d'épinettes ordinaires ont
été André Rukers, réfidant à Anvers, qui yivoit fur
la fin du fiecle dernier, & Jean Dénis de Paris;:fmais
depuis la mort de Rukers on a fait quelques ehanj
gemens „avantageux à fes épinettes. 16. L*on a donné
I plus d’étendue à fes claviers qui n’avoient que trois
odaves & demie, ils commençoient à f a , odave
au-deffous de la clef d z fa , &c finiffoient à l’u t , douzième
au-deffus de la clef de fol ; l’on a ajouté une
odave aux baffes, & une quarte^aux tons Ripé»
rieurs , en confervant le même diapazon & la même
fotme: on y a ajouté outre cela les machines fuffi-
fantes pour imiter le luth & la harpe : quelques per*
fonnes y ont joint une petite orgue, cje qui centu*
pie l’agrément.
La plus finguliere & la plus étorirtante des découvertes
que l’on ait faite dans ce fiecle, pour perfectionner
les épinettes de Rukers, eft celle de M. Berger
, muficien, réfident à Grenoble : il a inventé
une méchanique fortfimple qui fait rendre àtYépi»
nette, non feulement le jeu du luth , celui de la harpe
, le piano , le forte, mais encore le crefcendo, effet
qui jufqu’alors avoit été regardé comme impoflible
à trouver: Mrs. de l’Académie des Sciences de Paris
lui ont donné des certificats avec beaucoup d’éloges
dans le mois d’août 1765. Les gazettes l’ont annoncé;
mais comme tous les connoiffeurs de Paris fe font
bornés à l’admirer, M. Berger n’a point trouvé à*
propos de publier la méchanique de cet inftrument *
ainfi que celle de l’orgue qui y étoit jointe , dont
les fons hauffoient & baiffoient ; elle faifoit aufli le
crefcendo que l’on regardoit également comme impoflible
d’appliquer à l’orgue. Ces deux méchanif-
mes finguliers font applicables à toute efpece à'épinette
, 6c à toute efpece d’orgue* fans en altérer le
toucher & le corps fonore. Il y a grande apparence
que fi quelque fouverain n’achete pas inceffamment
le fecret de la méchanique de M. Berger, on ne le
trouvera vraifemblablement jamais. M. de Laine ,
maître de vielle de Paris, a terné de procurer \e crefcendo
k fon épinette, en faifant avancer ou reculer
le fautereau : mais il arrive fouvent que dans cette
invention la plume du fauterau ne peut pas fe dégager
de la corde ; au lieu que jamais on ne fent au-*
cune difficulté dans la mécanique du fieur Berger ;
fon épinette n’exige point que l’on appuie plus ou
moins le doigt fur la touche pour faire 1 ç piano , le
forte, ou le crefcendo; le genou ou le pied preffe un
levier qui aboutit à la méchanique ; alors l’on â des
fons plus ou moins forts dans Y épinette , ainfi que
dans l’orgue. Voilà tout ce que l’on fait de la méchanique
de ces inftrumens.
Quelques perfonnes ont tenté de donner à Y épi*
nette la> commodité du tranfport, & dans cet objet ilà
ont divifé le clavier & le corps fonore en trois parties
parallèlement aux cordes : par ce moyen on eft
parvenu à réduire ces épinettes en parallélogramme
reélangles, en tranfpofant une des parties: mais ces
épinettes ont rarement les corps fonores proportionnels
en force, & en efpece de fon ; d’ailleurs elles
font fûjettes à des réparations continuelles, quoique
l’on faffe modeler lès fautereaux en étain pour les
rendre plus folides.
Le fieur Renaud, bourgeois de Paris, Originaire
d’Orléans, artifte fort ingénieux, a tenté de quadrupler
le fon de Y épinette, en y mettant un archet
fans fin, formé d’un tiffu de crin, coufu fur une
cburroie. Une pédale fait mouvoir la roue fur la-
quèUe paffe l’archet. Lés touches par la preflion du
doigt, font bailler la corde fur l’archet par le moyen
d’un pilote qui eft fixé à la touche. Ce pilote faifit
la corde en-deffus ; il la rapproche de l’archet, qui
circule horizontalement fous toutes lès cordes. Cet
inftrument a deux défauts: i°. comme les cordes
font en boyaux, il ne tient pas l ’accord ; l’humidité
& la fécnerèffe le font varier d’un inftant à l’autre.
i° . Si l’on baiffe plufieurs touches à la fois , elles
; prefîent trop fortement l’archet, il refte immobile»