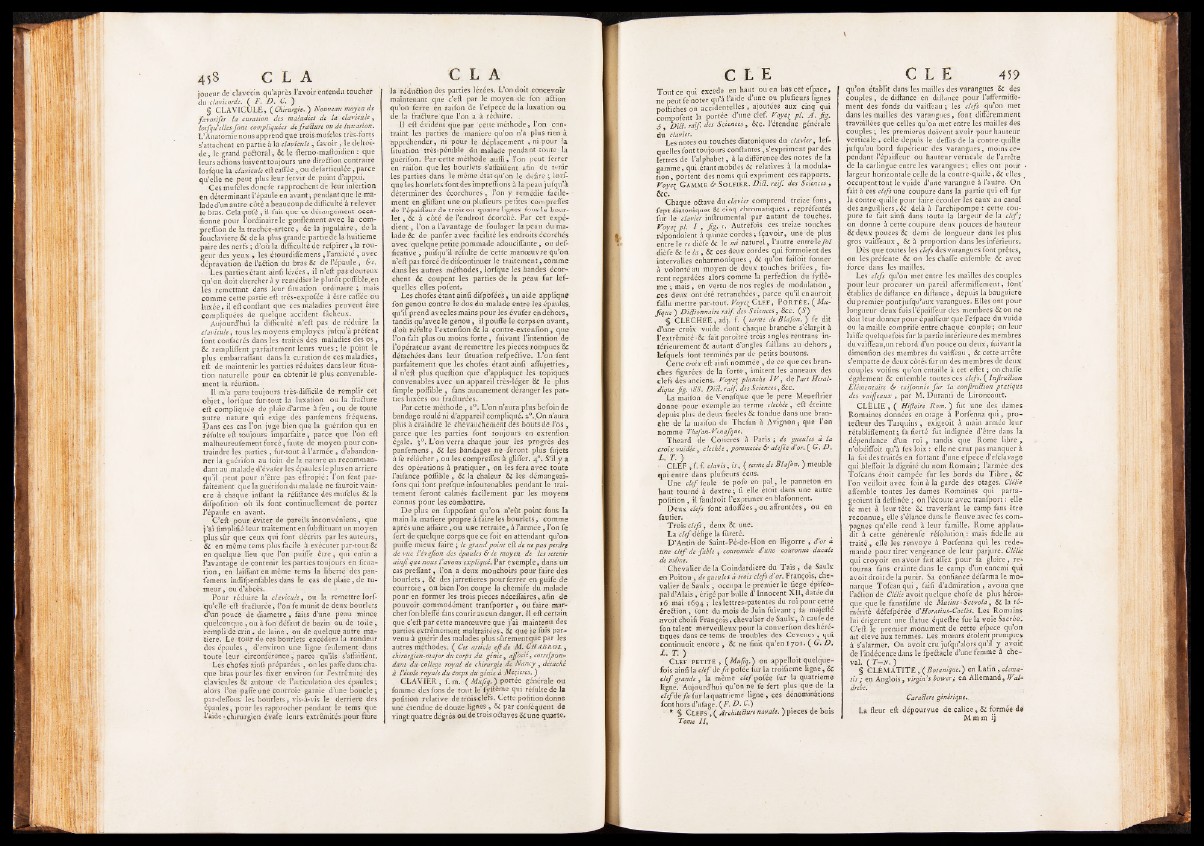
joueur de clavecin qu’après l’avoir entendu toucher
du clavicorde. ( F. D . C. )
§ CLAVICULE, (Chirurgie. ) Nouveau moyen de
favorifer la curation des maladies de la clavicule ,
lorfqu’elles font compliquées de fracture ou de luxation.
L’Anatomie nous apprend que trois mufcles très-forts
s’attachent en partie à la clavicule, favoir , le deltoi-
d e , le grand peftoral, 8c le fterno-maftoïdien : que
•leurs allions fuiventtoujours une dire&ion contraire
lorfque la clavicule eft caffée ^ou defarticulee, parce
qu’elle ne peut plus leur fervir de point d’appui.^
Ces mufcles donc fe rapprochent de leur infertion
en déterminant l’épaule en avant, pendant que le malade
d’un autre côté a beaucoup de difficulté à r elever
le bras. Cela pofé , il fuit que ce dérangement occasionne
pour l’ordinaire le gonflement avec la com-
preffion de la trachée-artere, de la jugulaire, de la
louclaviere 8c de la plus grande partie de la huitième
paire des nerfs ; d’où la difficulté de refpirer, la rougeur
des yeux , les étourdiffemens j l’anxiété , avec
dépravation de l’aâion du bras 8c de i’épauie , &c.
Les parties étant ainfi lézées, il n’efl pas douteux
qu’ on doit chercher à y remédier le plutôt poffible,en
les remettant dans leur fituation ordinaire ; mais
comme cette partie efl très-expofée à être caffée ou
luxée, il eft confiant que ces maladies peuvent être
compliquées de quelque accident fâcheux.
Aujourd’hui la difficulté n’efl pas de réduire la
clavicule, tous les moyens employés jufqu’à préfent
font confacrés dans les traités des maladies des o s ,
& rempliflent parfaitement leurs vues; le point lé
plus embarraffant dans la curation de ces maladies,
eft de maintenir les parties réduites dans leur fituation
naturelle pour en obtenir le plus convenablement
la réunion.
Il m’a paru toujours très-difficile de remplir cet
ob je t, lorfque fur-tout la luxation ou la fraûure
efl compliquée de plaie d’arme à feu , ou de toute
autre nature qui exige des panfemens fréquens.
Dans ces cas l’on juge bien que la guérifon qui en
réfulte eft toujours imparfaite, parce que l’on efl
malheureufement forcé, faute de moyen pour contraindre
les parties , fur-tout à l’armée , d’abandonner
là guérifon au foin de la nature en recommandant
au -malade d’évafer les épaules le plus en arriéré
qu’il -peut pour n’être pas eftropié : l’on fent parfaitement
que la guérifon du malade ne fauroit vaincre
à chaque inftant la réfiflance des mufcles 8c la
difpofition où ils font continuellement de porter
l’épaule en avant.
G’efl' pour, éviter de pareils inconvéniens, que
j ’ai Amplifié leur traitement en fubftituant un moyen
plus sûr que ceux qui font décrits par les auteurs,
8c en même téms plus facile à exécuter par-tout &
en quelque lieu que l’on puiffe être* qui enfin a
l’avantage de contenir les parties toujours en fituation
, en laîffant en même tems la liberté des panfemens
indifpenfables dans le cas de plaie, de tumeur,
ou d’abcès.
Pour réduire la clavicule, ou la remettre lorf-
qu’elle efl: fradurée, l’on'fe munit de deux bourlets
d’un poucé de diamètre, faits d’une peau mince
quelconque, ou à fon défaut de bazin ou de toile ,
rempli de crin, de laine , ou de quelque autre matière.
Le tour de. ces bourlets excédera la rondeur
des épaules, d’environ une ligne feulement dans
toute leur circonférence, parce qu’ils s’affaiffent.
Les-ehofes ainfi préparées , on les paffe dans chaque
bras pour les fixer environ fur l’extrémité des
clavicules 8c autour de l'articulation des épaules ;
alors l’on paffe une courroie garnie d’une boucle ;
par-deffoiis les bourlets, vis-à-vis le derrière des
épaules, pour les rapprocher pendant le tems que
l’aide - chirurgien évafe leurs extrémités pour faire
la féduétion dès parties lézées. L’on doit concevoir
maintenant que c’efi: par le moyen de fon aéiion
qu’on ferre en raifon de l’elpece de la luxation ou
de la fraéture que l’on a à réduire. .
Il efl évident que par cette méthode, l’on contraint
les parties de maniéré qu’on n’a plus rien à
appréhender, ni pour le déplacement , ni pour la
fituation très-pénible du malade pendant toute la
guérifon. Par cette méthode auffi, l’dn peut ferrer
en raifon que les bourlets s’affaifient afin de tenir
les parties dans le même état qu’on le defire ; lorfque
les bourlets font des împreffions à la peau jufqu’à
déterminer des écorchures , l’on y remédie facilement
en gliflant une ou plufieurs petites compreffes
de l’épaifleur de trois ou quatre lignes fous le bour-
l e t , 8c à côté de l’endroit écorché. Par cet expédient
, l’on a l’avantage de foulager la peau du malade
& de panfer avec facilité les endroits écorchés
avec quelque petite pommade adouciffante, ou def-
ficative , puifqu’il réfulte de cette manoeuvre qu’on
n’efl: pas forcé de difeontinuer le traitement, comme
dans les autres méthodes, lorfque les bandes écor-.
chent 8c coupent les parties de la peau fur lesquelles
elles pofent.
Les ehofes étant ainfi difpofées * lin aide applique
fon genou contre le dos du malade entre les épaules,
qu’il prend avecles mains pour les évafer ejn dehors,
tandis qu’avec le genou, il pouffe le corps en avant,
d’où réfulte l’extenfion 8c la contre-extenfion, que
l’on fait plus ou moins forte, fuivant l’intention de
l’opérateur avant de remettre les pièces-rompues &
détachées dans leur fituation refpeélive. L’on fent
parfaitement que les ehofes étant ainfi affujetties,
il n’efl plus queflion que d’appliquer les topiques
convenables avec un appareil très-léger 8c le plus
fimple poffible , fans aucunement déranger les parties
luxées ou fraftufées.
Par cette méthode, i° . L’on n’aura plus befoinde
bandage roulé ni d’appareil' compliqué. z°.,On n’aura
plus à craindre le chevauchement des bouts de l’os ,
parce que les parties font toujours en extenfion
égale. 30. L’on verra chaque jour les progrès des
panfemens, 8c les bandages ne -feront plus fujets
à fe rélâcher, ou les compreffes à gliffer. 40. S’il y a
des opérations à pratiquer, on les fera avec toute
l’aifance poffible, 8c la chaleur 8c les démangeai-
fons qui font prefque infourenables pendant le traitement
feront calmés facilement par les moyens
connus pour les combattre.
De plus en fuppofant qu’on n’ eût point fous la
main la matière propre à faire les bourlets , comme
après une affaire, ou une retraite, à l’armée, l’on fe
fert de quelque corps que ce foit en attendant qu’o»
puiffe mieux faire ; le grand point efl de ne pas perdrg
de vue l'évafion des épaules & le moyen, de Les retenir
ainfi que nous l'avons expliqué. Par exemple, dans un
cas preffant, L’on a deux .mouchoirs pour faire des
bourlets , 8c des jarretières pour ferrer en guife de
courroie, oû bien l’on coupe la chemife du malade
pour en former les trois pièces néceflàires, afin de
pouvoir commodément tranfporter , où faire marcher
fon bleffé fans courir aucun danger. Il efl certain
que c’efl par cette manoeuvre que j’ai maintenu des
parties extrêmement maltraitées , 8c que je fuis parvenu
à guérir des malades plus sûrementque par les
autres méthodes. ( Cet article efi de M. Ch a b r o l ,
chirurgien-major du corps du génie, affocie, correspondant
du college royal de chirurgie de Nancy , détaché
à l'école royale du Corps du génie à Mejieres. )
CLAVIER , f. m. ( Mufiq. ) portée générale ou
fômme desfons de tout le fyftême qui’ réfulte de la
pofition relative de trois clefs. Cette pofition donne
une étendue de douze lignes, 8c par conféquent de
vingt-quatre degrés ou.de trois octaves & une quarte.
Tout ce qui excede en temt-otien bas cetefpace, •
ne peut fè noter qu’à l’aide d’une ou plufieurs lignes
poftiebes ou accidentelles , ajoutées aux cinq qui
compoferit la portée d’uné clef. Voyc^ pl. A . fig,
5 Olcl. raif. des Sciences, & c. l’étendue générale
du clavier. . • 1 r
Les notes ou touches diatoniques du clavier, lel-
quelles font toujours confiantes, s’expriment par des
lettres de l’alphabet, à la différence des notes de la
gamme, qui.étant mobiles 8c relatives à la modulation,
portent des noms qui expriment ces rapports.
Voyei G a m m e & S o l f i e r . Dicl. raif. des Sciences ,
& c . , . f
Chaque oélave du clavier comprend treize Ions ,
fept diatoniques 8c cinq chromatiques, reprefentes
fur le clavier inftrumental par autant de touches.
Voye? pl. I , fig- h Autrefois cés treize touches
répondoient à quinze cordes ; fçavoir, une de plus
entre le re dièfe & le mi naturel, l’autre entre 1 efol
dièfe & le la , & ces deux cordes qui formoient des
intervalles enharmoniques , & qu’on faifoit fonner
à volonté au moyen de deux touches brifées, furent
regardées alors comme la perfeâion du fyîlê-
me ; mais, en vertu de nos réglés de modulation ,
ces deux ont été retranchées’, parce qu’il en au r oit
fallu mettre par-tout. Voye1 C l e f , Po r t é e . ( Mu-
fique) Dictionnaire raif. des Sciences, &c. (S)
§ CLECHÉE, adj. f. ( terme de Blafon. ) fe dit
d’une croix vuide dont chaque branche s élargit à
l ’extrémité'& fait paroître* trois angles rentrans intérieurement
& autant d’angles faillans au dehors ,
lefquels font terminés par de petits boutons.
Cette croix efl ainfi nommée , de ce que ces branches
figurées de la forte, imitent les anneaux des
clefs des anciens. Voye^ planche I V , de fart Héraldique
fig. 188. Dicl. raif. des Sciences, & c.
La maifon de VenafqUè- que le pere Meneflrier
donne pour exemple au terme cleckéc, efl éteinte
depuis plus de deux fiecLes &: fondue dans une branche
de la maifon de Thefan à Avignon, que l’on
nomme Thefan-Vtnafque. ■ ■ .
Theard de Cotieres à Paris ; de gueules d la
croix vuidée y c léché e , pommetée & alefée d'or. ( G. D .
L. T. )
CLEF , f . f. davis, is , ( terme de Blafon. ) meuble
qui entre dans plufieurs écus.
Une clef feule fe ppfe en p a l, le panneton en
haut tourné â dextre ; fi elle étoit dans une autre
pofition , il faudroit l’exprimer en blafonnent.
Deux clefs font adoflees, ou affrontées, ou en
fautier.
Trois clefs, deux & une.
La clef défige la fureté*
D ’Antin de Saint-Pé-de-Hon en Bigorre , d'or à
sine clef de fable , couronnée d'une couronne ducale
de même.
Chevalier de la Coindardiere du Tais , de. Saulx
en Poitou j de gueules a trois clefs d'or. François, chevalier
de Saulx , occupa le premier le fiege épifeo-
pal d’Alais , érigé par bulle, d’ Innocent X II, datée du
16 mai 1694; les lettres-patentes du roi pour cette
éreétion , font du mois de Juin fuivant ; fa majefle
avoit choifi François, chevalier de Saulx, à caufe de
fon talent merveilleux pour la converfion des héré^
tiques dans ce téms de troubles des Cevenes , qui
continuoit encore , & ne finit qu’en 1701. ( G. D .
L. T. )
C l e f p e t i t e , (Mufiq.) on appelloit quelquefois
ainfi la clef de fa pofée fur la troifieme ligne, 8c
clef grande , la même clef pofée fur la quatrième
ligne. Aujourd’hui qu’on ne fe fert plus que de la
clef Aq fa fur la quatrième ligne, ces dénominations
fonthors d’ufage. (F . D. C.) ^
* § C l e f s - , ( Architecture navale. ) p i è c e s d e b o i s
Tome //.
qu’on établit dans les mailles des varangues 8c des
couplés, de diflance en diflance pour l’affermiffe-
ment des fonds du vaiffeau ; les clefs qu’on met
dans les mailles des varangues, font différemment
travaillées que celles qu’on met entre les mailles des
couples ; les premières doivent avoir pour hauteur
verticale;, celle depuis le deffus de la contre-quille
jufqu’au bord fupérieur des varangues, moins cependant
i’épaiffeur ou hauteur verticale de l’arrête
de la carlingue entre les varangues ; elles ont pour •
largeur horizontale celle de la contre-quille, 8c elles t
occupent tout le vuide d’une varangue à l’autre. On
fait à ces clefs une coupure dans la partie qui eft fur
la contre-quille pour faire écouler les eaux au canal
des anguilliers, 8c delà à l’archipompe : cette coupure
fe fait ainfi dans toute la largëür de la clef;
on donne à cette cpùpure deux pouces de hauteur
8c deux pouces 8c demi de longueur dans les plus
gros vaiffeaux, ôc à proportion dans les inférieurs;
Dès que toutes les clefs des varangues font, prêtes,
on les préfente 8c on les chafl'e enfemble 8c avec
force dans les mailles.
Les clefs qu’on met entre les mailles des couples
pour leur procurer un pareil affermiffement, l’ont’
établies de diflance en diflance, depuis la bauguiere
du premier pontjufqu’aux varangues. Elles ont pour
longueur deux fois l’épaiffeur des membres 8c on ne
doit leur donner pour épaiffeur que l’efpace du vuide
ou la maille comprife entre chaque couplé; on leur
laiffe quelquefois fur la partie intérieure des membres
du vaiffeau,un rebord d’un pouce ou deux, fuivant la
dimenfion des membres du vaiffeau , 8c cette arrête
s’empatte de deux côtés fur un des membres de deux
couples voifins qu’on entaille à cet effet ; on chafîe
également 8c enfemble toutes ces clefs. ( Injlruclion
Élémentaire & raifonnée fur la confiruclion pratique
des vaiffeaux , par M. Duranti de Lironcourt.
CLÉLIE, ( Hifioire Rom. ) fut une des dames
Romaines données en otage à Porfennà q u i, protecteur
desTarquins, exigeoit à main armée leur
rétabliffement ; fa fierté fut indignée d’être dans la
dépendance d’un roi , tandis que Rome libre ,
n’obéiffoit qu’à fes loix : elle ne crut pas manquer à
la foi des traités en fortant d’une efpece d’efclavage
qui bleffoit la dignité du nom Romain ; l’armée des
Tofcans étoit campée fur les bords du Tibre, 8c
l’on veilloit avec foin à la garde des otages. Clélie
affemble toutes les dames Romaines qui parta-
geoient fa deftinée ; on l’écoute avec tranfport : elle
fe met à leur tête 8c traverfant le camp fans être
reconnue, elle s’élance dans le fleuve avec fes compagnes
qu’elle rend à leur famille. Rome ajiplaù-
dit à cette généreufe réfolution, : mais fidelle ait
traité, elle les renvoyé à Porferina qui les redemande
pour tirer vengeance de leur parjure. Clélie
qui croyoit en avoir fait allez pour fa gloire , retourna
fans crainte dans le camp d’un ennemi qui
avoit droit de la punir. Sa confiance défarma le monarque
Tofcan q u i, faifi d’admiration , avoua que
l’a&ion dé Clélie avoit quelque chofe de plus héroïque
que le fanatifme de Mutius - Sctvold, 8c la témérité
défefpérée d'Horatius-Coclïs. Les Romains
lui érigerent une flatue équeftre fur la voie Sacrée^
C ’eft le premier monument de cette efpece qu’on
ait élevé aux femmes. Les moeurs étoient promptes
à s’alarmer. On avoit Cru jufqu’alors qu’il y a voit
de l’indécence dans le fpéCtacle d’une femme à cheval.
( T—tt. ) ,
§ CLÉMATITE, ( Botanique. ) en Latin , clema-
tis; en Anglois, virgin s bower; en Allemand, TVal-
dtebe.
Caractère générique^
La fleur efl dépourvue de calice, 8c formée dé
Mmm ij