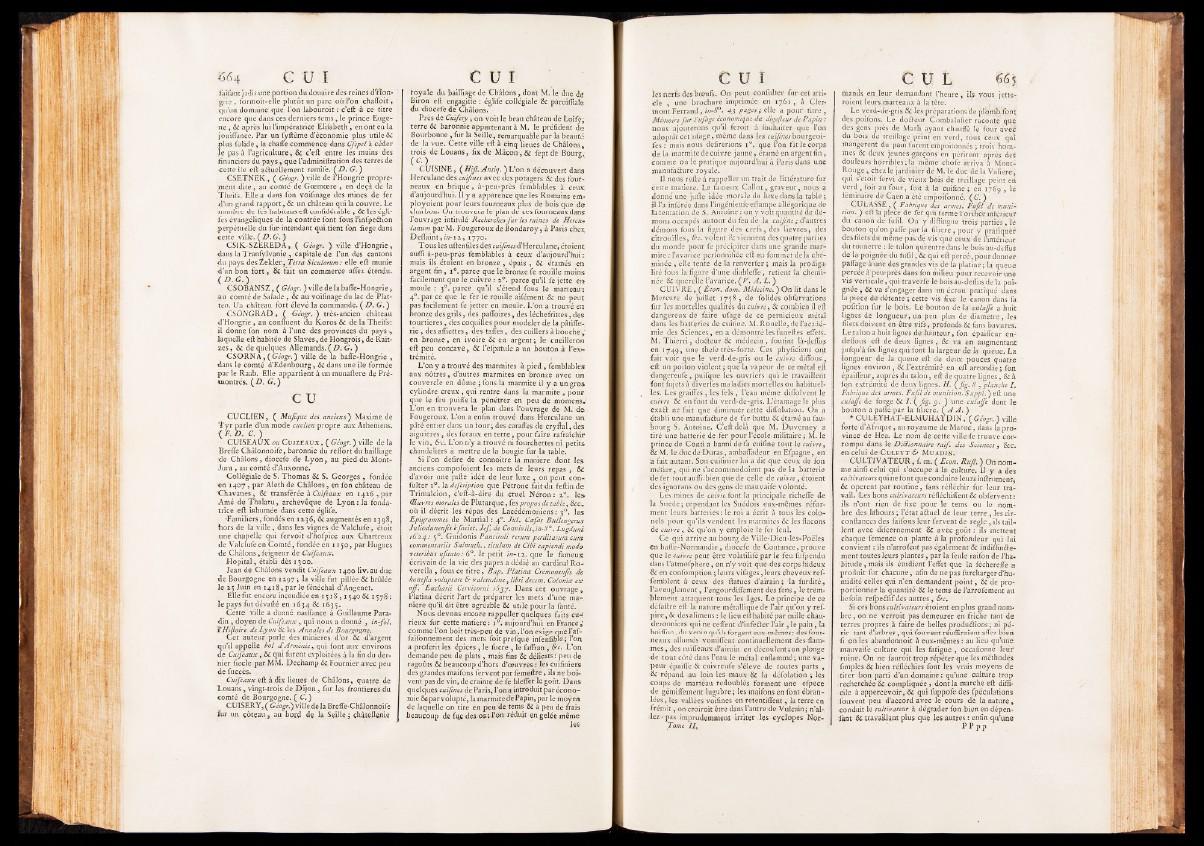
6 6 4 C U I
faifant jadis unè portion du douaire des reines d’Hongrie
, formoit-elle plutôt un parc où Fon chaffoit,
.qu’un domaine que l ’on labouroit : c ’eft à ce titre
encore que dans ces derniers tems, le prince Eugène
, & après lui l’impératrice Elisabeth, en ont eu la
jouiffance. Par un fyftême d’économie plus utile &c
.plus folide , la chaffe commence dans CJepel à céder
le pas à l’agriculture, & c’eft entre les mains des
financiers du pa ys, que l’adminiftration des terres de
■ cette île eft actuellement remife. (Z \ G .)
CSETNEK., ( Géogr. ) ville de l’Hongrie proprement
dite , au comté de Goemoere , en deçà de la
Theîfs. Ëlle a dans fon voilinage des mines de fer
<Tun grand rapport, & un château qui la couvre. Le
nombre de fes habitans eft confidérable , & les églises
évangéliques de la contrée font fous l’infpeCtion
.perpétuelle du fur-intendant qui tient fon fiege dans
cette ville. ( D . G. )
. CSIK-SZEREDA, ( Gèogr. ) ville d’Hongrie,
dans la Tranfylvanie , capitale de l’un des cantons
riu pays desZekler, Terra Siculorum: elle eft munie
■ d’un bon fo r t -, & fait un commerce affez étendu.
I d . g . )
CSOBANSZ, ( Géogr. ) ville de la baffe-Hongrie >
au comté de Salade , & au voilinage du lac de Plat-
ten. Un château fort élevé la commande. ( D .G .)
CSONGRAD, ( -Géogr. ) très-ancien château
d ’Hongrie , au confluent du Koros & de la Theifs-:
il donne fon nom à l’une des provinces du pays >,
laquelle eft habitée de Slaves,de Hongrois, de Rait-
ze s, & de quelques Allemands. ( D . G. )
C SO R N A , (Géogr.) ville de la bafle-Hongrie ,
■ dans le comté d’Edenbourg, & dans une île formée
par le Raab. Elle appartient à un monaftere de Pré-
«nontrés. (Z>. G. )
C U
CÜCLIEN, ( Mufique des anciens') Maxime dè
T y r parle d’un mode cuclien propre aux Athéniens.
( F. D . C. )
CUISEAUX ou Cuizeaux , ( Géogr. ) ville de la
Breffe Châlonnoife, baronnie du reffort du bailliage
de Châlons, diocefe de L y on , au pied du Mont-
Jura , au comté d’Auxonne.
Collégiale de S. Thomas & S. Georges , fondée
en 1407, par Aleth de Châlons, en fon château de
Chavanes, & transférée à Cuifeaux en 14x6 , par
Amé de Thalaru, archevêque de Lyon : la fondatrice
eft inhumée dans cette églife.
»Familiers, fondés en 1x36, & augmentés en 1398,
hors de la ville, dans les vignes de Valclufe, étoit
une chapelle qui fervoit d’hofpice aux Chartreux
de Valclufe en Comté, fondée en 1150, par Hugues
de Châlons, feigneur de Cuifeaux.
Hôpital, établi dès 1300.
Jean de Châlons vendit Cuifeaux 1400 liv.au duc
de Bourgogne en 1X97 ; la ville fut pillée & brîilée
le 15 Juin en 1418, par le fénéchal d’Angenet.
Elle fut encore incendiée en 15 18,1540 & 1578 :
le pays fut dévafté en 1634 & 1635.
Cette ville a donné naiffance à Guillaume Para-
din , doyen de Cuifeaux, qui nous a donné , in-fol.
VHiJioire de Lyon & les Annales de Bourgogne.
Cet auteur parle des minières d’or & d’argent
qu’il appelle bol d’Arménie, qui font aux environs
de Cuifeaux, & qui furent exploitées à la fin du dernier
fiecle par MM. Dechamp &c Fournier avec peu
de fuccès.
Cuifeaux eft à dix lieues de Châlons, quatre de
Louans, vingt-trois de D ijon , fur les frontières du
comté de Bourgogne. ( C.)
CUISERY, ( Géogr.) ville de là Breffe-Châlonnoife
fur un çôteau, au bord de la Sçille ; châtellenie
C U I
royale du bailliage de Châlons, dont M. le duc d<*
Biron eft engagilte : églife collégiale &c pâroifliale
du 'diocefe de Châlons.
Près de Cuifery, on voit le beau château de Loifÿ,’
terre & baronnie appartenant à M. le préfident de
Bourbonne , fur la Seille, remarquable par la beauté
de la vue. Cette ville eft à cinq lieues de Châlons,
trois de Louans, fix de Mâcon -, & fept de Bourg.
CUISINE, ( Hifi. Antiq. ) L’on a découvert dans
Herculanedes cuijines avec des potagers &c des fourneaux
en brique , à-peu-près femblables à ceux
d’aujourd’hui. 11 y a apparence que les Romains erfi-
ployoient pour leurs fourneaux plus de bois que de
charbon. On trouvera le plan de ces fourneaux dans
l’ouvrage intitulé Recherches fur les ruines de Hercu«
•lanum par M. Fougeroux de Bondaroy, à Paris chez^
Deflaintji/z-iz, 1770.
Tous les uftenfiles des cuifines d’Herculane, étoient
aufti à-peu-près femblables à ceux d’aujourd’hui:
mais ils étoient en bronze , épais , &c étamés en
argent fin, i° . parce que lé bronze fe rouille moins
facilement que le cuivre ; x°. parce qu’il fe jette et»
moule : 30. parce qu’il s’étend fous le marteau’:
40. par ce que le fer fe rouille aifément & ne peut
pas facilement fe jetter en moule. L’on a trouvé en
■ bronze des grils, des paflbires, des léchefrittes, des
tourtières, des coquilles pour modeler de la pâtiffe-
r ie , des affiettes, des taffes, des cuillers à bouche
en bronze, en ivoire & en argent ; le cueilleron
eft peu concave, & l’efpatule a un bouton à l’ex*-
trémité. . . ^ .
L’on y a trouvé des marmites à pied, femblables
aux nôtres, d’autres marmites en bronze avec un
couvercle en dôme,; fous la marmite il y a un gros
cylindre creux , qui rentre dans la marmite , pour
que le feu puiffe la pénétrer en peu de momensJ
L on en trouvera le plan dans l’ouvrage de M-. de
Fougeroux. L’on a enfin trouvé dans Herculane un
pâté entier dans un four; des caraffes de cryftal, des
aiguieres, des fceaux en terre, pour faire rafraîchir
le vin, &c. L’on n’y a trouvé ni fourchettes ni petits
chandeliers à mettre de la bougie fur la table»
Si l’on defire de connoître la maniéré dont les
anciens compofoient les mets de leurs repas , ôc
d’avoir une jufte idée de leur luxe , on peut con-,
fulter i° . la defeription que Pétrone fait du feftin de
Trimalcion, c’eft-à-dire du cruel Néron: x'\ les
OEuvres morales de Plutarque, fes propos de table, & c .
où il décrit les fépas des Lacédémoniens: 30. les
Epigrammes de Martial : 40. Jul. Ccefar Bullengerus
Juliodunenfis é fociet. Jef. de Conviviisy in-8°. Lugduni
1C2.4: 50. Guidonis Panciroli rerum perditarum cuih
commentants Salmuth.. titulum de Cibi capiendi modo
veteribus ufitato:6°. le petit in~ 11. que le fameux
écrivain de la vie des papes a dédié au cardinal Ro-
verella , fous ce titre, Bap. Plalince Cremonehfis de
honefia voluptate & valetudine , libri decem. Colonies ex
off. Eucharii Cervicorni iS37. Dans cet ouvrage,
Platina décrit l’art de préparer les mets d’une maniéré
qu’il dit être agréable & utile pour la fanté.
Nous devons encore rappeller quelques faits cu-î
rieux fur cette matière : 1°. aujourd’hui en France,’
comme l’on boit très-peu de vin, l’on exige que l’af-
faifonnement des mets foitprefque infenfible; l’on
a proferit les épices , le fucre , le faffran , Gc. L’on
demande peu de plats , mais fins & délicats: peu de
ragoûts & beaucoup d’hors d’oeuvres : les cuifiniers
des grandes maifons fervent par femeftre, ils ne boivent
pas de vin, de crainte de fe bleffer le goût. Dans
quelques cuifines de Paris, l’on a introduit par économie
ôi par volupté, la marmite de Papin, par le moÿen
de laquelle on tire en peu de tems & à peu de frais
beaucoup de fiic des os-Ton réduit en gelée même
}es
C U I
îes nerfs des boeufs. On peut confulter furcet article
, une brochure imprimée en 1 7 6 1 , à Clermont
Ferrand, in-8°. 43 F ages » elle a pour titre ,
■ Mémoire fur Çufage économique du digefleur de Papin :
nous ajouterons qu’il feroit à .fouhaiter que l’on
adoptât cet. ufage, même dans les cuifines bourgeoises
: mais nous defirerions i° . que l’on fît le corps,
de la marmite de cuivre jaune, étamé en argent fin,
comme on le pratique aujourd’hui à Paris dans une
manufaéhire royale.
Il nous refte à rappeller un trait de littérature fur
cette matière. Le fameux Callot, graveur, nous a
donné une jufte idée morale du luxe dans la table;
il l’a inférée dans l’ingénieufeeftnmpe allégorique, de
la tentation de S. Antoine : on y voit quantité d,e dé-r
mons occupés autour du feu de la, cuifinc ; d’autres
démons fous la figure des cerfs, des lievres, des
citrouilles, &c. volent & viennent des quatre parties
du monde pour fe précipiter dans une grande marmite
: l’avarice perfonnifiée eft au fommet de la cheminée
, elle tente de la renverfer ; mais la prodigalité
fous la figure d’une diableffe, retient là cheminée
& querelle l’avarice. ( V. A . L. )
CU IVR E, ( Êcon. dom. Médecine. ) On lit dans le
Mercure de juillet 1758 , de folides obfervàtions
fur les mortelles qualités du cuivre, & combien il eft
dangereux de faire ufage de ce pernicieux métal
dans les batteries de cuiline. M. Rouelle, de l’académie
des Sciences, en a démontré lesfuneftes effets.
M. Thierri, doâeur & médecin, fou tint là-deflus
en 1749, une thefe très-forte. Çes phyfieiens on,t
fait voir que le verd-de-gris ou le cuivre diffous,
eft un poifon v iolent; que la vapeur de ce métal eft
dangereufe, puifque les ouvriers qui le travaillent
fontfujets à diverfes maladies mortelles ou habituelles.
Les graiffes , les fels ÿ-'f’eau même diffolvent le
cuivre & en font du verd-de-gris. L’étamage le p.lu?
exaft ne fait que diminuer cette diffolution. On à
établi une mânufaûure de fer battu & étamé au faubourg
S. Antoine» G’eft delà que M. Duverney a
tiré une batterie de fer pour l ’éçole-militaire; M. le
prince.de COnti a banni de fa cuifine tout le cuivre,
& M. le duede Duras, ambaffadeur enEfpagne, en
a fait autant. Son cuifinier lui a dit que ceux de fon
métier, qui ne s’accommodoient pas de la batterie
de fer tout aufli-bien que de celle de cuivre, étoient
des ignorans ou des gens de mauvaife volonté.
Les minés de cuivre font la principale richeffe de
la Suede ; cependant les Suédois eux-mêmes réforment
leurs batteries: le roi a écrit à tous’lès colonels
pour qu’ils vendent les marmites St les flacons
de cuivre , & qu’on y emploie le fer feul.
Ce qui arrive au bourg, de Ville-Dieu-les-Poëles
en baffe-Normandie, diocefe de Coutance, prouve
que le cuivre peut être volatilifé par le feu fufpendu
dans l’atmofphere, on n’y voit que.des corps hideux
& en confomption ; leurs vifages, leurs cheveux ref-
■ femblent à ceux des ftatues d’airain; la furdité,
l ’aveuglement, l’engourdiffement des fens, le tremblement
attaquent tous les âges. Le principe de ce
défaftre eft'la nature métallique deTair qu’on y ref-
pire, & desalimens : le lieu eft habité par mille chau-
deronniers qui ne ceffent d’infefter l’air ,1e pain, la
boiffon, du venin qu’ils forgent eux-mêmes: des fourneaux
allumés vomiffent continuellement des flammes
, des ruiffeaux d’airain en découlent;on plonge
de tout côté dans l’eau le métal enflammé; une vapeur
épaiffe & cuivreufe s’élève de toutes parts ,
& répand au loin les maux & la défolation ; les
coups de martëau redoublés forment une efpece
de gémiffement lugubre ; les maifons en font- ébranlées,
les vallées voifines en retentiffent, la terre en
frémit, on croiroit être dans l’antre de Vulcain; n’al-.
lez - pas imprudemment irriter les eyclopes Nor-
Tome //,
CÜL 665
fliands en leur demandant l’heure, ils vous, jette-
roient leu’rs.marteaux à la tête.
Le verd-de-gris Sf. les^ préparations de plomb;ïpn£
des poifons. Le doéieur Combalufier raconte, que
des gens près de Marli. ayant chauffé le four àvée
du bois, de treillage peint en verd, tous ceux qiu
mangefent du pain furent empoifonnés ; trois' hom-
mes & deux jeunes gârçOns en périrent après des
douleurs horribles; la même chofe arriva à Mont-^
Rouge , chez le jardinier'de M. le duc delà Valiere,
qui s’étoit fervi de vieux bois de treillage peint en
verd', foit au four, foit à la cuifine ; en 1769 , lë
féminaire de Caen a été empôiforiné. ÇC. )
CULASSE, ( Fabrique, des armes. Fufil de muni-
eft la pièce'de fer qui ferme l’orifice inférieur
du canon de' fufil. On y'diftingue trois parties , le
bouton qu’on paffe par la filiere ? pour’y pràtlquér
des filets’dit même pas'de vis que ceux dé ^intérieur
du tonnerre : le talon qui entré dans -le bois aû-deffiià
de’ la poignée du fufil, & qui eft percé, pour donner
paffage' à une des grandes vis de la platiné; la quèue
percée à peu-près dans fon milieu pour recevoir une
vis verticale', qui travérfë leboisau-deffusde la poignée
, & va s’engager dans Un écrou pratiqué dans
la pieée de détente ; cette vis fixe le canon dans fa
pofition fur le bois.- Le bouton de la cuïaffe a huit
lignes'de longueur,.un peu plus de diamètre, les
filets doivent en être vifs , profonds & fans, bavures.
Le talon a huit lignes de .hauteur, fon épaiffeur en-
deflbus eft de deux lignes, & va en augmentant
jufqu’à fix lignes qui font la iargèur d.e la q.ii.eue. La
longueur de la queue eft de deux pouces quatre
lignes environ, & l ’extrémité en eft arrondie; fon
épaiffeur, auprès du talon, eft de quatre ligne?, & à
fon extrémité de deux lignes. H. ( fig. 8 , planche I.
Fabrique des armes. Fufil de munition. Suppl. ) eft une
culajfe de forge &: /. ( fig. c>. ) une cutafic dont le
bouton a paffé par la filiere. ( A A t )
* CULEYHAT-ELMUHAYDIN ,• ( Géogr. ) villé
forte d’Afrique, au royaume de Maroc, dans la province
de Hea. Le nom de cette villeffe trouve corrompu
dans le Dictionnaire raif. des Sciences , &c;
en celui de !C u le y t <S* Mü adin.
CULTIVATEUR, f. m. ( Êcon. Rufii ) On nomme
ainfi celui qui s’occupe à la culture. Il y a dés
cultivateurs quine font que conduire leurs inftrumens;
& opèrent par routine, fans réfléchir fur leur travail.
Les bons cultivateurs réfléchiffent Sc obfervent :
ils n’ont rien de fixe pour le tems ou le nombre
des lâbours ; l’état a&uel de leur terre * les cir-
conftances des faifons leur fervent de réglé, ils taillent
avec difeernement & avec goût : ils mettent
chaque femence ou plante à la profondeur qui lui
convient : ils n’arrofent pas également & indiftinéle-
ment toutes leurs plantes, par la feule ràifon de l’habitude
, mais ils étudient l’effet que la féchereffe a
produit fur chacune, afin de ne pas fùrcharger d’humidité
celles qui n’en demandent point, & de proportionner
la quantité & le tems de l’arrofement au
:befpin refpeéfif des autres, &c.
Si ces^tons cultivateurs étoient en plus grand nom*
bre, on ne verroit pas demeurer en friche tant de
terres propres ,à faire de belles productions ; ni périr
tant d’arbres, qui fouvent réuflïroient affez bien
fi on les abandonnoit à eux-mêmes : au lieu qu^une
mauvaife culture qui les fatigue , oecafionne leuf
' ruine. On ne fauroit trop répéter que les méthodes
fimples & bien réfléchies font les vrais moyens de
tirer bon parti d ’un domaine : qu’une culture trop
-recherchée & compliquée, dont la marche eft difficile
à appercevôir, & qui fuppofe des fpéculations
fouvent peu d’accord avec le cours de la nature,
conduit le cultivateur à dégrader fon bien en dépen*
fant & travaillant plus que les autres : enfin qu’une