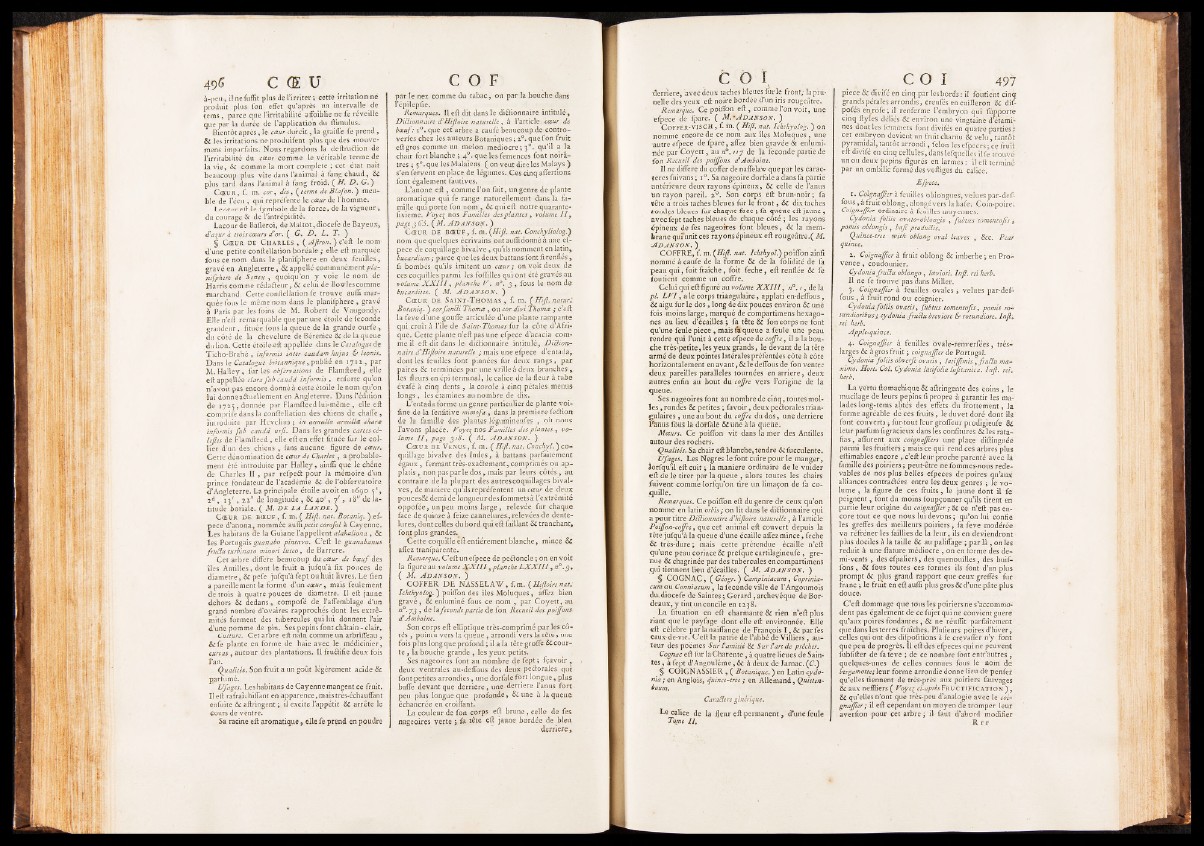
à-peti » il nefuffit plus dé l’irriter ; cette irritation ne
produit plus fon effet qu’a près un intervalle de
tems , parce que l’irritabilité affoiblie ne fe réveille
que par la durée de l’application du ftimulus.
Bientôt après, le coeur durcit, la graille fe prend,
& les irritations ne produifent plus que des mouve-
mens imparfaits. Nous regardons la deftr'ucHon de
l’irritabilité du coeur comme le véritable terme de
la vie, 8c comme la mort complété ; cet état naît
beaucoup plus vîte dans l’animal a fang chaud, 8c
plus tard dans l’animal à fang froid.'(Æf. D . G .)
C(EUR, f. m. cor, dis y (terme de Blafon.) meu-,
•ble de l’écu , qui repréfente le coeur de l’homme.
Lecteur eft le fymbole de la force, de la vigueur>
du courage & de l’intrépidité.
Lacour de Balleroi, de Maltot, diocefe de Bayeux,
d'azur à trois coeurs d’or. ( G. D. L. T. )
§ Coeur de Charles ( AJlron. ) c’eft le nom-
d ’une petite conftellation boréale ; elle eft marquée
fous ce nom dans le planifphere en deux feuilles,
gravé en Angleterre, &appellé communément planifphere
de Senex , quoiqu’on y voie le nom de
Harris comme rédacteur, & celui de Bowlescomme
marchand. Cette conftellation fe trouve aufli marquée
fous le même nom dans le planifphere , gravé
à Paris par les foins de M. Robert de Vaugondy.
Elle n’eft remarquable que par une étoile de fécondé
grandeur, fituée fous la queue de la grande ourfe ,
du côté de la chevelure de Bérénice 8c de la queue
du lion. Cette étoile^eft appellée dans le Catalogue de
Ticho-Brahé , informis inter caudam hujus & leonis.
Dans \e Catalogue britannique, publié en 1 7 1 1 , par
M. Halley, fur les obfervations de Flamfteed, elle
eft appellée clara fub caudâ informis , enforte qu’on
n’avoit pas encore donné à cette étoile le nom qu’on
lui donne a&uellement en Angleterre. Dans l’édition
de 1725, donnée par Flamfteed lui-même , elle eft
comprife dans la conftellation des chiens de chaffe,
introduite par Hevelius ; in annullo armilloe charte
informis fub caitdd urfî. Dans les grandes cartes cé~
lejles de Flamfteed, elle eft en effet fituée fur le collier
d’un des chiens , fans aucune figure de coeur.
Cette dénomination de coeur de Charles , a probablement
été introduite par Halley, ainffi que le chêne
de Charles II , par refpeft pour la mémoire d’un
prince fondateur de l’académie 8c de l’obfervatoire
d’Angleterre. La principale étoile avoit en 1690 5%
ad , 13' , 22" de longitude , & 40d, 7 ' , 18" de latitude
boriale. ( M. d e l a L a n d e . )
Coeur de boeuf , f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ),ef-
pece d’anona, nommée aufli petit corofol à Cayenne.
Les habitans de la Guiane l’appellent alakaliona , 8c
les Portugais guanabo pintavo. C’eft le guanabanus
fruclu turbinato minori luteo, de Barrere.
Cet arbre différé beaucoup du coeur de boeuf des
îles Antilles, dont le fruit a jufqu’à fix pouces de
diamètre, 8c pefe jufqu’à fept ou huit livres. Le fien
a pareillement la forme d’un coeur, mais feulement
de trois à quatre pouces de diamètre. Il eft jaune
dehors & dedans, compofé de, l’affemblage d’un
grand nombre d’ovaires rapprochés dont les extrémités
forment des tubercules qui lui donnent l’air
d’une pomme de pin. Ses pépins font châtain-clair.
Culture. Cet arbre eft nain comme un arbriffeau ,
& f e plante en forme de haie avec le médicinier,
curcas, autour des plantations. Il fruûifie deux fois
l’an.
Qualités. Son fruit a un goût légèrement acide &
ptarfume.
Ufages. Les habitans de Cayenne mangent ce fruit.
Il eft rafraîchiffant en apparence,maistres-échauffant
enfuite 8c aftringent ; il excite l’appétit 8c arrête le
cours de ventre.
Sa racine eft aromatique, elle fe prend en poudre
par le nez comme du tabac, ou par la bouche.dans
l’épilepfie.
Remarques. Il eft dit dans le dictionnaire intitulé,
Dictionnaire d’Hißoire naturelle , à l’article, coeur de
boeuf: i°. que cet arbre a caufé beaucoup de-contro-
verfes chez les auteurs Botaniques ; 20. que fon fruit
eft gros, comme un melon médiocre; 30. qu’il a la
chair fort blanche ; 40. que les femences font noirâtres
; 50. que lesMalaïens (;on veut dire les Malays )
s’en fervent en place de légumes. Ces cinq affertions
font également fautives.
L’anone eft , comme l’on fait, un genre de plante
aromatique qui fe range naturellement dans la famille
qui porte fon nom , 8c qui eft notre quarante-
fixieme. Voye7 nos Familles des plantes, volume ƒ/ ,
page g SS. ( M. A d a n so n . )
Coeur de boeuf , f. m. (Hiß. nat. Conchyliolog.)
nom que quelques écrivains ontauflidonnéàune ef-
pece de coquillage bivalve, qu’ils nomment en latin*
buçardium; parce que les deux battans font fl renflés ,
li bombés qu’ils imitent un coeur ; on voit deux de
ces coquilles parmi les foflilles qui ont été gravés au
volume X X I I I , planche V . n°. g , fous le nom de
bucardites. ( M. A d a N SO N . )
Coeur de Saint-Th om a s, f. m. (Hiß. naturl
Botaniq. ) corfancli Thomoe , ou cor divi Thomoe ; c’eft
la feve d’une gouflë articulée d’une plante rampante
qui croît à l’île de Saint-Thomas fur la côte d’Afrique.
Cette plante n’eft pas une efpece d’acacia comme
il eft dit dans le- dictionnaire intitulé, Dictionnaire
dHißoire naturelle ; mais une efpece d’entada,
dont les feuilles font pinnées fur deux rangs, par
paires 8c terminées par une vrille à deux branches *
les fleurs en épi terminal, le calice de la fleur à tube
évafé à cinq dents , la corole à cinq pétales menus
longs , les étamines au nombre de dix.
L’entada forme un genre particulier de plante voi-
fine de la fenfitive mimofa , dans la première feCtion
de la famille des plantes légumineufes , où nous
l’avons placée. Vcye{ nos Familles des plantes, volume
I I , page g 18. ( M. A d a n so n . )
Coeur de Venus , f. m. ( Hifl. nat. Conchyl. ) coquillage
bivalve des Indes, à battans parfaitement
égaux, fermant très-exaCtement, comprimés ou ap-
platis, non pas par le dos * mais par leurs côtés, au
contraire delà plupart des autres coquillages bivalv
es, de maniéré qu’ils repréfentent un coeur de deux
pouces& demi de longueur des fommets à l’extrémité
oppofée, un peu moins large, relevée fur chaque
face de quinze à feize cannelures, relevées de dentelures,
dont celles du bord qui eft faillant 8c tranchant,
font plus grandes.
Cette coquille eft entièrement blanche, mince 8c
affez tranfpàrente.
Remarque. C ’eft un efpece de peCtoncle ; on en voit
la figure au volume X X I I I , planche L X X I I I , n° .g*
( M. A d a n s o n . )
COFFER DE NASSELAW, f.m. (Hißoire natl
Ichthyolog. ) poiflon des îles Moluques, aflez bien
gravé, & enluminé fous ce nom , par C o y e tt ,au
n°. y g , de lafécondé partie de fon Recueil des poiffons
d'Amboine.
Son corps eft elliptique très-comprimé par les cotés
pointu vers la queue, arrondi vers la tête, une
fois plus long que profond ; il a la têtegroffe &cour-,
te , la bouche grande , les yeux petits. •
Ses nageoires font au nombre de fept ; fçavoir ,
deux ventrales au-defîbus des deux pectorales qui
font petites arrondies, une dorfale fort longue, plus
baffe devant que derrière, une-derrière l’anus fort
peu plus longue que profonde, & une à la queue
échancrée en croiflant.
La couleur de fon corps eft brune, celle de fes
nageoires verte ; fa tête eft jaune bordée de bleu
derrière,
•derrière, avec deux taches bleues furie front; la prunelle
des yeux eft noire bordée ;d’un iris rougeâtre.
Remarque. Ce poiflon eft , comme l’on voit, une
efpece de fparé. ( M.*A d an so n . )
Coffer-v is ch , f. m. ( Hiß. nat. Ichthyolog.') on
nomme encore de ce nom aux îles Moluques, une
autre efpece de fpare, aflez bien gravée & enluminée
par C o ÿ e tt, au n°. n y de là fécondé partie de
Ion Recueil des poiffons dAmboine.
Il ne différé du coffer de naffelaV que par les caractères
fuivaris ; i° . Sa nageoire dorfale a dans fa partie
antérieure deux rayons épineux, 8c celle de l’anus
Un rayon pareil. z ° . S'on corps eft brun-noir; fa
t è t e a trois taches bleues fur le front, 8c dix taches
rondes bleues fur chaque face ; fà quéue eft jaune,
avec fept taches bleues de chaque côté ; les rayons
épineux de fès nageoires font bleues, & la membrane
quninit ces rayons épineux eft rougeâtre. ( M.
A d a n s o n . )
COFFRE, f. m .(Hiß. hat. Ichthyol.) poiflon àirtfi
nommé à caufe de la forme 8c de la folidité de fa
peau qui, foit fraîche, foit feche, eft renflée & fe
foutient comme un coffre.
Celui qui eft figuré au volume X X I I I , n°. /, dé là
pl. L V I , a le corps triangulaire, applati en-deffous,
& aigu fur le dos, long de dix jiouces environ & une
fois moins large-, marqué de compartimens hexagones
au lieu d’écailles ; fa tête & fon corps ne font
qu’une feule piece , mais la queue a feule une peau
tendre qui l’unit à cette efpece de coffre, il a la bouche
très-petite, les yeux grands, le devant de la tête
armé de deux pointes latérales préfentées côte à côté
horizontalement en avant, & le deffoùsde fon ventre
deux pareilles paralleles tournées en arriéré, deu*
autres enfin au bout du coffre vers l’origine de la
queue.
Ses nageoires font âu nombre de cinq, toutes mol- .
le s , rondes & petites ; favoir, deux peftorales triangulaires
, une au bout du coffre du dos, une derrière
l'anus fous la dorfale &une à la queue.
Moeurs. Ce poiflon vit dans la mer des Antilles
autour des rochers.
Qualités. Sa chair eft blanche, tendre &fucculente.
Ufages. Les Negres le font cuire pour le manger,
lorfqu’il eft cuit ; la maniéré ordinaire de le vuider
e f t de le tirer par la queue , alors toutes les chairs
fuivent comme lorfqu’on tire un limaçon de fa coquille.
Remarques. Ce poiflon eft du genre de ceux qu’on
nomme en latin orbis ; on lit dans le di&ionnaire qui
a pour titre Dictionnaire d'hißoire naturelle, à l’article
Poijfon-coffre, que cet animal eft couvert depuis la
tête jufqu’à la queue d’une écaille affez mince, feche
& très-dure; mais cette prétendue écaille n’eft
qu’une peau coriace & prefque cartilagineufe , grenue
& chagrinée par des tubercules en compartimens
qui tiennent lieu d’écailles. ( M. A d a n s o n . )
§ CO GN A C , ( Géogr. ) Campiniacum, Coprinia-
cum ou Conniacum, la fécondé ville de l’Angoumois
du^diocefe de Saintes ; Gérard, archevêque de Bordeaux,
y tint un concile en 123 8.
La ïituation en eft charmante & rién n’eft plus
riant que le payfage dont elle eft environnée. Elle
«ft célébré parlanaiflance de François I ,& p a r fe s
eaux-de-vie. C’eft la patrie de l’abbé de Villiers, auteur
des poëmes Sur C amitié & Sur C art de prêcher.
Cognac eft fur la Charente, à quatre lieues de Saim
tes, à fépt d’Angoulême , & à deux de Jarnac. ((?.)
§ COIGNASSIER , ( Botanique. ) en Latin cydo-
nia ; en Anglois, quince-tree ; en Allemand, Quitten-
baum.
Caractère générique.
Le calice de la fleur eft permanent, d’une feule
Tapie IL
piece & divifé en cinq par lesbords: il foutient cinq
grands pétales arrondis, çreufés en cuilleron & dil-
pofé’s en^rofe ; il renferme l’émb'ryoh qui fiipporte
cinq ftyleS déliés & environ uné vingtaine d’étamines
dont les fomrhets font divifés eri quatre parties :
cet embryon devient un fruit charnu & v elu, tantôt
pyramidal, tantôt arrondi, félon les efpeces; ce fruit
eft divifé en cinq cellules, dans lefqùelles ilfe trouvé
un ou deux pépins figurés en larmes : il eft terminé
par un ombilic formé des veftiges du Calice.
Efpece.
1. Coignafßer à feuilles oblongues, velues par-de f-
fous, à fruit oblong, alongé vers la bafe. Coin-poirei
Coignafßer ordinaire à feuilles moyennes.
Cydonia foliis ovato-ôblongis , fubtus tomentofis ;
pomis oblongis , baß produclis.
Quince-tree with oblong oval leaves , &C. Pear
1fuinee.
2. Coignafßer à frliit oblong & imberbe ; en Provence
, coudounier.
Cydonia fruclu oblongo , loeviori. Inß, ni herb.
Il ne fe trouve pas dans Miller.
3. Coignafßer à feuilles ovales ; velués par-def^
fous., à fruit rond ou coignier.
Cydonia foliis ovatis, fubtus tomentofis y pomis ro-
tundioribus; cydonia fruclu breviàre & rotundiore. Inß;
ni herb.
Apple-quince
4. Coignafßer à feuilles Ovàle-fehverfées, très-
larges 8c à gros fruit ; coignafßer de Portugal.
Cydonia foliis obverfe ovatis , latiffimis ; fruclu ma-
ximo. Hort. Col. Cydonia làtifolia lufitdnica. Inß. rel.
herb.
La vertu ftomaçhiqüe & aftringenté des coins , le
mucilage de leurs pépins fi propre à garantir les malades
long-tems alités des effets du frottement, la
forme agréable de cés fruits, le duvet doré dont ils
font couverts , fur-tout leur groffeur protîigieufe &
' leUr parfum figracieux dans les confitures & les ratafias
, affurent aux coignafßers une place diftinguée
parmi les fruitiers ; mais ce qui rend ces arbres plus
eftimables encore ,,c’eft leur proche parenté avec là
famille des poiriers ; peut-êtré ne fommes-nous redevables
de nos plus belles efpeces de poires qu’aux
alliances côntraftées entre les deux genres ; le volume
, la figure de ces fruits, le jaune dont il fe
peignent, font du moins loupçonner qu’ils tirent eri
partie leur origine du coignafßer ; 8c ce n’eft pas encore
tout ce que nous lui devons ; qu’on lui confie
les greffes des meilleurs poiriers, fa feve modérée
va réfréner les faillies de la leur, ils en deviendront
plus dociles à la taille 8c au paliflage ; par là , on les
réduit à une ftàture médiocre , on en forme des demi
vents , des efpaliers, des quenouilles, des buif-
fons, & fous toutes ces formes ils font d’un plus
prompt & plus grand rapport que ceux greffés fur
franc ; le fruit en eft aufli plus gros & d’une pâte plus
douce.
C ’eft dommage que tôus les poiriers né s’accommodent
pas également de ce fujet qui ne convient gueré
qu’aux poires fondantes , & ne réuflït parfaitement
que dans les terres fraîches. Plufieurs poires d’hiver,
celles qui ont des difpofitions à fe crevaffer n’y font
que peu de progrès. Il eft des efpeces qui ne peuvent
fubfifter de fa lève ; de ce nombre fönt entf’àutres ,
quelques-unes de celles connues fous le nom dé
bergamotte; leur forme arrondie donne lieu de penfer
qu’elles tiennent de très-près aux poiriers fauvages
& aux neffliers ( Foÿe^ ci-après Fructification ) ,
& qu’elles n’ont que très-peu d’analogie avec le coignafßer
;\\ eft cependant un moyen de tromper leur
averfion pour cet arbre ; il faut d’abord modifier
R r r