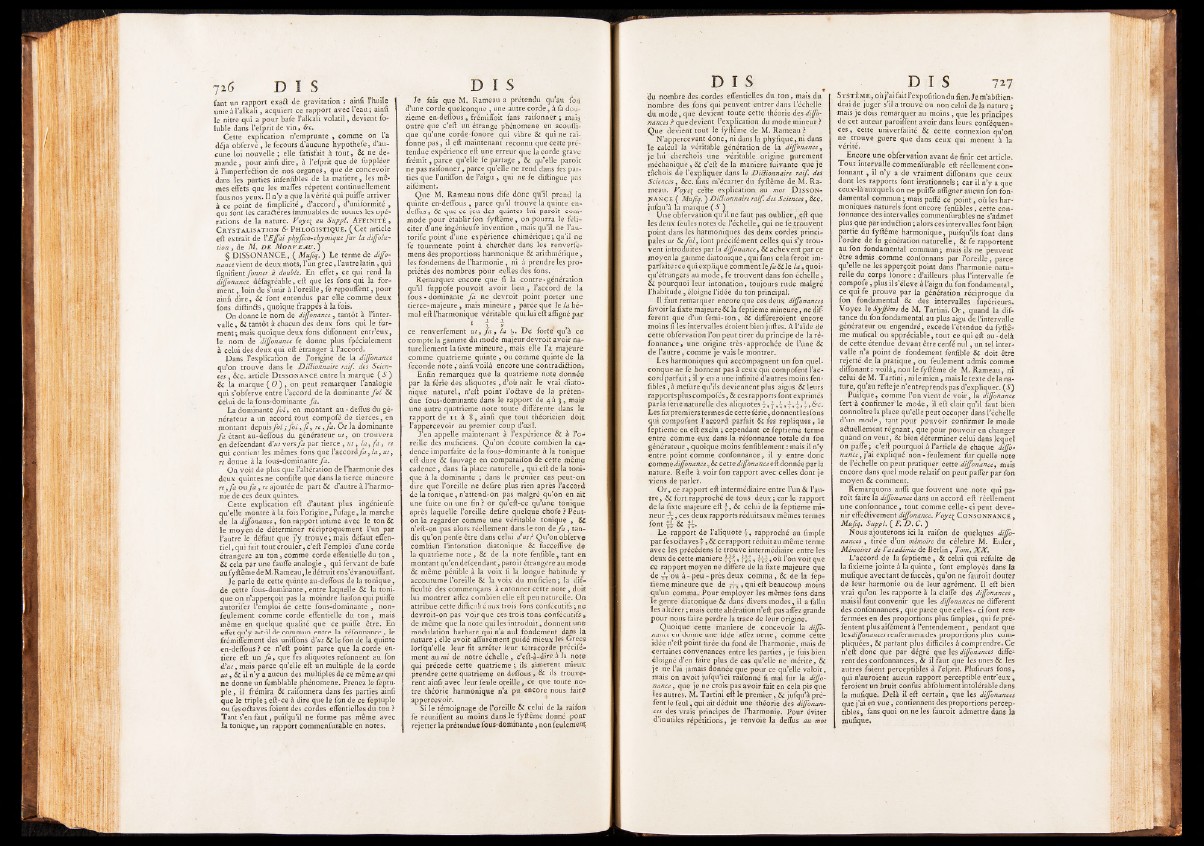
fant un rapport exaft de gravitation : ainfi l’huile
unie à l’alkali, acquiert ce rapport avec l’eau ; ainfi
le nitre qui a pour bafe l’alkali volatil, devient fo-
luble dans l’efprit de vin, &c.
Cette explication n’emprunte , comme on l’a
déjà obfervé , le fecours d’aucune hypothefe, d’aucune
loi nouvelle ; elle fatisfait à tout, & ne demande
, pour ainfi dire, à l’efprit que de fuppléer
à l’imperreftion de nos organes, que de concevoir
dans les parties infenfibles de la matière, les memes
effets que les maffes répètent continuellement
fous nos yeux. Il n’y a que la vérité qui puiffe arriver
à ce point de fimplicité, d’accord, d’uniformité ,
qui font les carafteres immuables de toutes les opérations
de la nature. Voyt{ au Suppl. Af f in it é ,
Crystalisation 6* Phlogistique. (C e t article
eft extrait de YEJfai phyjîco-ckymique fur la diffolu-
tion , de M. DE Mo r v e a u . )
§ DISSONANCE, ( Mujîq. ) Le terme de di(fo-
nanct vient de deux mots, l’un grec, l’autre latin, qui
lignifient fonner à double. En effet, ce qui rend la
dijfonance défagréable, eft que les fons qui la forment
, loin de s’unir à l’oreille, fe repouffent, pour
ainfi dire, & font entendus par elle comme deux
fons diftinâs, quoique frappés à la fois.
On donne le nom de dijfonance, tantôt à l’intervalle
, & tantôt à chacun des deux fons qui le forment;
mais quoique deux fons diffonnent entr’eux,
le nom de dijjonance fe donne plus fpécialement
à celui des deux qui eft étranger à l’accord.
Dans l’explication de l’origine de la dijfonance
qu’on trouve dans le Dictionnaire raif. des Sciences
, &c. article D issonance entre la marque (S1 )
& la marque ( O ) , on peut remarquer l’analogie
qui s’obferve entre l’accord de la dominante fo l &
celui de la fous-dominante fa.
La dominante f o l , en montant au - deffus du générateur
a un accord tout compofé de tierces, en
montant depuis foL ; fo i ,J î , re ,fa . Or la dominante
fa étant au-deffous du générateur ut, on trouvera
en defeendant à’ut vers fa par tierce ,u t , la, fa , re
qui contient les mêmes fons que l’accord fa , la, u t,
re donne à la fous-dominante fa..
On voit de plus que l’altération de l’harmonie des
deux quintes ne confifte que dans la tierce mineure
re ,fa ow. f a , re ajoutée de part & d’autre à l’harmonie
de ces deux quintes..
Cette explication eft d’autant plus ingénieufe
qu’elle montre à la fois l’origine, l’ufage, la marche
de la dijfonance, fon rapport intime avec le ton &
le moyen de déterminer réciproquement l’un par
l’autre le défaut que j’y trouve ; mais défaut effen-
tiel, qui fait tout crouler, c’eft l’emploi d’une corde
étrangère au ton, comme corde effentielle du ton ,
& cela par une fauffe analogie, qui fervant de bafe
au fyftême de M.Rameau, le détruit en s’é vanouiffant.
Je parle de cette quinte au-deffous de la tonique,
de cette fous-dominante, entre laquelle & la tonique
on n’apperçoit pas la moindre liaifon qui puiffe
autorifer l’emploi de cette fous-dominante , non-
feulement comme corde effentielle du to n , mais
même en quelque qualité que ce puiffe être. En
effet qu’y a-t-il de commun entre la réfonnance , le
frémiffement des unifions d’«r & le fon de la quinte
en-deffous ? ce n’eft point parce que la corde entière
eft un fa , que les aliquotes refonnent au fon
S u t , mais parce qu’elle eft un multiple de la corde
u t , & il n’y a aucun des multiples de ce même ut qui
ne donne un femblable phénomène. Prenez le feptu-
p le , il frémira & raifonnera dans fes parties ainfi
que le triple ; eft-ce à dire que le fon de ce feptuple
ou fes o&aves foient des cordes effentielles du ton ?
Tant s’en fau t, puifqu’il ne forme pas même avec
la tonique, un rapport commenfurable en notes.
Je fais que M. Rameau a prétendu qu’au iba
d’une corde quelconque , une autre corde, à fa doii-
zieme en-deffous, frémiffoit fans raifonner ; mais
outre que c’eft un étrange phénomène èn acoufti-
que qu’une corde-fonore qui vibre & qui ne râi-
fonne pas, il eft maintenant reconnu queceîté^pré-
tendue expérience eft une erreur que la corde grave
frémit, parce qu’elle fe partage , & qu’elle paroît
ne pas raifonner, parce qu’elle ne rend dans fes parties
que l’uniffon de l’aigu ; qui ne fe diftingue pas
aifément.
Que M. Rameau nous dife donc qu’il prend la
quinte en-deffous , parce qu’il trouve la quinte en-
deffus, & que ce jeu des quintes lui paroît commode
pour établir fon fyftême, on pourra le féliciter
d’une ingénieufe invention , mais qu’il ne l’au-
torife point d’une expérience chimérique ; qu’il ne
fe tourmente point à chercher dans les renverfe-
mens des proportions harmonique & arithmétique,
les fondemens de l’harmonie , ni à prendre les propriétés
des nombres pour celles des fons.
Remarquez encore que fi la contre - génération
qu’il fuppofe pouvoit avoir lieu , l’accord de la
fous - dominante fa ne devroit point porter une
tierce-majeure, mais mineure , parce que le la bémol
eft l’harmonique véritable qui lui eft afligné par*
compte la gamme du mode majeur devroit avoir naturellement
la fixte mineure, mais elle l’a majeure
comme quatrième quinte , ou comme quinte de la
fécondé note ,■ ainfi voilà encore une contradiction.
Enfin remarquez que la quatrième note donnée
par la férié des aliquotes , d’oii naît le vrai diatonique
naturel, n’eft point l’oCtave de la prétendue
fous-dominante dans le rapport de 4 à y , mais
une autre quatrième note toute différente dans le
rapport de 11 à 8 , ainfi que tout théoricien doit
l’appercevoir au premier coup d’oeil.
J.’en ajîpelle maintenant à l’expérience & à l’oreille
des muficiens. Qu’on écoute combien la cadence
imparfaite de la fous-dominante à la tonique
eft dure & fauvage en comparaifon de cette même
cadence, dans fa place naturelle , qui eft de la tonique
à la dominante ; dans le premier cas peut-on
dire que l’oreille ne defire plus rien après l’accord
de la tonique, n’attend-on pas malgré qu’on en .ait
une fuite ou une fin ? or qu’eft-ce qu’une tonique
après laquelle l’oreille defire quelque chofe ? Peut-
on la regarder comme une véritable tonique , &
n’eft-on pas alors réellement dans le ton de fa , tandis
qu’on penfe être dans celui d’ut ? Qu’on obferve
combien l’intonation diatonique & fucceflive de
la quatrième note , & de la note fenfible, tant en
montant qu’en defeendant, paroît étrangère au mode
& même pénible à la voix fi la longue habitude y
accoutume l’oreille & la voix du muficien ; la difficulté
des commençans à entonner cette note , doit
lui montrer affez combien elle eft peu naturelle. On
attribue cette difficulté aux trois fons confécutifs ; ne
devroit-on pas vojrque ces trois tons confécutifs,
de même que la note qui les introduit, donnent une
modulation barbare qui n’a nul fondement dans la
pâture ; elle avoit affurément guidé mieux les Grecs
lorfqu’elle leur fit arrêter leur tétracorde precifé-
ment au mi de notre échelle , c’eft-à-dire à la note
qui précédé cette quatrième ; ils aimèrent mieux
.prendre cette quatrième en deflous , & ils trouvèrent
ainfi avec leur feule oreille, ce que toute notre
théorie harmonique n’a pu encore nous faire
appercevoir. *
Si le témoignage de l’oreille & celui de la raifon
fe réunifient au moins dans le fyfteme donné pour
rejetter la prétendue fous-dominante, non feulement
D I S
du nombrê des cordes effentielles du ton, mais du
nombre des fons qui peuvent entrer dans l ’échelle
du mode, que devient toute cette théorie des
nances ? que devient l’explication du mode mineur ?
Que devient tout le fyftême de M. Rameau ?
N’appercevant donc, ni dans la phyfique, ni dans
le calcul la véritable génération de la dijfonance,
je hû cherchois une véritable origine purement
méchanique, & c’eft de la maniéré fuivante que je
îâchois de l’expliquer dans le Dictionnaire raif. des
Sciences, &c. fans m’écarter du fyftême de M. Rameau.
Foye^ cette explicatioa au mot D isson-
NANCE ( Mujîq. ) Dictionnaire raif. des Sciences, & c .
jufqu’à la marque ( 5 )
Une obfervation qu’il ne faut pas oublier ,,.qft que
les deux feules notes de l’échelle, qui ne fe trouvent
point dans les harmoniques des deux cordes principales
ut & fo l, font précifément celles qui s’y trouvent
introduites par la dijfonance, & achèvent par ce
moyen la gamme diatonique, qui fans cela feroit imparfaite
: ce qui explique comment \tfa & le la , quoi-
qu’étrangers au mode, fe trouvent dans fon échelle,
& pourquoi leur intonation, toujours rude malgré
l’habitude, éloigne l’idée du ton principal.
Il faut remarquer encore que ces deux diffonances
favoir la fixte majeure & la feptieme mineure, ne different
que d’un femi-ton, & différeroient encore
moins fi les intervalles étoient bien juftes. A l’aide de
cette obfervation l’on peut tirer du principe de la réfonnance,
une origine très-approchée de l’une &
de l’autre, comme je vais le montrer.
Les harmoniques qui accompagnent un fon quelconque
ne fé bornent pas à ceux qui compofent l’accord
parfait ; il y en a une infinité d’autres moins fen-
fibles , à mefure qu’ils deviennent plus aigus & leurs
rapports plus compofés, & ces rapports font exprimés
par la ferie naturelle des aliquotes -g-, ÿ,6*c.
Les fix premiers termes de cette férié, donnent lesfons
qui compofent l’accord parfait & fes répliqués, le
feptieme en eft exclu ; cependant ce feptieme terme
entre comme eux dans la réfonnance totale du fon
générateur, quoique moins fenfiblement : mais il n’y
entre point comme confonnance, il y entre donc
comme dijfonance, & cette,dijfonance eft donnée par la
nature. Refte à voir fon rapport avec celles dont je
viens de parler.
O r , ce rapport eft intermédiaire entre l’un & l’autre
, & fort, rapproché de tous deux ; car le rapport
de la fixte majeure eft y, & celui de la feptieme mineur
-j^;, ces deux rapports réduits aux mêmes termes
font | | & fy.
Le -rapport de l’aliquote y, rapproché au fimple
par fes oCtaves j ,& ce rapport réduit au même terme
avec les précédens fe trouve intermédiaire entre les'
deux de cette maniéré , yy|, oii l’on voit que
ce rapport moyen ne diffère de la fixte majeure que
de -fy'pu à-p eu -p rè s deux comma, & de la feptieme
mineure que de 5-7-5 , qui eft beaucoup moins
qu’un comma. Pour employer les mêmes fons dans
le genre diatonique & dans divers modes, il a fallu
les altérer ; mais cette altération n’eft pas affez grande
pour nous faire perdre la trace de leur origine.
Quoique cette maniéré de concevoir la diffo-
nance en donne une idée affez nette, comme cette
idée n’eft point tirée du fond de l’harmonie, mais de
certaines convenances entre les parties, je fuis bien
éloigné d’en faire plus de cas qu’elle ne mérite, &
je ne l’ai jamais donnée que pour ce qu’elle valoit,
mais on avoit jufqu’ici raifonné fi mal fur la dijfonance
, que je ne crois pas avoir fait en cela pis que
les autres. M. Tartini eft le premier, & jufqu’à pré-
fent le feul, qui ait déduit une théorie des dijfonan-
ces des vrais principes de l’harmonie. Pour éviter
d’inutiles répétitions, je renvoie la deffus au mot
D I S 7*7
Sy st èm e , oùj’aifaitl’expofîtiondu fien. Jem’abftien*
draide juger s’il a trouvé ou non celui de la nature ;
mais je dois remarquer au moins, que les principes
de cet auteur paroiffent avoir dans leurs conféquen-
ce s, cette univerfaiité & cette connexion qu’on
ne trouve guere que dans ceux qui mènent à la
vérité.
Encore une obfervation avant de finir cet article.
Tout intervalle commenfurable eft réellement con-
fonnant , il n’y a de vraiment diffonans que ceux
dont les rapports font irrationnels ; car il n’y a que
ceux-là auxquels on ne puiffe aflïgner aucun fon fondamental
commun ; mais paffé ce point, où les harmoniques
naturels font encore fenfibles, cette confonnance
des intervalles commenfurables ne s’admet
plus que par induCtion ; alors ces intervalles font bien
partie du fyftême harmonique, puifqu’ils font dans
l’ordre de fa génération naturelle, & fe rapportent
au fon fondamental commun ; mais ils ne peuvent
être admis.comme confonnans par l’oreille, parce
qu’elle ne les apperçoit point dans l’harmonie naturelle
du corps fonore : d’ailleurs plus l’intervalle fe
compofe, plus il s’élève à l’aigu du fon fondamental,
ce qui fe prouve, par la génération réciproque du
fon fondamental & des intervalles fupérieurs.
Voyez le Syjiême de M. Tartini. O r , quand la dif-
tance du fon fondamental au plus aigu de l’intervalle
générateur ou engendré, excede l’étendue du fyftême
mufical ou appréciable, tout ce qui eft au-delà
de cette étendue devant être cenfé nul, un tel intervalle
n’a point de fondement fenfible & doit être
rejetté de.la pratique, ou feulement admis comme
diffonant: voilà, non le fyftême de M. Rameau, ni
celui de M. Tartini, ni le mien, mais le texte de la nature,
qu’au refte je n’entreprends pas d’expliquer. (S)
Puifque, comme l’on vient de voir, la dijfonance
fert à confirmerMe mode, il eft clair qu’il faut bien
Connoître la place qu’elle peut occuper dans l’échelle
d’un mode, tant pour pouvoir confirmer le mode
actuellement régnant, que pour pouvoir en changer
quand on veut, & bien déterminer celui dans lequel
on paffe; c’eft pourquoi à l’article de chaque dijfo*
nance, j’ai expliqué non - feulement fur quelle note
de l’échelle on peut pratiquer cette dijfonance, mais
encore dans quel mode relatif on peut paffer par fon
moyen & comment.
Remarquons aufli que foüvent une note qui paroît
faire la dijfonance dans un accord eft réellement
une confonnance, tout comme celle - ci peut devenir
effectivement dijfonance. Voye{ C onsonnance ,
Mujîq. Suppl. ( F. D . C. )
Nous ajouterons ici la raifon de quelques dijfo-
nances , tirée d’un mémoire du célébré M. Euler,
Mémoires de l ’académie de Berlin, Tom. X X .
L’accord de la feptieme , & celui qui réfulte de
la fixieme jointe à la quinte, font employés dans la
mufique avec tant defuccès, qu’on ne fauroit douter
de leur harmonie ou de leur agrément. Il eft bien
vrai qu’on les rapporte à la claffe des diffonances ,
mais il faut convenir que les dijjonances ne different
des confonnances, que parce que celles - ci font renfermées
en des proportions plus fimples, qui fe pré-
fentent plus aifément à l’entendement, pendant que
les diffonances renferment des proportions plus compliquées,
& partant plus difficiles à comprendre. Ce
n’eft donc que par dégré que les diffonances different
des confonnances, & il faut que les unes & les
autres foient perceptibles à l’efprit. Plufieurs fons,
qui. n’auroient aucun rapport perceptible entr’eux ,
feroientun bruit confus abfolumentintolérabledans
la mufique. Delà il eft certain, que les diffonances
que j’ai en v u e , contiennent des proportions perceptibles
, fans quoi on ne les fauroit admettre dans la
mufique.
, p i