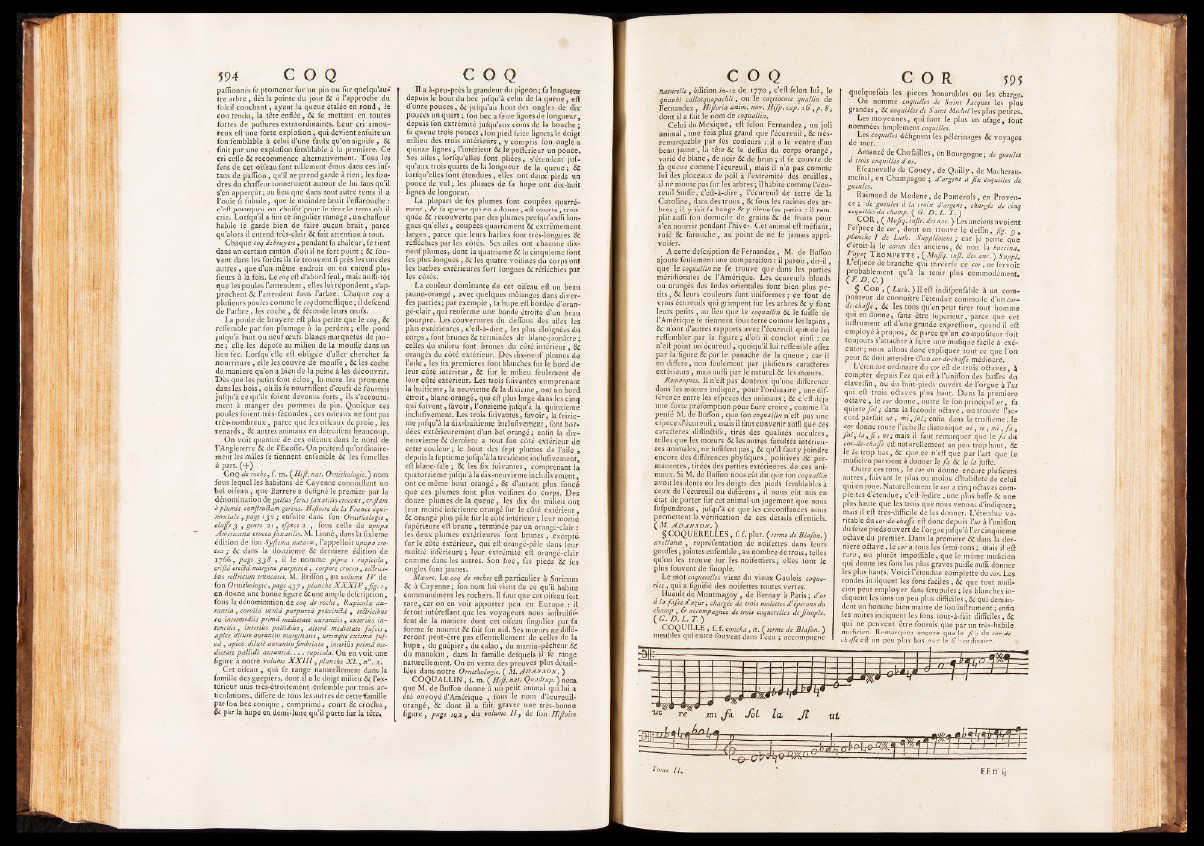
paflionnés fe promener fur un pin ou fur qtielqu’âu-
tre arbre , dès la pointe du jour & à l’approche du
foleil couchant, ayant la queue étalée en rond , le
cou tendu, la tête enflée, 6c fe mettant en toutes
fortes de poftures extraordinaires. Leur cri amoureux
eft une forte explofion, qui devient enfuite un
fon femblable à- celui d’une faulx qu’on aiguife , 6c
finit par une explofion femblable à la première. Ce
cri ceffe & recommence alternativement. Tous les
fens de cet oifeau font tellement émus dans ces inf-
tans de paflion, qu’il ne prend garde à rien; les foudres
du chafleur tonneroient autour de lui fans qu’il
s’en apperçût; au lieu que dans tout autre tems il a
Fouie fi fubtile, que le moindre bruit l’effarouche :
c’eft pourquoi on choifit 'pour le tirer le tems où il
crie. Lorfqu’il a fini ce fingulier ramage, un chafleur
habile fe garde bien de faire aucun bruit, parce
qu’alors il entend très-clair 6c fait attention à tout.
Chaque coq debruyere, pendant fa chaleur, fe tient
dans un certain canton d’où il ne fort point ; 6c fou-
vent dans les forêts ils fe trouvent fi près les uns des
autres, que d’un même endroit on en entend plu-
fieurs à la fois. Le coq efl d’abord feul, mais aufli-tôt
que les poules l’entendent, elles lui répondent, s’approchent
& l’attendent fous l’arbre. Chaque coq a
plufieurs poules comme le coq domeftique ; il defcend
de l’arbre, les coche , 6c féconde leurs oeufs.
La poule de bruyere eft plus petite que le coq, &
reffemble paf fon plumage à la perdrix ; elle pond
jufqu’à huit ou neuf oeufs blancs marquetés de jaune
; elle les dépofe au milieu de la moufle dans un
lieu fec. Lorfqu’elle eft obligée d’aller chercher fa
nourriture, elle les couvre de moufle, 6c les cache
de maniéré qu’on a bien de la peine à les découvrir«
Dès que les petits font éclos, la-mere les promene
dans les bois, où ils fe nourriffent d’oeufs de fourmis
jufqu’à ce qu’ils foient devenus forts, ils s’accoutument
à manger des pommes de pin. Quoique ces
poules foient très-fécondes, ces oifeaux ne font pas
très-nombreux, parce que les oifeaux de proie, les
venards, 6c autres animaux en détruifent beaucoup.
On voit quantité de ces oifeaux dans le nord de
l ’Angleterre & de l’Ecoffe. On prétend qu’ordinaire-
ment les mâles fe tiennent enfemble 6c les femelles à part. (+ )
Coq de roche, f. m. ( Hifi. nat. Ornithologie.') nom
fous lequel les habitans de Cayenne connoiffent un
bel oifeau, que Barrere a défigné le premier par la
dénomination de gallus férusJaxatilis croceus, crijlam
èplumis conjiruclam gerens. Hifloire de la France équinoxiale
, page 132; enfuite dans fon Ornithologie ,
xlajfe 3 , genre 2 1 , efpece 2 , fous celle de upupa
Americana crocea Jaxatilis. M. Linné, dans la fixieme
édition de fon Syfiema natures, l’appelloit upupa crocea
; 6c dans la douzième & derniere édition de
1766, page 338 , il le nomme pipra t rupicola,
criflâ ereclâ margine purpureâ, corpore croceo, teclrici-
.bus reclricum truncatis, M. Briflon , au volume IV de
fon Ornithologie, page 437, planche X X X IV ,Jig. 1,
en donne une bonne figure 6c une ample defcriptipn,
fous la dénomination de coq de roche, Rupicola au-
rantia, corollâ tcenid purpureâ prtecinctd , teclricibus
J o intermediis prima medietate aurantiis , exteriùs in-
tendus, interiùs pallidiits, altéra medietate fufcis,
apice dilutï aurantio marginatis, utrinque extimâ fuf-
c â , apice dilutï aurantio fimbriata, interiùs prima medietate
pallidï aurantid. . . . rupicola. On en voit une
figure à notre volume X X I I I , planche X L , n°. 2.
Cet oifeau , qui fe range naturellement dans la
famille des guêpiers, dont il a le doigt milieu 6c l’extérieur
unis très-étroitement enfemble par trois articulations,
différé de tous les autres de cette famille
par fon bec conique , comprimé, court 6c crochu ,
& par la hupe en demi-lune qu’il porte fur la tête«
TI a à-peu-près la grandeur du pigeon ; fa longueur
depuis le bout du bec jufqu’à celui de la queue, eft
d’onze pouces ,6 c jufqu’au bout des ongles-., de dix
pouces un quart ; fon bec a feize lignes de longueur,
depuis fon extrémité jufqu’aux coins de la bouche ;
fa queue trois pouces, fon pied feize lignes; le doigt
milieu des trois antérieurs , y compris fon- ongle a
quinze lignes, l’intérieur &Je poftérieur un pouce.
Ses ailes, lorfqu’elles font pliées, s’étendent jusqu’aux
trois quarts de la longueur de la queue ; 6c
lorfqu’elles font étendues, elles ont deux pieds un
pouce de vol ; les plumes de fa hupe ont dix-huit
lignes de longueur.
La plupart de fes plumes font coupées quarré-
ment, & fa queue qui en a douze, eft courte, tronquée
6c recouverte par des plumes prefqu’aufli longues
qu’elles, coupées quarrément 6c extrêmement
larges, parce que leurs barbes font très-longues 6c
réfléchies parles côtés. Ses ailes ont chacune dix-
neuf plumes, dont la quatrième 6c la cinquième font
les plus longues, 6c les quatre voifines du corps ont
les barbes extérieures fort longues 6c réfléchies par
les cotés.
La couleur dominante de cet oifeau eft un beau
jaune-orangé , avec quelques mélanges dans divér-
fes parties ; par exemple, fa hupe eft bordée d’orari-
gé-clair, qui renferme une bande étroite d’un beau
pourpre. Les couvertures du deflous des ailes les
plus extérieures, c’eft-à-dire, les plus éloignées du
corps, font brunes 6c terminées de blanc-jaunâtre ;
celles du milieu font brunes du côté intérieur, 6c
orangés du côté extérieur. Des dix-neuf plumes de
l’a ile , les fix premières font blanches fur le bord de
leur côté intérieur, 6c fur le milieu feulement de
leur côté extérieur. Les trois fuivantes comprenant
la huitième, la neuvième & la dixième, ont un bord
étroit, blanc-orangé, qui eft plus large dans les cinq
qui fuivent, favoir, l’onzieme jufqu’à la quinzième
inclufivement. Les trois fuivantes, favoir, la feizie-
me jufqu’à la dix-huitieme inclufivement, font bordées
extérieurement d’un bel orangé ; enfin la dix-
neuvieme & derniere a tout fon côté extérieur de
cette couleur ; le bout des fept plumes de l’aile ,
depuis la feptieme jufqu’à la treizième inclufivement,
eft blanc-fale ; 6c les fix fuivantes, comprenant la
quatorzième jufqu’à la dix-neuvieme inclufivement,
ont ce même bout orangé, 6c d’autant plus foncé
que ces plumes font plUs voifines du corps. Des
douze plumes de la queue, les dix du milieu ont
leur moitié inférieure orangé fur le côté extérieur,
6c ofangé plus pâle fur le côté intérieur ; leur moitié
fupérieure eft brune , terminée par un orangé-clair i
les deux plumes extérieures font brunes , excepté
fur le côté extérieur, qui eft orangé-pâle dans leur
moitié inférieure ; leur extrémité eft orangé-clair
comme dans les autres. Son b e c , fes pieds 6c fes
ongles font jaunes.
Moeurs. Le coq de roches eft particulier à Surinam
& à Cayenne ; fon nom lui vient de ce qu’il habite
communément les rochers. Il faut que cet oifeau foit
rare , car on en voit apporter peu en Europe : il
feroit intéreffant que les voyageurs nous, inftruififi-
fent de la maniéré dont cet oifeau fingulier par/a
forme fe nourrit & fait fon nid. Ses moeurs ne différeront
peut-être pas effentiellement de celles de la
hupe , du guêpier, du calao, du martin-pêcheur &
du manakin, dans la famille defquels il fe range
naturellement. On en verra des preuves plus détaillées
dans notre Ornithologie. ( M. A d a n s o n . )
COQUALLIN, f. m. ( HiJl. nàt. Quadrup. ) nom
que M. de Buffon donne à un petit animal qui lui a
été envoyé d’Amérique , fous le nom d’écufeuil-
orangé, 6c dont il a fait graver une très-bonne
figure, page 19.2 , du volume U , de fon Hifloire
naturelle, édition in-12 de 17 70 , c’eft félon lui, le
qüauhi callotquapachli, ou le co^tiocote quallin de
Fernandez, Hifioria anim. nov. Hifp. cap. 2 6 ,p . 8 ,
dont il a fait le nom de coquallin.
Celui du Mexique, eft felçn Fernandez, un joli
animal, une fois plus grand que l’écureuil, 6c très-
remarquable par fes couleurs :,il a le ventre d’un
beau jaune , la tête & le deffus du corps orangé,
varié de blanc, de noir 6c de brun ; il fe couvre de
fa queue comme l’écureuil, mais il n’a pas comme
lui des pinceaux de poil à Fextrémité des oreilles ,
il ne monte pas fur les arbres ; il habite comme l’écureuil
Suiffe , c’eft-à-dire, l’écureuil de terre de la
Caroline, dans des trous , 6c fous les racines des arbres
; il ÿ fait fa bauge 6c y élevefes petits : il remplit
aufli fon domicile de grains 6c <Je fruits pour
s’en nourrir pendant l’hiver. Cet animal eft méfiant,
rûfé 6c farouche1, au point de ne fe jamais apprivoiser.
A cette defcrçption dé Fernandez, M. de Buffon
ajoute feulement une comparaison : il paroîr, d it-il,
que le coquallin ne fe trouve que dans les parties
méridionales de l’Amérique. Les écureuils blonds
ou orangés des Indes orientales font bien plus petits,
& leurs couleurs font uniformes; ce font de
vrais écureuils qui grimpent fur les arbres & y font
leurs petits , au lieu que 1 e coquallin 6c le fuiffe de
l’Amérique fe tiennent fous terre comme les lapins,
6c n’ont d’autres rapports avec l’écureuil qûë de lui
reffembler par la figure ; d’où il conclut ainfi : ce
n’eft point un écureuil / quoiqu’il lui reffemble allez
par la figure 6c par le panache de la queue ; car il
en différé, non feulement par plufieurs caradteres
extérieurs, mais aufli par le naturel 6c les moeurs.
Remarques. Il n’eft pas douteux qu’une différence
dans' les moeurs indique, pour l’ordinaire , une différence
entre les efpeces des animaux ; & c ’elLdéja
une forte préfomption pour faire croire, comme l’a
penfé M. de Buffon, que fon coquallin n’eft pas une
efpece d?écureuil; mais il faut convenir aufli que ces
carafteres diftin&ifs, tirés des qualités occultes, ;
telles que les moeurs 6c les autres facultés intérieures
animales , ne fuffifent pas, 6c qu’il faut y joindre
encore des différences phyfiques, pofitives 6c permanentes
, tirées des parties extérieiîres de ces animaux.
Si M. de Buffon nous eût dit que fon coquallin
avoit les dents ou les doigts des pieds femblables à
ceux de l’écureuil ou différens, il nous eût mis en
état de porter fur cet animal un jugement que nous
fufpendrons , jufqu’à ce que les circonftances nous
permettent la vérification de ces détails effentiels. •
( M. A d a n s o n . )
§ COQUERELLES, f. f. plur. ( terme deBlafon.)
avellanoe , repréfentation de noifettes dans leurs
gouffes, jointes enfemble, au nombre de trois, telles
qu’on les trouve fur les noifettiers; elles font le
plus fouvent de finople.
Le mot coquerelles vient du vieux Gaulois coque-
réef, qui a fignifié des noifettes toutes vertes.
Huault de Montmagny , de Bernay à Paris ; d’or
a la fafce dlaçur, chargée de trois molettes d'éperons du
champ , & accompagnée de trois coquerelles de finople.
(G . D .L . T .) J
COQUILLE, f. f. concha, à. ( terme de Blafon. )
meubles qui entre Souvent dans l’écu ; accompagne
quelquefois les pièces honorables ou les charge.
On nomme coquilles de Saint Jacques les plus
grandes, 6c coquilles de Saint Michel les plus petites.
Les moyennes, qui font le plus en ufage, font
nommées Amplement coquilles.
Les coquilles défignent les pèlerinages & voyages
de mer. . J °
^ Amanze de Chofailles, en Bourgogne; de gueules
a trois coquilles d'or.
Efcanevelle de Cou cy , de Quilly, de Macherau-
mefnil, en Champagne ; d'argent à f ix coquilles de
gueules.
Raimond de Modene, de Pomerols, en Provenc
e ; de gueules à. la croix d'argent, chargée de cinq
coquilles du champ. ( G. D. L. T. )
» ( Mufiq. infir. des anc. ) Les anciens a voient
! efpece de cor, dont on trouve le deflin, fig. § ,
planche I de Luth. Supplément ; car je penfe que
C’étoit-là le cornu des anciens, & non la buccïna.
v oye{ T rompette , ( Mufiq. infi. des anc. ) Suppl,
L’éfpece de branche qui traverfe ce cor, nefervoit
probablement qu’à la tenir plus commodément.
( F. D . G. )
§ C or , ( Luth.^ ) Il eft indifpenfable à un com-
pofiteur de connoitre l’étendue commode d’un cor-
de-chaJJe , ôc les tons qu’en peut tirer tout homme
qui én donne, fans être fupérieur, parce que cet
infiniment eft d’une grande expreflion, quand il eft
employé à propos, & parce qu’un compofiteur doit
toujours s attacher à faire une mufique facile à exécuter;
nous allons donc expliquer tout ce que l’on
peut 6c doit attendre d’un cor-de-chajfe médiocre.
L’étendue ordinaire du cor eft de trois oétaves, à
compter depuis l’ut qui eft à l’ uniffon des baffes du
claveflîn, ou du huit-pieds ouvert de l’orgue à Vue
qui eft trois o&aves plus haut. Dans la première
oâave , le cor donne, outre le fon principal u t , fa
quinte fo l; dans la fécondé oftavè, on trouve l’accord
parfait u t, mi, fo l; enfin dans la troifieme, le
cor donne toute l’échelle diatonique u t, re, mi , f a t
f°l-> la * fi » utl il faut remarquer que le fa du
cor-de-chajfe eft naturellement un peu trop haut, 6c
le la trop bas, 6c que ce n’eft que par l’art que le
muficien parvient à donner le fa 6c le la jufte.
Outre ces tons, le cor en donne encore plufieurs
autres, fuivant le plus ou moins d’habileté de celui
qui en joue. Naturellement le cor a cinq oftaves complexes
d’étendue, c’eft-à^dire , une plus baffe 6c une
plus haute que les trois que nous venons d’indiquer;
mais il eft très-difficile de les donner. L’étendue véritable
du cor-de-chajfe eft donc depuis l'ut à l’uniffon
dufeize piedsouvert de l’orgue jufqu’à l'ut cinquième
oclave du premier. Dans la première 6c dans la derniere
oélave, le cor a tous les femi-tons ; mais il eft
rare, ou plutôt impoflible, que le même muficien
qui donne les fons; les plus graves puiffe aufli donner
les plus hauts. Voici l’étendue compfette du cor. Les
rondes indiquent les fons faciles , 6c que tout muficien
peut employer fans fcrupules ; les blanches indiquent
les fons un peu plus difficiles ,& qui demandent
un homme bien maître de fon inftrument ; enfin
les noires indiquent les fons tout-à-fait difficiles, 6c
qui ne peuvent être fournis que par un très-habile
muficien. Remarquez encore que le f i b du cor-de-
chajfe eft un peu plus bas nue le fi. I? ordinaire. N