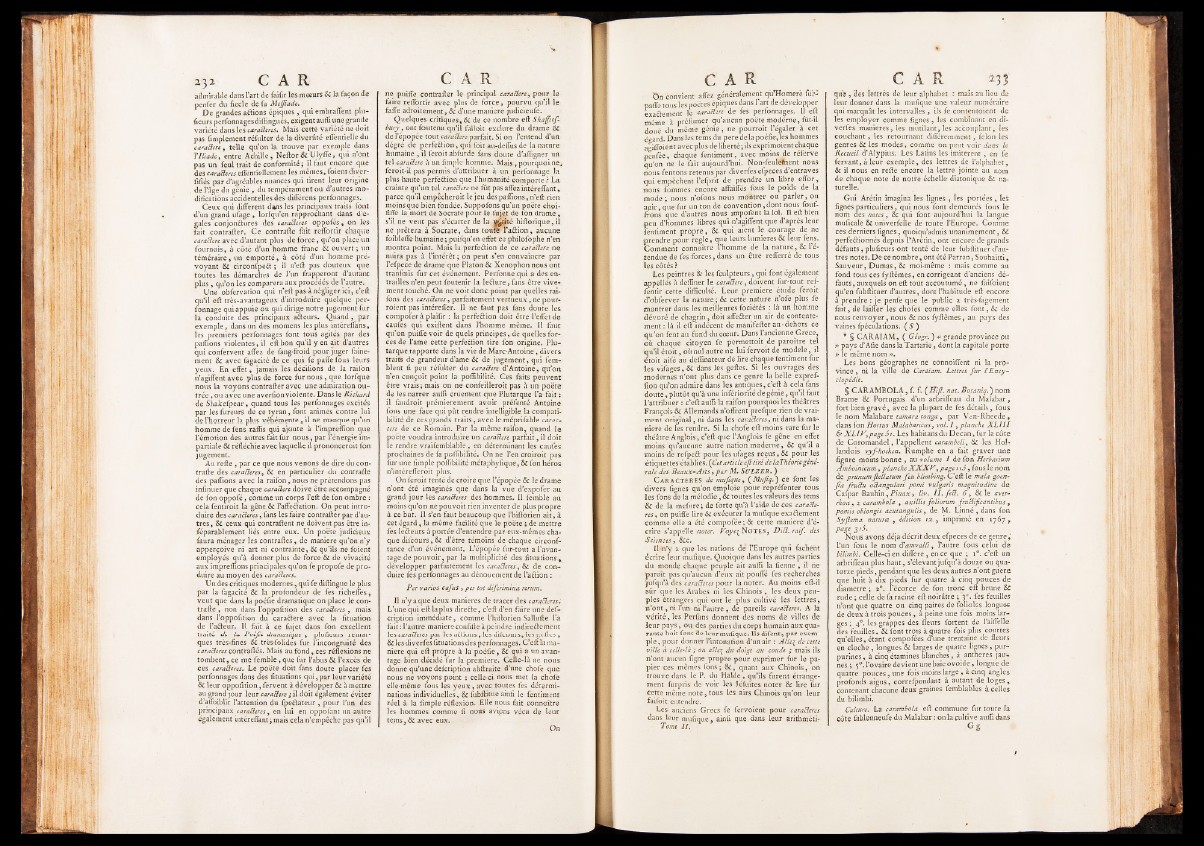
admirable dans l’art de faifir les moeurs & la façon de
penfer du fiecle de fa Mefiiade.
De grandes aûions épiques , qui embraffent plu-
fieurs perfonnagesdiftingués, exigent aufli une grande
variété dans les caractères. Mais cette variété ne doit
pas Amplement réfulter de la diverfité effentielle du
caractère, telle qu’on la trouve par exemple dans
VIliade, entre Achille, Neftor& Ulyffe, qui n’ont
pas un feul trait de conformité ; il faut encore que
des caractères effentiellement les memes, foient diver-
fifiés par d’agréables nuances qui tirent leur origine
de Page du génie , du tempérament ou d’autres, modifications
accidentelles des différens perfonnages.
Ceux qui different dans les principaux traits font
d’un grand ufage , lorfqu’en rapprochant dans d’égales
conjonctures des caractères oppofés, on les
fait contrafter. Ce contraire fait reffortir chaque
caractère avec d’autant plus de force, qu’on place un
Tournois, à côté d’un homme franc & ouvert ; un
téméraire, un emporté, à côté d’un homme prévoyant
& circonfpeû ; il n’eft pas douteux que
toutes les démarches de l ’un frapperont d’autant
plus , qu’on les comparera aux procèdes de l’autre.
Une observation qui n’eft pas-à négliger ici, c’eft
qu’il eft très-avantageux d’introduire quelque per-
fonnage qui appuie ou qui dirige notre jugement fur
la conduite des principaux afteurs. Quand, par
exemple, dans un des momens les plus intéreffans,
les premiers perfonnages font tous agités par des
pallions violentes, il eft bon qu’il y en ait d’autres
qui confervent affez de fang-froid pour juger faine-
ment & avec fagacité de ce qui fe paffe fous leurs
yeux. En effet, jamais les déeifions de la raifon
n’agiffent avec plus de force fur nous, que lorfque
nous la voyons contrafter avec une admiration outrée
, ou avec une averfion violente. Dans le Richard
de Shakefpear, quand tous les perfonnages excités
par les fureurs de ce tyran, font animés contre lui
de l’horreur la plus véhémente, il ne manque qu’un
homme de fens raflis qui ajoute à l’imprefîion que
l’émotion des autres fait fur nous, par l’énergie impartiale
& réfléchie avec laquelle il prononceroit l'on
jugement.
Au refte, par ce que nous venons de dire du con-
trafte des caractères, & en particulier du contrafte
des pallions avec la raifon, nous ne prétendons pas
infinuer que chaque caractère doive être accompagné
de fon oppofé, comme un corps l’eft de fon ombre :
cela fentiroit la gêne & l’affeftation. On peut introduire
des caractères, fans les faire contrafter par d’autres,
& ceux qui contraftent ne doivent pas être in-
féparablement liés entre eux. Un poëte judicieux
l'aura ménager les contraftes, de maniéré qu’on n’y
apperçoive ni art ni contrainte, & qu’ils ne foient
employés qu’à donner plus de force & de vivacité
aux impreflions principales qu’on fe propofe de produire
au moyen des caractères.
Un des critiques modernes, qui fe diftingue le plus
par la fagacité & la profondeur de fes richeffes,
veut que dans la poélie dramatique on place le contraire
, non dans l’oppofition des caraSeres , mais
dans l’oppofition du caraôere avec la lituation
de l’aâeur. Il fait à ce fujet dans fon excellent
traité de la Poéjie dramatique , plulieurs remarques
très-fines &C très-folides fur l’incongruité des
caractères contraftés. Mais au fond, ces réflexions ne
tombent, ce me femble, que fur l’abus & l’excès de
ces caractères. Le poëte doit fans doute placer fes
perfonnages dans des fituations qui, par leur variété
& leur oppofition, fervent à développer & à mettre
au grand jour leur caractère ; il doit également éviter
d’affoiblir l’attention du fpeâateur , pour l’un des
principaux caractères, en lui en oppofant un autre
également intéreffant ; mais cela n’empêche pas qu’il
ne puiffe contrafter le principal caractère, pour le
faire reflortir avec plus de force, pourvu qu’il le
faffe adroitement, & d’une maniéré judicieufe.
Quelques critiques, & de ce nombre eft Shaffief-
bury, ont foutenu qu’il falloit exclure du drame 6c
de l’épopée tout caractère parfait. Si on l’entend d’un
dégré de perfection, qui foit au-deffus de la nature
humaine , il feroit abfurde fans doute d’aflïgner un
tel caractère à un Ample homme. Mais, pourquoi ne*
feroit-il pas permis d’attribuer à un. perfonnage la
plus haute perfection que l’humanité comporte ? La
crainte qu’un tel caractère ne fut pas affez intéreffant,
parce qu’il empêeheroit le jeu des pallions, n’eft rien
moins que bien fondée. Suppofons qu’un poëte choi-
fiffe la mort de Socrate pour le fujet de fon drame ,
s’il ne veut pas s’écarter de IzÆamé hiftorique,il
ne prêtera à Socrate, dans touteTaCtion, aucune
foibleffe humaine ; puifqu’en effet ce philofophe n’en
montra point. Mais la perfection de ce caractère ne
nuira pas à l’intérêt ; on peut s’en convaincre par
l’efpece de drame que Platon & Xenophon nous ont
tranfmis fur cet événement. Perfonne qui a des entrailles
n’en peut foutenir la leCture, fans être vive-,
ment touché. On ne voit donc point par quelles rai-
fons des caractères, parfaitement vertueux, ne pour-
roient pas intéreffer. Il ne faut pas fans doute les
compofer à plaifir : la perfection doit être l’effet de
caufes.qui exiftent dans l’homme même. Il faut
qu’on puiffe voir de quels principes, de quelles forces
de l’ame cette perfection tire fon origine. Plutarque
rapporte dans la vie de Marc-Antoine, divers
traits de grandeur d’ame & de jugement, qui fem-
blent fi peu réfulter du caractère d’Antoine, qu’on
n’en conçoit point la poflibilité. Ges faits peuvent
être vrais j mais on ne confeiileroit pas à un poëte
de les narrer aufli ornement que Plutarque l’a'fait :
il faudroit premièrement avoir préfenté Antoine
fous une face qui pût rendre intelligible la compatibilité
de ces grands traits, avec le méprifable caractère
de ce Romain. Par la même raifon, quand le
poëte voudra introduire un caractère parfait, il doit
le rendre vraifemblable, en- déterminant les caufies
prochaines de fa poflibilité. On ne l’en croiroit pas
fur une fimple poflibilité métaphyfique, & fon héros
n’intérefferoit plus.
On feroit tenté de croire que l’épopée & le drame
n’ont été imaginés que dans la vue d’expofer au
grand jour les caractères des hommes. Il femble au
moins qu’on ne pouvoit rien inventer de plus propre
à ce but. Il s’en faut beaucoup que l’hiftorien ait, à
cet égard, la même facilité que le poëte ; de mettre
fes lefteurs à portée d’entendre par eux-mêmes chaque
difeours, & d’être témoins de chaque circonf-
tance d’un événement. L’épopée fur-tout a l’avantage
de pouvoir, par la multiplicité des fituations^
développer parfaitement les caractères, & de conduire
fes perfonnages au dénouement de l’aftion :
Per varios cafus, per tôt diferimina rerum.
Il n’y a que deux maniérés de tracer des caracteresl
L’une qui eft la plus direfte, c’eft d’en faire une description
immédiate, comme l’hiftorien Sallufte l'a
fait : l’autre maniéré confifte à peindre indirectement
les caractères par les aCtions, les difeours, les geftes ,
& les diverfes fituations des perfonnages. C ’eftla maniéré
qui eft propre à la' poélie, & qui a un avantage
bien décidé fur la première. Celle-là ne nous
donne qu’une defeription abftraite d’une chofe que
nous ne voyons point : celle-ci nous met la chofe
elle-même fous les y e u x , avec toutes fes déterminations
individuelles, & fubftitue ainfi le fentiment
réel à la fimple réflexion. Elle nous fait connoître
les hommes comme fi nous avions vécu de leur
tems, & avec eux.
On
ftn convient affez généralement qu’Homerè fur-
paffe tous les poëtes épiques dans l’art de développer
exactement le caractère de fes perfonnages. 11 eft
même à préfumer qu’aucun poëte moderne, fut-il
doué du même génie, ne pourroit l’égaler à cet
égard. Dans les tems du pere de la poéfie,les hommes
agiffoient avec plus de liberté ; ils exprimoient chaque
.penfée, chaque fentiment, avec moins de referve
qu’on ne le fait aujourd’hui. Non-feulefnent nous
nous fentons retenus par diverfes efpeces d’entraves
qui empêchent l’efprit de prendre un libre effor,
nous fommes encore affaiffes fous le poids de la
mode ; nous n’ofons nous montrer ou parler, ou
agir, que fur un ton de convention, dont nous fouf-
frons que d’autres nous impofent la loi. Il eft bien
peu d’hommes libres qui n’agiffent que d’après leur
fentiment propre, & qui aient le courage de ne
prendre pour réglé, que leurs lumières & leur fens.
Comment connoître l’homme de la nature, & l’é-
Tendue de fes forces, dans un être refferré de tous
tes côtés? . >
Les peintres & les fculptëurs, qui font également
appelles à defliner le caractère, doivent fur-tout ref-
fentir cette difficulté. Leur première étude feroit
d’obferver la nature ; & cette nature n’ofe plus fe
montrer dans lès meilleures fociétés : là un homme
dévoré de chagrin, doit affeCter un air de contentement
: là il eft indécent demanifefter au-dehors ce
qu’on fent au fond du coèut. Dans l’anciérine Grèce,
oîi chaque citoyen fe pèrmettoit de pafoitre tel
tni’il étoit, où nul autre rie lui fervoit de modèle, il
étoit aifé au dèflinateur dè lire chaque leritiment fur
les vifages, & dans tes geftes. Si les ouvrages des
modernes n’ont plus dans èe genre la belle expref-
ïiori qu’on admire dans les antiques, c’eft à cela fans
doute, plutôt qu’à une infériorité de génie, qu’il faut
l ’attribuer : c’eft aufli lâ raifon pourquoi les théâtres
François &: Allemands n’offrent prefque rien de vraiment
original, ni dans lès caractères, ni dans la maniéré
de les rendre. Si la chofe eft moins rare fur le
théâtre Anglois; c’eft que l’Anglois fe gêne en effet
moins qu’autune autre nation irioderne, & qu’il a
moins de refpeél pour les ufages reçus, & pour les
étiquettes' établies. {Cet article eji tiré de laThéoriegénérale
des Beaux-Arts t par M. St/LZER. )
CARACTERES de mufique, ( Mujiq.) ce font les
divers lignes qu’on emploie pour repréfenter tous
les fions de la mélodie, & toutes les valeurs dés tems
& de la mefure; de forte qu’à l’aide de ces caractères
, on puiffe lire & exécuter la mufique exactement
comme elle a été compofée ; & cette maniéré d’écrire
s’appelle noter. Voye%_ NOTES , Dict.raif. des
'Sciences, &c.
Il în’y a que les nations de* l’Europe qui fâchent
écrire leur mufique. Quoique dans les autres parties
du monde chaque peuple ait aufli la fienne , il ne
paroît pas qu’aucun d’eux ait pouflë fes recherches
jufqu’à des caractères pour la noter. Au moins eft-ii
sûr que les Arabes ni les Ghinois , les deux peuples
étrangers qui ont le plus cultivé les lettres ,
n’on t, ni l’un ni l’autre , de pareils caractères. A la
vérité, les Perfans donnent des noms de villes de
leur pays, oiv des parties du corps humain aux quarante
huit fons de leur mufique. Ils difent, par exemple
, pour donner l’intonation d’un air : Alle{ de cette
•ville -a celle-là ; ou àlle^ du doigt au coude } mais ils
n’ont aucun ligne -propre pour exprimer fur le papier
ces mêmes fons; & , quant aux Chinois, ôn
trouve dans le P. du Hâldè, qu’ils; furent étrangement
furpris de voir les Jéfuites noter & lire fur
cette même note, tous les airs Chinois qu’on leur
faifoit entendre.
Les anciens Grecs fe fervoient pour caractères
dans leur mufique, ainfi que dans leur arithméti-
Tome m
que , 3es lettrés de leur alphabet : mais au lieu de
leur donner dans la mufique une valeur numéraire
qui marquât les intervàlles , ils fe contentoient de
les employer comme lignes, les combinant en diverfes
maniérés, les mutilant, les accouplant, les
couchant, les retournant différemment, félon les
genres & .les modes, comriie on peut voir dans le
Recueil. d’Alypius;. Les Latins les imitèrent , en fe
fervant, à leur exemple, des lettres de l’alphabet,
& il nous en refte encore la lettre jointe au' nom
de chaque note dè notre échelle diatonique & naturelle.
Gui Arétin imagina les lignes , les portées, leà
lignes particuliers, qui nous font demeurés fous le
nom des notes, & qui font aujourd’hui la langue
muficale & univerfelle de toute l’Europe. Comme
ces derniers lignes, quoiqu’admis unanimement, &
perfeétionnés depuis PArétin, ont encore de grands
défauts y plufieurs ont tenté de leur fubftituer d’autres
notes. D e ce nombre, ont été Parran ; Souhaitti,
Sauveur, Dumas, & moi-même : mais comme au
fond tous ces fyftêmes, en corrigeant d’anciens défauts,
auxquels On eft toür accoutumé, ne faifoient
qu’en fubftituer d’autres, dont l’habitude eft encore
à prendre : je penfe que le public a très-fagement
fait, de Iaiffer les chofes comme elles font, & de
nous renvoyer, nous & nos fyftêmes 3 ait pays des
vaines fpéculations. ( S )
* § CARAIAM, ( Géogr. ) « grande province pu
» pays d’Afie danslaTartarie, dont la capitale porte
>> le fliême nom ».
Les bons géographes rië connoiffent ni la province
, ni la ville de Caraiam. Lettres fur CEncyclopédie.
§ CARAMBOLA, f. fi ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom
Brame & Portugais d’un arbriffeau du Malabar,
fort bien gravé, avec la plupart de fes détails, fous
le nom Malabare tamara tongà, par Van-Rheede ,
dans fon Hortus Malabaricus, vol. I , planche X L I I I
6* XLIVypage 5 1. Les habitans du Decan ; fur la côte
de Coromandel, l’appellent carambeli, & les Hoir
landois vyf-hoeken. Rumphe en a fait graver une
figure moins bonne , au volume I de fon Herbarium
Amboinicum, planche X X X V , page 116, fous le nom
de prunum flellatum feù blimbing. C ’eft le mata goen-
fia fruclu octangulari pOm'i vulgaris magnitudine de
Cafpar Bauhin, Pinax> liv. Il.fe c t. G, & le aver-
rhoa, 2. carambola , axillis foliorum fructificantibus ,
pomis oblongis acutangulis, de M. Linné , dans fon
Syflema naturel , édition iz. 9 imprimé en 1 76 7 ,
page j / 3;
Nous avons déjà décrit deux efpeces de ce genre,'
L’un fous le nom üamvalli, l’autre fous celui de
bilimbi. Celle-ci en différé , en ce que ; i°. c’eft un
arbriffeau plus haut, s’élevant jufqu’ à douze ou quatorze
pieds, pendant que les deux autres n’ont guère
que huit à dix pieds fur quatre à cinq pouces de
diamètre ; 20, l’écorce de fon trône eft brune &
rude ; celle de fa racine eft noirâtre ; 30. fes feuilles
h’ônt que quatre ou cinq paires de folioles longues
de deux à trois pouces, à peine une fois moins Lir-
ges ; 40. les grappes des fleurs fortent de l’aiflelle
des feuilles, & font trois à quatre fois plus courtes
qu’elles, étant compofées d’une trentaine de fleurs
en cloche , longues & larges de quatre îignes , purpurines
, à cinq étamines blanches, à anthères jaunes.
; 5®. l’ovaire devient line baie ovoïde , longue de
quatre pouces, line fois moins large , à-cinq angles
profonds aigus, correfpondant à autant de loges ,
contenant chacune deux graines femblables à celles
du bilimbi.
Culture. La carambola eft commune fur toute la
côte fablonneufe dù Malabar ; onia cultive aufli dans