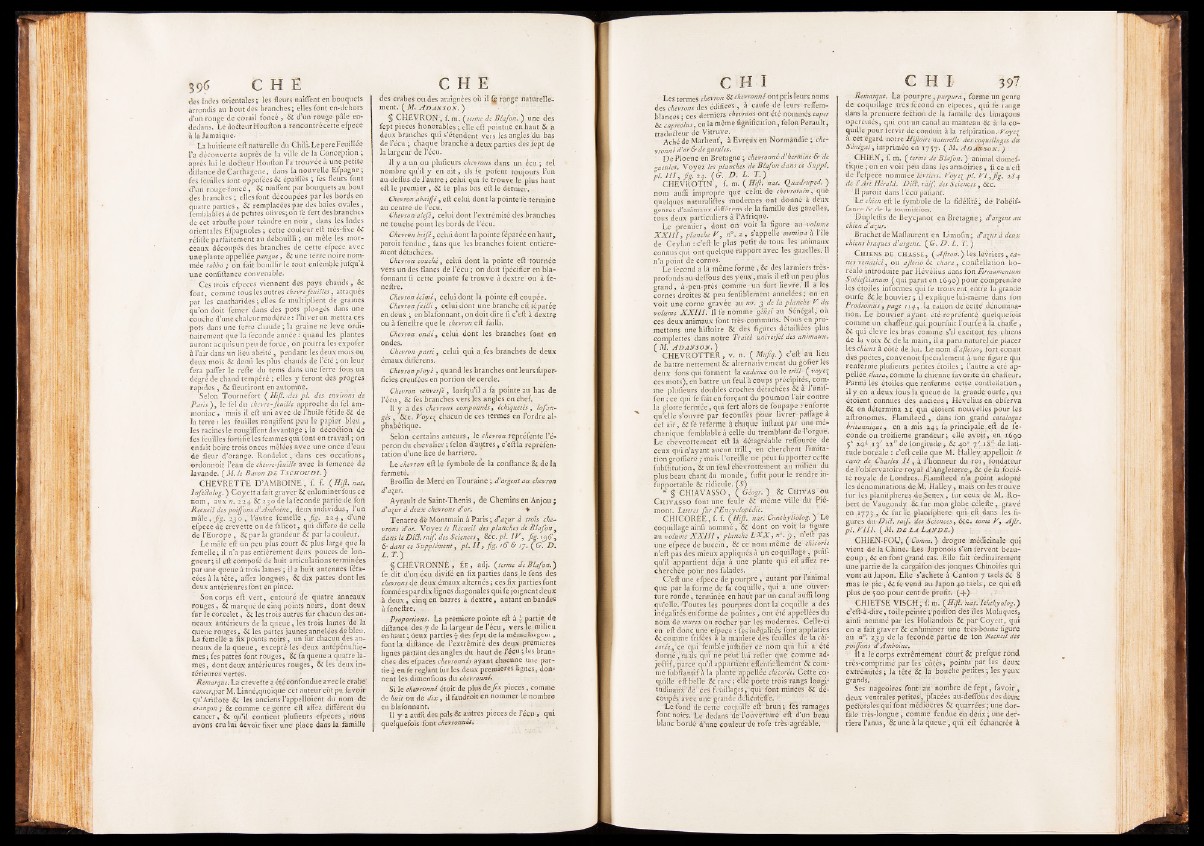
dés Indes orientales ; les fleurs naiflent en bouquets
arrondis au bout des branches; elles font en-dehors
d’un rouge de corail foncé , 6c d’un rouge-pâle en-
dedans. Le doéteur Mouflon a rencontré cette efpece
à la Jamaïque.
La huitième eft naturelle du 'Chili.LèpereFeuillee
l’a découverte auprès de la ville de la Conception ;
-après lui le dofteiir Houfton l’a trouvée a une petite
diftanee de Carthagene, dans la nouvelle Efpagne;
fes feuilles font oppofées 6c epaiffès ; les fleurs font
d’un rouge-foncé , 6c naiflent par bouquets au bout
des branches ; elles font découpées parles bords en
quatre parties , 6c remplacées par des baies ovales,
femblablës à de petites olives; ôn fe fert des branches
de cet arbufte pour teindre en noir, dans les Indes
orientales Efpagnoles ; cette couleur eft très-fixe 6c
réfifte parfaitement au débouilli ; on mêle les mot*
ceaux découpés des branches de cette efpece avec
line plante appellée pangue, 6c une terre noire nommée
robbo ; on fait bouillir le tout enfemble jufqu à
une confiftance convenable.
Ces trois efpeces viennent des pays chauds, 6ç
font, comme tous les autres chèvre-feuilles, attaques
par les cantharides ; elles fe multiplient de graines
qu’on doit femer dans des pots plongés dans une
couche d’une chaleur modèreé : l’hiver on mettra ces
pots dans une ferre chaude ; la graine ne leve ordinairement
que la fécondé année : quand les plantes
auront acquisun peu de force, on pourra les expofer
à l’air dans un lieu abrité , pendant les deux mois ou.
deux mois & demi les plus chauds de l’été ; on leur
fera paflèr le refte du tems dans une ferre fous un
dégré de chaud tempéré ; elles y feront des progrès
rapides , 6c fleuriront en automne.
Selon Tournefort ( Hift.'des pl. des environs de
Paris ) , le fel du chevre-feuille approche du fel ammoniac,
mais il eft uni avec d e l’huilè fétide 6c de
la terre : les feuilles rougiflent peu le papier bleu ,
les racines le rougiflent davantage ; la décoûion ' 4e
fes feuilles fortifie les femmes qui font en travail ; on
en fait boire trois onces mêlées avec une once d’eau
de fleur d’orange. Rondelet, dans ces occafiohs,
èrdonnoit l’eau de chèvrefeuille avec la femencé de
lavande. ( M. le Baron DE Ts ch o u d i . )
1 CHEVRETTE D ’AMBOINE, f. f. (Hifi. nat.
înfcHolog. ) Coyett a fait graver 6c enluminer fous ce
nom, aux n. 224 &230 de lafeconde partie de fort
Recueil des poiffùns d'Ainboine, deux individus, l’un
mâle , ' fig. 2 36 , l’a'utre f em e l le ,^ . 224 , d’une
efpece de crevette ou de falïcot , qui différé de celle
de l’Europe , & pa r la grandeur 6c par la couleur.
' Le mâle eft un peu plus court & plus large que la
femelle; il n’a pas entièrement deux pouces de longueur;
il eft compofé de huit articulations terminées
par une queue à trois lames ; il a huit antennes féta-
cées à la tête, àffez longues, & dix pattes dont les
deux antérieures font en pince.
Son corps eft vert, entouré de quatre ânneaùx
rouges, & marqué de cinq points noirs, dont deux
fur le corcelet, & les trois autres fur chacun des anneaux
antérieurs de la queue, lë's trois lamés 'de la
queue rouges, 6c les pattes jaunes anneléesde bleu.
La femelle a'fix points noirs, un fur chacun des anneaux
de la queue, excepté les deux antépénultièmes
; fes pattèS font rouges, & fa queue a quatre lames,
dont deux antérieures rouges, & les deux inférieures
vertes.
Remarque. La crevette a été confondue avec le èrabé'
cancer,par M. Linné,quoiqué cet auteur eût pu favoir
qu’Ariftote & les anciens l’âppelloiént du nom de
crangon ; 6c comme ce genre eft affez different du
cancer, St qu’il contient plufieurs efpeces, riPüs
avons cru lui devoir fixer une place dans la famille
des crabes ou.des araignées où il fe range naturellement.
(M . A D A N S O N . )
§ CHEVRON", f. m. ( terme de Blafon. ) une des
fept pièces honorables ; elle éft pointue en haut & a
deux branches qui s’étendent vers les. angles‘du bas
de l’écu ; chaque branche à deux parties des'fept de
la largeur de l’écu.
Il y a un ou plufieurs chevrons dans un écu ; tel
nombre qu’il y en a i t , ils fe pofent toujours l’un
au-deflus de l’autre ; celui qui Te trouve l.e plus haut
eft le premier , & le plus bas eft le dernier. .
Chevron abaißé , eft celui dont la pointe fe termine
au centre de l’écu.
Chevron alefé, celui dont l’extrémité des branches
ne touche point les bords de l’écu.
Chevron brifé, celui dont la pointe féparée en haut,
paroît fendue, fans que les branches ioient entièrement
détachées.
Chevron couché, celui dont la pointe eft tournée
vers un des flancs de l ’écu ; on doit fpécifier en bla-
fonnant fi cette pointe fe trouve à dextre ou à fc-
neftre.
Chevron édifié, celui dont la pointe eft coupée.
Chevron fa illi, celui dont une branche eft léparée
en deux ; en blafonnant, on doit dire fi c’eft à dextre
ou à feneftre que le chevron, eft failli.
Chevron ondé, celui dont les branches font en
ondes.
Chevron parti, celui qui a, fes branches de deäx
émaux difterens.
Chevron ployé, quand les branches ont leurs fuper-
ficies creulées en portion de cercle.
Chevron renverfè, lorfqu’il à fa pointe ait bas de
l’écu, 6c fes branches vèrs les angles en chef.
Il y a des chevrons coniponnés, échiquetés , lofan-
gés , Stc. Voye^ chacun de Ces termes en l’ordre alphabétique.
Selon certains auteurs, le chevron repréfente l’éperon
du chevalier ; félon d’autres, c’eft la repréfen-
tation d’une lice de barrière.
Le chevron eft le fymbole de la confiance & de la
fermeté.
Broflin de Meré en Touraine ; d'argent au chevron
d'azur.
Ayrault de Saint-Thenis, de Chemins en Anjou ;
d'azur à deux chevrons d'or. ♦
Tenarre de Montmain à Paris ; cfa^ur à trois chevrons
'{Cor. Voyez le Recueil des planches de Blafon ,
dans léDîtl. raif .des Sciences, 6cc.pl. IV , fig. ig6~,
& dans ce Supplément, pl. I l , fig- ‘ G & t j. ( G. D .
L. T .)
§ CHÉVRONNÉ , ÉE, adj. ( terme de Blafon.)
fe dit: d’un écu divifé en fix parties dans .le fens des
chevrons de deux émaux alternés ; ces fix parties font
formées par dix lignes diagonales qui fe joignent deux
à deux, ciuq en barres à dextre, autant en bandes
à feneftre. .
Proportions. La première pointe eft à 7 partie de
diftanee des.y de la largeur de l’écu, vers le milieu
en haut ; deux parties 7 des fept de la même,largeur,
font la diftanee de l’extrémité des deiix premières
lignes par.tânt des angles, du haut de l’écu ; les branches
des efpaees chevronnés ayant chacune une partie
7 en fe réglant fur les deux premières lignes, don-*
nent les .dimenfions du chevronné«
Si le chtjironnl étoit-de plus de fix. pièces, comme
de Huit ou de dix , il faudroit en nommer le nombre
en blafonnant. ",
Il y a aufli des pals & autres pièces de l’écu-, qui
quelquefois font chevronnés.
C H I
Les termes chevron 6cchevrdnné-ontm\$ leurs noms
H H H l caufe de H H
blances - ces derniers chevrons ont ete nommes caper
& capreotùs, en la même figmfication, félon Perault,
tradufteur de Vitruve. ^
Aché de Marbeuf, à Evféiïx en Normâiidie ; clie-
vronnè d'or & de gueules.- ■ ' 'I
De Ploëiie en Bretagne ;- chevronné fi'hermine & de
vueules. Voyez les planches de Blafon dans ce Suppl,
pl. I I I , fig. 24. {G. D . B. T. )
CHEVROTIN, f. m. {H i f i j nat. Quadruped. )
nom aufli impropre que ce lui dé chevrotain, que
quelques naturaliftes modernes ont donné à deux
genres d’animaux différens de la famille des gazelles,
tous deux particuliers à l’Afrique.
Le premier, dont on voit la figure au ■ volume
X X I I I , planche V , tz°j 2 s’appelle mèiiiinà à l’île
de Ceylan : c’eft le plus petit’ de tous les animaux
connus qui ont quelque rapport avec les gazelles.1 Il
n’a point de cornes. - ■* V, ‘
Le fécond a la même forme , & des larmiers très-
profonds au-deffous des yeux, mais il eft un peu plus
grand, à-peu-près commeTm fort lievfè. Il a ies
cornes droites & peu fenfiblemént annelées ; on-en
voit une corne gravée au no. 3 de la planche V du.
volume X X I I I . Il fe nomme géüfi au Sériëgâl/qii
c es deux animaux font très-communs. Nous en promettons
une hiftoire & des figures détaillées plus
complexes dans notre Traité univerfel des animaux,
CM. A d a n so n . ) ' ,
CH EVROTTER, v. n. ( Mufiq. ) c’eft àü lieu
de battre nettement & alternativement du gôfier les
deux fons qui forment la cadencé ou le t r i l f f voyé\
ces mots)i en battre un fëlil à Coups précipites, comme
plufieurs doubles croches détachées & à: Tùnif-
fon ; ce qui fe fait en forçant du poumon l’air contre
.la glotte fermée, qui fért alors de foupape ^ènforte
qu’elle s’ouvre par fecoufles pour livrer pàffage à
cet air, 6c fe referme à chaque i'nftant par une mé-
chanique femblable à celle; du tremblant- de -l’orgue.
Le chevrôttemeot eft là déiàgrëable reflpüfce de
ceux qui n’ayant aucun trill,' en cherchent l’fniità-
tion grofliere ; mais l’oreille, ne peut lupporter cette
fubftitution, & uh feul chêvrottement au milieu du
plus beau chant du monde, fuffit pour le rendre in-
fupportable & ridicule. (T) .
* § CHIAVASSO, £ y io ]g ï') & Gh iv às - ou
C hiv asso font une feule' 'même ville-du Piémont.
Lettres fur l'Encyclopédie: ' 1 '
CHICORÉE, f. f. (Hifl- - nàt. Conchyliblogi ) Le
coquillage ainfi nommé',. & dont on voit là figure
au volume X X I I I , planche L X X , n°. g j n eu pas
iine efpece de buccin, & ce nom même de' chicorée
n’eft pas des mieux appliqués à un' coquillagè , puif-
qu’il appartient déjà à" une plante qiiï éft affez ré1
cherchée pour nos.falades. .
C ’eft une efpëée de pourpre, autant par l’animal
que par la forme de fa coquille, qui a une ouverture
ronde, terminée en haut par un canal aufli long
qu’elle. T ’bUtes les pourpres dont la coquille a des
inégalités.en forme de pointes , ont été appelléès di;
nom de. murex ou rocher par les modernes. Celle-ci
en eft donc une efpece : les inégalités font applaties
& comme frifées à Ia,manierë dès feuilles de la chicorée.,
Cé mii, ‘féiUbIe juftifiër ce nom qui lui a"été
donné,"mais, qui ne pé\ii lui refter que comme ad-
jeflif, parce qu’il appaftibnt’ éffehttéllëmént .&tomme
fubftantif à la plante appeïlëë chicorée: Cette coquille
èfthèlle & rareVéllë porte trois rangs longi-
tudinaifPdë' pes fcùillagcs J qui font minces & dé-
Cbiipés'âve'c nné grande dé'l'iëatçffe.
Le fond de dette coquille'eft'‘brun ; lés ramages
font hoirs. Le dedans TJe'l’oûvèrturé eft a’un beau
blanc bordé d’une couleurde rofe frès-'àgféâble.
C H I 397
Remarque. La pourpre ^purpura,, forme un genre
de coquillage très fécond en efpeces, qui.fe range
dans la première feûion de la famille des limaçons
operculés, qui ont un canal au manteau ■ & à la coquille
pour lervir de conduit à la relpiratiün .1 Yoye^
à cét "égard notre Hiftoth naturelle des coquillages du
Sénégal", imprimée en 1757. ( M . A d a n s o n : )
CHIEN, f. m. C terme de Blafon. f -animal domef*
tique ; on en voit peu dans, les armoiries, fl ce n’eft
deTefpece nommée lévriers, f^oye^ pl. V l,fig . 2.#4
de C Art Hérald. Ditl. raif.. des Sciences , &c.
Il paroît dans l’écii paliant.
Le chien eft le fy mbole de la fidélité, de l’obéif-
fance &.de la foumiliion.
Dnplçflis de Beyéjanot en Bretagne; £ argent au
chien £a^ïir.
Brachet de Maflaurent en Limolin; £a\ur à deux
chiens braques £ argent. ( G. D . L. T. )
C h i e n s d e . chasse, ( Afiron.) les.levrièrs, cet-
nés vehàtici f ou afierio ÔL chara., conftellation boréale
introduite par Hévélius dans fon Firmammium
Sobiefcianum (qui parut en 1690) pour comprendre
les étoiles informes qui fe trouvent piitré la grande
ourfe & le bouvier ; il explique lui-rméme dans fon
Prodrônius, page 1 / 4 ,.la raifon de.cette'.dénomination.
Le bouvier ayant été reprefentq quelquefois
comme un chaffeur qui, po.urfuit i’ourfe à là çhaffe ,
& qui éleve les bras'comme s’il excitpit. les chiens
de la .voix ôc de la main, il a paru naturel de .placer
les chiens à côté de. lui. Le nom £ afierio-, fort, connu
des poètes, convenoit fpéçialement à une figure qui
renferme plufieurs. petites étoiles ; l’autre a été ap-
pellèe.çhara, comme la .chienne favorite, du. chafleur.
Parmi lès étoiles que renferme cette, çonilellation ,
il y eh a'deux fous lâ queue de la grandp ourfe, qui
étoient connues des anciens ; Hévélius en obferva
& en détermina z i 'q u i étpient naùvelles pour les
aftronomes. Flamfteed , dans fon grand catalogue
britannique, en a mis 24; là principale.eft de fécondé
ou troilieme grandeur; elle avo)t, en 1690
5* 20d \ 22" de longitude > & 40° 7 .de.lati-
.tude boréale : c’eft celle que M. Halley appelloit le
coeur de Charles 11 , .à l’honneur du ro i, fondateur
de.l’oblervatoire ro^yal d’Angleterre,, &C de la focié-
té royale de Londres-Flamfteed n’a ^ôint adopté
les dénominations deM> Halley, mai)» on les trouve
fur les planifpheres. de;Senex, fur ceux de M. Robert
de Vaugondy. ôc fur mon globe.céiefte,.gravé
en ,1773,^; 6c fur le. planifphere- qui eft dans les figures
dwDicl. raif. des Sciences-, ÔCC. tpme V, -dfir.
p l . V I I I . ( M . d e l a L a n d e . )
CHIEN-FCMJ, ( Comm. ) drogue médicinale qui
vient de la Chine. Les Japbnois s’en fervent beaucoup
, 6c en font grand cas. JElle fait ordinairement
une partie de la càrgaifon des jonques Chinoifes qûi
vont ati Japon. Elle s’achete à:Canton 7 taels 6c 8
mas le p ic , 6c Ce vend air Japon 40 taels, ce qui eft
plus de 500 pour cent dë profit. (+ ) ■
CH1ETSE V rSCHM m. ( LLifiÀfill Mthyolog.)
c’eft'-à-dire, toile peihtë'j'poiffon dès îles Moluques,
ainfi nomnié par les Hbilàndois &.pàr Coyett, qui
en a fait graver 6c éhltiihrnef line très1bomie figure
au ri°i 239 de la fécondé partie de fon Recueil des
pdiffdns £ Amboine.
Il a le corps extrêiriéqieut court $c prefque rond
très-comprimé par les ' côçés, pointu par les deux
extrémités ; la têté & la 'bouche pètites ; les yeux
grands.
Ses nageoires fottfr-àü' nonibre de fept, favoir,,
deux ventrales petites1, ’placées aii-déflbüs'des deux
pèéïôratés qui font médiqtres & quarrëës ;' une dor-
fale très-longue, cpmmé fendue en deiix ; une derrière
l’anus, 6c une à la queue, qui ' eft échancrée à