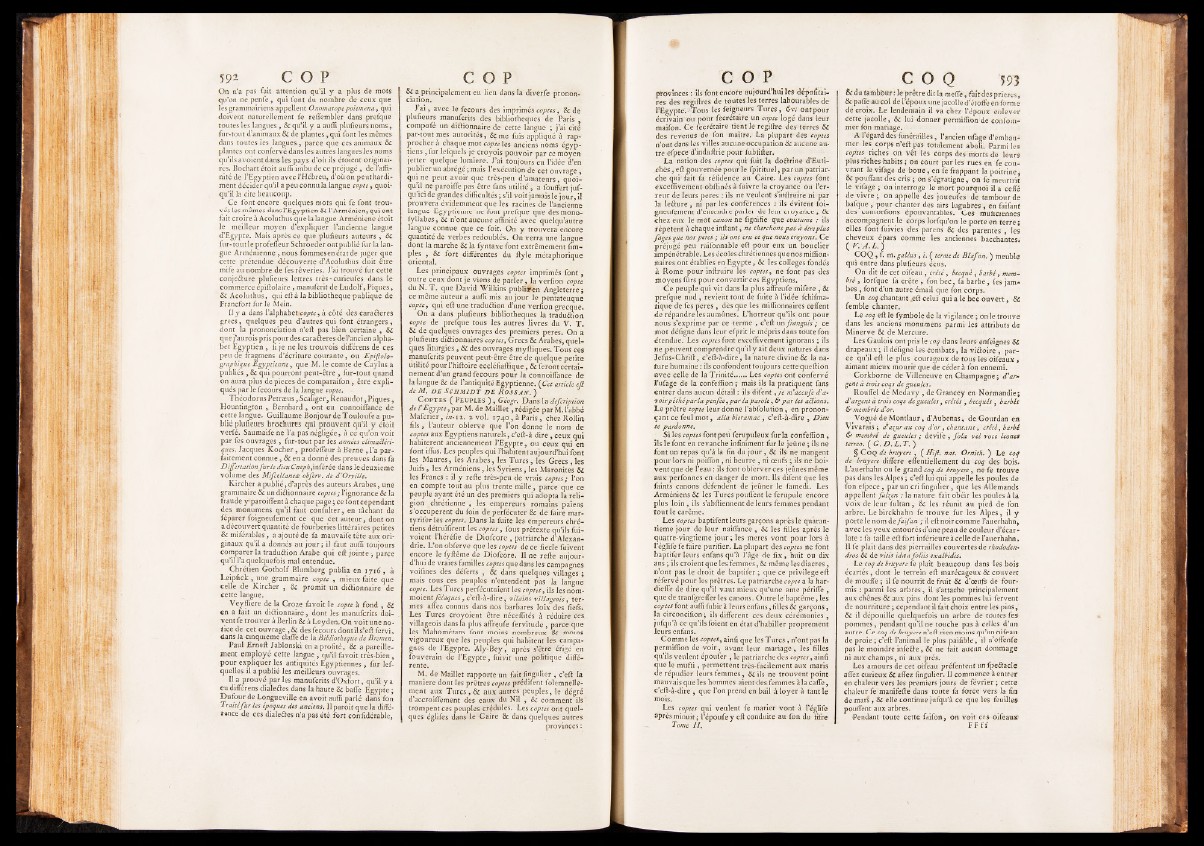
On n’a pas fait attention qu’il y a plus de mots
qu’on ne penfe , qui font du nombre de ceux que
les grammairiens appellent Onomatopepoiemena, qui
doivent naturellement fe reffembler dans prefque
toutes les langues, & qu’il y a auffi plufieurs noms,
fur-tout d’animaux & de plantes, qui font les mêmes
dans toutes les langues, parce que ces animaux &
plantes ont confervé dans les autres langues les noms
qu’ils avoient dans les pays d’oii ils étoient originaires.
Bochart étoit auffi imbu de ce préjugé, de l’affinité
de l’Egyptien avec l’Hébreu, d’oiion peuthardi-
ment décider qu’il a peu connu la langue copte, quoiqu’il
la cite beaucoup.
Ce font encore quelques mots qui fe font trouvés
les mêmes dans l’Egyptien & l’Arménien, qui ont
fait croire à Acoluthus que la langue Arméniene étoit
le meilleur moyen d’expliquer l’ancienne langue
d’Egypte. Mais après ce que plufieurs auteurs , &
fur-tout le profeffeur Schroeder ont publié fur la langue
Arménienne , nous fommesenétatde juger que
cette prétendue découverte d’Acoluthus doit être
mife au nombre de fes rêveries. J’ai trouvé fur cette
conjecture plufieurs lettres très-curieufes dans le
commerce épiftolaire, manuferit de Ludolf, Piques,
& Acoluthus, qui eft à la bibliothèque publique de
Francfort fur le Mein.
Il y a dans l’alphabet*copte, à côté des cara&eres
grecs, quelques peu d’autres qui font étrangers ,
dont la prononciation n’eft pas bien certaine , &
que j’aurois pris pour des caratteres de l’ancien alphabet
Egyptien , fi je ne les trouvois différens de ces
peu de fragmens d’écriture courante, ou Epijlolo-
graphique Egyptienne, que M. le comte de Caylus a
publiés , & qui pourront peut-être , fur-tout quand
on aura plus de pièces de comparaifon, être expliqués
par le fecours de la langue copte.
Théodorus Petræus, Scahger, Renaudot, Piques,
Hountington ,. Bernhard, ont eu connoiflance de
cette langue. Guillaume Bonjour de Touloufe a publié
plufieurs brochures qui prouvent qu’il y étoit
verfé. Saumaife ne l’a pas négligée, à ce qu’on voit
par fes ouvrages , fur-tout par fes années climactériques.
Jacques K ocher, profeffeur à Berne , l’a parfaitement
connue, & en a donné des preuves dans fa
Differtationfurie dieu Cneph^infévée dans le deuxieme
volume des Mifcellanece obferv. de d'Orville.
Kircher a publié, d’après des auteurs Arabes, une
grammaire & un dictionnaire coptes ; l’ignorance & la
fraude y* paroiffent à chaque page ; ce font cependant
des monumens qu’il faut confulter, en tâchant de
féparer foigneufement ce que cet auteur, dont on
a découvert quantité de fourberies littéraires petites
& miférables, a ajouté de fa mauvaife tête aux originaux
qu’il a donnés au jour ; il faut auffi toujours
comparer la traduction Arabe qui eft jointe -, parce
qu’il l’a quelquefois mal entendue.
Chrétien Gotholf Blumberg publia en 1 7 16 , à
Leipfick, une grammaire copte , mieux faite que
celle de Kircher , & promit un dictionnaire de
cette langue.
Veyffiere de la Croze favoit le copte à fond , &
en a fait un dictionnaire, dont les manuferits doivent
fe trouver à Berlin & à Leyden. On voit une notice
de cet ouvrage, & des fecours dont il s’eft fervi,
dans la cinquième claffe de la Bibliothèque de Bremen.
Paul Erneft Jablonski en a profité, & a pareillement
employé cette langue , qu’il favoit très-bien,
pour expliquer les antiquités Egyptiennes , fur lef-
quelles il a publié les meilleurs ouvrages.
l ia prouvé parles manuferits d’Oxfort, qu’il y a
eu différens dialeCtes dans la haute & baffe Egypte ;
Dufour de Longueville en avoit auffi parlé dans fon
Traité fur les époques des anciens. Ilparoît que la différence
de ces dialeCtes n’a pas été fort confidérable,
& a principalement eu lieu dans la diverfe prononciation.
J a i , avec le fecours des imprimés coptes, & de
plufieurs manuferits des bibliothèques de Paris ,
compofe un dictionnaire de cetté langue ; j’ai cité
par-tout mes autorités, & me fuis appliqué à rapprocher
à chaque mot copte les anciens noms égyptiens
, fur lefquels je croyois pouvoir par ce moyen
jetter quelque lumière. J’ai toujours eu l’idée d’en
publier un abrégé ÿ mais l’execution de cet ouvrage ,
qui ne peut avoir que très-peu d ’amateurs, quoiqu’il
ne paroiffe pas être fans utilité , a fouffe^t juf-
qu’ici de grandes difficultés ; s’il voit jamais le jour, il
prouvera évidemment que les racines de l’ancienne
langue Egyptienne ne font prefque qiie des mono-
lyllabes, &c n’ont aucune affinité avec quelqu’autre
langue connue que ce foit. On y trouvera encore
quantité de verbes redoublés. On verra une langue
dont la marche & la fyntaxe font extrêmement Amples
, & fort differentes du ftyle métaphorique
oriental.
Les principaux ouvrages coptes imprimés fon t ,
outre ceux dont je viens de parler, la verfion copte
du N. T . que David 'Wilkins publiâPen Angleterre;
ce meme auteur a auffi mis au jour le pentateuque
copte, qui eft une traduction d’une verfion grecque.
On a dans plufieurs bibliothèques la traduction
copte de prefque tous les- autres livres du V. T .
& de quelques ouvrages des premiers peres. On a
plufieurs dictionnaires coptes, Grecs & Arabes, quelques
liturgies , & des ouvrages myftiques. Tous ces
manuferits peuvent peut-être être de quelque petite
utilité pour l’hiftoire eccléfiaftique, & feront certainement
d’un grand fecours pour la connoiflance de
la langue & de l’antiquité Egyptienne. ( Cet article ejl
de M. d e S c h m i d t d e R o s s a h . )
C optes ( Peuples ) , Géogr. Dans la defcnption
de l'Egypte, par M. de Maillet, rédigée par M. l’abbé
Mafcrier, in-îz. z vol. 1740, à Paris, chez Rollin
fils , 1 auteur obferve que l’on donne le nom de
coptes aux Egyptiens naturels; c’eft-à dire , ceux qui
habitèrent anciennement l’Egypte, ou ceux qui en
font iffus. Les peuples qui l’habitent aujourd’hui font
les Maures, les Arabes, les Turc s, les Grecs , les
Juifs, les Arméniens, les Syriens, les Maronites &
les Francs : il y refte très-peu de vrais coptes ; l’on
en compte tout au plus trente mille, parce que ce
peuple ayant été un des premiers qui adopta la religion
chrétienne , les empereurs romains païens
s’occupèrent du foin de perfécuter & de faire mar-
tyrifer les coptes. Dans la fuite les empereurs chrétiens
détruifirent les coptes , fous prétexte qu’ils Envoient
l’héréfie de Diofcore , patriarche d’Alexandrie.
L’on obferve que les coptes de ce fiecle fuivent
encore le fyftême de Diofcore. 11 ne refte aujourd’hui
de vraies familles coptes que dans les campagnes
voifines des déferts , &c dans quelques villages ;
mais tous ces peuples n’entendent pas la langue
copte. Les Turcs perfécutoient les coptes, ils les nom-
moient félaques, c’eft-à-dire, vilains villageois, termes
affez connus dans nos barbares loix des fiefs.
Les Turcs croyoient être néceflités à réduire ces
villageois dans la plus affrçufe fervitude, parce que
les Mahométans font moins nombreux & moins
vigoureux que les peuples qui habitent les campagnes
de l’Egypte. Aly-Bey, après s’être érigé en
fouverain de l’Egypte, fuivit une politique différente.
M. de Maillet rapporte un fait fingulier , c’eft la
maniéré dont les prêtres coptes prédirent folemnelle-
ment aux Turc s, & aux autres peuples, le dégré
d’accroiffement des eaux du Nil , & comment ils’
trompent ces peuples crédules. Les coptes ont quelques
églifes dans le Caire & dans quelques autres
provinces :
provinces : dis font encore aujourd’hui les dépofîtai-
res des regiftres de toutes les terres labourables de
l’ Egypte.J Tous les feignéitrs Turc s, &ci ont pour
écrivain Oii pour fecrétàire un copte logé dans leur
maifon. Ce fecrétàire tient le regiftre des terres &
des revenus de fon maître. La plupart' des coptes
n’ont dans les villes aucune occupation &£ aucune autre
efpece d’iudùftrie pour fubfiftcr.
• La nation dès coptes ouf fuit la doCtrine d’Euti-
chès, eft gouvernée pour le fpirituél, par un patriarche
qui' fait fa réfidence au Caire. Les coptes■ font
éxceflîvementobftinés à fuivre la croyance ou l’erreur
de leurs peres : ils ne veulent s’inftrùire ni par
la leCturé, ni par les conférences ; ils évitent foigneufement
d’entendre parler de leur croyance, &
chez eux le mot canon né lignifie que coutume : ils
répètent à chaque inftant, rie cherchons pas à être plus
fages que nos peres ; ils ont cru ce que nous croyons. Ce
préjugé pqu raifonnable eft pour eux un bouclier
impénétrable. Les écoles chrétiennes quenOs millionnaires
ont établies en Egypte, & les colleges fondés
à Rome pour inftruire les coptes, ne font pas des
moyens fûrs pour convertir ces Egyptiens.
Ce peuple qui vit dans la plus affreufe mifere , &
prefque nud, revient tout de fuite à l’idée fehifma-
tique de fes peres , dès que les riiiffionnaireS ceffent
de répandre les aumônes. L’horreur qu’ils ont pour
nous s’exprime par ce -terme , c’eft un franguis ; ce
mot défigne dans leur efprit le mépris dans toute fon
étendue. Les coptes font exceffivement ignorans ; ils
ne. peuvent comprendre qu’il y ait deux natures dans
Jefus-Chrift, c’eft-à-dire, la nature divine & la nature
humaine : ils confondent toujours cette queftion
avec' celle de la T rinité...... Les coptes ont confervé
l ’ufage de la confeffion ; mais ils la pratiquent fans
entrer dans aucun détail : ils difent ,j e maccufe d'avoir
péché par la penfée ,par la parole, & par les allions.
L e prêtre copte leur donne l’abfolution, en prononçant
ce feul m ot, alla bieramac, c’eft-à-dire , Dieu
te pardonne.
Si les coptes font peu fcrupuleux furla confeffion ,
ils le font en revanche infiniment fur le jeûne ; ils ne
font un'repas qu’à la fin du jo u r , & ils ne mangent
pour lors ni poiflon, ni beurre , ni oeufs ; ils ne boivent
que de l’eau : ils font obferver ces jeûnèsmême
aux perfonnes en danger de mort. Ils difent que les
faints canons défendent de jeûner le famedi. Les
Arméniens & les Turcs pouffent le fcrupule encore
plus loin , ils s’abftiennent de leurs femmes pendant
tout le carême.
Les coptes baptifent leurs garçons après le quarantième
jour de leur naiffance , & les filles après le
quatre-vingtieme jour ; les meres vont pour lors à
l’églife fe faire purifier. La plupart des coptes ne font
baptifer leurs enfans qu’à l’âge de f ix , huit ou dix
ans ; ils croient que les femmes, & même les diacres,
n’ont pas le droit de baptifer ; que ce privilège eft
ïéfervé pour les prêtres. Le patriarche copte a la har-
dieffe de dire qu’il vaut mieux qu’une ame périffe ,
que de tranfgreffer les canons. Outre le baptême, les
coptes font auffi fubir à leurs enfans, filles & garçons,
la circoncifion ; ils different ces deux cérémonies ,
jufqu’à ce qu’ils foient en état d’habiller proprement
leurs enfans.
Comme les coptes, ainfi que les Turc s, n’ont pas la
permiffion de vo ir , avant leur mariage, les filles
qu’ils veulent époufer , le patriarche des coptes, ainfi
que le mufti, permettent très-facilement aux maris
de répudier leurs femmes, & ils ne trouvent point
mauvais que les hommes aient des femmes à la caffe,
c’eft-à-dire , que l’on prend en bail à loyer à tant le
mois.
Les coptes qui veulent fe marier vont à l’églife
après minuit ; l’époufey eft conduite au fon du fifre
Tome II.
& du tambour : le prêtre dit la meffe, fait des prières,
& paffe au col de l’époux une jacolle d'étoffe en forme
dé croix. Le lendemain il va chez l’époux enlever1
dette jacolle, & lui donner permiffibn de confom-
mer fon mariage. • -
A l’égard des funérailles, Fanden ufage d’embau*
mer- les corps n’eft pas totalement aboli. Parmi les
coptes riches On vêt les corps deS liiorts dé leurs
plus riches habits ; on court parles rues en fe couvrant
le vifage de boue, en fe frappant la poitrine;
& pouffant des cris ; on s’égratigne, on fe meurtrit
le vifage ; on interroge le mort pourquoi il a ceffé
de vivre ; on appelle des joueufes de tambour de
bafque , pour chanter des airs lugubres , en faifant
des contorfions épouvantables. Ces muficiennes
accompagnent le corps lorfqu’on le porte en terre;
elles font fuivies des parens & des parentes , les
cheveux épars comme les anciennes bacchantes.
f^V.A.L.')
C O Q , f. m. galtus, /. ( terme de B la f on. ) meuble
qui entre dans plufieurs écus.
On dit de cet oifeau , crêté, becquê, barbé, ment-
brê, lorfque fa crête , fon bec, fa barbe, fes jambes
, font d’un autre émail que fon corps.
Un coq chantant .eft celui qui a le bec ouvert, &
femble chanter.
Le coq eft le fymbole de la vigilance ; on le trouve
dans les anciens monumens parmi les attributs de
Minerve & de Mercure.
Les Gaulois ont pris le coq dans leurs enfeignes &
drapeaux ; il défigne les eoriibats, la vi&oire ; parce
qu’il eft le plus courageux de tous les oifeaux,
aimant mieux mourir que de céder à fon ennemi.
Corkborne de Villeneuve en Champagne ; d'ar*
gent a trois coqs de gueules.
Rouffel de Medavy , de Granceÿ en Normandie;
d'argent à trois coqs de gueules, crêtés , becquês , barbés
& membrés £ or.
Vogué de Montlaur, d’Aubênas, de Gourdan en
Vivarais ; (Partir au coq d'or, chantant, crêté, barbé
& membre de gueules ; devife , fola vel voce leones
terreo. ( G. D. L .T .y
§ C o Q de bruyere , ( Hiß. nat. Ornith. ) Le coq
de bruyere différé effentiellement du coq des bois.
L’auerhahn ou le grand coq de bruyere, ne fe trouve
pas dans les Alpes ; c’eft lui qui appelle les poules de
fon efpece, par un cri fingulier, que les Allemands
appellent fallen : la nature fait obéir les poules à la
voix de leur fultan, & les iéunit au pied de fon
arbre. Le birckhahn fe trouve fur les Alpes, il y
porte le nom de faifan ; il eft noir comme l’auerhahn,
avec les yeux entourés d’une peau de couleur d’écarlate
: fa taille eft fort inférieure à celle de l’auerhahn.
Il fe plait dans des pierrailles couvertes de rhododen-
dros & de vitis idaa foliis exalbidis.
Le coq de bruyere fe plaît beaucoup dans les bois
écartés , dont le terrein eft marécageux & couvert
de moufle ; il fe nourrit de fruit & d’oeufs de fourmis
: parmi les arbres, il s’attache principalement
aux chênes & aux pins dont les pommés lui fervent
de nourriture ; cependant il fait choix entre les pins,
& il dépouille quelquefois un arbre de toutes fe S
pommes, pendant qu’il ne touche pas à celles d’un
autre. Ce coq de bruyere n’eft rien moins qu’un oifeau
de proie ; c’eft l’animal le plus paifible, il n’offenfe
pas le moindre infeéte, & ne fait aucun dommage
ni aux champs, ni aux prés.
Les amours de cet oifeau préfentent un fpeéîacle
affez curieux & affez fingulier. Il commence à entrer
en chaleur vers les premiers jours de février ; cette
chaleur fe manifefte dans toute fa force vers la fin
de mar5, & elle continue jufqu’à ce que les feuilles
pouffent aux arbres.
•Pendant toute cette faifon, on voit ces oifeau*
FF f f