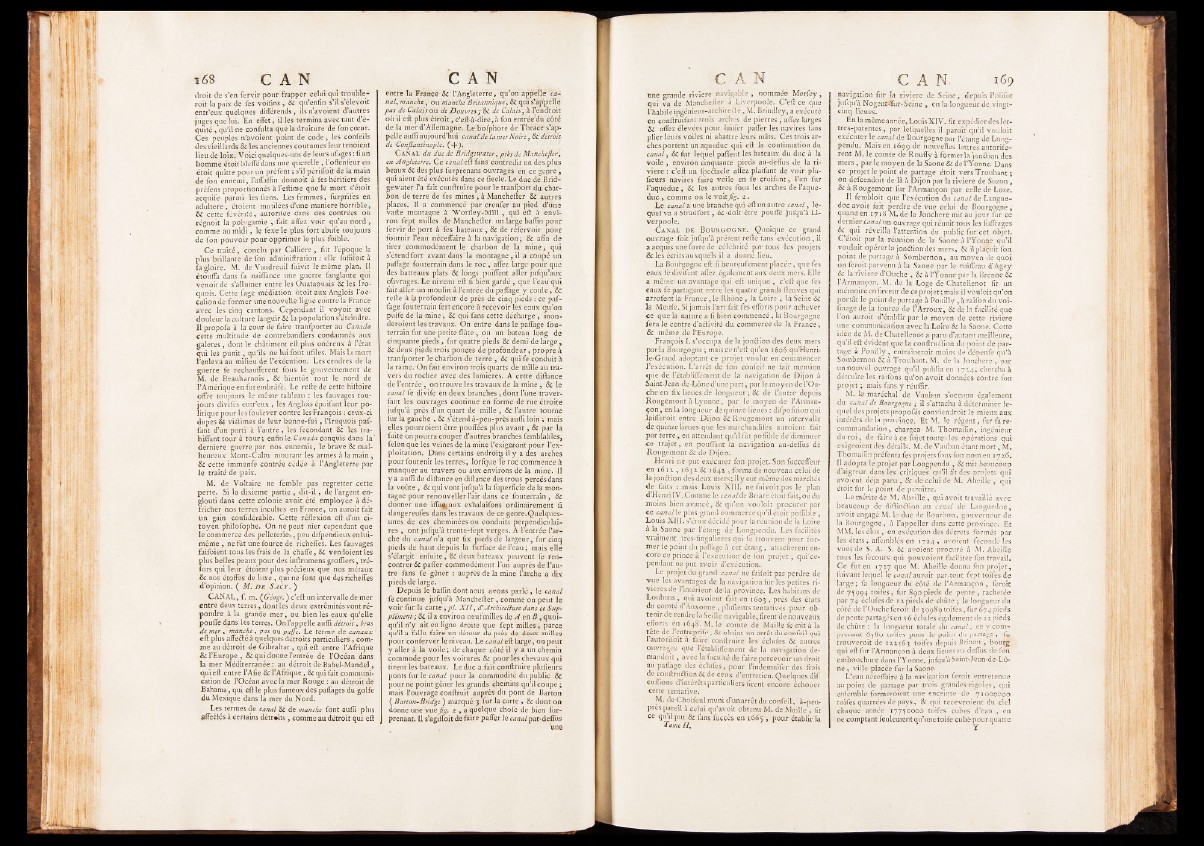
droit de s’ en fervir pour frapper celui qui trouble-
roit la paix de fes voifins , & qu’enfin s’il s’elevoit
entr’eux quelques différends, ilsn’avoient d autres
juges que lui. En effet, il les termina avec tant d’équité
, qu’il ne confulta que la droiture de fon coeur.
Ces peuples n’avoient point de code, les confeils
des vieillards & les anciennes coutumes leur tenoient
lieu de loix. Voici quelques-uns de leurs ufages : fi un
homme étoit bleffé dans une querelle , 1 offenfeur en
étoit quitte pour un prefent ; s’il periffoit de la main
de fon ennemi, l’affaffin donnoit à fes héritiers des
préfens proportionnés à l’eftime que le mort s’étoit
acquife parmi les fiens. Les femmes, furprifes en
adultéré, étoient mutilées d’une maniéré horrible,
& cette févérité, autorifée dans des contrées oit
régnoit la polygamie , fait a fiez voir qu’au nord,
comme au midi, le fexe le plus fort abufe toujours
de fon pouvoir pour opprimer le plus foible.
Ce traité, conclu par Calliere , fut l’épbque la
plus brillante de fon adminiftrarion : elle fuffifoit à
fa gloire. M. de Vaudreuil fuivir le même plan. Il
étouffa dans fa naiffancè une guerre fanglante qui
venoit de s’allumer entre les Ouataouais & les Iro-
quois. Cette fage médiation ôtoit aux Anglois l’oc-
cafion de former une nouvelle ligue contre la France
avec les cinq cantons. Cependant il Voyoit avec
douleur la culture languir & la population s’éteindre.
Il propofa à la cour de faire tranfporter au Canada
cette multitude de contrebandiers condamnés aux
galeres, dont le châtiment eft plus onéreux à l’état
qui les punit, qu’ils ne lui font utiles. Mais la mort
l ’enleva au milieu de l’exécution. Les cendres de la
guerre fe réchauffèrent fous le gouvernement de
M. de Beauharnois , & bientôt tout le nord de
l’Amérique en fut embrâfé. Le refte de cette hiftoire
offre toujours le même tableau : les fauvages toujours
divifés entr’eux , les Anglois épuifant leur politique
pour les foulever contre les François : ceux-ci
dupes & vi&imes de leur bonne-foi, l’iroquois paf-
fant d’un parti à l’autre, les fécondant & les tra-
hiffant tour à tour; enfin le Canada conquis dans la'
derniere guerre par nos ennemis, le brave & malheureux
Mont-Calm mourant les armes à la main ,
& cette immenfe contrée cédée à l’Angleterre par
le traité de paix.
M. de Voltaire ne femble pas regretter cette
perte. Si la dixième partie , d it-il, de l’argent englouti
dans cette colonie avoit été employée à défricher
nos terres incultes en France, on auroit fait
un gain confidérable. Cette réflexion eft d’un citoyen
philofophe. On ne peut nier cependant que
le commerce des pelleteries, peu difpendieux en lui-
même , ne fut une fource de richeffes. Les fauvages
faifoient tous les frais de la chaffe, & vendoient les
plus belles peaux pour des inftrumens grofliers, tré-
fors qui leur étoient plus précieux que nos métaux
& nos étoffes de luxe , qui ne font que des richeffes
d’opinion. ( M. d e Sa c y . )
CANAL, f. m. ( Géogr. ) c’eft un intervalle de mer
entre deux terres, dont les deux extrémités vont répondre
à la grande mer, ou bien les eaux qu’elle
pouffe dans les terres. On l’appelle aufli détroit, bras
de mer, manche, pas ou pajfe. Le terme de canaux
eft plus affecté à quelques détroits particuliers, comme
au détroit de Gibraltar , qui eft entre l’Afrique
& l’Europe , & qui donne l’entrée de l’Océan dans
la mer Méditerranée : au détroit de Babel-Mandel,
qui eft entre l’Afie & l’Afrique, & qui fait communication
de l’Océan avec la mer Rouge : au détroit de
Bahama, qui eft le plus fameux des paffages du golfe
du Mexique dans la mer du Nord.
Les termes de canal & de manche font aufli plus
afffi&és à certains détruits, comme au détroit qui eft
entre la France & l’Angleterre, qu’on appelle canal,
manche, ou manche Britannique, & qui s’àp'pellè
pas de Calais ou de Douvres ; & de Calais, à l’endroit
oii il eft plus étroit, c’eft-à-dire,à fon entréeMü côté
de la mer d’Allemagne. Le bofphore déThfàce's’a'fr-
pelle aufli aujourd’hui canafde la mer Noire, & détroit
de Conjlantinoplc. (+_)•
C anal du duc de Bridgewater, prés de Manchefler',
en Angleterre. Ce canal.Qu. fans contredit un des plus
beaux & des plus furprenans ouvrages en ce gepre ,
qui aient été exécutés dans ce fiecle. Le duc de Bridge
watér l’a fait conftruire pour le tranfport du charbon
de terre de fes mines , à Manchefter & autres
places. Il a commencé par creufer au pied d’une
vafte montagne à Worfley-Mill , qui eft à environ
fept milles de Manchefter un large baflin pour
fervir de port à fes bateaux , & de réfervoir pour
fournir l’eau néceffaire à la navigation ; & afin de
tirer commodément le charbon de la mine, qui
s’étend fort avant dans la montagne , il a coupé un
paffage fouterrain dans le roc , allez large pour que
des batteaux plats & longs puiffent aller jufqu’aux
oùvrages. Le niveau eft fi bien gardé , que l’eau qui
fait aller un moulin à l’entrée du paffage y coule, ÔC
refte à 1^ profondeur de près de cinq pieds : ce paffage
fouterrain fert encore à recevoir les eaux qu’on
puife de la mine, & qui fans cette décharge , inon-
deroient les travaux. On entre dans le paffage fouterrain
fur une petite flûte, ou un bateau long de
cinquante pieds , fur quatre pieds & demi de large ,
& deux pieds trois pouces de profondeur, propre à
tranfporter le charbon dve terre , & qui fe conduit à
la rame. On fait environ trois quarts de mille au travers
du rocher avec des lumières. A cette diftance
de l’entrée, on trouve les travaux de l'a mine, & le
canal fe divife en deux branches , dont l’une traver-
fant les ouvrages continue en forme de rue étroite
jufqu’à près d’un quart de mille , & l’autre tourne
fur la gauche , & s’étend à-peu-près aufli loin ; mais
elles pourroient être pouffées plus avan t, & par la
fuite on pourra couper d’autres branches femblables,
félon que les veines de la mine l’exigeront pour l’exploitation.
Dans certains endroits il y a des arches
pour foutenir les terres, lorfque le roc commence à
manquer au travers ou aux environs de la mine. Il
y a aufli de diftance en diftance des trous percés dans
la voûte , & qui vont jufqu’à la fuperficie de la montagne
pour renouveller l’air dans ce fouterrain, &
donner une iffu^aux exhalaifons ordinairement fi
dangereufes dans les travaux de ce genre.Quelques-
unes de ces cheminées ou conduits perpendiculaires
, ont jufqu’à trente-fept verges. A l’entrée l’arche
du canal n’a que fix pieds de largeur , fur cinq
pieds de haut depuis la furfaCe de l’eau ; mais elle
s’élargit enfuite, & deux bateaux peuvent fe rencontrer
& paffer commodément l’un auprès de l ’autre
fans fé gêner : auprès de la mine l’arche a dix
pieds de large.
Depuis le baflin dont nous avons parlé , le canal
fe continue jufqu’à Manchefter , comme on peut le
voir fur la carte ,p l. X I I , d’Architecture dans ce Supplément
; & il a environ neufmilles de A en B , quoiqu’il
n’y ait en ligne droite que fept milles, parce
qu’il a fallu faire un détour de près de deux milles
pour conferver le niveau. Le canalèft large, on peut
y aller à la voile; de chaque côté il y a un chemin
commode pour les voitures & pour les chevaux qui
tirent les bateaux. Le duc a fait conftruire plufieurs
ponts fur le canal pour la commodité du public &
pour ne point gêner les grands chemins qu’il coupe ;
mais l’ouvrage conftruit auprès du pont de Barton
( Barton-Bridge ) marqué 3 fur la carte , & dont on
donne une vue fig. z , a quelque chofe de bien fur-
prenant. U s’agiffoit de faire paffer le canal par-deffus
unô
une grande riviere navigable , nommée Merfey,
qui va de Manchefter à Liverpoole. C ’eft ce que
l’habile ingénieur-archireâe, M. Brindley, a exécuté
en conftruifant trois arches de pierres, allez larges
& affez élevées pour lailfer paffer les navires fans
plier leurs voiles ni abattre leurs mâts. Ces trois arches
portent un aqueduc qui eft la continuation du
canal, & fur lequel paffent les bateaux du duc à la
v o ile , environ cinquante pieds au-deffus de la rivière
: c’eft un fpeaacle affez plaifant de voir plufieurs
navires faire voile en fe croifant, l’un fur
l’aqueduc ; & les autres fous les arches de l’aqueduc
, comme on le voitfig. z .
Le canal a une branche qui eft un autre canal, le-
quel va à Stradfort, &>doit être pouffé jufqu’à Liverpooie.
C anal de Bo urgo gne. Quoique ce grand
ouvrage fôit jufqu’à préiènt refté fans exécution, il
a acquis une forte de célébrité pat tous les projets
& les écrits auxquels il a donné lieu.
La Bourgogne eft fi heureufement p lacée, que fes
eaux fe divifent affez également aux deux mers. Elle
a même un avantage qui eft unique , e’eft que fes
eaux fe partagent entre les quatre grands fleuves qui
arrofentla France,le Rhône , la Loire , la Seine &
la Meufe. Si jamais l’art fait fes efforts pour achever
•ce que la nature a fi bien commencé , la Bourgogne
fera le centre d’aftivité du commerce de la France,
& même de l’Europe.
François I. s’occupa de la jonttion des deux mers
parla Bourgogne; maiscen’eft qu’en 1606 qu’Henri-
le-Grand adoptant ce projet voulut en commencer
l ’exécution. L’arrêt de fon confeil ne fait mention
que de l’établiffement de la navigation de Dijon à
Saint-Jean-de-Lône d’une part, par le moyen de l’Ou-
che en fix lieues de longueur ; & de l’autre depuis
Rougemont à Lyonne, par le moyen de l’Arman-
ço n , en la longueur de quinze lieues : difpofition qui
laifferoit entre Dijon & Rougemont un intervalle
de quinze lieues que les marchandifes auroient fait
par terre, en attendant qu’il fût poflible de diminuer
c e trajet, en pouffant la navigation au-deffus de
Rougemont & de Dijon.
Henri ne put exécuter fon projet. Son fucceffeur
en 1612 , 1632 & 1642 , forma de nouveau celui de
la jonftion des deux mers; il y eut même des marchés
de faits : mais Louis XIII. ne fuivoit pas le plan
d’Henri IV. Comme le canalàz Briare étoit fait, ou du
moins bien avancé, Sc qu’on vouloit procurer par
ce canal le plus grand commerce qu’il étoit poflible ,
Louis XIII. s’étoit décidé pour la réunion de la Loire
à la Saône par l’étang de Longpendu. Les facilités'
vraiment très-fingulieres qui fe trouvent pour former
le point du paffage à cet étang, attachèrent encore
ce prince à l’exécution'de fon projet, qu^ce-
pendant ne put avoir d’exécution.
Le projet du grand canal ne faifoit pas perdre de
vue les avantages de la navigation fur les petites rivières
de l’intérieur de^la province. Les habitans de
Louhans, qui avoient fait en 160.3 » Pr^s des états
du comte d’Auxonne , plufieurs tentatives pour obtenir
de rendre la Seille navigable, firent de nouveaux
efforts en 1648. M. le comte de Maille fe mit à la
tete de 1 entreprife, & obtint un arrêt du confeil qui
l’autorifoit à faire conftruire les éclnfes & autres
ouvrages que l’établiffement de la navigation de-
mandoit, avec la faculté de faire percevoir un droit
au paffage des eclufes, pour l’indemnifer des frais
de conftru£Hon& de ceux d’entretien. Quelques dif-
euflions d’intérêts particuliers firent encore échouer
cette tentative.
M. de Choifeul muni d’un arrêt du confeil, à-peu-
près pareil à celui qu’avoit obtenu M. de Maille , fit
ce qu’il put & fans fuccès en 1665 , pour établir la
Tome 11.
navigation fur la riviere de Seine, depuis Polifot
jufqu’à No g ent-ffu r- Sein e , en la longueur de vingt-
cinq lieues.
En la même année, Louis X IV . fit expédier des lettres
patentes , par lefquelles il paroît qu’il vouloit
exécuter le canal de Bourgogne par l’étang de Long-
pendu. Mais en 1699 de nouvelles lettres autorife-
rent M. le comte de Rouffy à former la jonÛion des
mers, par le moyen de la Saône & de l’Yonne. Dans
ce projet le point de partage étoit vers Trouhant ;
on defeendoit de là à D ijon par la riviere de Suzon,
• & à Rougemont fur l’Armançon par celle de Loze.
Il fembloit que l’exécution du canal de Languedoc
avoit fait perdre de vue celui de Bourgogne,'
quand en 1718 M. de la Jonchere mit au jour fur ce
dernier canal un ouvrage qui réunit tous les fuffrages
& qui réveilla l’attention du public fur cet objet.
C ’étoit par la réunion de la Saône à l’Yonne qu’il
vouloit opérer la jonôion des mers, & il plaçoit fon
point de partage à Sombernon, au moyen de quoi
on feroit parvenu à la Saône par le ruiffeau d’A gey
& la riviere d’Ouche , & à l’Yonne parla Brenne 6c
l’Armançon. M. de la Loge de Chatellenot fit un
mémoire en faveur de ce projet ; mais il vouloit qu’on
portât le point de partage à Pouilly , à raifon du voi-
finage de la fource de l’Arroux, & de la facilité que
l’on auroit d’établir par le moyen de cette riviere
une communication avec la Loire & la Saône. Cette
idée de M. de Chatellenot a paru d’autant meilleure,
qu’il eft évident que la conftruéfion du point de partage
à Pouilly, entraîneroit moins de dépenfe qu’à
Sombernon & à Trouhant. M. de la Jonchere , par
un nouvel ouvrage qu’il publia en 172.4, chercha à
détruire les raifons qu’ on avoit données contre fon
projet ; mais fans y réuflir.
M. le maréchal de Vauban s’occupa également
du canal de Bourgogne ; il s’attacha à déterminer lequel
des projets propofés conviendroit le mieux aux
intérêts de la province. Et M. le régent, fur fa recommandation
, chargea M. Thomaflin, ingénieur
du roi, de faire à ce fujet toutes les ôpérations qui
exigeoient des détails. M. de Vauban étant mort, M.
Thomaflin préfenta fes projets fous fon nom en 1726.
Il adopta le projet par Longpendu , & mit beaucoup
d’aigreur dans les critiques qu’il fit des projets qui
avoient déjà paru ? & de celui de M. Abeille , qui
étoit fur le point de paroître.
Le mérite de M. Abeille , qui avoit travaillé avec
beaucoup de diftinêlion au canal de Languedoc,
avoit engagé M. le duc de Bourbon, gouverneur de
la Bourgogne, à l’appeller dans cette province. Et
MM. les élus , en exécution des décrets formés par
les états, affemblés en 1724 , avoient fécondé les
vues de S. A. S. & avoient 'procuré à M. Abeille
tous les fecours qui pouvoient faciliter fon travail.
Ce fut en 1717 que M. Abeille donna fon projet,
fuivant lequel le canal auroit par-tout fept toifes de
large; fa longueur du côté de l’Armançon , feroit
de 75994 toifes, fur 890 pieds de pente , .rachetée
par 74 éclufes de 12 pieds de chûte ; la longueur du
côté de l’Ouche feroit de 39989 toifes, fur 674 pieds
de pente partagés en 5 6 éclufes également de x 2 pieds
de chûte : la longueur totale du canal, en y comprenant
6580 toifes pour le point du partage, fe
trouveroit de 122563 toifes depuis Brinon , bourg
qui eft fur l’Armançon à deux lieuesau-deffus de fon
embouchure dans l’Yonne, jufqu’à Saint-Jean-de-Lô-
n e , ville placée fur la Saône.
L’eau néceffaire à la navigation feroit entretenue
au point de partage par trois grandes rigoles, qui
enfemble formeroient une enceinte de 71000000
toifes quarrées de pays, & qui recevroient du ciel
chaque année 17750000 toifes cubes d’eau , en
ne comptant feulement qu’une toife cubé pour quatre
Y