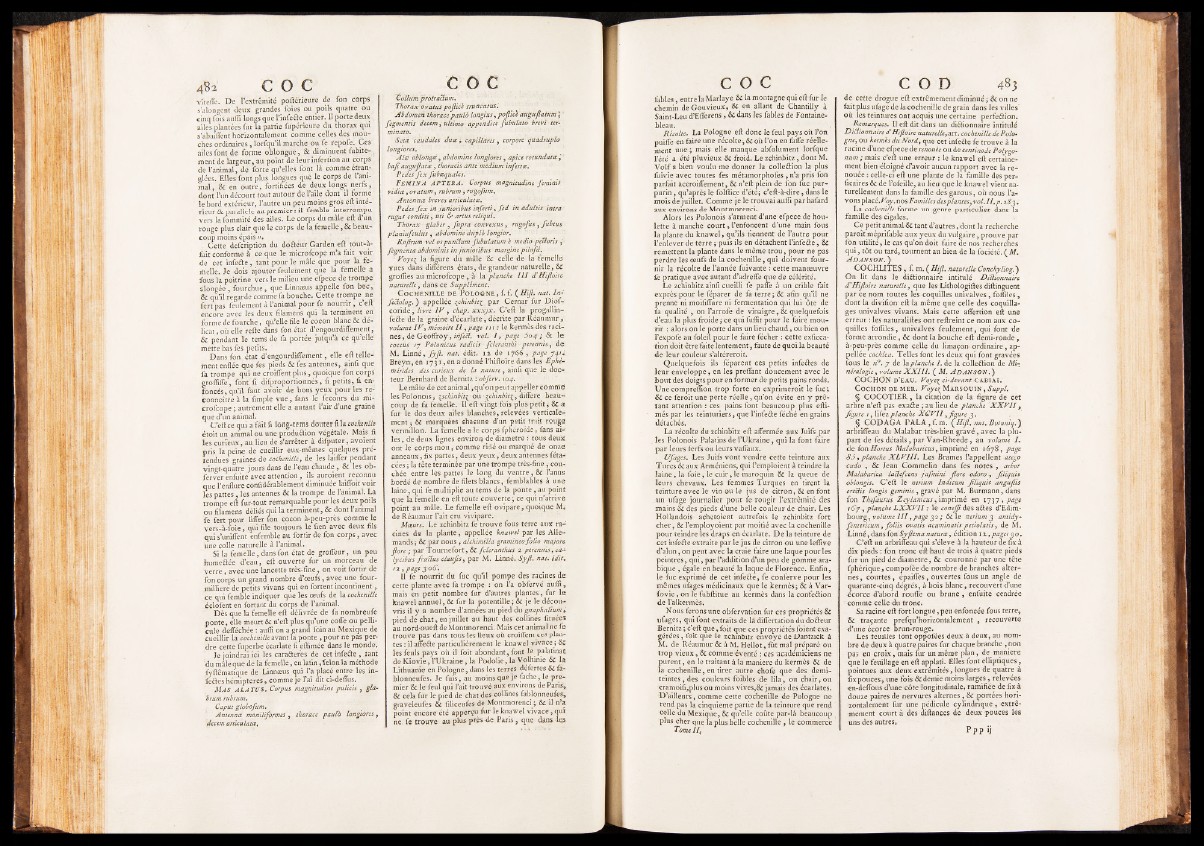
vîteffe. De l’extrémité pôftérieure de fon corps
s’alongent deux grandes foies ou poils quatre ou
cinq fois suffi longs que l’infe&e entier. Il porte deux
ailes plantées fur la partie füpérieure du thorax qui
s’àbaiffent horizontalement comme celles des mouches
ordinaires, lorfqu’il marche ou fe repofe. Ces
ailes font de forme oblongue, & diminuent fübite-.
ment de iargeur, au point de leur infertion au corps
de l’animal, de forte quelles font là comme étranglées.
Elles font plus longues què le corps de 1 animal,
& en outre, fortifiées de deux longs nerfs,
dont l’un décourt tout autour de 1 aile dont il forme
le bord extérieur, l’autre un peu moins gros eft intérieur
& parallèle au premier : il femble interrompu
vers la fommité des ailes. Le corps du mâle eft d’un
rouge plus clair que le corps de la femelle, & beaucoup
moins épais »•
. Cette defcription du dôftëur Garden eft tôut-à-
fait conforme à ce que le microfcope m’a fait voir
de cet infefte, tant pour le mâle que pour la femelle.
Je dois ajouter feulement que la femelle a
fous la poitrine vers le milieu une efpece de trompe
alongée , fourchue, que Linn«èus appelle fon bec,
& qu’il regarde comme fa bouche. Cette trompe^ne
fert pas feulement à l’animal pour fe nourrir,. c’eft
encore avec les deux filamens qui la terminent en
forme de fourche, qu’elle file le cocon blanc & délicat
, où elle refte dans fon état d’engourdiffement,
& pendant le tems de fa portée jufqu’à ce qu’elle
mette bas fes petits. '
Dans fon état d’engourdiflement, elle eft tellement
enflée que fes pieds & fes antennes, ainfi que
fa trompe qui ne croifîent plus , quoique fon corps
groffifle, font-fi difproportionnés, fl petits, fi enfoncés
, qu’il faut avoir de bons yeux pour les re-
connoîtfe à la fimple vu e, fans le fecours du microfcope
; autrement elle a autant l’air d’une graine
que d’un animaL . .
C ’eft ce qui a fait fi long-tems douter fi la côckenlle
étoit un animal ou une produ&ion végétale. Mais fi
les curieux, au lieu de s’arrêter à difputer, avoierit
pris la peine de cueillir eux-mêmes quelques prétendues
graines de cochenille, de les laifler pendant
vingt-quatre jours dans de l’eau chaude , & les ob-
ferver enfuité avec attention, ils auroient reconnu
que l’enflure confidérablement diminuée laifîoit voir
les pattes, les antennes & la trompe de l’animal. Là
trompe eft fur-tout remarquable pour les deux poils
ou filamens déliés qui la terminent, & dont l’animal
fe fert pour liffer fon cocon à-peu-près comme le
vers-à-foie, qui file toujours le fien avec deux fils
qui s’uniffent enfemble au fortir de fon corps, avec
une colle naturelle à l’animal.
Si la femelle, dans fon état de grofleur, un peu
hume&ée d’eau, eft ouverte fur un morceau de
verre, avec une lancette très-fine,. on voit fortir de
fon corps un grand nombre d’oeufs, avec une four-
millierede petits vivans qui en fortent incontinent-,
ce qui femble indiquer que les oeufs de la cochenille
éclofent en fortant du corps de l’animaj.
Dès que la femelle eft délivrée de fa nombreuse
ponte, elle meurt & n’ eft plus qu’une cofle ou pellicule
deflechée : aufli on a grand foin au Mexique de
cueillir la cochenille avant la ponte , pour ne pas perdre
cette fuperbe écarlate fi eftimée dans le monde’.
Je joindrai ici les cara&erès de cet infefte , tant
du mâle que de la femelle, en latin, félon la méthode
fyftêmatique de Linnæus qui l’a placé entre les in-
feftes hémiptères, comme je l’ai dit ci-deflus.
M a s a l a t v s . Corpus magnitudine pulicis , gla-
brum rubrum.
Caputglobofum.
Antennce moniliformes, thorace paulb longiores,
idec'em articulâtce.
Collum pràtraclüm.
Thorax ovatus poflicè trUncutus.
Abdomen thorace paulb longius, poßicl augußatum J 1
fegmentis decem, Ultimo appendice Jubulato brevi ttr-
rninato. ,
Setcé caudales duce, capillarcs, corpore quadruplo
longiores.
Alce oblohgd, abdomine longiores, apice rotundatce ,
baß augußatce , thoracis ante medium infertce.
Pedes fe x fubcequales. ■
Fem in a APTERA. Corpus magnitudine feminis
vidiez, ovatum, rubrum, rugofum.
Antennce brèves articulatce.
Pedes fe x in junioribus inferti, fed in adültis intra
rugas conditi, ùti & art us reliqui.
Thorax glaber , fupra convexus, rugofus , fubtus
planiufculus , abdomine dûplb longior.
Roßrum vel os punctum fubulatum è medio pectoris
fegmenta abdominis in junioribus margme pilofd.
' Poye^ la figure du mâle & celle de la femelld
vues dans différens états, de grandeur naturelle, &
groflies au microfcope , à la planche I I I d'Hifioire
naturelle, dans ce Supplement.
Cochenille de Pologne , f. f. ( Hiß. nat. In-
fectplog. ) appellée [ chinbitç par Cernar fur Diof-
coride g livre I P , chap. x x x jx . C ’eft la progallln-,
fe&e de la graine d’écarlate, décrite par Réaumur *
volume I P , mémoire I I , page m : le kermes des racines
, de Geoffroy, infeïl. voh 1, page So4 ; 8l le
coccus ly Polonicus ràdicïs fclerantki perennis, de
M; Linné, fyft. nat. édit.’ i l de 1J66 , page y4iè
Breyn, en 1731, en a donné Phiftoire dans les Ephé-
mé rides des curieux de la nature, ainfi que le doc-,
i teur Bernhard de Bernitz Vobferv.104.
Le mâle de cet animal, qu’on peut appeller comme*
les Polonois, \schinbit\- ou -^chinbit^, différé beaucoup
de fa femelle. Il eft vingt fois plus petit j & a
fur le dos deux ailes blanches, relevées verticale-,
ment, & marquées chacune d’un petit tra;t rouge
vermillon. La femelle a le corps fphéroïde, fans ailes
, de deux lignes erfviroq de diamètre ï tôus deu'îd
ont le corps mou,- comme ridé ou marqué de onze
anneaux, fix pattes, deux yeux,'deux antennes fêta-;
cées ; la tête terminée par une trompe très-fine, cou-:
chée'entre les pattes le long du ventre, & l’anûs
bordé de nombre de filets blancs, fembiables à une
laine, qui fe multiplie au tems de la ponte, au point
que la femelle en eft toute couverte; ce qui n’arrive
point au mâle. Le femelle eft ovipare, quoique M*
de Réaumur l’ait cru vivipare.
Moeurs. Le zchinbitz fe trouve fous terre aux racines
de la plante, appellée knawel par les Allemands;
& par nous ; alchimïlla gramineo folio majore
flore ; par Tournefort, & fcleranthüs x perennis, c<z-
lycibus frUctus claufis, par M. Linné. Syfl. nat. édit.
i x , page 306'.
Il fe nourrit du fuc qu’il pompe des racines de
cette plante avec fa trompe/ : on l’a obfervé aufli,
mais en petit nombre fur d’autres plantes, fur le
knawel annuel, & fur la potentille; & je le découvris
il y a nombre d’années au pied du gnaphaliumi
pied de chat, en juillet au haut des collines fituées
au nord-oueft de Montmorenci. Mais cet animal ne fe
trouve pas dans tous les lieux où croiflent ces plantes
: il afFeûe particuliérement le knawel vivace ; &c
lesfeuls pays où il foit abondant, font le palatinat
de Kiovie, l’Ukraine, la Podolie, la Volhinie & la-
Lithuanie en Pologne, dans les terres defertes & fa-
blonneufes. Je fuis, au moins que je fache, le premier
& le feul qui l’ait trouvé aux environs de Paris,
& cela fur le pied de chat des collines fablonneufes,
graveleufes & filiceufes de Montmorenci ; & il n’a
point encore été apperçu fur le knawel vivace, qui
ne. fe trouve au plus près-de Paris, que dans le?
fables, entre la Marlaye & la montagne qui eft fur le
chemin de G ouvieux, & en allant de Chantilly à
Saint-Leu d’Eflerens, & dans les fables de Fontainebleau.
Récolte. La Pologne eft donc le feül pays où l’on
puifle en faire une récolte-, & où l’on en fafle réellement
une-; mais elle manque âbfolument lorfque
l’été a été pluvieux & froid. Le zchinbitz, dont M.
V o lf a bien voulu me donner la colleéfion la plus
fuivie avec toutes fes métamorphofes, n’a pris fon
parfait accroiflement, & n’eft plein de fon fuc purpurin
, qu’après le folftice d’été; c’eft-àrdire, dans le
mois de juillet. Comme je le trouvai aufli par hafard
aux environs de Montmorenci»
Alors les Polonois s’arment d’une efpece de houlette
à manche court, l’enfoncent d’une main fous
la plante du knawel, qu’ils tiennent de l’autre pour
l ’enlever de terre ; puis ils en détachent l’infeûe, &
remettent la plante dans le même trou, pour ne pas
perdre les oeufs de la cochenille, qui doivent fournir
la récolte de l’année fuivante : cette manoeuvre
fe pratique avec autant d’adrefle que de célérité.
Le zchinbitz ainfi cueilli fe pafle à un crible fait
exprès pour le féparer de fa terre ; & afin qu’il ne
prenne ni moififliire ni fermentation qui lui ôte de
fa qualité , on l’arrofe de vinaigre, & quelquefois
d’eau la plus froide ; ce qui fuffit pour le faire mourir
: alors on le porte dans un lieu chaud, ou bien on
l’expofe au foleil pour le faire fécher : cette exficca-
tion doit être faite lentement, faute de quoi la beauté
de leur couleur s’altéreroit.
Quelquefois ils féparent ces petits infeâres de
leur enveloppe, en les preflant doucement avec le
bout des doigts pour en former de petits pains ronds.
Une compreflion trop forte en exprimeroit le fuc;
& ce feroit une perte réelle, qu’on évite en y prêtant
attention : ces pains font beaucoup plus efti-
més par les teinturiers, que l’infe&e féché en grains
détachés.
La récolte du zchinbitz eft affermée aux Juifs par
les Polonois Palatins de l’Ukraine, qui la font faire
par leurs ferfs ou leurs vaffaux.
Ufages. Les Juifs vont vendre cette teinture aux
Turcs & aux Arméniens, qui l’emploient à teindre la
laine, la foie, le cuir, le maroquin & la queue de
leurs chevaux. Les femmes Turques en tirent la
teinture avec le vin ou le jus de citron, & en font
,un ufage journalier pour fe rougir l’extrémité des
mains & des pieds d’une belle couleur de chair. Les
Hollandois achetoient autrefois le zchinbitz fort
cher, & l’employoient par moitié avec la cochenille
pour teindre les draps en écarlate. De la teinture de
cet infefte extraite par le jus de citron ou une leflîve
d’alun, on peut avec la craie faire une laque pour les
peintres, qui, par l’addition d’un peu de gomme arabique
, égale en beauté la laque de Florence. Enfin,
le fuc exprimé de cet infefte, fe conferve pour les
mêmes ufages médicinaux que le kermès; & à Var-
fo v ie , on le fubftitue au kermès dans la confettion
de l’alkermès.
Nous ferons une obfervation fur ces propriétés &
ufages, qui font extraits de là differtation du doéleur
Bernitz ; c’eft que, foit que ces propriétés foient exagérées
, foit que le zchinbitz envoyé de Dantzick à
M. de Réaumur & à M. Hellot, fût mal préparé ou
trop, vieux, & comme éventé : ces "académiciens ne
purent, en le traitant à la maniéré du kermès & de
la cochenille, en tirer autre chofe que des demi-
teintes , des couleurs foibles de lila, ou chair, ou
cramoifi,plus ou moins vives,& jamais des écarlates.
D ’ailleurs, comme cette cochenille de Pologne ne
rend pas la cinquième partie de la teinture que rend
celle du Mexique, & qu’elle coûte par-là beaucoup
plus cher que la plus belle cochenille , le commerce
Tomellf
de cette drogue eft extrêmement diminué; & o n ne
fait plus ufage de la cochenille de grain dans les villes'
où les teintures ont acquis une certaine perfeélion.
Remarques. Il eft dit dans un di&ionnaire intitulé
Dictionnaire d'Hifioire naturelle, art. cochenille de Pologne^
ou kermès du Nord, que cet infe&e fe trouve à la
racine d’une efpece de renouée ou de centinode Polygo-
num ; mais c’eft une erreur : le knawel eft certainement
bien éloigné d’avoir aucun rapport avec la renouée
: celle-ci eft une plante de la famille des per-
ficaires & de l’ofeille, au lieu que le knawel vient naturellement
dans la famille des garous, où nous Payons
p la c é e 3y. nos Familles des plantes, vol. II,p. 283 *
La cochenille forme un genre particulier dans la
famille des cigales.
Ce petit animal & tant d’autres, dont la recherche
paroît méprifable aux yeux du vulgaire, prouve par
ion utilité, le cas qu’on doit faire de nos recherches
qui, tôt ou tard, tournent au bien de la fociété. ( M.
A d AN SON.')
COCHLITES , f. m. ( Hiß, naturelle Conchyliog. )
On lit dans le dictionnaire intitulé Dictionnaire
d'Hifioire naturelle, que les Lithologiftes diftinguent
par ce nom toutes les coquilles uni valves, foffiles,
dont la divifion eft la même que celle des coquillages
univalves vivans. Mais cette affertion eft une
erreur : les naturaliftes ont reftreint ce nom aux coquilles
foffiles, univalves feulement, qui font de
forme arrondie, & dont la bouche eft demi-ronde,
à-peu-près comme celle du limaçon, ordinaire, appellée
cochlea. Telles font les deux qui font gravées
lous le 72°. y de la planche 1. de la collection de Minéralogie
, volume X X I I I . ( M. A DAN SO N. )
COCHON D’EAU. Poye^ ci-devant CABIAI.'
Cochon de mer. Poyeç Marsouin , Suppl.
§ CO CO T IER , la citation de la figure de cet
arbre n’eft pas exaCte ; au lieu de planche X X P 1I ,
figure 1, lifez planche X G P I I , figure j .
§ CO D AGA PA LA , f. m. (Hifi. nat. Botaniq.)
arbriflëau du Malabar très-bien gravé, avec la plupart
de fes détails, par Van-Rheede, au volume /.
de fon H or tus Malabaricus, imprimé en 1678, page
8S, planche X L P I I I . Les Brames l’appellent atego
cudo , & Jean Commelin dans fes notes , arbor
Malabarica lactefcens jafmini flore odoro, filiquis
oblongis. C ’eft le nerium Indicum filiquis anguflis
erectis longis geminis, gravé par M. Burmann, dans
fon Thefaurus Zeylanicus, imprimé en 1737 , page
iC y , planche L X X P l l : le coneffi des aCtes d’Edimbourg,
volume 1II,page 3 2; & le nerium 3 antidy-
fentericüm , foliis ovatis acuminatis petiolatis, de M.
Linné, dans fonSyßemanatura, édition 12 , pagei c)o.
C’ eft un arbriflëau qui s’élève à la hauteur de fix à
dix pieds : fon tronc eft haut de trois à quatre pieds
fur un pied de diamètre, &: couronné par une tête
fphérique, compofée de nombre de branches alternes,
courtes, épaiffes, ouvertes fous un angle de
quarante-cinq dégrés, à bois blanc, recouvert d’une
«corce d’abord rouffe ou brune, enfuite cendrée
comme celle du tronc.
Sa racine eft fort longue, peu enfoncée fous terre,
& traçante prefqu’horizontalement , recouverte
d’une écorce brun-rouge.
Les feuilles font oppofées deux à deux, au nombre
de deux à quatre paires fur chaque branche , non
pas en cro ix, mais fur un même plan, de maniéré
que le feuillage en eft applati. Elles font elliptiques ,
pointues aux deux extrémités, longues de quatre à
fix pouces, une fois & demie moins larges, relevées
en-deflous d’une côte longitudinale, ramifiée de fix à
douze paires de nervures alternes , & portées horizontalement
fur une pédicule cylindrique, extrêmement
court à des diftances de deux pouces les
uns des autres.
P p p ij