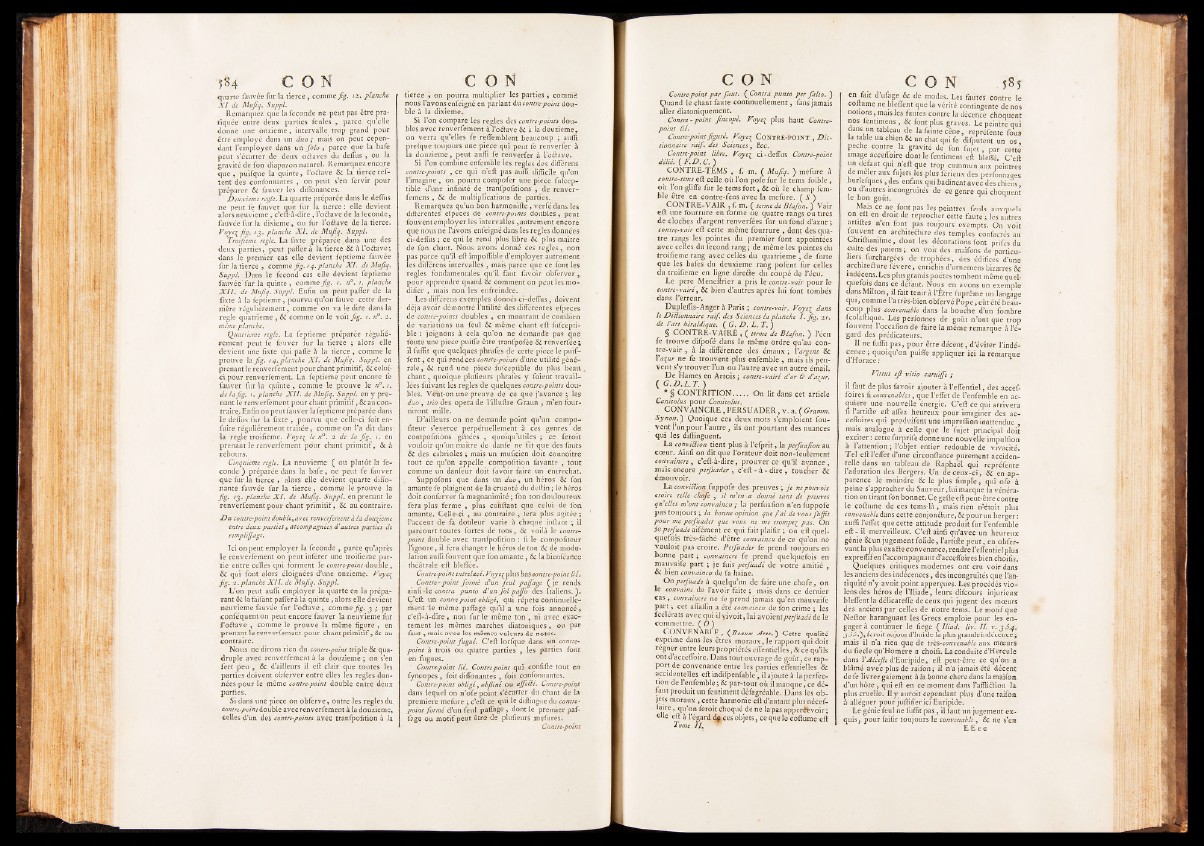
quarte fauvée fur la tierce, comme fig. 12. planche
X I de Mujîq. Suppl.
Remarquez que la fécondé ne peut pas être pratiquée
entre deux parties feules , parce qu’elle
donne une onzième, intervalle trop grand pour
être employé dans un duo ; mais on peut cependant
l’employer dans un folo y parce que la bafe
peut s’écarter de deux oûaves du deffus , ou la
gravité de fon diapazon naturel. Remarquez encore
que , puifque la quinte, i’oftave 8c la tierceref-
tent des confonnantes , on peut s’en fervir pour
préparer & fauver les diffonances.
Deuxieme réglé. La quarte préparée dans le deffus
ne peut fe fauver que fur la tierce : elle devient
alors neuvième, c’eft-à-dire, l’o&ave de la fécondé,
fauvée fur la dixième, ou fur l’oôave, de la tierce.
Voye^ fig. i j . planche X I. de Mujîq. Suppl-.
Troifieme réglé. La fixte préparée .dans une des
deux parties, peut pafferà la tierce 8c à l ’o&ave;
dans le premier cas elle devient feptieme fauvée
fur la tierce , comme fig. 14. planche XI. de Mujîq.
Suppl. Dans le fécond cas elle devient feptieme
fauvée fur la quinte, comme fig. 1. n°. 1. planche
X I I . de Mujîq. Suppl. Enfin on peut paffer de la
fixte à la feptieme, pourvu qu’on fauve cette dernière
régulièrement, comme on va le dire dans la
réglé quatrième , 8t comme on le voit fig. 1. n°. 2.
même planche.
Quatrième réglé. La feptieme préparée régulièrement
peut fe fauver îur la tierce ; alors elle
devient une fixte qui paffe à la tierce, comme le
prouve la fig. 14. planche XI. de Mujîq. Suppl, en
prenant le renverfèment pour chant primitif, & celui-
ci. pour renverfement. La feptieme peut encore fe
fauver fur la quinte , comme le prouve le n°. 1.
de la fig. 1. planche XII. de Mujîq. Suppl, en y prenant
le renverfement pour chant primitif,8c au contraire,
Enfin on peut fauver la feptieme préparée dans
le deffus fur la fixte , pourvu que celle-ci foit en-
fuite régulièrement traitée, comme on l’a dit dans*
la réglé troifieme. Foye[ le n°. 2 de la fig. 1. en
prenant le renverfement pdur chant primitif, & à
rebours.
Cinquième réglé. La neuvième ( ou plutôt la fécondé
) préparée dans la bafe, ne peut fe fauver
que fur la tierce , • alors elle devient quarte difl’o-
nante fauvée fur la tierce, comme le prouve la
fig. IJ . planche X I . de Mujîq. Suppl, en prenant le
renverfement pour chant primitif, 8c au contraire.
D u contre-point double, avec renverfement à la douzième
entre deux parties , accompagnées d'autres parties de
remplijjage.
Ici on peut employer la fécondé , parce qu’après
le renverfement on peut inférer une troifieme partie
entre celles qui forment le contre-point-double,
& qui font alors éloignées d’une onzième. Voyeç
fig. 2. planche X I I . de Mujîq. Suppl.
L’on peut auffi employer la quarte en la préparant
8c lafaifant pafferà la quinte, alors elle devient
neuvième fauvée fur l’o&ave , comme fig. j ; par
conféquent on peut encore fauver la neuvième fur
l ’o&ave , comme le prouve la même figure , en
prenant le renverfement pour chant primitif, & au
contraire.
Nous ne dirons rien du contre-point triple & quadruple
avec renverfement à la douzième ; on s*en
fert peu , 8c d’ailleurs il eft clair que toutes les
parties doivent obferver entre elles les réglés données
pour le meme contre-point double entre deux
parties.
Si dans une piece on obferve, outre les réglés du
contre-point double avec renverfement à la douzième,
celles d’un des contre-points avec tranfpofition à la
tierce , on pourra multiplier les parties j comrtiè
nous l’avons enfeigné en parlant du contre-point double
à la dixième.
Si l ’on compare les réglés des contre-points doubles
avec renverfement à l’o&ave & à ia douzième,
on verra qu’elles fe reffemblent beaucoup ; aufîi
prefque toujours une piece qui peut fe renverfer à
la douzième, peut auffi fe rénverfer àToûave.
Si l’on combine enfemble les réglés des différens
contre-points , ce qui n’eft pas auffi difficile qu’on
l’imagine , on pourra compofer une piece fufeep-
tible d’une infinité de tranfpofitioris , de renvër-
femens , 8c de multiplications de parties.
Remarquez qu’un bon harmonifte, verfé dans les
différentes efpeces de contre-points doubles, peut
fouvent employer lès intervalles , autrement encorè
que nous ne l’avons enfeigné dans les réglés données
ci-deffus ; ce qui le rend plus libre 8c plus maître
de fon chant. Nous avons donné ces réglés, non
pas parce qu’il efi impoffible d’employer autrement ■
les différens intervalles , mais parce que ce font les
réglés fondamentales qu’il faut favoir obfetVer,
pour apprendre quand & comment on peut les modifier
, niais non les enfreindre.
Les différens exemples donnés ci-deffus, doivent
déjà avoir démontré l’iitilité des différentes efpece9
de contre-points doubles , en montrant de combien
de variations un. feul & même chant eft fufcepti-
ble : joignons à cela qu’on ne demandé pas qué
toute une piece puiffe être tranfpofée & renverfée y
il fuffit que quelques phrafes de cette piece le puif-
fen t, ce qui rend ces contre-points d’une utilité générale,
8c rend une piece fufceptible du plus beau
chant, quoique plufieurs phrafes y foient travaillées
fuivant les réglés de quelques contre-points dou-*-
blés. Veut-on une preuve de ce que j’avance ; les
duo , trio des opéra de l’illuftre Graun , m’en fourniront
mille.
D ’ailleurs on ne demande point qu’un compo-*
fiteur s’exerce perpétuellement à ces genres de
compofitions gênées , quoiqu’utiles ; ce feroit
vouloir qu’un maître de danfe ne fît que des fauts
& des cabrioles ; mais un muficien doit connoître
tout ce qu’on appelle compofition favante , tout
comme un danfeur doit favoir faire un entfechat.
Suppôfons que dans un duo, un héros' 8c fort
amante fe plaignent de la cruauté du deftin ; le héros
doit conferver fa magnanimité ; fon ton douloureux
fera plus ferme , plus coîiftant que celui de fon
amante. Celle-ci , au contraire , fera plus agitée ;
l’accent de fa douleur varie à .chaque inftant ; il
parcourt toutes fortes de tons, & voilà le coritre-
points double avec tranfpofition : fi le compofiteur
l’ignore, il fera changer le héros de ton 8c de modulation
auffi fouvent que fon amante , 8c la bienféartee
théâtrale eft bleffée.
Contre-point entrelacé. Voye[ plus bas »outre-point lié*
Contre-point formé d!un feul paffage ( je rends
ainfi * le contra punto d'un fo l paffo des Italiens.).
C’eft un contrepoint obligé, qui répété continuellement
le même paffagé qu’il a une fois annoncé,
c’eft-à-dire , non fur le même ton ', ni avec exactement
les mêmes marches diatoniques, ou par
faut, mais avec les mêmes valeurs de notes.
Contre-point fugué. C’eft lorfque dans un ' contrepoint
à trois ou quatre parties , les parties font
• en fugues.
Contre-point lié. Contrepoint qui confifte tout en
fyncopes , foit diffonantes , foit confonnantes.
Contre-point obligé, objliné ou affecte. Contre-point
dans lequel on n’ofe point s’écarter du chant de la
première mefure ; c’eft ce qui le diftingue du contrepoint
formé d’un feul paffage , dont le premier pa f
fage ou motif peut être de plufieurs mefures.
Contre-point
Contre-point par faut. ( Contra punto per falto. )
Quand le chant faute continuellement, fans jamais
aller diatoniquement.
Contre - point Jincopê. Voye{ plus haut Contrepoint
lié.
Côntre-point figuré. Voye£ CONTREPOINT , Dictionnaire
raif. des Sciences, 8cc.
Contre-point libre. Foyer ci-deffus Contre-point
délié. ( F .D . C. )
CONTRE-TEMS , f. m. ( Mujîq. ) méfure à
contre-tems eft celle où l’on pofe fur le tems foîble,
où l’on gliffe fur le tems fo r t , & où le champ fem-
ble être en contrerfens avec la mefure. ( S j
CONTRE-VAIR , f. m. ( terme de Blafon. ) Vair
eft une fourrure en forme de quatre rangs ou tires
de cloches d’argent renverfées fur un fond d’azur ;
contre-vair eft cette même fourrure , dont des quatre
rangs les pointes du premier font appointées
avec celles du fécond rang; de même les pointes du
troifiçme rang avec celles du quatrième , de forte
que les bafes du deuxieme rang pofent fur celles
du troifieme en ligne direâe du coupé de l’écu.
Le pere Meneftrier a pris le contre-vair pour le
contre-vairè, 8c bien d’autres après lui font tombés
' dans l’erreur.
Dupleffis-Anger à Paris ; contre-vair. Voye{ dans
le Dictionnaire rétif, des Sciences la planche I. fig. 21.
dt l'art, héraldique. ( G. D . L. T. )
§ CONTRE -VAIRÉ, ( terme de Blafon. ) l’écu
fe trouve difpofé dans le même ordre qu’au contre
vair , à la différence des émaux ; Vargent 8c
Vaçur ne fe trouvent plus enfemble , mais ils peuvent
s’y trouver l’un ou l’autre avec un autre émail.
D e Hames en Artois ; contre-vairé d'or & d'aiur.
( G .D .L .T . )
* § CONTRITION........On lit dans cet article
Canitolus pour Comitolus.
CONVAIN CRE, PERSUADER, v . a. ( Gramm;
Synon. ) Quoique ces deux mots s’emploient fouvent
l’un pour l ’autre, ils ont pourtant des nuances
qui les diftinguent.
La conviction tient plus à l’efprit, la perfuajîon au
coeur. Ainfi on dit que l’orateur doit non-feulement
convaincre y c’eft-à-dire, prouver ce qu’il avance,
mais encore perfuader , c’eft - à - dire , toucher 8c
émouvoir.
La conviction fuppofe des preuves ; je nepouvois
croire telle chôfe , il m'enta donné tant de preuves
qu'elles m'ont convaincu ; la perfuafion n’en fuppofe
pas toujours ; la bonne opinion que j'ai de vous fuffit
pour me perfuader que vous ne me trompe? pas. On
fe perfuade àxfimtnt ce qui fait plaifir ; on eft quelquefois
tres-fâché d’être convaincu de ce qu’on ne
vouloit pas croire. Perfuader fe prend toujours en
bonne part ; convaincre fe prend quelquefois en
mauvaife part ; je fuis perfuadé de votre amitié ,
8c bien convaincu de fa haine.
On perfuade à quelqu’un de faire une chofe, on
le convainc de l’avoir faite ; mais dans ce dernier
c a s , convaincre ne fe prend jamais qu’en mauvaife
Par^> ce* affaffin a été convaincu de fon crime ; les
fcélérats avec qui il yivoit, lui avoientperjuadéde le
commettre. (O )
CONVENABLE, ( i? eaux-Arts.') Cette qualité
exprime dans les êtres moraux, le rapport qui doit
régner entre leurs propriétés effentielles, & ce qu’ils
ont d acceffoire. Dans tout ouvrage de goût, ce rapport
de convenance entre les parties effentielles &
accidentelles eft indifpenfable , il ajoute à la perfection
de Penfemble ; 8c par-tout où il manque y ce défaut
produit un fentiment défagréable. Dans les objets
moraux , cette harmonie eft d’autant plus nécef-
,îre > qi?’on feroit choqué de ne la pas apperSfevoir ;
elle eft à l’égard cjf ces objets, ce que le coftume eft
Tome I I . "
en fait d’ufage & de modes. Les fautes contre le
coftume ne bleffent que la vérité contingente de nos
notions, mais les fautes contre la décence choquent
nos fentimens , & font plus graves. Le peintre qui
dans un tableau de la fainte cène, repréfente fous
la. table un chien 8c un chat qui Ce difputent un os ,
peche contre la gravité de fon fuje t, par cette
image acceffoire dont le fentiment eft bleffé. C ’elt
un défaut qui n’eft que trop communiaux peintres
de mêler aux fujets les plus férieux dés perfonnages
nurlefques , des enfàns qui badinent avec des chiens
cm d’autres incongruités de ce genre qui choquent
le bon goût.
Mais ce ne font pas les peintres feuls auxquels
on elt en droit de reprocher cette faute ; les autres
artares n’en font pas toujours exempts. On voit
fouvent en architeéhire des temples confacrés au
Chnftianifme, dont les décorations font prifés du
culte des païens ; on voit des maifons de particuliers
furchargées de trophées, des édifices d'une
architeôure févere, enrichis d’ornemens bizarres 8c
indécens. Les plus grands poètes tombent même quelquefois
dans ce défaut. Nous en avons un exemple
dans Milton, il fait tenir à l’Être fuprême un langage
qui, comme l’a tres-bien obférvé Pope, eût été beaucoup
plus convenable dans la bouche d’un fombre
fcolaftique. Les perfonnes de goût n’ont que trop
fouvent 1 qccafion de faire la même remarque à l’égard
des prédicateurs.
Il ne fuffit pas, pour être décent, d ’éviter l’indécence
; quoiqu’on puiffe appliquer ici la remarque
d’Horace :
Firtus efi vitio caruiffe ;
il faut de plus favoir ajouter à l’effentiel, des accef-
foires fi convenables, que l’effet de l’enfemble en acquière
une nouvelle énergie. C’eft ce qui arrivera
n l’artifte eft affez heureux pour imaginer des ac-
ceffoires qui produifent une impreffion inattendue ,
mais analogue à celle que le fujet principal doit
exciter : cette furprife donne une nouvelle impulfion
à l’attention ; l’objet entier redouble de vivacité.
Tel eft l’effet d’une circonftance purement accidentelle
dans un tableau de Raphaël qui repréfénte
l’adoration des Bergers. Un de ceux-ci, & en apparence
le moindre & le plus fimple, qui ofe à
peine s’approcher du Sauveur, lui marque fa vénération
en tirant fon bonnet. Ce gefte eft peut-être contre
le coftume de ces tems-là, mais rien rfétoit plus
convenable dans cette conjon&ure, 8c pour un berger :
auffi l’effet que cette attitude produit fur l’enfemble
eft - il merveilleux. C ’eft ainfi qu’avec un heureux
génie & un jugement folide, l’arrifte peut, en obfer-
vant la plus exafte convenance, rendre l’effentiel plus
expreffifen l’accompagnant d’acceffoires bien choifis.
Quelques critiques modernes ont cru voir dans
les anciens des indécences, des incongruités que l’antiquité
n’y avoit point apperçues. Les procédés vio-
lens des héros de l’Iliade, leurs difeours injurieux
bleffent la délicateffe de ceux qui jugent des moeurs
des anciens par celles de notre tems. Le motif que
Neftor haranguant les Grecs emploie pour les engager
à continuer le fiege ( lliad. liv. II. v. J S4 .
j 5i . ) , feroit aujourd’hui de la plus grande indécence;
mais il n’a rien que de très-convenable aux moeurs
du fiecle qu’Homere a choifi. La conduite d’Hercule
dans VAlcefte d’Euripide, eft peut-être ce qu’on a
blâmé avec plus de raifon ; il n'a jamais été décent
de fe livrer gaiement à la bonne chere dans la maifon
d’un hôte , qui eft en ce moment dans l’affliélion la
plus cruelle. Il y auroit cependant plus d’une raifon
à alléguer pour juftifier ici Euripide.
Le génie feul ne fuffit pas, il faut un jugement exquis,
pour faifir toujours le convenable, & ne s’en
E E e e