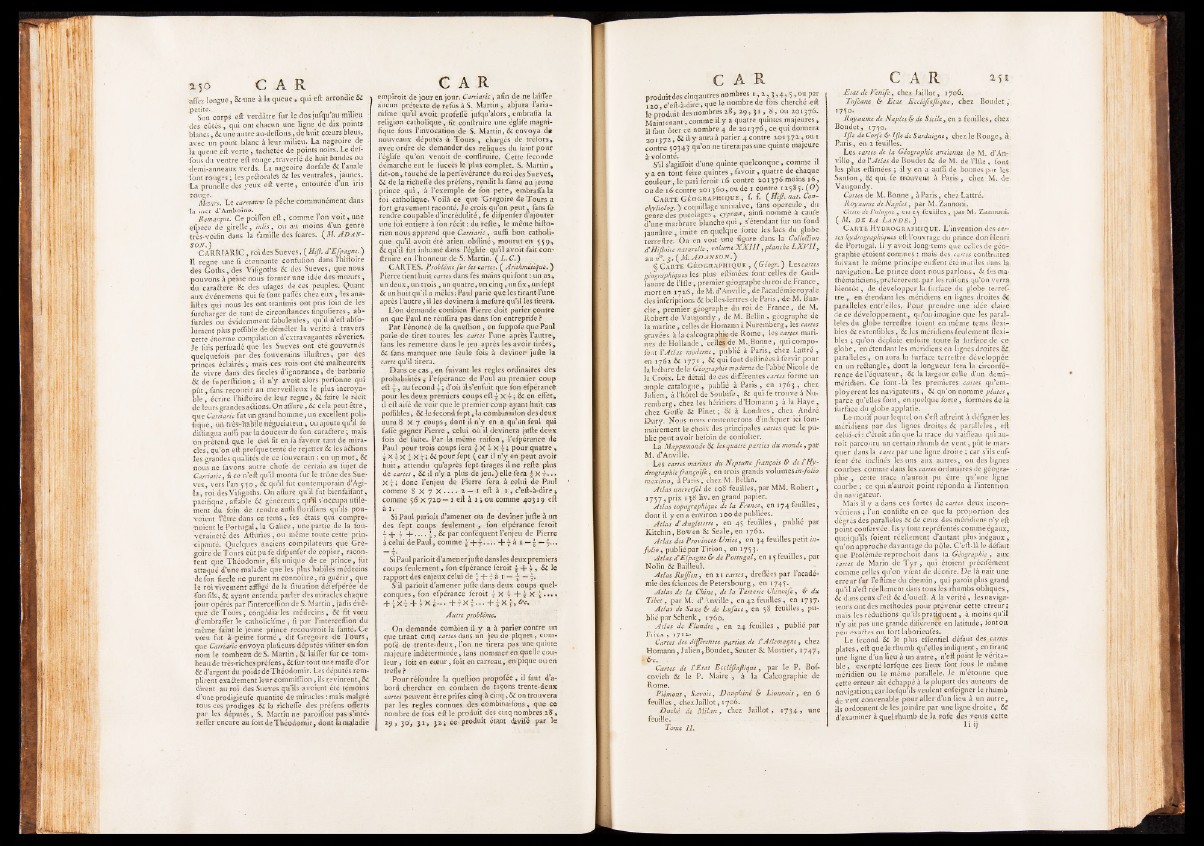
affez longue , & -une à la queue-, qui eft arrondie &
jjeîite.. . M M
Son corps eft verdâtre fur le dosjufqu au milieu ;
des côtés, qui ont chacun une ligne de dix points _
blancs, & une-autre au-deffous, de huit coeurs bleus,
avec un point blanc à leur milieu. La nageoire de •
la queue ,eft verte , tachetée de points noirs. Le def-
fous du ventre eft rouge »traverfé de huit bandes ou
•demi-anneaux verds. La nageoire dorfale anale
font rouges ; les peélorale's & les ventrales , jaunes.
La prunelle des yeux eft verte, entourée d’un iris
rouge. ,
Moeurs. L e carreauw te .peche communément dans
la mer d’Amboine.
Remarque. Ce poiffon eft , comme l’on v o i t , une
eïpece de girëlte, iulis, où au moins d’un genre
très-voifin dans la famille des fcares. (M. A d a n -
'SoN.)
CARlU ARfC, foi des Sueves, ( Hijl. d'Efpagne.)
Il régné une fi étonnante confufion dans l’hiftbire
des Goths, des Vifigoths & des Sueves, que nous
pouvons à peine nous former une idee des moeurs,
du caraftere & des ufages. de ces peuples. Quant
aux événemens qui fe font paffés chez eu x, les ana-
liftes qui nous les ont tranl'mis ont pris foin de les
furcharger de tant de circonftances lingulieres, ab-
lurdes ou évidemment fabuleufes-, qu’il n’eft abfo-
lument plus poflible de demeler la véçite a ^travers
cette énorme compilation d’extravagantes rêveries. ;
Je fuis perfuadé que les Sueves ont été gouvernés
quelquefois par des fouverains illuftres, par des
princes éclairés ; mais ces rois ont été malheureux
de vivre dans des fiecles d’ignorance, de barbarie
& de fuperdition-, il n’y avoit alors perfonne qui
p û t, fans recourir au merveilleux le plus incroyable
, écrire l’hiftoire de leur régné, & faire le récit
de leurs grandes avions. On affure , & cela peut être,
que Carrianc fut un grand homme, un excellent politique,
un très^habile négociateur; on ajoute qu’il fe
diftinwua aufli par la douceur de fon caraôere ; mais
on prétend que le ciel fit en fa faveur tant de miracles,
qu’on eft prefque tenté de rejetter & les à&ions
les grandes qualités de ce fouverain : en un mot, &
nous ne favons autre chofe de certain au fujet de
Carrianc, fi ce n’eft qu’il monta fur le trône des Sueves,
vers l’an 5 50, & qu’il fut contemporain d’Agi-
•jjjjj roi des Vifigoths. On affure qu’il fut bienfaifant,
pacifique , affable & généreux ; qtt’il. s’occupa utilement
du foin de rendre aufli floriflàns qu’ils pou-
Voient Fêtre dans ce tems , fes états qui compre-
tooient le Portugal, la Galice, une partie de la foû-
veraineté des Afturîes, ou même toute cette prin-
-cipaufé. Quelques anciens compilateurs que Grégoire
de T ours eut pu fe difpenfer de copier, racontent
que Théodomir, fils unique de ce prince, fut
attaqué d’une maladie que les plus habiles médecins
de fon fiede ne purent.ni connoître, ni guérir , que
le rôt vivement affligé de la fituation défefpérée de
fon fils , & ayant entendu parler des miracles chaque
jour opérés pair l’interceflion de S. Martin, jadis évêque
de Tours, congédia-les médecins, & fit voeu
d’embraffer le catholicifme, fi par l’interceflion du
'même faiut le jeune prince r.ecouvroit la farité. C e
voeu fut à peine formé, dit Grégoire de Tôurs,
que Carrianc erivoya plufieurs députés vifiter en-fon
nom le tombeau de S. Martin, & laifl'er fur ce tombeau
de très-riches préfens, & fur-tout une maffe d’or
& d’argent du poids de Théodomir. Les députés remplirent
exactement leur commiflion , ils revinrent, &
dirent au roi des Sueves qu'ils avoient été témoins
d’une prodigieufe quantité de miracles : mais malgré
tous ces prodiges & la richeffe des préfens offerts
par les députés, S. Martin ne paroiffoit pas s’inté-
xeffer encore au fort de Théodomir, dont la maladie
empîroit de jbur eft )0\\t.Carriaric, afin de ne laiffer
aucun prétexte de refus à S. Martin , abjura l’aria-
nifme-qu’il avoit profeffé jufqu’alors, embraffa la
religion catholique-,-fit :cOnftruire une églife magnifique
fous l’invocation de S. Martin, & envoya d#
nouveaux députés -à Tours , chargés de. tréfors,
avec ordre de demander des reliques du faint pour
l’églife. ; qu’on venoit de -cOnflruire. Cette fécondé
démarche eut le fuccès le plus complet. S. Martin,
dit-on, touché de la perfévérance du roi des Sueves,
& de la richeffe des préfens, rendit la fanté au jeune
, prince, q u i, à l’exemple de fbh père-, embraffa la
foi catholique. Voilà ce que Grégoire de Tours a
fort gravement raconté. Je crois qu’on peut, fans fe
rendre coupable d’incrédulité, fe difpenfer d’ajouter
une foi entière à fon récit : du refte > le même hifto-
rien nous apprend que Carriaric, -aufli bon catholique
qu’il avoit été arien obftiné -, mourut en 559,
& qu’il fut inhumé dans l’églife qu’il avoit fait con-
ftruire en l’honneur de S. Martin. ( L. C. )
CARTES. Problème fur les cartes. ( Arithmétique. )
Pierre tient huit cartes dans fes mains qui font : un as*
un deux,un trois, un quatre, un cinq, un fix, un fep.t
& un huit qu’il a mêlés: Paul parie que les tirant l’une
après l ’autre, il les devinera à mefure qu’il les tirera-.
L’on demande combien Pierre doit parier contre
un que Paul ne réuflira pas dans fon entreprife ?
Par l’énoncé de la queftion, on fuppofe que Paul
parie de tirer toutes les cartes l’une après l’autre,
fans les remettre dans le jeu après les avoir tirées,
& fans manquer une feule fois à deviner-jufte la
■1carte qu’il tirera.
Dans ce ca s , en fuivant les réglés ordinaires des
probabilités y l’efpérance de Paul au premier coup
eft j , au fécond ÿ ; d’où il s’enfuit que fon éfpérancé
pour les deux premiers coups eft j X j ; & en effet*
il eft aifé de voir que le premier coup ayant huit cas
poflibles, & le fécond fept * la combinaifon des deux
aura 8 x 7 coups, dont il n’y en a qu’ùn feul qui
faite gagner Pierre , celui où il devinera jufte deux
fois de’ fuite. Par la même raifou, l’efpérance de
Paul pour trois coups fera; f X f X 7 ; pour quatre *
i * J X i X T ; & pour fept ( car il n’y en peut avoir
huit, attendu qu’après fept tirages il ne refte plus
de cartes , & il n’y a plus dè jeu.) elle fèria { X y - . »
X t i donc l’enjeu de Pierre fera à celui de Paul
comme 8 X 7 X . . . • x— 1 eft à i , c’eft-à-dire *
comme 0 x 7 10 — 1 eft à 1 ; ou comme 40319 eft
à 1,
Si Paul parioit d’amener où de deviner jufte à un
des fept coups feulement , fon. efpérance ferait
■ t -f- j + . . . . £ ,& par cônféquent l’enjeu de Pierre
à celui de Paul, comme j- j- -? .... + ? à J/ — f — f .. .
Si Paul parioit d’amener jufte dans les deux premiers
coups feulement, fon efpérance feroit | - f ? y & le
rapport des enjeux celui de f + j à r — -f? ~ 7.
S’il parioit d’amener jufte dans deux coups quelconques,
fon efpérance feroit i X j + j X | . . . .
+ i X i + 7 X i . . . + 7 X ' i - - - d - i x - r , &c.
Autre problème.
■ On demande combien il y a à parier contre un
que tirant cinq cartes dans un jeu de piquet, com-
pofé1 de trente-deux, l’on-ne tirera pas une quinte
majeure indéterminée, fans nommer en quelle cou*
leur, foit en coeur, foit en carreau, en pique ou en
treflei - p
• Pour réfoudre la queftion propofee ,- il faut d’abord
chercher en combien de façons trente-deux
cartes peuvent être prifes cinq à cinq, & on trouvera
par les réglés connues, des combinaifons, que ce
nombre de fois eft le produit des cinq nombres 28 ,
2 9 , 30', 3 1 , 31 ; ce-produit étant divifé par le
produitdes cb q ^ sBO in b te s ■ , ou par
1-20 c’eft-à^dire, que 1e nombre de fois cherche .eit
le produit desnombres z8 , 2 9 , 3 1 , 8 , ou 20x376.
Maintenant, comme;il y a quatre quintes, majeures,
il faut ôter ce nombre 4 de 201376, ce qui: donnera
201371, & ily aura à parier 4 contre 201372 ,.ou 1
contre 50343' qu’on ne tirera;pas.une quinte majeure
à volonté.
S'il s?agiffoit d’une quinte quelconque, comme il
y a en tout feize quintes, fa-voir, quatre de chaque
couleur , le pari feroit: 16 contre 201376. moins 16 ,
ou de I.6-contre 20136a, ou de 1 contre 12585. (O)
Carte Géographique., f. f. Conchyliolo
«r..) coquillage univalve, fans opercule ,. du
genre'des pucelages , cyprasa, ainfi nomme à caufe
d’une marbrure blanche q u i, s’étendant fur un fond
jaunâtre , imite en quelque forte les lacs, du globe
terreftre. On en voit une figure dans la Collection
d’Hiftoite naturelle, volume X X .U l , planche, LX V I I ,.
atl n°.y. ( M. A d AN SON. ) • } 'r
§ Carte Géographique , (Géogr*) Les cartes
géographiques les plus eftimées font celles de Guillaume
de r if le , premier géographe du roi de France,
mort en 1726, de M.d’Anville, de L’académie royale
des inferiptions & belles-lettres de Paris ,'de M. Bua-
ch e, premier géographe du roi de France, de M.
Robert de Vaugondy , de M. Bellin , géographe de
la marine, celles de Homann à Nuremberg, les cartes
gravées à la ealcographie de Rome, les cartes marines
de Hollande, cellésde M.,Bonne, quicompo-
fent l’Atlas moderne, publié à Paris, chez Lattre ,
en 1762 & 1771 , & qui font deftinéesà fervir pour
la lefture de la Géographie moderne de l’abbé Nicole de
la Croix. Le détail de ces différentes cartes forme un
ample catalogue, publie à Paris , en 1763 » chez
Julien, à l’hôtel de Soubife, & qui fe trouve à Nuremberg,
chez les héritiers d’Homann ; à la Haye,
chez Goffe & Pinet ; & à Londres, chez André
Dury. Nous nous contenterons d’indiquer ici fom-
mairement le choix des principales cartes que le public
peut avoir befoin de confulter.
La Mappemonde & les quatre parties du monde, par
M .d ’Anville.
Les cartes mannes du Neptune français & de P Hydrographie
françoife, en trois grands volumes in-folio
maximoy à Paris, chez M. Bellin.
Atlas univerfel de 108 feuilles, par MM. Robert,
17 5 7 , prix 138 liv. en grand papier.
Atlas topographique de la France, en 174 feuilles,
dont il y en a environ 100 de publiées.
- Atlas d"Angleterre , en 45 feuilles , publie par
Kitchin, Bowen & Seale, en 1762.
Atlas des Provinces-Unies, en 34 feuilles petit in-
folio , publié par Tirion, en 17 5 3.
Atlas (TEfpagne & de Portugal, en 15 feuilles, par
Nolin & BailleujL*’ .. ( -
Atlas RuJJîen, en 21 cartes, dreffées par l’académie
des fciences de Petersbourg, en 1745.
Atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoife, & du
Tibet, par M. d’ Anville, en 42 feuilles , en 1737.
Atlas de Saxe & de Luface , en 5 8 feuilles , publié
par Schenk, 1760.
- Atlas de Flandre , en 24 feuilles , publié par
Friçx , 1712.
Cartes des différentes parties de VAllemagne, chez
Homann, Julien,Boudet, Seuter & Mortier, 1747,
k&c. Cartes de CEtat Eccléjiaftique, par le P. Bof-
covich & le P. Maire , à la Calcographie de
Rome.
Piémont, Savoie, Dauphiné & Liqnnois , en 6
feuilles , chez Jaillot, 1706. .
Duché de Milan, chez Jaillot, 1 7 3 4 , une
feuille.
Tome II.
Etat de Venife, chez Jaillot, 1706.
Toftane & Etat Eccléjiaflique, chez Boudet,'
Ï7 0 -
. Royaume de Naples<S"de Sicile,,en 2 feuilles, chez
Boudet, 1,750.
: Ifle de Corfe & IJU de Sardaigne, chez-le Rouge, à
Paris, en- 2 feuilles.
Les cartes de la Géographie ancienne de M,. d’Anville
, de i’Atlas de Boudet & de M. de l’ ifle , font
les plus eftimées ; il y en a aufli de bonnes par les
Sanl'on, 6c qui fe- trouvent à Paris , chez M. de
Vaugondy.
Cartes de M. Bonne ,,à Paris, chez Lattre.
Royaume de Naples. , par M. Zaononi.
Cavu de Pologne, en 25 feuilles, par M. Zannoni,
( M. d e la L a n d e . )
C arte Hydrograph ique. L’invention des carres
hydrographiques eft l’ouvrage du, prince don Henri
de Portugal- U y avoit long-tems que cefles,de géographie
étaient connues : mais des cartes conftruites
fuivant le même principe euftenr été inutiles clans la>
navigation. Le prinçe dont nous parlons, & fes mathématiciens,
préférèrent, par les rai ions qu’on verra
bientôt, de développer la furfaçe du globe terrefi
tre , en étendant les méridiens en-lignes droites &
parallèles entr’elles. Pour prendre une idée claire
de ce développement, qu’on imagine que les parallèles
du globe terreftre foient en même tems flexibles
& extenfibles ,.& les méridiens feulement flexibles
; qu’on déploie enfuite toute la furface de ce
globe, en étendant les méridiens en lignes droites Sc
parallèles , on aura- la furface terreftre développée
en un reâangle, dont la longueur fera la circonférence
de l’équateur, & la largeur celle d’un demi-
méridien. Ce font-là les premières cartes, qu’em-
ployerent les navigateurs, & qu’on nomme plates ,
parce qu’elles font, en quelque forte, formées de la
furface du globe applatie.
Le motif pour lequel on s’eft aftreint à défignerles,
méridiens par des lignes droites & parallèles, eft
celui-ci : c’étoit afin que la trace dù vaifi'eau qui au-
roit parcouru un certain rhumb de vent, pût fe marquer
dans la carte par une ligne droite ; car s’ils euf-
fent été inclinés les uns aux autres, ou des lignes
courbes comme dans les cartes ordinaires de géographie
, cette trace n’auroit pu être qu’une ligne
courbe ; ce. qui n’auroit point répondu à l’intention
du navigateur.
Mais il y a dans ces fortes de cartes deux incon-
vêniens ; l’un confifte en ce que la proportion des
degrés des parallèles & de ceux des méridiens n’y eft
point confervée. Iis y font repréfentés comme égaux,
quoiqu’ils foient réellement d’autant plus inégaux ,
qu’on approche davantage du pôle. C ’eft-là le défaut
que Ptolémée reprochoit dans la Géographie , aux
cartes de Marin de Ty r , qui étoient précifément
comme celles qu’on vient de décrire. D e là naît une
erreur fur l’eftime du chemin, qui paroît plus grand
qu’il n’eft réellement dans tous les rhumbs obliques,
& dans ceux d’eft & d’oueft. A la vérité , les navigateurs
ont des méthodes pour prévenir cette erreur;
mais les rédu&ions qu’ils pratjauent, à moins qu’il
n’y ait pas une grande différence en latitude, font ou
peu exaêtes ou fort laborieufes.
Le fécond & le plus effentiel défaut desyartes
plates, eft que le rhumb qu’elles indiquent, en tirant
une ligne d’un lieu à un autre, n’eft point le véritable
, excepté lorfque ces lieux font fous le même
méridien ou le même parallèle. Je m’étonne que
cette erreur ait échappé à la plupart des auteurs de
navigation ; car lorfqu’ils veulent enfeigner le rhumb
de vent convenable pour aller d’un lieu à un autre,
ils ordonnent de les joindre par une ligne droite, ôç
d’examiner à quelrhprnb de la r.ofe des v<?nts c.ette.