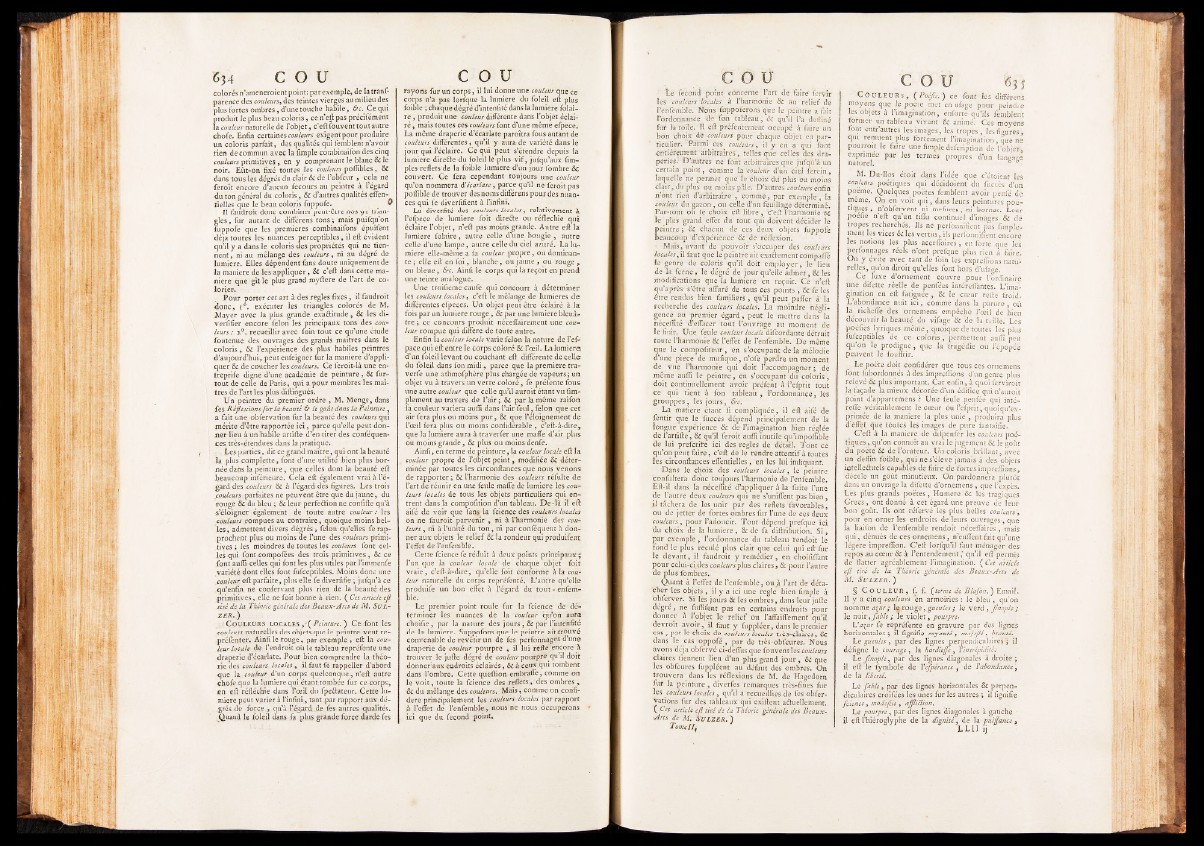
Colorés n’amèneraient point: par exemple, de la tranf-
parence des couleurs, des teintes vierges au milieu des
plus fortes ombres, d’une touche habile, &c. Ce qui
produit le plus beau coloris, ce n’eft pas précifément
la couleur naturelle de l’objet, c’eft fouvent tout autre
chofe. Enfin certaine? couleurs exigent pour produire
un coloris parfait, des qualités qui femblent n’avoir
rien de commun avec la fimple combinaifon des cinq
couleurs primitives, en y comprenant le blanc & le
noir. Eût-on fixé toutes les couleurs poflîbles, &
dans tous lès d'égrés du clair & de l’obfcur , cela ne
feroit encore d’aucun fecours au peintre à Pegard
du ton général du coloris, & d’autres qualités effen-
îielles que le beau coloris fuppofe. 0
Il faudroit donc combiner peut-être nos 91 triangles
, fur autant de différons tons ; mais puifqu’on
Fuppofe que les premières combinaifons épuifent
déjà toutes les nuances perceptibles, il eft évident
qu’il y a dans le coloris des propriétés qui ne tiennent,
ni au mélange des couleurs, ni au degré de
lumière. Elles dépendent fans doute uniquement de
la maniéré de lés appliquer, & c’eft dans cette maniéré
que gît le plus grand myftere de l’art de colorier.
Pour porter cet art à des réglés fixes, il faudroit
donc, i° . exécuter les triangles colorés de M.
Mayer avec la plus grande exactitude, & les di-
verfifier encore félon les principaux tons des couleurs
; 2°. recueillir avec foin tout ce qu’une étude
foutenue des ouvrages des grands maîtres dans le
coloris, & l’expérience des plus habiles peintres
d’aujourd’hui, peut enfeigner fur la maniéré d’appliquer
& de coucher les couleurs. Ce feroit-là une en-
treprife digne d’une académie de peinture, & fur-
tout de celle de Paris, qui a pour membres les maîtres
de l’art les plus diftingués.
Un peintre du premier ordre , M. Mengs, dans
fes Réflexions fur la beauté & le goût dans la Peinture ,
a fait une obfervation fur la beauté des couleurs qui
mérite d’être rapportée ic i, parce qu’elle peut donner
lieu à un habile artifte d’en tirer des conféquen-
ces_ très-étendues dans la pratique»
Les parties, dit ce grand maître, qui ont îa beauté
la plus complette, font d’une utilité bien plus bornée
dans la peinture, que celles dont la beauté eft
.beaucoup inférieure. Cela eft également vrai à l’égard
des couleurs & à l’égard des figures. Les trois
„couleurs parfaites ne peuvent être que du jaune, du
rouge & du bleu ; & leur perfe&ion ne confifte qu’à
«’éloigner également de toute autre couleur : les
couleurs rompues au contraire, quoique moins belles
, admettent divers dégrés, félon qu’elles fe rapprochent
plus ou moins de l’une des couleurs primitives
; les moindres de toutes les couleurs font celles
qui font eompofées des trois primitives, & ce
font aufli celles qui font les plus utiles par l’immenfe
variété dont elles font fufceptibles. Moins donc une
couleur, eft parfaite, plus elle fe diverfifie ; jufqu’à ce
.qu’enfin ne confervant plus rien de la beauté des
-primitives, elle ne foit bonne à rien. ( Cet article efl
tiré de la Théçrie générale des Beaux-Arts de M. Su l -
ZER.)
: r C ouleurs locales , ' ( Peinture. ) Ce. font les
-couleurs naturelles des objets que le peintre veut re-
préfénter. Ainfile rouge , par exemple , eft la couleur
locale de l’endroit où le tableau repréfente une
draperie d’écarlate, Pour bien comprendre la théorie
des couleurs, locales, il faut fe rappëlier d’abord
que la couleur d’un corps quelconque, n’eft autre
chofe que la lumière qui étant;tonibée fur ce corps,
en eft réfléchie dans l’oeil du fpe&ateur. Cette lumière
peut varier à l’infini, tant par rapport aux dé-
grés de force , qü’à l’égard de fes autres qualités.
Quand le foleil dans fa plus grande force darde fes
rayons fur un corps, il lui donne une couleur que ce
corps n’a pas lorlque la lumière du foleil eft plus
foible ; chaque dégré d’intenfité dans la lumière folai-
r e , produit une couleur différente dans l’objet-éclai-
r é , mais toutes ces couleurs font d’une même efpece.
La même draperié d’écarlate paroîtra fous autant de
couleurs différentes, qu’il y aura de variété dans le
jour qui l’éclaire. Ce qui peut s’étendre depuis la
lumière dire&e du foleil le plus v if , jufqu’aux Amples
reflets de la foible lumière d’un jour fombre &
couvert. Ce fera cependant toujours une couleur
qu’on nommera $ écarlate, parce qu’il ne feroit pas
poflible de trouver des noms différéns pour des nuances
qui fe diverfifient à l’infini.
La diverfité des couleurs locales, relativement à
l’èfpece de lumière foit direfte ou réfléchie qui
éclaire l’objet, n’eft pas moins grande. Autre eft la
lumière folaire, autre celle d’une bougie , autre
celle d’une lampe, autre celle du ciel azuré. La lumière
elle-même a fa couleur propre, ou dominante
; elle eft en fo i , blanche, ou jaune, ou rouge ,
ou bleue, &c. Ainfi le corps qui la reçoit en prend
une teinte analogue.
Une troifieme caufe qui concourt à déterminer,
les couleurs locales, c’eft le mélange de lumières de
différentes efpeces. Un objet peut être éclairé à la
fois par un lumière rouge, & par une lumière bleuâ--
tre ; ce concours produit néceffairement une cou-,
leur rompue qui différé de toute autre.
Enfin la couleur locale varie félon la nature de l’elV
pace qui eft entre le corps coloré & l’oeil. La lumière
d’un foleil levant ou couchant eft différente de celle
du foleil dans fon midi, parce que la première tra-
verfe une athmofphère plus chargée de vapeurs ; un
objet vu à travers un verre coloré, fe préfente fous
une autre couleur que celle qu’il auroit étant vu Amplement
au travers de l’air ; & par la même raifon
fa couleur variera aufli dans Pair feul, félon que cet
air fera plus ou moins pur, & que l’éloignement de
l’oeil fera plus ou moins confidérable , c’eft-à-dire,
que la lumière aura à traverfer une maffe d’air plus
Ou moins grande, & plus ou moins denfe.
Ainft, en terme de peinture, la couleur locale èft la
couleur propre de l’dbjet peint, modifiée & déterminée
par toutes les circonftances que nous venons
de rapporter ; & l’harmonie des couleurs réfulte de
l’art de réunir en une feule maffe de lumière les couleurs
locales de tous les objets particuliers qui entrent
dans la compofition d’un tableau. De-là il eft:
aifé de voir que fans la fcience des couleurs locales
on ne fauroit parvenir , ni à l’harmonie des couleurs
, ni à l’unité du ton , ni par conféquent à donner
aux objets le relief & la rondeur qui produifent
l’effet de l’enfemblè.
Cette fcience fe réduit à deux points principaux ;
l’un que la couleur locale de chaque objet foit
vraie, c’eft-à-dire, qu’elle foit conforme à la couleur
naturelle du corps repréfenté. L’autre qu’elle
produife un bon effet à l’égard du tout - enfetn-
ble.L
e premier point roule fur la fcience de déterminer
les nuances de la couleur qu’on aura
choifie, par la nature des jours, & par l’intëhfité
de la lumière. Suppofons que le peintre ait trouve
convenable de revêtir un de fes perfonnàgéS d’une
draperie de couleur pourpre , il lui refte. encore a
trouver le jufte dégré de couleur pourpre qu’ildoit
donner aux endroits éclairés, & à ceux qui tombent
dans l’ombre. Cette qûeftion embraffe, comme on
le v o it, toute la fcience des reflets, dés ombres ,
& du mélange des couleurs. Mais, comme on confi-
dere principalement les couleurs locales par rapport
à l’effet de l’enfemble, nous ne nous occuperons
ici que du fécond point.
Le fécond-point concerne l’art de faire1 fervir
les couleurs 'locales à l’harmonie & au relief de
l’eofèmble. Nous fuppoièrons que le peintre a fait
l’ordonnance de fon tableau, & qu’il l’a defliné
fur latôil'e. Il eft préfente'm’ent occupé à faire un
bon choix de couleurs pour chaque objet en particulier.
-'Pârmi tes couleàrs, il y en a qui font
entier çme ht-- arbitraires', telles que celles des draperies.'
D ’autres ne font arbitraires que jufqù’à un
certain point, comme la couleur d’un ciel ferein,
laquelle ne permet q ü é le'choix dit plus OU mpins
clair, dû plus ou moins pâle. D’autres couleurs enfin
n’ont rien d’arbitraire , comme, par exemple , la
couleur du gazon , ou celle.d’un feuillage détermine.
Par-tout oit le choix eft libre , c’eft l’harmonie &
le ■ plus grand effet du tout qui doivent décider le
peintre ; & chacun de ces deux objets fuppofe
beaucoup d’expérience ôi de réflexion.
■ Mais, avant de pouvoir - s’occuper des couleurs
locales, il faut que le peintre ait exactement compafle
le'genre de coloris qu’il doit employer, -le lieu
de la fcërie, le dégré de jour qu’elle admet, & les
modifications que la lumière en reçoit. Ce n’eft
qu’après s’être affuré de tous ces points , & fê lés
être rendus bien familiers , qu’il peut paffer à la
recherche des couleurs locales. La moindre négligence
au premier égard, peut le mettre dans la
héçeflïté d’effacer tout l’ouvrage ail moment dé
le finir. Une feule couleur locale difeordante détruit
toute l’harmonie & l’effet de Penfemblë. De même
que le cbmpofitëur , en s’occupant de la mélodie
d’une piece de mufique, n’ofe perdre un moment
de vue l’harmonie qui doit l’accompagner ; de
même aufli le peintre, en s’occupant du coloris,
doit continuellement avoir préfent à l’efprit tout
ce qui tient à fon tableau , l’ordonnance, lés
grouppes, les jours -, &c.
La matière étant fi compliquée, il eft aifé de
fentir que le fuccès dépend principalement de la
longue expérience & de l’imagination bien réglée
de l’artifte, & qu’il feroit aufli inutile qu’impoffible
de lui preferite ici des réglés de détail. Tout ce
qu’on peut faire, c’eft de le rendre attentif à toutes
les circonftances effentielles , en les lui indiquant.
Dans le choiix des couleurs locales, le peintre
çonfultera donc toujours l’harmonie de l’enfemble.
Eft-il dans la néceflité d’appliquer à la fuite l’une
de l’autre deux couleurs qui ne s’uniffent pas bien ,
il tâchera de les unir par des reflets favorables
ou de jettër de fortes ombres fur l’une de ces deux
couleurs, pour l’adoucir. Tout dépend prefque ici
du choix de la lumière , & de fa diftribution. S i ,
par exemple , l’ordonnance du tableau tendoit le
fond le plus reculé plus clair que celui qui eft fur
le devant, il faudroit y remédier, en choififlant
pour celui-ci des couleurs plus claires, & pour l’autre
de plus fombres;
Quant à l’effet de l’enfemble, ou à l’art de détacher
les objets , il y a ici une réglé bien fimple à
bbferver. Si lès jours & les ombres, dans leur jufte
degre, ne fuffifent pas en certains endroits pouf
donner à l’objet le relief ou l’affaiffemenf qu’il
devrait avoir, il faut y fuppléer, dans le premier
cas, par le choix de couleurs locales très-çlaires ; &
dans le cas 'oppofé , par de très-obfcures. Nous
avons déjà obfervé ci-deflus que fouvent les couleurs
çlaires tiennent lieu d’un plus grand jour , & que
les obfctires fuppléent au défaut des ombres. On
trouvera dans les réflexions de M. de Hagedorn ■
fur la peinture , diverfes remarques très-fines fur
les couleurs locales, qu’il a recueillies de fes obfer-
vations fur des tableaux qui exiftent actuellement.
( Cet article efl tiré de la Théorie générale des Beaux-
Arts de M. S u LZER, )
Tome II j
C o u l e u r s , (P o é f le .) ce font les différéns
moyens que le poete met en ufage pour peindre
les objets à l’imagination, enforte qu’ils femblent
former un tableau vivant & animé. Ces moyens
font entr’autres les images, les tropes , les figures,
qtu rëmuent plus fortement l’imagination, que ne
pourront le faire une fimple defeription de l’objet-;
exprimée par les termes propres d’un langagè
hatiirel. • °
M. Du-Bôs étoit dans l’idée que c’étoient les
couleurs poétiques qui décidoient du fuccès d’un
poëme. Quelques poètes femblent avoir penfé dé
même. On en voit q ui, dans leurs peintures poétiques
, n’obfervent ni mefures, ni bornes. Leur
poéfie n’eft qu’un tiflu continuel d’images & dé
tropes recherches. Ils ne perfonnifient pas Amplement
les yices & les vertus, ils perfonnifient encore
les notions les plus acceffoires, en forte que les
perfonnages réels n’ont prefque plus rien à faire.
On y évite avec tant de foin les expreflîons naturelle?,
qu’on diroit qu’elles font hors d’ufage.
C e , luxe d’ornement couvre pour l’ordinaire
line difette réelle de penfées intéreffantes. L’imagination
en eft fatiguée ,, & le coeur refte froid.
L’abondance nuit ic i, comme dans la parure, où
la richefle des ornemens empêche l’oeil de bien
découvrir la beauté du vifage & de la taille. Les
poéfiës^ lyriques même, quoique de toutes les plus
ïiifceptibles de ce coloris, permettent aufli peu
qu’on le prodigue, que la tragédie où l’épopée
peuvent le fouffrir.
Le poëte doit confidérer que tous ces ornemens
font fubordonnés à des impreflions d’un genre plus
relevé ôf plus important. Car enfin, à quoi ferviroit
la façade la mieux décorée d’un édifice qui n’auroit
point d’appartemens ? Une feule penfée qui inté-
refle véritablement le coeur Ou l’efprit, quoiqu’ex-
primée de la maniéré la plus unie , produira plus
d’effet que toutes les images, de pure fantaifie.
C ’eft à la maniéré de difpenfer les couleurs poétiques
, qu’on connoît au vrai le jugement & le goût
du poëte & de l’orateur. Un coloris brillant, avec
un deflîn foible, qui ne s’élève jamais à des objets
içtelleéhiels capables de faire de fortesimpreflions,
décele un goût minutieux. On pardonnera plutôt
dans un ouvrage la difette d’ornemens , que l’excès.
Lès plus grands poètes, Homere & les tragiques
Grecs, ont donné à cet égard une preuve de leur
bon goût. Ils ont réfervé les plus belles couleurs \
pour en orner les endroits de leurs ouvrages-, que
la liaifon de l’enfemble rendoit néceflaires, mais
qui, dénués de ces ornemens, n’eufîent fait qu’une
. d igéré impreflïon. C’eft Iorfqu’il faut ménager des
repos au coeur & à l’entendement,‘ qu’il eft permis
de flatter agréablement l’imagination. ( Cet article
efl tiré de la Théorie générale des Beaux-Arts de
M. SU LZER. )
§ CO U L EU R , f. f. (terme de 5 /ayo/z. ) Email.
Il y a cinq couleurs en armoiries : le bleu , qu’on
nomme aqjir; l^ rouge, gueules; le v e rd , flnople ;
le noit , fable ; le violet, pourpre.
L’a^ur fe repréfente en gravure par des lignes
horizontales ; il fignifie royauté, majefté, beauté.
Le gueules, par des lignés perpendiculairesil
défigne le courage , la hardietfe , l’intrépidité.'
Le flnople, par des lignes diagonales à droite ';
il eft le fymbolè de Yefpèrance , de l’abondance,
de la liberté.
Le fable, par des lignes horizontales & perpendiculaires
croifées lés unes fur les autres ; il fignifie
fciencemodeflie , affliction.
Le pourpre, par des lignes diagoriales à gaîiche •
il eft l’hiéroglyphe de la dignité, de la puifjance,
L L 11 ij