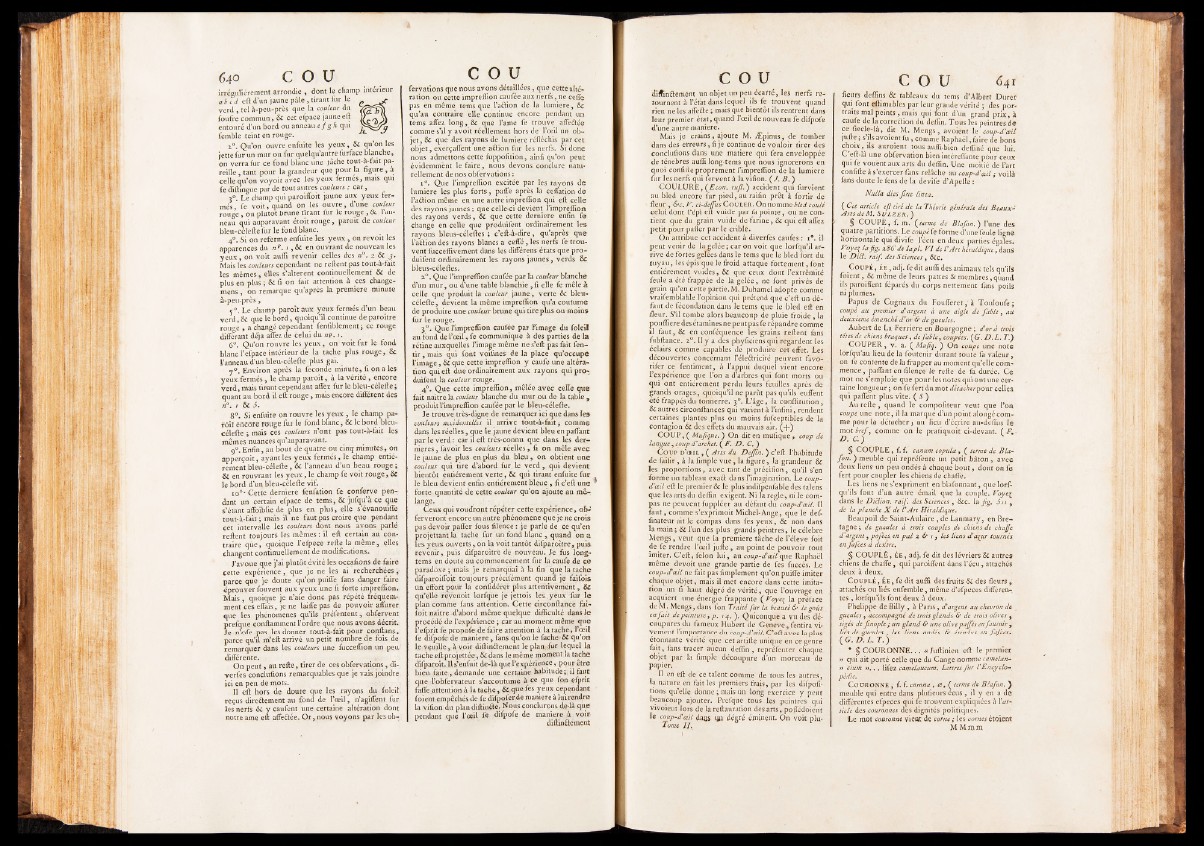
640 c o u
irrégulièrement arrondie , dont le champ intérieur
a b cd eft d’un jaune pâle , tirant fur le
verd , tel à-peu-près que la couleur du
foufre commun,, 6c cet efpace jaune eft )/_^
entouré d’un bord ou anneau e f g h qui
femble teint en rouge.
i ° . Qu’on ouvre enfuite les y e u x , & qu’on les
jette fur un mur ou fur quelqu’autre lurface blanche,
on verra fur ce fond blanc une jache tout-à-fait pareille
, tant pour la grandeur que pour la figure, à
celle qu’on voyoit avec les yeux fermes, mais qui
fe diftmgue par de tout autres couleurs : car,
30. Le champ qui paroiffoit jaune aux yeux fermés
fe vo it, quand on les ouvre, d’une couleur
rouge, ou plutôt brune tirant fur le rouge, 6c l’anneau
qui auparavant étoit rouge, paroît de couleur
bleu-celefte fur le fond blanc.
40. Si on referme enfuite les y e u x , on revoit les
apparences du n 9. 1 ,6c en ouvrant de nouveau les
y e u x , on voit aufli revenir celles des n°. 2 6c 3 .
Mais les couleurs cependant ne reftent pas tout-à-fait
les mêmes, elles s’altèrent continuellemenf & de
plus en plus ; 6c fi on fait attention à ces change-
mens, on remarque qu’apres la première minute
à-peu-près',
50. Le champ paroît aux yeux fermés d’un beau
verd, & que le bord, quoiqu’il continue de paroître
rouge , a changé cependant fenfxblement ; ce rouge
différant déjà affez de celui du nç. 1.
6°. Qu’on rouvre les y eu x , on voit fur le fond
blanc l’efpace intérieur de la tache plus rouge, 6c
l’anneau d’un bleu-célefte plus gai.
7 0. Environ après la fécondé minute, fi on a les
yeux fermés, le champ paroît, à la vérité , encore
verd, mais tirant cependant affez fur le bleu-célefte ;
quant au bord il eft rouge, mais encore différent des
n°. 1 6c 5.
8°. Si enfuite on rouvre les yeux , le champ par
roît encore rouge fur le fond blanc, 6c le bord bleu-
célefte ; mais ces couleurs n’ont pas tout-à-fait les
mêmes nuances qu’auparavant.
o°. Enfin, au bout de quatre ou cinq minutes, on
apperçoit, ayant les yeux fermés, le champ entièrement
bleu-célefte, 6c l’anneau d’un beau rouge ;
6c en rouvrant les y eux , le champ fe voit rouge»&
le bord d’un bleu-célefte v if.
1©0' Cette derniere fenfation fe eonferve pendant
un certain efpace de teins, 6c jufqu’à ce que
s’étant affoiblie de plus en plus, elle s ’évanouiffe
tout-à-fait; mais il ne faut pas croire que pendant
cet intervalle les couleurs dont nous avons parlé
reftent toujours les mêmes : il eft certain au contraire
que, quoique l’efpece refte la même, elles
changent continuellement de modifications.
J’avoue que j’ai plutôt évité les occafions de faire
cette expérience, que je ne les ai recherchées j$
parce que je doute qu’on puiffe fans danger faire
éprouver fouvent aux yeux une fi forte impreffion.
Mais, quoique je n’aie donc pas répété frequem-.
ment ces effais, je ne laiffe pas de pouvoir affurer
que les phénomènes qu’ils préfentent, obfervent
prefque conftamment l’ordre que nous avons, décrit.
Je n’ofe pas les donner tout-à-fait pour conftans,
parce qu’il m’eft arrivé un petit nombre de fois de
remarquer dans les couleurs une fucceflion un peu
différente. . *■ .
On peut, au refte, tirer de ces obfervations, di-
verfes conclufions remarquables que je vais joindre
ici en peu de mots.
Il eft hors de doute que les rayons du foleiL
reçus direftement au fond de l’oe il, n’agiffent fur
les nerfs 6c y caufent une certaine altération dont
notre ame eft affettée. O r , nous voyons par les ob-
C O U
fervations que nous avons détaillées, que cette altération
ou cette impreffion caufée aux nerfs, ne eeffe
pas èn même tems que l’aftion de la lumière, 6c
qu’au contraire elle continue encore pendant un
tems affez long, 6c que l’ame fe trouve affeélée
comme s’il y avoit réellement hors de l’oeil un obje
t, & que des rayons de lumière réfléchis par cet
objet, exerçaffent une aâion fur les nerfs. Si donc
nous admettons cette fuppofition, ainfi qu’on peut
évidemment le faire, nous devons conclure naturellement
de nos obfervations :
i° . Que l’impreffion excitée par les rayons de
lumière les plus forts, paffe après la ceffation de
l’attion même en une autre impreffion qui eft celle
des rayons jaunes ; que celle-ci devient rimpreffion
des rayons verds, 6c que cette derniere enfin fe
change en celle que produifent ordinairement les
rayons bleus-céleftes ; c’eft-à-dire, qu’après que
l’a&ion des rayons blancs a ceffé, les nerfs fe trouvent
fucceffivement dans les différens états que produifent
ordinairement les rayons jaunes, verds 6c
bleus-céleftes.
z°. Que l’impreffion caufée par la couleur blanche
d’un mur, ou d’une table blanchie , f i elle fe mêle à
celle que produit la couleur jaune, verte 6c bleu-
célefte , devient la même impreffion qu’a coutume
de produire une couleur brune qui tire plus ou moins
fur le rouge.
30. Que l’impreffion caufée par Pimage du foleil
au fond de l’oe il, fe communique à des parties de la
rétine auxquelles l’image même ne s’eft pas fait fen-
t i r , mais qui font voifines de la place qu’occupe
l’image, 6c que cette impreffion y caufe une altération
qui eft due ordinairement aux rayons qui produifent
la couleur rouge.
40. Que cette impreffion, mêlée avec celle que
fait naître la couleur blanche du mur ou de la table
produit l’impreffion caufée par le bleu-célefte.
Je trouve très-digne de remarquer ici que dans les
couleurs accidentelles il arrive tout-à-fait, comme
dans les réelles, que le jaune devient bleu en paffant
par le verd : car il eft très-connu que dans les dernières
, favoir les couleurs réelles , fi on mêle avec
le jaune de plus en plus du bleu, on obtient une
couleur qui tire d’abord fur. le v e rd , qui devient
bientôt entièrement v erte, 6c qui tirant enfuite fur
le bleu devient enfin entièrement bleue , fi c’eft une *
forte quantité de cette couleur qu’on ajoute au mélange.
Ceux qui voudront répéter cette expérience, ob^
ferveront encore un autre phénomène que je ne crois
pas devoir paffer fous filence : je parle de ce qu’en
projetant la tache fur un fond blanc , quand on a
les yeux ouverts , on la voit tantôt difparorîre, puis
revenir, puis difparoîtrë de nouveau. Je fus long-
tems en doute au commencement fur la caufe de ce
paradoxe ; mais je remarquai à la fin que la tache
difparoiffojt toujours précifément quand je faifois.
un effort pOiir la confidérer plus attentivement, 6z
qu’elle revenoit lorfque je jettois les. .yeux fur le
plan comme fans attention. Cette circonftancë fai-
foit naître -d’abord même quelque difficulté dans le
procédé de l’expérience ; car au moment mênve 'que
l’efprit fe propofe de faire attention à la tache, foe il
fe difpofe de maniéré , fans qu’on le fâche-& qu’on
le veuille , à voir diftinéfement le plan -fur lequel la
tache eft pro jettée, 6c dans le même mojnent la tache
difparoît. Il s’enfuit de-là que l’expérience, pour être
bien faite,, demande une certaine habitude;; il faut
que l’obfervateur s’accoutume à ce que fpn éfprit
rafle.attention à la tache, 6c, que fes )reux cependant
foient empêchés de fe difpoferde maniéré à lui rendre
la vifion du plan diftinjfte. Nous conclurons de-là que
pendant que l’oeil fe difpofe de maniéré à voie
iliftinftement
C O U
diffinftenlent un objet un peu écarté, les nerfs retournent
à Tétât dans lequel ils fe trouvent quand
rien ne les affe&e ; mais que bientôt ils rentrent dans
leur premier état, quand l’oeil de nouveau fe difpofe
d’une autre maniéré.
Mais je crains, ajoute M. Æpinus, de tomber
dans des erreurs, fi je continue de vouloir tirer des
conclufions dans une matière qui fera enveloppée
de ténèbres auffi long-tems que nous ignorerons en
quoi confifte proprement l’impreffion de la lumière
fur les nerfs qui fervent à la vifion. ( /. B. )
COULURE, (Econ. rujl.') accident qui furvient
au bled encore fur pied, au raifin prêt à fortir de
fleur , &c. y . ci-dcjfus Couler. On nomme bled coulé
celui dont l’épi eft vuide par fa pointe, ou ne contient
que du grain vuide de farine, 6c qui eft affez
petit pour palier par le crible.
On attribue cet accident à diverfes eau fes : i*. il
peut venir de la eelée; car on voit que lorfqu’il arrive
de fortes gelées dans le tems que le bled fort du
tuyau, les épis que le froid attaque fortement, font
entièrement vuides, 6c que ceux dont l’extrémité
feule a été frappée de la gelée, ne font privés de
grain qu’en cette partie. M. Duhamel adopte comme
vraifemblahle l’opinion qui prétend que c’eft un défaut
de fécondation dans le tems que le bled eft en
fleur. S’il tombe alors beaucoup de pluie froide , la
pouffiere des étamines ne peut pas fe répandre comme
il faut, 6c en conféquence les grains reftent fans
fubftance. z°. Il y a des phyficiens qui regardent les
éclairs comme capables de produire cet effet. Les
découvertes concernant l’éleftricité peuvent favo-
rifer ce fentiment, à l’appui duquel vient encore
l’expérience que l’on a d’arbres qui font morts ou
qui ont entièrement perdu leurs feuilles après de
grands orages, quoiqu’il ne parût pas qu’ils euffent
été frappés du tonnerre. 30. L’âge, la conftitution,
& autres circonftances qui varient à l’infini, rendent
certaines plantes .plus ou moins fufceptibles de la
contagion 6c des effets du mauvais air. (4-)
CO UP, ( Mujîque. ) On dit en mùfique , coup de
langue, coup d'archet. ( F. D . C. )
Coup d’oeil , ( Arts du DeJJin. ) c’eft l’habitude
de failir , à la fimple vu e, la figure, la grandeur 6c
les proportions, avec tant de précifion, qu’il s’en
forme un tableau exa£l dans l’imagination. Le coup-
d’oeil eft le premier & le plus indifpenfable des talens
que les arts du deffin exigent. Ni la réglé, rli le compas
ne peuvent fuppléer au défaut du coup-d’oeil. Il
fau t, comme s’exprimoit Michel-Ange , que le def-
finateur ait le compas dans fes yeux, 6c non dans
la main ; 6c l’un des plus grands peintres, le célébré
Mengs, veut que la première tache de l’éleve foit
de fe rendre l’oeil jufte, au point de pouvoir tout
imiter. C ’eft, félon lui, au coup-d'oeil que Raphaël
même devoit une grande partie de fes fuccès. Le
coup-d?ceil ne fait pas Amplement qu’on puiffe imiter
chaque objet, mais il met encore dans cette imitation
un fi haut dégré de vérité, que l’ouvrage en
acquiert une énergie frappante ( Voyeç la préface
de M. Mengs, dans fon Traité fur la beauté & Le goût
en fait de peinture, p. 14. ). Quiconque a vu des découpures
du fameux Hubert de Geneve, fentira vi*
vement l’importance du coup-d’oeil. C ’eft avec la plus
etonnante vérité que cet artifte unique en ce genre
fait, fans tracer aucun deffin , repréfenter chaque
objet par la fimple découpure d ’un morceau de
papier.
Il eh eft de ce talent comme de tous les autres,
la nature en fait les premiers frais, par les difpofi-
tions qu’elle donne ; mais un long exercice y peut
beaucoup ajouter. Prefque tous les peintres qui
vivoient lors de la reftauration des arts ,.poffédoient
le coup-d’oeil daos un dégré éminent. On voit plu-
Tome /ƒ.
fieûrs deffins & tableaux du tertis d’Albert Dtirer
qui font eftimables par leur grande vérité ; des portraits
mal peints , mais qui font d’un grand prix, à
caufe de la correflion du deffin. Tous les peintres de
ce fiecle-là, dit M. Mengs, avoient le coup-d’oeil
jufte ; s’ils avoient fu , comme Raphaël,faire de bons
choix, ils auroient tous auffi-bien delfiné que lui.
C ’eft-là une obfervation bien intéreffartte pour ceux
qui fe vouent aux arts du deffin. Une moitié de l’art
confifte à s’exercer fans relâche au coup-d'oeil ; voilà
fans doute le fens de la devife d’Apelle :
N alla dies fine linea.
( Cet article ejl tiré de la Théorie générale des Beaux-
Arts de M. S u l z e r . )
§ COUPÉ, f. m. ( terme de Blafon.') l’une des
quatre partitions. Le coupé fe forme d’une feule ligne
horizontale qui divife l’écu en deux parties égales*
Voye^ lafig. %8G de lapl. y i de l ’Art héraldique , dans
le Dicl. raif. des Sciences, &c.
Coupé, ée , adj. fe dit auffi des animaux tels qu’ils
foient, 6c même de leurs pattes & membres, quand
ils paroiffent féparés du corps nettement fans poils
ni plumes»
Papus de Cugnaux du Foufferet,’ à Touloufe;
coupe au premier' d’argent à une aigle de fable, ait
deuxieme émanché d’or & de gueules.
Aubert de La Ferriere en Bourgogne ; d’or à trois
têtes de chiens braques, de fable, coupées. (G. D .L . T.)
COUPER, v. a. ( Mu(iq. ) On coupe une hôte
lorfqu’au lieu de la foutenir durant toute fa valeur,
on fe contente de la frapper au moment qu’elle commence
, paffant en filence le refte de fa durée. Ce
mot ne s’emploie que pour les notes qui ont une certaine
longueur; on,fe fertdu mot détacher pour celles
qui paffent plus vîte. ( S )
Au refte, quand le compofiteur veut que l’on
coupe une note, il la marque d’un point alongé comme
pour la détacher, au lieu d’écrire au-deffus le
mot bref f comme on le pratiquoit ci-devant. ( F. ^
D . C.)
§ COUPLE, f. f. canum copula, ( terme de Blafon.
) meuble qui repréfente lin petit bâton , avec
deux liens un peu ondés à chaque bout, dont on fe
fert pour coupler les chiens de chaffe.
Les liens ne s’expriment en blafonnant, quelorf-
qu’ils font d’un autre émail que la couple, yoye^
dans le Diction, raif. des Sciences , 6cc. la fig. 5 u 9
de la planche X de l ’Art Héraldique.
Beaupoil de Saint-Aulaire , de Lanmary, en Bretagne
; de gueules à trois couples dt chiens de chaffe
d'argent, pofées, en pal 2. & / , les liens d'azur tournés,
en fafees à dextre.
§ COUPLÉ, ée , adj. fe dit des lévriers & autre?
chiens de chaffe, qui paroiffent dans l’écu, attachés
deux à deux.
Couplé, é e , fe dit auffi des fruits 6c des fleurs,
attachés ou liés enfemble, même d’efpeces différentes
, lorfqu’ils font deux à deux.
Phelippe de B illy , à Paris, d’argent au chevron de
gueules, accompagné de trois glands & de trois olives ,
tiges de Jînople ; un gland & une olive pajfés en fautoir ,
liés de eueules , Us liens ondés & étendus en fafees.
( G. D. L. T. )
* £ COURONNE.. . « Juftinien eft le premier
» qui ait porté celle que du Cange nomme camelan-
» ciuih » . . . lifez camelaucum. Lettres fur l'Encyclopédie.
COURONNE , f. f. corona , æ, ( terme de Blafon. )
meuble qui entre dans plufieurs écus , il y en a de
différentes efpeces qui le trouvent expliquées à l'article
des couronnes des dignités politiques.
Le mot couronne vient de corne ; les cornes étoient
M Mnjm