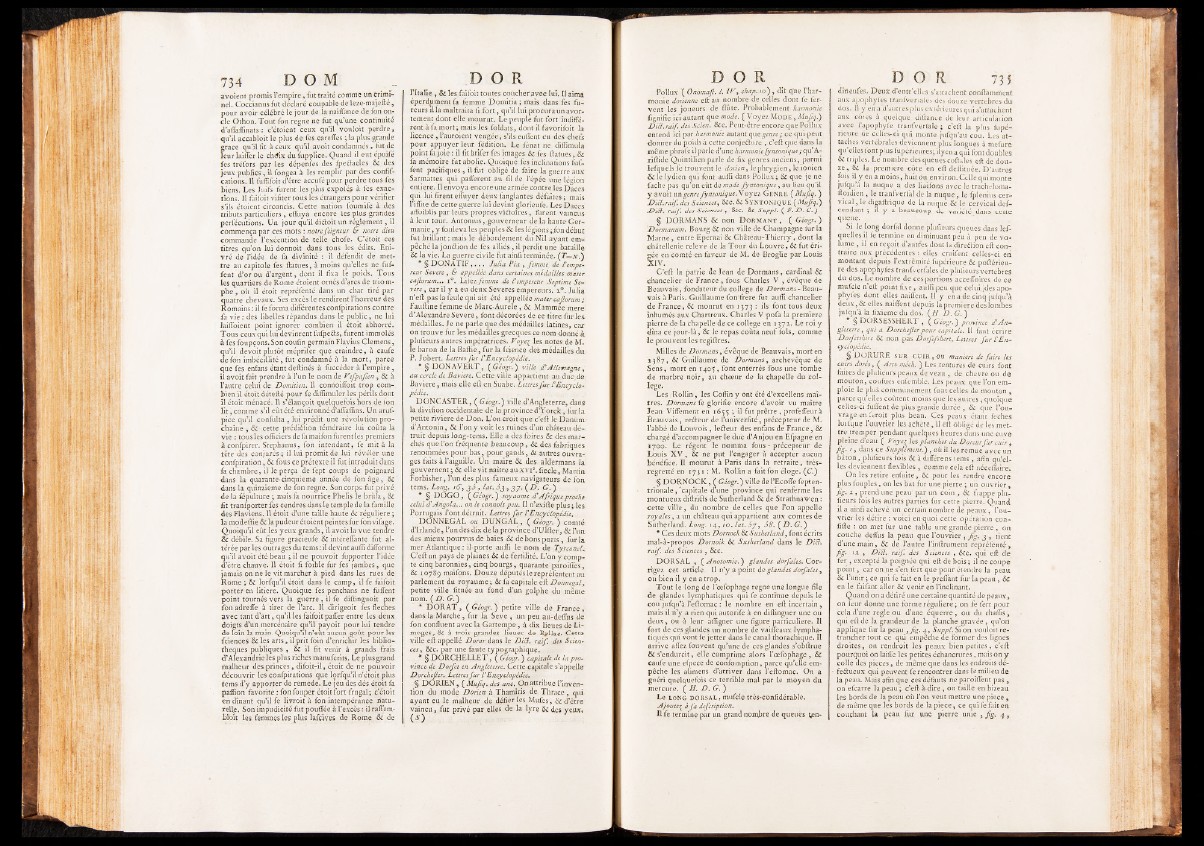
»voient promis l’empire, fut traité comme un criminel.
Coccianus fut déclaré coupable de leze-majefté,
pour avoir célébré le jour de la naifl'ance de fon oncle
Othon. Tout fon régné ne fut qu’une continuité
d’affaffinats : c’étoient ceux qu’il vouloit perdre,
qu’il accabloit le plus de (es eareffes ; la plus grande
grâce .qu.’il fit à ceux qu’il avoit condamnés, fut de
leur laiffer le chdix du fupplice. Quand il eut épuifé
les tréfors par les dépenfes des ipeftaeles 8c des
jeux publics, il fongea à les remplir par des confif-
cations. Il fuffifoit d’être accufé pour perdre tous fes
biens. Les Juifs furent les plus expolés à fes exactions.
Il faifoit vifiter tous les étrangers pour vérifier
s’ils étoient circoncis. Cette nation foumife à des
tributs particuliers , effuya encore les plus grandes
perfécutions. Un jour qu’il diftoit un réglement, il
commença par ces mots : notre feigneur & notre dieu
commande l’exécution de telle chofe. C ’étoit ces
titres qu’on lui donnoit dans tous les. édits. Enivré
de l’idée de fa divinité : il défendit de mettre
au capitole fes ftatues, à moins qu’elles ne fuf-
fent d’or ou d’argent, dont il fixa le poids. Tous
les quartiers de Rome étoient ornés d’arcs de triomphe
, où il étoit repréfenté dans un char tiré par
quatre chevaux. Ses excès le rendirent l’horreur des
Romains : il fe forma différentes confpirations contre
fa vie : des libelles répandus dans le public, ne lui
laiffoient point ignorer combien il étoit abhorré.
Tous ceux qui lui devinrent fufpeéis, furent immolés
â fes foupçons. Son coufin germain Flavius Clemens,
qu’il de voit plutôt méprifer que craindre, à caufe
de fon imbécillité, fut condamné à la mort, parce
que fes enfans étant deftinés à fuccéder à l’empire,
il avoit fait prendre à l’un le nom de Vzfpaften , & à
l’autre celui de Domitien. Il connoifloit trop combien
il étoit détefté pour fe diffimuler les périls dont
il étoit ménacé. Il s’élançoit quelquefois hors de fon
l i t , comme s’il eût été environné d’ affaffins. Un aruf-
pice qu’il confulta , lui prédit une révolution prochaine
, 8c cette prédi&ion téméraire lui coûta la
vie : tous les officiers de fa maifon furent les premiers
à confpirer. Stephanus, fon intendant, fe mit à la
tête des conjurés ; il lui promit de lui révéler une
confpiration, 8c fous ce prétexte il fut introduit dans
fa chambre, il le perça de fept coups de poignard
dans la quarante-qinquie me année de fon âge, 8c
dans la quinzième de fon régné. Son corps fut privé
de la fepulture ; mais fa nourrice Phelis le brûla, 8c
fit transporter fes cendres dans le temple de la famille
des Flaviens. 11 étoit d’une taille haute ôc'réguliere ;
la modeftie 8c la pudeur étoient peintes fur fon vifage.
Quoiqu’il eût les yeux grands, il avoit la vue tendre
& débile. Sa figure gracieufe 8c intéreffante fut altérée
par les outrages du tems : il devint auffi difforme
qu’il avoit été beau ; il ne pouvoit fupporter l’idée
d’être chauve. Il étoit fi foible fur fes jambes, que
jamais on ne le vit marcher à pied dans les rues de
Rome ; 8c lorfqu’il étoit dans le camp, il fe faifoit
porter en litiere. Quoique fes penchans ne fuffent
point tournés vers la guerre , il fe diftinguoit par
îon adreffe à tirer de l’arc. Il dirigeoit fes fléchés
avec tant d’art, qu’il les faifoit paffer entre les deux
doigts d’un mercenaire qu’il payoit pour lui tendre
de loin la main. Quoiqu’il n’eût aucun goût pour les
fciences 8c les arts, il prit foin d’enrichir les bibliothèques
publiques , & il fit venir à grands. frais
d’Alexandrie les plus riches manufcrits. Le plus grand
malheur des princes, difoit-il, étoit de ne pouvoir
découvrir les confpirations que lorfqu’il n’étoit plus
tems d’y apporter de remede. Le jeu des dés étoit fa
paffion favorite : fon fouper étoit fort frugal; .c’étoit
en dînant qu’il fe livroit à fon intempérance riatu-
fellel Son impudicité fut pouffée à l’excès : ilraffem-
bloit les femmes les plus lafcives de Rome 8c de
l’Italie , 8c les faifoit toutes coûchet'avêe lui. Il aima
éperdument fa femme Domitia ; mais dans fes fureurs
il la maltraita fi fort, qu’il lui procura un avortement
dont elle mourut. Le peuple fut fort indifférent
à fa mort; mais les foldats, dont il favorifoit la
licence,Tauroient vengée, s’ils euffent eu des chefs
pour appuyer leur fédition. Le fénat ne, diffimula
point fa joie : il fitbrifer fes images & fes fia tues,. &
fa mémoire fut abolie. Quoique fes inclinations fuffent
pacifiques , il fut obligé de faire la guerre aux
Sarmattes qui paflérent au fil de l’épée une lésion
entière. Renvoya encore une armée contre.les Dacés
qui lui firent effuyer deux fanglantes défaites ; mais
ï’iffue de cette guerre lui devint glorieufe. Les Daces
affoiblis par leurs propres v ictoires, furent vaincus
à leur tour. Antonius, gouverneur de la haute Germanie
, y fouléva les peuples & les légions ; fon début
fut brillant : mais le débordement du Nil ayant empêché
la jonôion de fes alliés , il perdit une bataille
8c la vie. La guerre civile fut ainfi terminée. (T— jv.)
* § D ONATIF, . . . Jtdia Pia , femmey de l ’empereur
Severe , & appillée dans certaines médailles mater
cajlorum... i°. Liiez femme de l’empereur Septime Se-
vere., car il y a eu deux Severes empereurs. i ° . Julia
n’eft pas la feule qui ait été appellée mater cajlorum ;
Fauftine femme de Marc-Aurele , 8c Mamm.ee mere
d’Alexandre Severe, font décorées de ce titre furies
médailles. Je ne parle que des médailles latines, car
on trouve fur les médaillés grecques.ce nom donné à
plufieurs autres impératrices. Voye{ les notes de M.
le baron de la Baftie, fur la fcience de!> médailles du
P. Jobert. Lettres fur l'Encyclopédie.
* § DON A V E R T , ( Géogr. ) ville d.’ Allemagne y
au cercle de Bavière. Cette ville appartient au duc.de
Bavière, mais elle eft en Suabe. Lettres fur l’Encyclopédie.
DONCASTER, ( Géogr-') ville d’Angleterre, dans
la divifion occidentale de la province d’Y orck , fur;la
petite rivière de Don, L’on croit que c ’eft le Danum:
d’Antonin, 8c l’on y voit les ruines d’un château détruit
depuis long-tems. Elle a des foires 8c des marchés
que l’on fréquente beaucoup, & des fabriques
renommées pour bas, pour gands, & autres ouvra-
ges faits à l’aiguille. Un maire 8c des. aldermans la
gouvernent ; 8c elle vit naître au x v i e. fiecle, Martin
Forbisher, l’un des plus fameux navigateurs de fon
tems. Long, /(f, , la t .5j , g,y. { D . G. )
* § D O G O , ( Géqgr. ) royaume d’Afrique proche
celui d’Angola... on le conn.oit peu. Il n’exifte plus ; les
Portugais l’ont détruit. Lettres fur l’Encyclopédie.
DONNEGAL ou D U N G À L , ( Géogr. ) comté
d’Irlande, l’un des dix de la province d’Ulfter, 8c l’un
des mieux pourvus de baies 8c de bons ports, fur la
mer Atlantique: il porte auffi le nom de TyrconeU
C ’eft un pays de plaines 8c de fertilité. L’on y compte
cinq baronnies, cinq bourgs, quarante paroiffes,
8c 10789 maifons. Douze députés le repréfentent au
parlement du royaume ; & fa capitale eft Donnegal,
petite ville fituée au fond d’un golphe du même
nom. ( D . G .)
* D O R A T , {Géogr.) petite ville de France,
dans la Marche, fur la Seve , un peu au-deffus de
fon confluent avec la Gartempe, à dix lieues de Limoges,
& à trois grandes lieues de Bjrilac. Cette
ville eft appellé Dorar dans le Dicl. raif. des Sciences
, &c. par une faute typographique.
* § DORCHELLET, ( Géogr. ) capitale de la province
de Dorfet en Angleterre. Cette capitale s’appelle
Dorchejler. Lettres fur l 'Encyclopédie.
§ DORIEN, ( Mufiq. des anc. On attribue l’invention
du mode Dorien .à Thamiris de Thrace, qui
ayant eu le malheur de défier les Mufes, 8c d’être
vaincu, fut privé par elles de la lyre 8c des yeux»
PolluX ( On'omafl. I. IP , chàp. 10), dit que l’harmonie
dorienne eft au nombre de celles dont fe fervent
les joueurs de flûte. Probablement harmonie
fignifie ici autant que mode. ( Voyez Mode , Mufiq.)
Dicl.raif. des Scien. & c . Peut-être encore que Pollux
entend ici par harmonie autant que genre ; ce qui peut
donner du poids à cette conjecture , c’eft que dans la
même phrale il parle d’une harmoniefyntonique; qu’ A-
riftide Quintilien parle de fix genres anciens* parmi
lefquels fe trouvent le dorien, le phrygien * le ionien
&: le lydien qui font auffi dans Pollux ; 8c que je ne
fâche pas qu’on eût de mode fyntonique, au .lie.u qu’il
y avoit un genre fyntonique. V oyez Genr E ( Mufiq. )
Dicl.raif des Sciences, &c. 8c SYNTONIQUE {Mufiq.)
Dicl. raif. des Sciences * &C. 8c Suppl. { F. D . C .)
§ DORMANS 8c non Dormant, ( Géogr.)
Dormanum. Bourg & non ville de Champagne fur la
Marne, entre Epernai 8c Château-Thierry, dont la
châtellenie releve de la Tour du Louvre, 8c fut érigée
en comté en faveur de M. de Broglie par Louis
XIV.
C ’eft là patrie de Jean de Dormans, cardinal 8c
chancelier de France., fous Charles V , évêque de
Beauvais, fondateur du collège de Dormans - Beauvais
à Paris. Guillaume fon'frere fut auffi chancelier
de France, 8c mourut en 1373 : ils font tous deux
inhumés aux Chartreux. Charles V pofa la première
pierre de la chapelle‘de ce college en 1371. Le roi y
dîna ce joùr-là, 8c le repas coûta neuf fols, comme
le prouvent lès regiftres.
Milles de Dormans, évêque de Beauvais, mort en
3387, 8c Guillaume de Dormans, archevêque de
Sens, mort en 1405, font enterrés fous une tombe
d e marbre noir, au choeur de la chapelle du col-
lege-
Les /Rollin, les Coffin y ont été d’excellens maîtres.
Dormans (e glorifie encore d’avoir vu maître
Jean Viffement en 1655 ; il fut prêtre , profeffeurà
Beauvais, reéfèur de l’unive'rfité, précepteur de M.
l ’abbé de Lbuvois , leéteur des enfans de France, 8c
chargé d’accompagner le duc d’Anjou en Efpagne en
1700. Le régent le nomma fous - précepteur de
Louis X V , 8c ne put l’engager -à’ accepter aucun
bénéfice. Il mourut à Paris dans la retraite, très-
regretté en 17 31 : M. Rollin a fait fon éloge. (C.)
§ D O RN O CK , ( Géogr. ) ville de l’Ecoffe fepten-
Irionale * "capitale d’une province qui renferme les
montueux diftriÔs de Sutherland 8c de Strathnawen :
cette v ille , du nombre de celles que l’on appelle
royales, a un château qui appartient aux comtes de
Sutherland. Long. 14,10 . lat. 5y , 58. { Ï ) .G . )
* Ces deux mots Dornock 8c Sutherland, font écrits
mal-à-propos Dornoik 8c Susherland dans le Dicl.
raif. des Sciences , &c.
DORSAL , {Anotomie.) glandes dorfales. Corrigez
cet article. Il n’y a point de glandes dorfales,
©u bien il y en a trop.
Tout le long de loefophage régné une longue file
de glandes lymphatiques qui fe continue depuis le
cou jufqu’à l’eftomac : le nombre en eft incertain ,
mais il n’y a rien qui autorife à en diftinguer une ou
deux, ou -à leur affigner une figure particulière. Il
fort de ces glandes un nombre de vaiffeaux lymphatiques
qui vont fe jetter dans le canal thorachique. Il
arrive a fiez fouvent qu’une de ces glandes s’obftrue
& s’endurcit, elle comprime alors l’oefophage , 8c
caufe une elpece de confomption, parce qu’elle empêche
les alimens d’arriver dans l’eftomac. On a
guéri quelquefois ce terrible mal par le moyen du
mercure. ( H. D. G. )
Le long dorsal, mufcle trèsr-eonfidérablë.
Ajouteç à fa defeription.
Il fe termine par un grand nombre de queues t^endirieufes.
Deux d’entr’elles s’attachent cônftàmment
aux apophyfes tranfvenales des douze vertebres dù
dos. Il y en â d’autresplus extérieures qui s’attachent
aux cotes à quelque diftapce de leur articulation
avec l’apophyfe tranfveriale ; c’eft la plus fupé-^
rieure de celles-ci qui monte jufqu’au cou. Les attaches
vertébrales deviennent plus longues à mefure
qu’elles font plus fupérieures; ilyen a qui font doubles
8c triples. Le nombre des queues coftales eft de douz
e , 8c la première côte en eft deftituée. D ’autres
fois il y en a moins, huit Ou .environ. Celle qui monte
jufqu’à la nuque a. des liaifons avec le tracheloma-
ftoïdien , le tranfverfal de la nlique, le fpleni'us cervical,
le digaltrique de la nuque 8c le cervical def-
cendant ; il y a beaucoup de variété dans cette
queue.
Si le long dorfal donne plufieurs queues dans lesquelles
il fe termine en diminuant peu à peu de vo^
lume , il en reçoit d’autres dont la direction eft contraire
aux precedentes : elles croifent celles-ci en
montant depuis l’extrémité, fupérieure 8c poftérieu-
re des apophyfes tranfverfales de plufieurs vertebres
du dos. Le nombre de ces portions acceffoires de cô
mufcle n’eft point fixe, auffi peu quë celui [des apophyfes
dont elles naiffent. Il y en a de cinq jüfqu’à
deux ,& elles naiffent depuis la première des lombes
jufqu’à la fixieme du dos. _{ H. D . G. )
* § DORSESSHERT , { Géogr.) province d’Angleterre
, qui a Dorchejler pour capitale. Il faut écrire
Dorfetshire 8c non pas Dorfefshert. Lettres fur l’Encyclopédie,
§ DORURE SUR CUIR , ou maniéré de faire les
cuirs dorés, { Arts méch. ) Les tentures de cuirs font
faites de plufieurs peaux de veau , de chevrè ou de
mouton, côufues enfemble* Les peaux que l’on emploie
le plus communément font celles de mouton *
parce qu’elles coûtent moins que les autres, quoique
celles-ci fuflènt de plus grande durée , 8c que l’ouvrage
en leroit plus beau. Ces peaux étant feches
lorfque l’ouvrier les achète, il eft obligé de les mettre
tremper pendant; quelques heures dans une cuve
pleine d eau ( P'yyeç les planches du Doreur fur cuir *
fig. /, dans ce Supplément.) , où il les remue avec un
bâton, plufieurs fois 8c à différens tems , a fin qu’elles
deviennent flexibles , comme cela eft néeeffaire.
On les retire enluite, & pour les rendre encore
plus fouples, on les bat fur une pierre ; un ouvrier *
fig. z , prend une peau par un coin , 8c frappe plur
fieurs fois les autres parties fur cette pierre. Quand
il a ainfi achevé un certain nombre de peaux, l’ouvrier
les détire : voici en quoi cette opération con-
fifte : on met fur une table une grande pierre , on
couche deffus la peau que l’ouvrier i fig. g , tient
d’une main, 8c de l’autre l’inftrument repréfenté,
fig. iz , Dicl. raif. des Sciences , 8cc. qui eft de
fer * excepté la poignée qui eft de bois ; il ne coupe
point, car on ne s’en fert que pour étendre la peaii
8c l’unir ; ce qui fe fait en le preffant fur la peau , 8 c
en le faifant aller 8c venir en l’inclinant.
Quand on a détiré une certaine quantité de peaux*
on leur donne une forme régulière ; on fe fërt pour
cela d’une réglé ou d’une équerre, ou du chaffisj
qui eft de la grandeur de la planche gravée , qu’ori
applique fur la peau ,fig. 4 , Suppl. Si on vouloit retrancher
tout ce qui empêche de former des lignes
droites, on rendroit les peaux bien petites, c’eft
pourquoi on laiffe les petites échancrures, mais on y
colle des pièces, de même que dans les endroits dé-
feftueux qui peuvent fe rencontrer dans le milieu de
la peau. Mais afin que ces défauts ne paroiffent pas ,
on efearre la peau ; ç’eft-à-dire, on taille en bizeau
les bords de la peau où l’on veut mettre une piece ,
de même que les bords de la piece, ce qui fe fait en
couchant la peau fur une pierre unie , fig, 4 ,