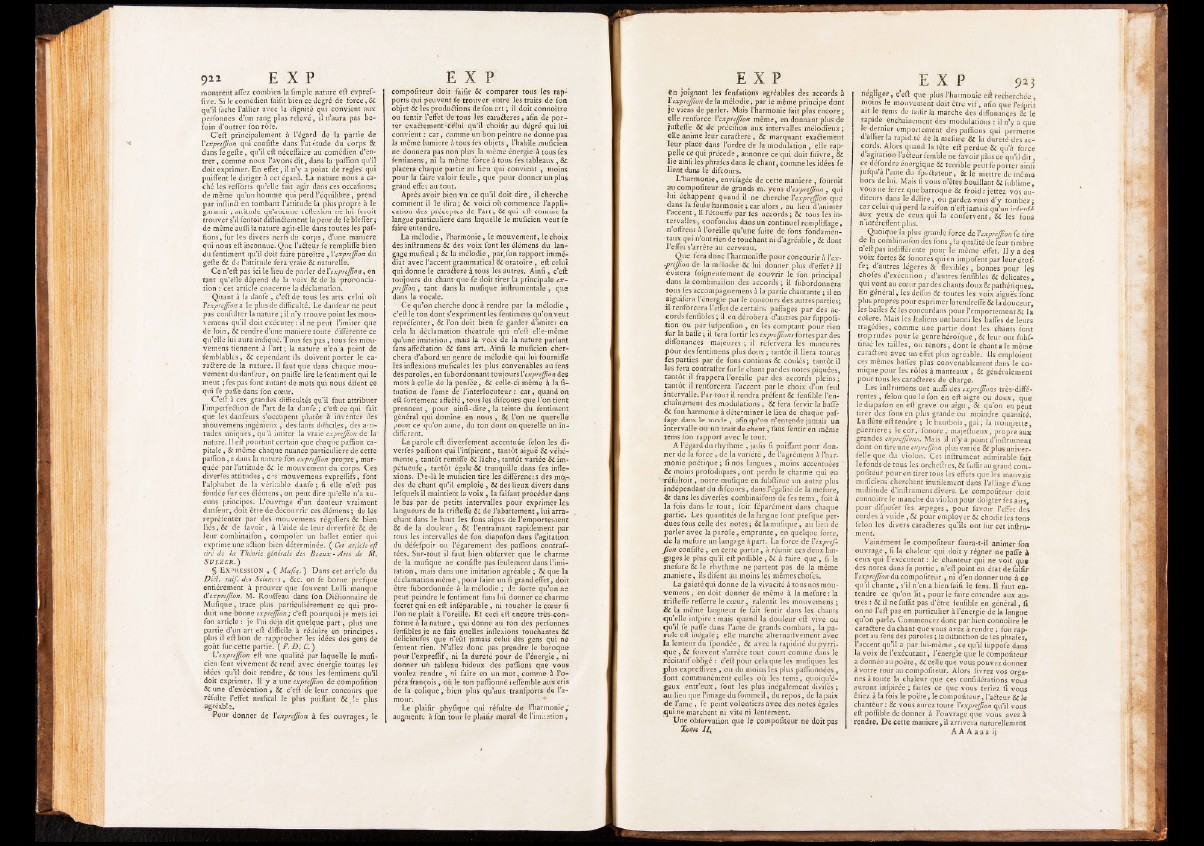
montrent affez combien la fimple nature eft expref-
iive. Si le comédien faifit bien ce dégré de force, &
qu’il fâche l’allier avec la dignité qui convient aux
perfonnes d’un rang plus relevé, il n’aura pas be-
foin d’outrer fon rôle.
C’eft principalement à l’égard ae la partie de
YexpreJJîon qui confifte dans l’at f.tude du corps &
dans le gefte, qu’il eft néceffaire au comédien d’ent
re r, comme nous l’avons d it, dans la paffion qu’il
doit exprimer. En effet, il n’y a point de réglée qui
puifîent le diriger à cet égard. La nature nous a caché
le^refforts qu’elle fait agir dans ces occafions;
de même qu’un homme qui perd l’équilibre, prend
par inftinéf en tombant l’ attitude la plus propre à le
garantir ; attitude qu’aucune réflexion ne lui feroit
trouver s’il fentoit diflinélement la peur de fe bleffer ;
de même auffi la nature agit-elle dans toutes les paf-
flons, fur les divers nerfs du corps, d’une maniéré
qui nous eft inconnue. Que l’aâeur fe rempliffe bien
du fentiment qu’il doit faire paroître , YexpreJJîon du
gefte 8c de l’attitude fera vraie 8c naturelle.
Ce n’eft pas ici le lieu de parler de YexpreJJîon, en
tant qu’elle dépend de la voix & de la prononciation
: cet article concerne la déclamation.
Quant à la danfe , c’eft de tous les arts celui ôû
YexpreJJîon a le plus de difficulté. Le danfeur ne peut
pas confulter la nature ; il n’y trouve point les mouvemens
qu’^l doit exécuter : il ne peut l’imiter que
dé loin, & rendre d’une maniéré toute différente ce
qu’elle lui aura indiqué. Tous fqs pas , tous fes mouvement'tiennent
à l’art; la nature n’èh à point de
■ femblablcs, & cependant ils doivent porter le ca-
raéfere de la nature. Il faut que dans chaque mouvement
dudanfeur, on puiffe lire le fentiment qui le
meut ; fes pas font autant de mots qui nous difent ce
qui fe paffe dans fon coeur.
C ’eft à ces^ grandes difficultés qu’il faut attribuer
l’imperfeâion de l’art de la danfe ; c’eft ce qui fait
que les danfeurs s’occupent plutôt à inventer des
mou vemens ingénieux , des fauts difficiles, des a* ri—
tudes uniques, qu’à imiter la vraie exprejjîon de la’
nature. Il eft pourtant certain que chaque paffion capitale
, & même chaque nuance particulière de cette
paffion, a dans la nature fon exprejjîon propre , marquée
par l’attitude 8c le mouvement du corps. Ces
diverfes attitudes , o?s mouvemens expreffifs, font
l’alphabet de la véritable danfe ; fi elle n’eft pas
fondée fur ces élémens, on peut dire qu’elle n’a aucuns
principes. L’ouvrage d’un danfeur vraiment
danfeur, doit être de découvrir ces élémens ; de les
repréfenter par des mouvemens réguliers & bien
liés, 8c de favoir, à l’aide de leur diverfité & de
leur combinaifon, compofer un ballet entier qui
exprime une aétion bien déterminée. J Cet article ejl
tiré de la Théorie générale des Beaux - Arts de M.
SüLZER.')
§ Expression , ( Mujîq.') Dans cet article du
Z)ici. raif. des Sciences, &c. on fe borne prefque
entièrement à prouver que fouvent Lulli manque
d’exprejjîon. M. Rouffeau dans fon Di&ionnaire de
Mufique, trace plus particuliérement ce qui produit
une bonne exprejjîon; c’eft pourquoi je mets ici
fon article : je l’ai déjà dit quelque part, plus une
partie d’un art eft difficile à réduire en principes,
plus il eft bon de rapprocher les idées des gens de
goût fur cette partie. ( F. D. C. )
VexpreJJîon eft une qualité par laquelle le muficien
fent vivement & rend avec énergie toutes les
idées qu’il doit rendre, 8c tous les fentimens qu’il
doit exprimer. Il y a une exprejjîon de compofition
& une d’exécution , 8c c’eft de leur concours que
réfulte l’effet mufical le plus puiffant 8c le plus
agréable.
Pour donner de YexpreJJîon à £es ouvrages, le
compofiteur doit faifir & comparer tous les rapports
qui peuvent fe trouver entre les traits de fon
objet 8c les produéfions de fon art ; il doit connoître
ou fentir l’effet ^te'jous les cara&eres, afin de porter
exactement-Cëiui qu’il choifit au dégré qui lui
convient : car, côiiime un bon peintre ne donne pas
la même lumière à tous fês objets , l’habile muficien
ne donnera pas non plus la même énergie à tous fes
fentimens, ni la même force à tous fes tableaux, 8c
placera chaque partie aii lieu qui convient , moins
pour la faire valoir feule, que pour donner un plus
grand effet au tout.
Après avoir bien vu ce qu’il doit dire, il cherche
comment il le dira ; 8c voici oh commence l’application
des préceptes de l’art, 8c qui eft comme la
langue particulière dans laquelle le muficien veut fe
faire entendre.
La mélodie, l’harmonie, le mouvement, le choix
des inftrumens 8c des voix font les élémens du langage
mufical ; & la mélodie, par', fon rapport immédiat
avec l’accent grammatical 8c oratoire , eft celui
qui donne le caraétere à tous les autres. Ainfi, c’eft
toujours du chant que fe doit tirer la principale exprejjîon
, tant dans la mufique inftrumentale, que
dans la vocale.
Ce qu’on cherche donc à rendre par la mélodie ,
c’eft le ton dont s’expriment les fentimens qu’on veut
repréfenter, 8c l’on doit bien fe garder d’imiter en
cela la déclamation théâtrale qui n’eft el'e-même
qu’une imitation , mais la voix de la nature parlant
fans affeétation & fans art. t Ainfi le muficien cherchera
d’abord un genre de mélodie qui lui fourniffe
les inflexions muficales les plus convenables au fens
des paroles, en fubordonnant toujours YexpreJJîon des
mots à celle de la penfée, & celle-ci même à la fi-
tuation de l’ame de l’interlocuteur : ca r, quand on
eû fortement affetté, tous les difcours que l ’on tient
prennent, pour ainfi - dire, la teinte du fentiment
général qui domine en nous , & l’on ne querelle
point ce qu’on aime, du ton dont on querelle un indifférent.
La parole eft- diverfement accentuée félon les diverfes
pallions qui l’infpirent, tantôt aiguë 8c véhémente
, tantôt remiffe 8c lâche, tantôt variée & im-
pétueüfe, tantôt égale 8c tranquille dans fes inflexions.
De-là le muiicien tire les différences des mo,-*
des de chant qu’il emploie, 8c des lieux divers dans
lefquels il maintient la v o ix , la faifant procéder dans
le bas par de petits intervalles pour exprimer les
langueurs de la trifteffe 8z de l’abattement, lui arrachant
dans le haut les fons aigus de l'emportement
& de la douleur, & l’entraînant rapidement par
tous les intervalles de fon diapafondans l’agitation
du défefpoir ou l’égarement des paffions contraf-
tées. Sur-tout il faut bien obferver que le charme
de la mufique ne confifte pas feulement dans l’imitation
, mais dans une imitation agréable ; & que la
déclamation même , pour faire un fi grand effet, doit
être fubordonnée à la mélodie ; de forte qu’on ne
peut peindre le fentiment fans lui donner ce charme
fecret qui en eft inféparable , ni toucher le coeur fi
l’on ne plaît à l’oreille. Et ceci êft encore très-conforme
à la nature, qui donne au ton des perfonnes
fenfibles je ne fais quelles inflexions touchantes 8c
délicieufes que n’eût jamais celui des gens qui ne
fentent rien. N’allez donc pas prendre le baroque
pour l’expreflif, ni la dureté pour de l’énergie, ni
donner un tableau hideux des paffions que vous
Voulez rendre , ni faire en un mot, comme à l’o péra
françois, oit le ton paffionné 1 effemble aux cris
de la colique, bien plus qu’aux tranfports de l’amour.
Le plaifir phyfique qui réfulte de l’harmonie,’
augmente à fon tour le plaifir moral de l’imitation,
fch joignant les lenfations agréables des accords à
? ’exprejjîon de la mélodie, par le même principe dont
je viens de parler. Mais l’harmonie fait plus encore ;
elle renforce YexpreJJîon même, en donnant plus de
jufteffe & de précifion aux intervalles mélodieux;
elle anime leur eara&ere, 8c marquant exaétement
leur place dans'l’ordre de la modulation , elle rappelle
ce qui précédé, annonce ce qui doit fuivre, 8c
lie ainfi les phrafes dans le chant, comme les idées fe
lient dans le difcours.
L ’harmonie, envifagée de cette maniéré, fournit
au compofiteur de grands moyens d’exprejjîon , qui
lui échappent quand il ne cherche YexpreJJîon que
dans la feule harmonie ; car alors , au lieu d’animer
l’accent, il l’étouffe par fes accords ; 8c tous les intervalles,
confondus dans un continuel rempliffage,
n’offrent à l’oréille qu’une fuite de fons fondamentaux
qui n’ont rien de touchant ni'd’agréable, 8c dont
l ’effet s’arrête au cerveau.
Que fera donc l’harmonifte pour concourir à Yex-
.prejjion de la mélodie 8c lui donner plus d’effet ? Il
évitera foigneulement de couvrir le fon principal
dans la combinaifon des accords ; il fubordonnera
tous fes accompagnemens à la partie chantante ; il en
aiguifera l’énergie parle concours des autres parties;
il renforcera l’effet de certains paffages par des accords
fenfibles ; il en dérobera d’autres par fuppofi- I
tion ou par fùfpenfion , en les comptant pour rien I
fur la baffe ; il fera fortir les exprejjions fortes par des
diffonances majeures ; il réfervera les mineures
pour des fentimens plus doux ; tantôt il liera toutes
fes parties par de fons continus & coulés; tantôt il
les fera contrafter furie chant par des notes piquées,
tantôt il frappera l’oreille par des accords pleins ;
tantôt il renforcera l’accent par le choix d’un feul
intervalle. Par tout il rendra préfent 8c fenfible l’enchaînement
des modulations , 8c fera fervir la baffe
& fon harmonie à déterminer le lieu de chaque paf-
fage dans le mode, afin qu’on n’entende jamais un
intervalle ou un trait de chant, fans fentir en même
tems fon rapport avec le tout.
A l’égard du rhythme , jadis fi puiffant pour donner
de la force, de la variété , de l’agrément à l’harmonie
poétique ; fi nos langues, moins accentuées |
& moins profodiques, ont perdu le charme qui en
•réfultoit, notre mufique en fubftitue un autre plus
indépendant du difcours, dans l’égalité de la mefure,
& dans les diverfes combinaifons de fes tems, foit à
la fois dans le tout, foit féparément dans chaque
partie. Les quantités de la langue font prefque perdues
fous celle des notes; & la mufique, au lieu de
parler avec la parole, emprunte, en quelque forte,
de la mefure un langage à part. La force de Yexpref-
fion confifte, en cette partie, à réunir ces deux langages
le plus qu’il eft poffible , 8c à faire que , fi la
mefure 8c le rhythme ne partent pas de la même
maniéré, ils difent au moins les mêmes chofes.
La gaieté qui donne de la vivacité à tous nos mouvemens
, en doit donner de même à la mefure : la
trifteffe refferre le coeur, ralentit les mouvemens.;
& la même langueur fe fait fentir dans les chants
qu’elle infpire : mais quand la douleur eft vive ou
qu’il fe paffe dans l’ame de grands combats, la parole
eft inégale ; elle marche alternativement avec
la lenteur du fpondée, & avec la rapidité du pyrri-
q u e , & fouvent s’arrête tout court comme dans le
récitatif obligé : c’eft pour cela que les mufiques les
plus expreflives, ou du moins les plus paflionnées,
font communément celles où les tems, quoiqu’é-
gaux entr’eu x , font les plus inégalement divifés ;
au lieu que l’image du fommeil, du repos, de la paix
de l’ame , fe peint volontiers avec des notes égales
qui ne marchent ni vîte ni lentement.
Une obfervation que lç compofiteur ne doit pas
%omt //,
négligé?, c eft que plus l’harmonie eft recherchée ,
moins le mouvement doit être v if, afin que l’efprit
ait le rems de faifir la marche des diffonances & le
rapide enchaînement des modulations : il n’y a que
le dernier emportement des paffions qui permette
d allier la rapidité de la mefure 8c la dureté des ac*
cpf ds. Alors quand la tête eft perdue & qu’à force
d agitation l’aéleur femble ne favoir plus ce qu’il d it,
ce défordre énergique 8c terrible peut fe porter ainfi
jufqu’à l’ame du fpeftateur, & le mettre de mémo
hors de lui. Mais fi vous n’êtes bouillant 8c fublime,
vous ne ferez que barroque & froid : jettez vos auditeurs
dâns^ lè délire, ou gardez-vous d’y tomber ;
car celui qui perd la raifon n’eft jamais qu’un infenfé
aux yeux de ceux qui la confervent, 8c les fous
n’intéreffent plus.
Quoique la plus grande force de Y exprejjîon fe tiré
de la combinaifon des fons, la qualité de leur timbre
n eft pas indifférente pour le même effet. Il y a des
voix fortes 8c fonores qui en impofent par leur étoffe
; d autres^ legeres & flexibles, bonnes pour lès
chofes d’exécution ; d’autres fenfibles & délicates ,
qui vont au coeur par des chants doux & pathétiques.
En general, les deffus & toutes les voix aiguës font
plus propres pour exprimer latendreffe & la douceur,
les baffes & lesconcordans pour l’emportement & la
colere. Mais les Italiens ont banni les baffes de leurs
tragédies, comme une partie dont les chants font
trop rudes pour le genre héroïque, & leur ont fiibf-
tirue les tailles, ou ténors, dont le chant a le même
caraftere avec un effet plus agréable. Ils emploient
ces memes baffes plus convenablement dans le comique
pour les rôles à manteaux , & généralement
pour tous les caraéteres de charge.
Les inftrumens ont auffi des exprejjions très-différentes
, félon que le fon en eft aigre ou doux, que
le diapafon en eft grave ou aigu , & qu’on en peut
tirer des fons en plus grande ou moindre quantité.
La flûte eft tendre ; le hautbois, gai ; la trompette,
guerriere ; le cor, fonore, majeftueux, propre aux
grandes exprejjions. Mais il n’y a point d’inftrument
dont on tire une exprejjîon plus variée & plus univer-
felle que du violon. Cet inftrument admirable fait
le fonds de tous les orcheftres, & fuffit au grand compofiteur
pour en tirer tous les effets que les mauvais
muficiens cherchent inutilement dans l’alliage d’une
multitude d’inftrumens divers. Le compofiteur doit
connoître le manche du violon pour doigter fes airs,
pour difpofer fes arpégés, pour favoir Feffet des
cordes à vuide, & pour employer 8c choifir fes tons
félon les divers cara&eres qu’ils ont fur cet inftru-.
ment.
Vainement le compofiteur faura-t-il animer fon
ouvrage , fi la chaleur qui doit y régner ne paffe à
ceux qui l ’exécutent : le chanteur qui ne voit qu«
des notes dans fa partie, n’eft point en état de faifir
YexpreJJîon du compofiteur , ni d’en donner une à ce
qu’il chante , s’il n’en a bienfaifi le fens. Il faut entendre
ce qu’on li t , pour le faire entendre aux autres
: & il ne fuffit pas d’être fenfible en général, fi
on ne l’eft pas en particulier à l’énergie de la langue
qu’on parle. Commencez donc par bien connoître le
caraftere du chant que vous avez à rendre ; fon rapport
au féns des paroles ; ladiftinéfion de lés phrafes,
l’accent qu’il a par lui-même , ce qu’il fuppofe dans
la voix de l’exécutant, l’énergie que le compofiteur
a donnée au poëte, & celle que vous pouvez donner
à votre tour au compofiteur. Alors livrez vos organes
à toute la chaleur que ces confidérations vous
auront infpirée ; faites ce que vous feriez fi vous
étiez à la fois le poëte, le compofiteur, l’a&eur & le
chantèur : & vous aurez toute YexpreJJîon qu’il vous
eft poffible de donner à Poùvrage que vous avez à
rendre. De cette maniéré, il arrivera naturellement
A A A a a a i j
II|