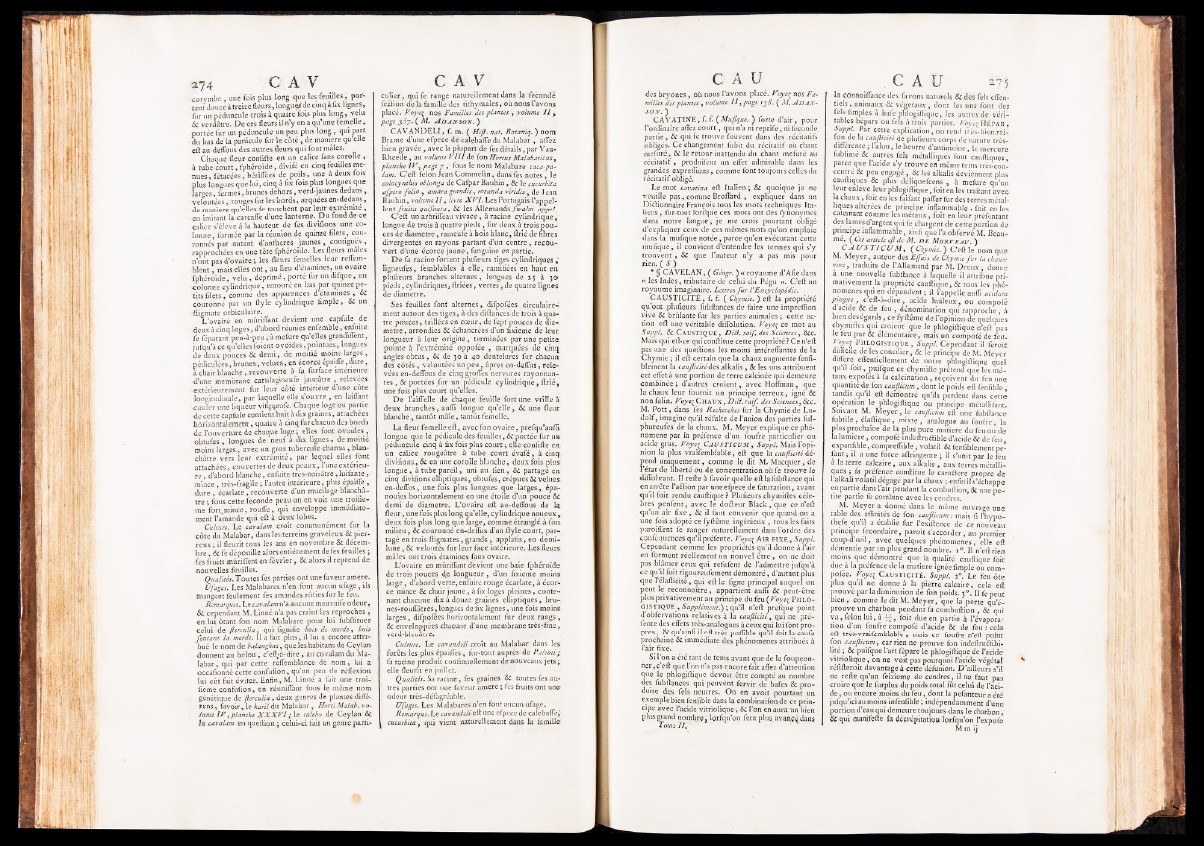
corymbe , une fois plus long que les feuilles, portant
douze à treize fleurs, longu^de cinq à fix lignes,
fur un péduncule trois à quatre fois plus long, velu
& verdâtre. De ces fleurs il n’y en a qu’une femelle,
portée fur un péduncule un peu plus long, qui part
du bas de la panicule fur le côté, de maniéré qu’elle
eft au-deffous des autres fleurs qui font mâles.
Chaque fleur confifte en un calice fans corolle ,
à tube-court, fphéroïde-, divifé en cinq feuilles menues,
fétacées, hériffées de poils, une à deux lois
plus longues que lui, cinq à fix fois plus longues que
larges, fermes, brunes dehors, verdqaunes dedans,
veloutéesronges fur lesbords, arquées en-dedans,
de maniéré qu’elles fe touchent par leur extrémité,
en imitant la càrcaffe d’une lanterne. Du fond de ce
calice s’élève à la hauteur de fes divifions une colonne
»formée par la réunion de quinze filets , couronnés
par autant d’antheres jaunes, contiguës,
rapprochées en une tête fpheroïde. Les fleurs males
n’ont pas d’ovaire ; les fleurs femelles leur reffem-
blent, mais elles ont, au lieu d’étamines, un ovaire
fphéroïde, velu , déprimé, porté fur un difque, en
-colonne cylindrique, entouré en bas par quinze petits
filets , comme des apparences detamines, 8c
couronné par un ftyle cylindrique fimple, 8c un
ftigmate orbiculaire.
L ’ovaire en mûriflant .devient une capfule de
deux à cinq loges, d’abord réunies enfemble, enfuite
fe féparant peu-à-peu ,-àmefure qu’elles grandiffent,
jufqu’à ce qu’elles foient ovoïdes » pointues, longues
de deux pouces 8c demi, de moitié moins larges,
p ç die niées, brunes, velues, en écorce épaifle, dure,
à chair blanche, recouverte à fa fürface intérieure
d’ une membrane cartilagineufe jaunâtre relevees
extérieurement fur leur cote intérieur d une cote
longitudinale, par laquelle elle.s’ouvré , en laiflant
couler une liqueur vilqqeufe. Chaque loge ou partie
de cette capfule contient huit à dix graines, attachées
horizontalement, quatre à cinq fur chacun des bords
de l’ouverture de chaque loge ; elles font ovoïdes,
obtufes , longues de neuf à dix lignés , de moitié
moins larges, avec un gros tubercule charnu , blanchâtre
vers leur extrémité, par lequel elles font
attachées, couvertes de deux peaux, 1 une extérieure
, d’abord blanche, enfuite très-noirâtre, luifante ,
mince, très-fragile ; l’autre intérieure, plus épaifle,
•dure , écarlate, recouverte d’un mucilage blanchâtre
; fous cette fécondé peau on en voit une troifie-
me for^mince, rouffe, qui enveloppe immédiatement
l’amande qui eft à deux lobes. ^
'Culture. Le cavalam croît communément fur la
-côte du Malabar, dans lesterreins graveleux & pierreux;
il fleurit tous les ans en novembre & décembre
, & fe dépouille alors entièrement de fes feuilles ;
■ fes fruits mûriffent en février, 8c alors il reprend de
•nouvelles feuilles.
Qualités. Toutes fes parties Ont une faveur amere.
Ufagss. Les Malabares, n’en font aucun ufage, ils
•mangent feulement fes amandes rôties fur le feu.
Remarques. Le cavalamrtz aucune mauvaife odeur,
8c. cependant M. Linné n’a pas craint les reproches ,
en lui ôtant fon nom Malabare pour lui fubftituer
•celui dejlerculia, qui fignifie bois de merde, bois
f entant la. merde. Il a fait plus, il lui a encore attribué
le nom de balanghas, que les habitans de Ceylan
donnent au belou, c’efl>à-dire, au covalam du Malabar,
qui par cette reflemblance de nom, lui a
occafionné cette confufion, qu’un peu de réflexion
lui eût fait éviter. Enfin, M. Linné a fait une troi-
fieme confufion, en réunifiant fous le-même nom
générique de flerculia, deux genres de plantes diffé-:
rens, (avoir, le karil du Malabar, Horti Malab. volume
IV , planche X X X V l ; le talebo de Ceylan &
le cavalam en queftion* celui-ci (ait un .genre particuber,
quife rangé naturellement dans la fécondé
féûion de là famille des tithymales, où nous l’avons
placé. Voyez nos Familles des planus , volume I I >
page .3S7. ( M. A d a n s d u . )
CA VANDELI, f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) nom
Brame d’une efpeee dë câlebaflb du Malabar , affez
bien gravée, avec la plupart de fes détails, par Van-
Rheede, au volume V I I I de fon Hortus Malabaricus,
planche IV , page y , fous le nom Malabare caca-pa-
Lam. C ’eft felön Jean Co'mmelin, dans fes notes, le
colocynthis ob longa de Cafpar Bauhin, & le cucurbita
afpero folio , amara grandis, rotunda viridis, de Jean
Bauhin, volume I I , livre X V I. Les Portugais l’appellent
fruita qui fout a , 8c les Allemands fwahn appel,
C ’eft un arbrifleau vivace, à racine cylindrique,
longue de trois à quatre pieds, fur deux à trois pouces
de diamètre, rameute à bois blanc, (trié de fibres
divergentes en rayons partant d’un centre, recouvert
d’une écorce jaune, fanguine en partie.
D e fà racine fortent plufieurs tiges cylindriques
ligneufes, femblables à elle, ramifiées en haut en
plufieurs branches alternes, longues de 15 à 30
pieds, cylindriques,(triées, vertes, de quatre lignes
de diamètre.
Ses feuilles font alternes, difpofées circulaire-»
ment autour des tiges, à des diftançes de trois à quatre
pouçes, taillées en coeur, de fept pouces de diamètre
, arrondies 8c échancrées d’un fixieme de leur
longueur à leur origine, terminées par une petite,
pointe à l’extrémité oppofée , marquées de cinq,
angles obtus, & de 30 à 40 dentelures fur chacun
des côtés , veloutées un peu, âpres en-deflùs, relevées'en
deflous de cinq großes nervures rayonnantes.
, 8e portées fur un pédicule cylindrique, (trié,
une fois plus court qu’elles.
De l’aiflelle de chaque feuille fort une vrille à
deux branches, aufîi longue qu’elle, 8c une fleur,
blanche, tantôt mâle, tantôtfemelle,
La fleurfemelle eft, avec fon ovaire, prefqu’aufli
longue que le pédicule des feuilles, 8c portée fur un
péduncule cinq à fix fois plus court ; elle confifte en
un calice rougeâtre à tube court évafç, à cinq
divifions, & en une corolle blanche, deux fois plus
longue , à tube pareil, uni au lien, 8c partagé en
cinq divifions elliptiques, obtufes, crépues & velues,
en-deflus, une fois plus longues que larges., épanouies
horizontalement en une étoile d’un pouce 8c
. demi de diamètre. L’ovaire eft au-defibus de la
fleur, une fois plus long qu’elle, cylindrique noueux
deux fois plus long que large, comme étranglé à-fon,
milieu, & couronné en-deffus d’un ftyle court, partagé
en trois ftigmates, grands, applatis, en demi-
lune , 8c veloutés fur leur face intérieure. Les fleurs
mâles ont trois étamines fans ovaire.
L’ovaire en mûriflant devient une baie fpheroïde
de trois pouces d.e longueur, d’un fixieme moins'
large, d’abord verte, enfuite rouge écarlate, à écorce
mince 8c chair jaune, à fix loges pleines, contenant
chacune dix à douze graines elliptiques, bru-
nes-rouflâtres, longues de fix lignes, une fois moins
larges, difpofées horizontalement fur deux rangs ,
8c enveloppées chacune d’une membrane très-fine,
verd-bleuatre.
Culture. Le cavandeli croît au Malabar dans les
forêts les .plus épaiffes, fur-tout auprès dè Paleoti ;
fa racine produit continuellement de nouveaux jets ;
elle fleurit en juillet.
Qualités. Sa ratine, fes graines & toutes fes autres
parties ont une faveur amere ; fes fruits ont une
' odeur très-défagréable.
üfagès. Les Malabares n’en font aucun ufage.
Remarque. Le cavandeli eft une efpeee de calebaffe,*
cucurbita, qui yient naturellement dans la famille
des bryones, où nous l’avons placé. Voyez nos Familles
des plantes, volume I I , page 138. ( M. A d a n -
SON. )
CAVATINE, f. f. ( Mufique. ) forte d’a ir , pour
l’ordinaire affez cou rt, qui n’a ni reprife, ni fécondé
partie, 8c qui fe trouve fouvent dans des récitatifs
obligés. Ce changement fubit du récitatif - aù chant
mefuré, 8c le retour inattendu du chant mefuré au
récitatif, produifent un effet admirable dans les
grandes expreflions, comme font toujours celles du
récitatif obligé.
Le mot cavatina eft Italien ; & quoique je ne
veuille pas, comme Broîlard , expliquer dans un
Diâionnaire François tous les mots techniques Italiens
, fur-tout lorfque ces mots ont des fynonymes
dans notre langue, je me crois pourtant obligé
d’expliquer ceux de ces mêmes mots qu’on emploie
dans la mufique notée, parce qu’en exécutant cette
mufique, il convient d’entendre les termes qui s’y
trouvent, 8c que l’auteur n’y a pas mis pour
rien. ( S )
* § CAVELAN, ( Géogr. ) « royaume d’Afie dans
» les Indes, tributaire de celui du Pégu ». C ’eft un
royaume imaginaire. Lettres fur VEncyclopédie.
CAUSTICITÉ, f. f. ( Chymie. ) eft la propriété
qu’ont plufieurs fubftances de faire une impreflïon
vive 8c brûlante fur les parties animales ; cette action
eft une véritable diffolution. Voyez ce mot au
Suppl. 8c Caust iqu e, Dict. raif. des Sciences, 8cc.
Mais qui eft-ce qui conftitue cette propriété ? Ce n’eft
pas une des queftions les moins intéreffantes de la
Chymie ; il eft certain que la chaux augmente fenfi-
blement la cauflicité des alkalis , & les uns attribuent
cet effet à une portion de terre calcinée qui demeure
combinée ; d’autres croient, avec Hoffman, que
la chaux leur fournit un principe terreux, igné 8c
non falin. V 1yez C haux , DiH. raif. des Sciences, 8cc.
M. Pott, dans fes Recherches fur la Chymie de Lu-
dolf, imagine qu’il réfulte de l’union des parties ful-
phureufes de la chaux. M. Meyer explique ce phénomène
par la préfence d’un foufre particulier ou
acide gras. Voyez Ca ü s t ic u m , Suppl. Mais l’opinion
la plus vraisemblable, eft que la cauflicité dépend
uniquement, comme le dit M. Macquer, de
1 état de liberté cni de concentration où fe trouve le
diffolvant. II refte à favoir quelle eft la fubftance qui
en arrête l’aélion par une efpeee de faturation, avant
qu’il foit rendu cauftique ? Plufieurs chymiftes célébrés
penfent, avec le dofteur Black, que ce n’eft
qu’un air fixe , & il faut convenir que quand on a
une fois adopté ce fyftême ingénieux , fous les faits
paroiffent fe ranger naturellement dans l’ordre des
conféquences qu’il préfente. Voyez Air f ix e , Suppl.
Cependant comme les propriétés qu’il donne à l’air
en forment réellement un nouvel être , on ne doit
pas blâmer ceux qui refufent de l’admettre jufqu’à
ce qu’il foit rigoureufement démontré, d’autant plus
que l’élafticite, qui eft le figne principal auquel on
peut le reconnoître, appartient auffi & peut-être
plus privativement au principe du feu ([Voyez Phlo-
GISTIQUE , Supplémenté) ; qu’il n’eft prefque point
d’obfervations relatives à la cauflicité, qui ne préfente
des effets très-analogues à ceux qui lui font propres
, 8c qu’ainfi il eft très-poffible qu’il foit la caufe
prochaine 8c immédiate des phénomènes attribués à
l’air fixe.
Si l’on a été tant de tems avant que de le foupçon-
ner, c’eft que l’on n’a pas encore fait affez d’attention
que le phlogiftique devoit être compté au nombre
des fubftances qui peuvent fervir de bafes 8c produire
des fels neutres. On en a v o if pourtant un
exemple bien fenfible dans la combinaifon de ce principe
avec l’acide vitriolique v&: l’on en aura un bien
plus grand nombre , lorfqu’on fçra plus, avancé dans
T ortie I l f
•la connoiffance des favons naturels 8c des fels effen-
tiels, animaux 8c végétaux, dont les uns font des
fels fimples à bafe phlogiftique, les autres de véritables
hepars ou fels à trois parties. Voyez HÉpar,
Suppl. Par cette explication, on rend très-bien.rai-
j? " , e a ca*fkcué de plufieurs corps de nature très-
dijrerente ; 1 alun, le beurre d’antimoine, le mercurè
fubhme 8c autres fels métalliques font cauftiques,
parce que l’acide s’y trouve en même tems très-con-
centre 8c peu engage , 8c (es alkalis deviennent plus
cauftiques 8c plus déliquefeens , à mefure qu’on
leur enleve leur phlogiftique, foit en les traitant avec
la chaux, foit en les faifant paffer fur des terres métalliques
altérées de principe inflammable, foit en les
calcinant comme les métaux, foit en leur préfentant
des lames d’argent qui fe chargent de cetteportion de
principe inflammable, ainfi que l’a obfervé M. Beau*
me. ( Cet article eflde M. d e Mo r v e a u . )
Ü Ü M E m m S m9 ( Chymic' ) C’eft le nom que
M. Meyer, auteur des Effais de Chymie fur la chaux
vive, traduits de l’Allemand par M. D reu x, donne
a une nouvelle fubftance à laquelle il attribue pri-
mativëment la propriété cauftique, 8c tous les phé*
nomenes qui en dépendent ; il l’appelle auffi aciduni
pingue , c eft-a-dire, acide huileux, ou compofé
d’acide & de feu , dénomination qui rapproche , à
bien des égards, ce fyftême de l’opinion de quelques
chymiftes qui croient que le phlogiftique n’eft pas
le feu pur 8c élémentaire, mais un compofé de feu.
Voyez P h l o g i s t i q u e , Suppl. Cependant il feroic
difficile de les concilier, 8c le principe de M. Meyer
différé effentiellement de notre phlogiftique quel
qu’il foit, puifque ce chymifte prétend que les métaux
expofés à la calcination, reçoivent du feu une
quantité de fon caujlicum, dont le poids eft fenfible |
tandis qu’il eft dénîontré qu’ils perdent dans cette
operation le phlogiftique oii principe métallifant.
Suivant M. Meyer, le cauflicum eft une fubftance
fubtile , elaftique, /nixte , analogue ait foufre, la
plus prochaine de la plus pure matière du feu ou de
la lumière, compofé indeftrufrible d’acide 8c de feu
expanfible, compreflîble, volatil 8c fenfibîementpe-
fant ; il a une force aftringente ; il s’unit par le feu
à la terre calcaire, aux alkalis , aux terres métalliques
; fa préfence conftitue le caraôere propre de
1 alkali volatil dégagé par la chaux ; enfin il s’échappe
en partie dans l’air pendant la combuftion, 8c une petite
partie fe combine avec les cendres.
M. Meyer a donné dans le même ouvrage une
table des affinités de fon cauflicum: mais fi l’hypo-'
thefe qu il a établie fur l’exiftence de ce nouveau
principe fecondaire, paroît s’accorder, au premier
coup-d’oe il, avec quelques phénomènes, elle eft
démentie par un plus grand nombre. 1 °. Il n’eft rien
moins que démontré que la qualité cauftique foit
due à la préfence de la matière ignée fimple ou com-
pofée. Voyez C a u s t i c i t é . Suppl. 20. Le feu ôte
plus qu’il ne donne à la pierre calcaire, cela eft
prouvé par la diminution de fon poids. 30. Il fepeut
bien, comme le dit M. Meyer, que la perte qu’éprouve
un charbon pendant fa combuftion , 8c qui
v a , félon lui, à foit due en partie à l’évaporation
d’un foufre compofé d’acide ôc de feu : cela
eft tres-vraifemblable ; mais ce foufre n’eft point
fon caujlicum, car rien ne prouve fon indeftruftibi-
lite ; 8c puifque l’art fépare le phlogiftique de l’acide
vitriolique, on ne voit pas pourquoi l’acide végétal
réfifteroit davantage à cette défunion. D ’ailleurs s’il
ne refte qu’un feizieme de cendres, il ne faut pas
croire que le furplus du poids total fut celui de l’acide
» ou encore moins du feu, dont la pefanteur a été
jufqu’ici au moins infenfible ; indépendamment d’une
portion d’eau qui demeure toujours dans le charbon ,
ôc qui manifefte fa déçrépitatiça lorfqu’on l’expofe
M m ij