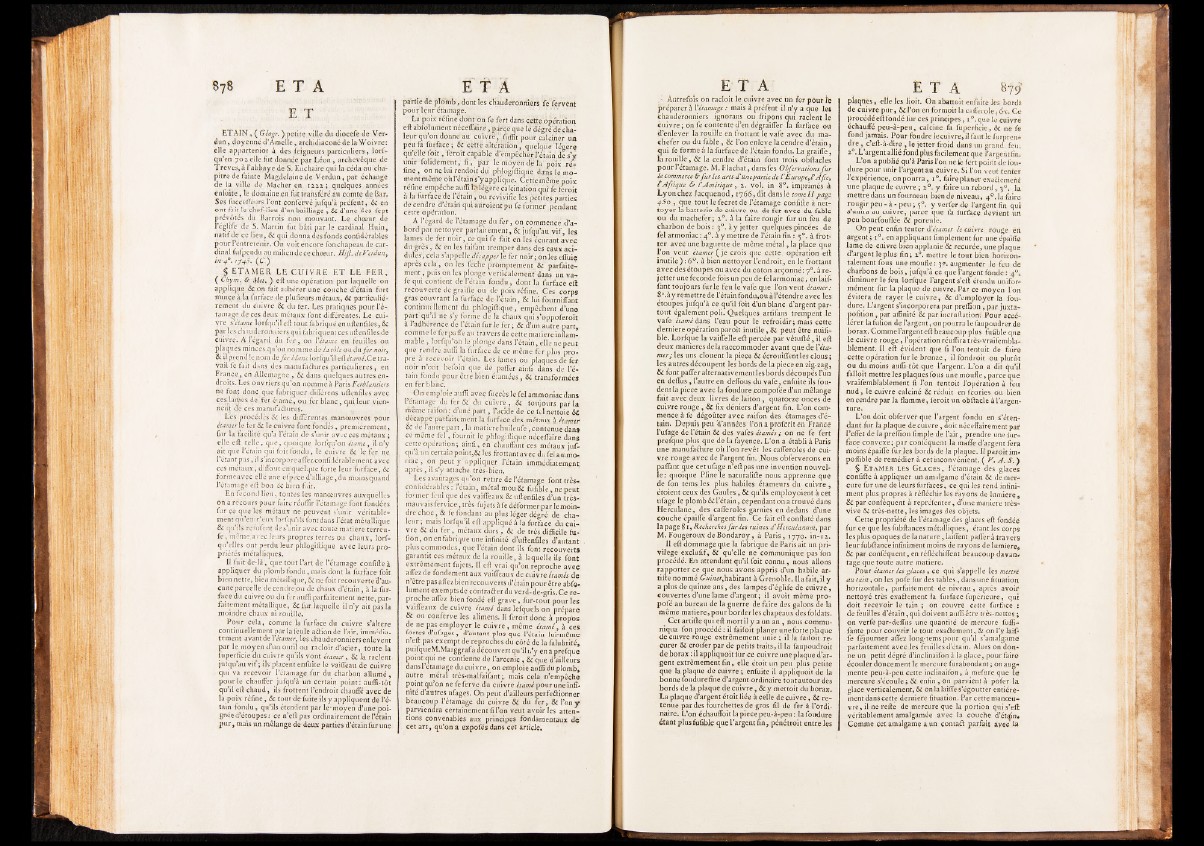
E T A
E T
ETAIN , ( Gcogr. ) petite ville du diocefe de Verdun
, doyenné d’Amelle, archidiaconé de la Woivres
elle appàrteniot à des l'eigpeurs particuliers, lorf-
qu’en 703, elle fut donnée par-Léon, archevêque de
Treves,à l’abbaye de S. Euchaire qui la céda au chapitre
de fainte MagdeJaine de Verdun, par échange
de la ville de Mâcher en 1222; quelques années
enfuite , lé domaine en fut transféré au comte de Bar.
Ses fuccefleurs l’ont çonfervé jufqu’à préfent, & en
ont fait le chef-lieu d’un bailliage , & d’une des fept
prévôtés du Barrois non mouvant. Le choeur de
l’églife de S. Martin fut bâti par le cardinal Huin,
natif de ce lieu, & qui donna des fonds confidérables
pour l’entretenir. On voit encore fon chapeau de cardinal
fufpendu au milieude ce choeur. Hift.de Verdun,
w-40. /74I (C )
§ ETA)MER- l e c u i v r e e t l e f e r ,
( ) eft une opération par laquelle on
applique & o p fait adhérer une couche d’étain fort
mince à- la; furface de plufieijrs métaux, & particuliérement
du cuivre & du fer. Les pratiques pour l’é-,
ta mage de ces, deux métaux font différentes. Le cuivre
s'éiame lorfqu’il eft tout fabriqué en uftenfiles, &
par les chauderonniers qui fabriquent ces uAenfiles de
cuivre. A l’egard du fe r , on l'étamé en feuilles ou
plaqués minces qu’on nomme de la nie ou du fer noir,
& il prend le nom de fer blanc lorfqu’il eft étamé. Ce travail
fe fait dans des manufafhires particulières, en
France., en Allemagne , & dans quelques autres endroits.
Les ouvriers qu’on nomme à Paris Ferblantiers
ne font donc qùe fabriquer diflférens uftenfiles avec
c e s s é s de fer étamé, ou fer blanc, qui leur viennent
dé ces manufactures.
Les procèdes & les différentes manoeuvres pour
etanierle fe r& le cuivre font fondés, premièrement,
ûir la facilité qu’a l’étain de s’unir avec ces métaux ;
elle eA telle, que, quoique Jorfqu’on étame, il n’y
ait que l’étain qui foit fondy, le cuivre & le fer ne
l’étant pas, il s’incorporeafîezconfidérablement avec
ces métaux, diAout enquelque forte leur furface, &
forme avec elle une efpece d’alliage, du moins quand
l’étamage eft bon & bien fuir.
En fécond lieu, toutes les manoeuvres auxquelles
on a recours pour faire réuflir l’étamage font fondées
fur çe que les métaux ne peuvent s’unir véritablement
qu’erir r’eux lorfqu’ils font dans l'état métallique
& qu’ils refufent de s’unir avec toute matière terreu-
fe , même avec leurs propres terres ou chaux, lorf-
qu’elles ont perdu leur phlogiAique avec leurs propriétés
métalliques.
Il fuit de-là, que tout l’art de l’étamage confiAe à
appliquer du plomb fondu, mais dont la furface foit
bien nette, bien métallique, & ne foit recouverte d’aucune
parcelle de cendre.ou de chaux d’étain, à la fur-
face du cuivre ou du fer aufli parfaitement nette, parfaitement
métallique, Sc fyr laquelle il n’y ait pas la
moindre chaux ni rouille.
Pour cela, comme la furface du cuivre s’altere
continuellement par la feule a£lion de l’air, immédiatement
avant de l'étamer, les chauderonniersenlevent
par le,moyen d’un outil ou racloir,d’acier, toute la
l'uperficie du Cuivre qu’ils vont étamer, & la raclent
juf qu’au v if ; ils placent enfuite le vaifleau de cuivre
qui va recevoir l’étamage fur du charbon allumé,
pour le chauffer jufqu’à un certain point: aufîî-tôt
qu’il eA chaud, ils frottent l’endroit chauffé avec de
là poix réfine, & tout de fuite ils y appliquent de l’étain
fondu , qu’ils étendent par le-moyen d’une poignée
d’étoupes : ce n’eA pas ordinairement de l’étain
pur, mais un mélange de deux parties d’étain fur une
partie de plomb, dont les Chauderonniers. fe fervent
pour leur étamage.
La poix réfine doht on fe. fert dans çêtte,opération
eA absolument néceffàirê, parte que ledégrede chaleur
qu’on donne au cuivre,'fuffit pour calçiper un
peu fa furface; & cèttë altération, quelcuïe légère
qu’elle fo i t , fer oit capable d’empêcher ï’étaiq. çle s’y
unir folidement, fi, par le môyëii de la - poix ré.-*
fine, on ne lui rendoit du phlogiAique dans le moment
même oit l’étain s’y applique. Cette même poix
réfîne empêche auffi I?tlégère calcination qui /eieroit
à la furface de l’étain, ou revivifie les petites parties
de cendre d’ etairi qui aiiroièrit pu fe former1 pendant
cette opération.
A l’égard de l’étamage du fer, on commence d’abord
par nettoyer parfaitement, & jufqu’au v i f , les
lames de fer noir, ce qui fe fait en lesécurant avec
du grès, & en les faifant tremper dans des eaux aci-
dul’es'i cela s’appelle décapper le fer noir ;.ç>n les eflùie
après cela , on les fecfie promptement &: parfaitement,
puis on les plonge verticalemenfdans un va-»
fe qui contient de l’étain fondu, dont la' furface eft
recouverte de graifl'e ou de poix réfîne. Ces corps
gras couvrant la futfaCe de l’étain, & lui fourniflant
continuellement du phlogiAique, empêchent d’une
part qu’il ne s’y forme de la chaux qui s’oppoferoit
à l’adhérence de l’étain furie fer; & d’un autre part,,
comme le fer paffe au travers de cette matière inflam-
mable , lorfq'u’Oh le plonge dans l’étain, elle ne peut
que rendre aufli la furface de ce même fer plus propre
à recevoir l’étain. Les lames ou plaques de fer
noir n’ont bëfoin que de pafler ainfi dans de l’étain
fondu pour être bien étamées, & transformées
en fer blanc.
On emploie aufli avec fuccèslefelammoniacdans
l’étamage du fer & du cuivré, & toujours par la
même râifqri : d’une part, l’acide de ce fel nettoie &
décappe parfaitement la furface des métaux R étamer
& dej’autreparr, la matièrehuileufe »contenue dan»
ce même fel , fournit le phlogiftique néceflaire dans
cette opération; ainfi, en chauffant ces métaux jufqu’à
un certain point,& les frottant avec du fel ammoniac
, on peut y Appliquer l’étain immédiatement
après, il s’y attache, très-bien.
Les avantages qu’on retire de l’étamage font très-,
confiderables : 1 etain, métal mou & fufible, ne peut
former foui que des vaifleaux & uAenfiles d’un très-
mauvais fervice, très fujets à fe déformer par lemoin-
dre choc, & fe fondant au plus léger dégré de chaleur
; mais lorfqu’il efi appliqué à la furface du cuivre
& du fe r , métaux durs , & de très difficile fu-
fion, on en fabrique une infinité d’ufienfiles d’autant
plus commodes, que l’etain dont ils font recouverts
garantit ces métaux de la rouille, à laquelle ils font
extrêmement fujets. Il eA vrai qu’on reproche avec
allez de fondement aux vaifieaux de cuivre étamés de
n’être pas aflez bien recouverts d’étain pour être abfo*
lument exemptsde contrarier du verd-de-gris.Ce reproche
aflez bien fondé eft grave, fur-tout pour les
vaifieaux de cuivre étamé dans lefquels on prépare
& on conferve les alimens. Il feroit donc à propos
de ne pas employer le cuivre , même étamé, à ces
fortes d’ufages, d’autant plus que l’étain lui-même
n’eft pas exempt de reproches du côté de la falubriré,
puifqueM.Marggrafa découvert qu’il n*y en a prefque
point qui ne contienne de l’arcenic , & que d’ailleurs
dansl’étamage du cuivre, on emploie aufli du plomb,
autre métal tres-malfaifant ; mais cela n’empêche
point qu’on ne feferve du cuivre étamé pour une infinité
d’autres ufages. On peut d’ailleurs perfectionner
beaucoup l’étamage du cuivre & du fer, & l’on y
parviendra certainement fi l’on veut avoir les attentions
convenables aux principes fondamentaux dç
cet art, qn’on a expofés dans cet article.
: Autrefois on racloit le cuivre avec un fer pour Ife
jpréparer à Yétamage : mais à préfent il n’y a que les
Chauderonniers ignorans ou fripons qui raclent le
cuivre ; on fe contente d’en dégraifler la furface ou
Ü’enlever la rouille en frottant le vafe avec du mâchefer
ou du fable , & l’on enleve la cendre d’étain,
qui fe forme à là furface de l’étain fondu. La graifle,
la rouille, & la cendre d’étain font trois obftacles
pourl’étaniage. M. Flachat, dansfes Obfervationsfur
le commerce & furies arts <£Unepartie de fEurope, f A fie,
P Afrique & l'Amérique, 2. vol; in 8°. imprimés à
Lyon chez Jacquenod, 1766, dit dans le tome I I page
4Îo , que tout lefecretde l’étamage confifte à nettoyer
la batterie de cuivre ou de fer avec du fable
Ou du mâchefer; i ° . à la faire rougir fur Un feu de
charbon de bois : 30. à y jetter quelques pincées de
fel armoniac : 4°. à y mettre de l’étain fin : 50. à frotter
avec une baguette de même métal, la place que
l’on veut étamer ( je crois que cette, opération eft
inutile) : à bien nettoyer l’endroit, en le frottant
avec des étoupes ou avec du coton arçonné: 7®. à re-
jetter une fécondé fois un peu de fel armoniac, en laiT-
fant toujours furie feu le vafe que l’on veut étamer:
8°.à y remettre de l’étain fondu,ou à l’étendre avec les
étoupes jufqu’à ce qu’il foit d’un blanc d’argent partout
également poli. Quelques artifans trempent le
Vafe étamé dans l’eau pour le refroidir ; mais cette
derniere opération paroît inutile, & peut être nuifi-
ble. Lorfque la vaiflelle eft percée par vétufté, il eft
deux maniérés de la raccommoder avant que de lVr<z-
mer; les uns clouent la piece & écrouiffenties clous ;
les autres découpent les bords de la piece en zig-zag,
& font pafler alternativement les bords découpés l’un
en deffus, l’autre en deflous du vafe, enfuite ils fou-
dent la piece avec la foudure jcompofée d’un mélange
fait avec deux livres de laiton, quatorze onces de
cuivre rouge, & fix déniers d’argent fin. L’on commence
à fe dégoûter avec raifon des étamages d’étain.
Depuis peu 'd’années' l’on a proferit en France
l’ufage de l’étain & des vafes étamés ; on ne fe fert
prefque plus que de la fayence. L’on a établi à Paris
une manufacture où l’on revêt les caflerôles de cuivre
rouge avec de l’argent fin. Nous obferverons en
paflant que cetufage n’ eft pas une invention nouvelle:
quoique Pline le naturalifte nous apprenne que
de fon tems les plus habiles étameurs du cuivre ,
étoient ceux des Gaules, & qu’ils employoient à cet
ufage le plomb & l’étain, cependant on a trouvé dans
Herculane, des cafteroles garnies en dedans d’une
couche épaifle d’argent fin. Ce fait eftconftaté dans
la page 81, Recherches fur les ruines, d'Herculanttni, par
M. Fougeroux deBondaroy, à Paris, 1770. in-12.
II eft dommage que la fabrique de Paris ait un privilège
exclufif, & qu’elle ne coftimunique pas l'on
procédé. En attendant qu’il foit connu, nous allons
rapporter ce que nous avons appris d’un habile ar-
tifte nommé Guinet,habitant à Grenoble. 11 a fait, il y
a plus de quinze ans, des lampes d’églife de cuivre,
couvertes d’une lame d’argent ; il avoit même pro-
pofé au bureau de la guerre de faire des galons de la
même matière, pour border les chapeaux des foldats.
^ Cet artifte qui eft mort il y a un an , nous communiqua
fon procédé : il faifoit planer une forte plaque
de cuivre rouge extrêmement unie ; il la faifoit recurer
& croifer par de petits traits, il la faupoudroit
de borax : il appliquoit fur ce cuivre une plaque d’argent
extrêmement fin, elle étoit un peu plus petite
que la plaque de cuivre ; enfuite il appliquoit de la
bonne toudurefine d’argent ordinaire tout autour des
bords de la plaque de cuivre, & y mettoit du borax.
La plaque d’argent étoit liée à celle de cuivre, & retenue
par des fourchettes de gros fil de fer à l’ordinaire.
L’on échauffoit la piece peu-à-peu : la foudure
étant plus fufible que l ’argent fin, pénétroit entre les
ptaqüës, elle les iioit. On abattoit enfuite les borda
de cuivre pur, & l’on en formoit la cafferole, &c. Ce
procédé eft fondé fur ces principes, i° . que le cuivré
échauffé peii-à-peu, calcine fa fuperficie, & ne fë
fond jamais. Pour fondre le cuivre, il faut le furpren*
d re , c’eft-à-dire , le jetter froid dans un grand feiu
20. L ’argent allié fond plus facilement que l’argeritfim
L’on a publié qu’à Paris l’on ne fe fert poirit de fou-
dure pôur unir l’argent au cuivre. Si l’on veut tenter
l’expérience, on pourra * i° . faire planer exaêtemefit
une plaque de cuivre ; 20. y faire un rebord, la
mettre dans un fourneau bien de niveau, 40. la faire
rougir peu - à - peu ; 50. y verfer de l’argent fin qui
s unira au cuivre, parce que fa furface devient uii
peu bourfouflée & poreufe.
On peut enfin tenter d'étamer le cuivre fbü^è ëri
argent.;'i°. en appliquant Amplement fur une épaiffë
lame de cuivre bien applanie & recurée, une plaque
d’argent le plus fin; i°. mettre le tout bien horizontalement
fous une moufle: 3?; augmenter le feu de
charbons de bois, jufqu’à ce que l’argent fonde J 40.
diminuer le feu Iorfqüe l’argent s’eft étendu uniformément
fur la plaque de cuivre. Par ce moyen l'on
évitera de rayer le cuivre, & d’employer la fou-
dure. L’argent s’incorporera par preflion * par jüxta-
pofition, par affinité &c par incruftationi Pour accélérer
lafufion de l’argent, on pourra le faupoudrerdë
borax. Comme l’argent eft beaucoup plus fufible que
le cuivre rouge, l’opération réuflira très-vràifembla-
blement. Il eft évident que fi l’on tentoit de faire
cette opération fur le bronze, il fondroit ou plutôt
ou du moins aufli tôt que l ’argent. L’on a dit qu’il
falloir mettre les plaques fous une moufle, parce que
Vraifemblablement fi l’on tentoit l’opération à feu
nud, le cuivre calciné & réduit en feories ou bien
en cendre par la flamme, feroit un obftaçle à l’argenture.
L’on doit obfervër que l’argent fondu en s’éterl*
dant fur la plaque de cuivre, doit néceflairement pair
l’effet de la preflion fimple de l’air, prendre une fur-
faCe convexe; par conféquent la mafle d’argent fera
moins épaifle fur les bords de la plaque. Il paroît im-
poflible de remédier à cet inconvénient. ( V. A. S . )
§ Etamer les Gl a c e s , l’étamage des glaces
confifte à appliquer un amalgame d’étairt ôc de mercure
fur une de leurs furfaces, ce qui les rend infiniment
plus propres à réfléchir les rayons de lumière ,
& par conféquent à repréferiter, d’une maniéré très-
vive & très-nette, les images des objets.
Cette propriété de l’étamage des glaces eft foiidéë
fur ce que les fubftances métalliques, étant les corps
les plus opaques de la nature, laiflent pafler à tra vers
leur fubftance infiniment moins de rayons de lumière#
& par conféquent, en réfléchiflent beaucoup davan^
tage que toute autre matière.
Pour étamer les glaces, ce qui s’appelle les mettri
au tain, on les pofe fur des tables, dans une ficuation
horizontale, parfaitement de niveau, après avoir1
nettoyé très exactement la furface fupérieurë, qui
doit recevoir le tain ; on couvre cette furface :
de feuilles d’étain, qui doivent aufli être tfès-rtettes ;
on verfe par-deflùs une quantité de mercure fuffi-»
fante pour couvrir le tout exactement, & on l’y laifi»
fe féjourner aflez long-tems pour qu’il s’amafgamë
parfaitement avec,les feuilles d’étain. Alors on donne
un petit dégré d’inclinaifon à la glace, pour faire
écouler doucement le mercure furabondant ; on augmente
peu-à-peu cette inchnaifon, à mefure que le
mercure s’écoule ; & enfin , On parvient à pofer la
glace verticalement, & on la laifle s’égoutter entièrement
dans cette derniere fituation. Par cette manoeuvre,
il. ne refte de mercure que la pôrtion qui s’eft
véritablement amalgamée avec la couche d’étmn*
Comme cet amalgame a un contaCt parfait avec la