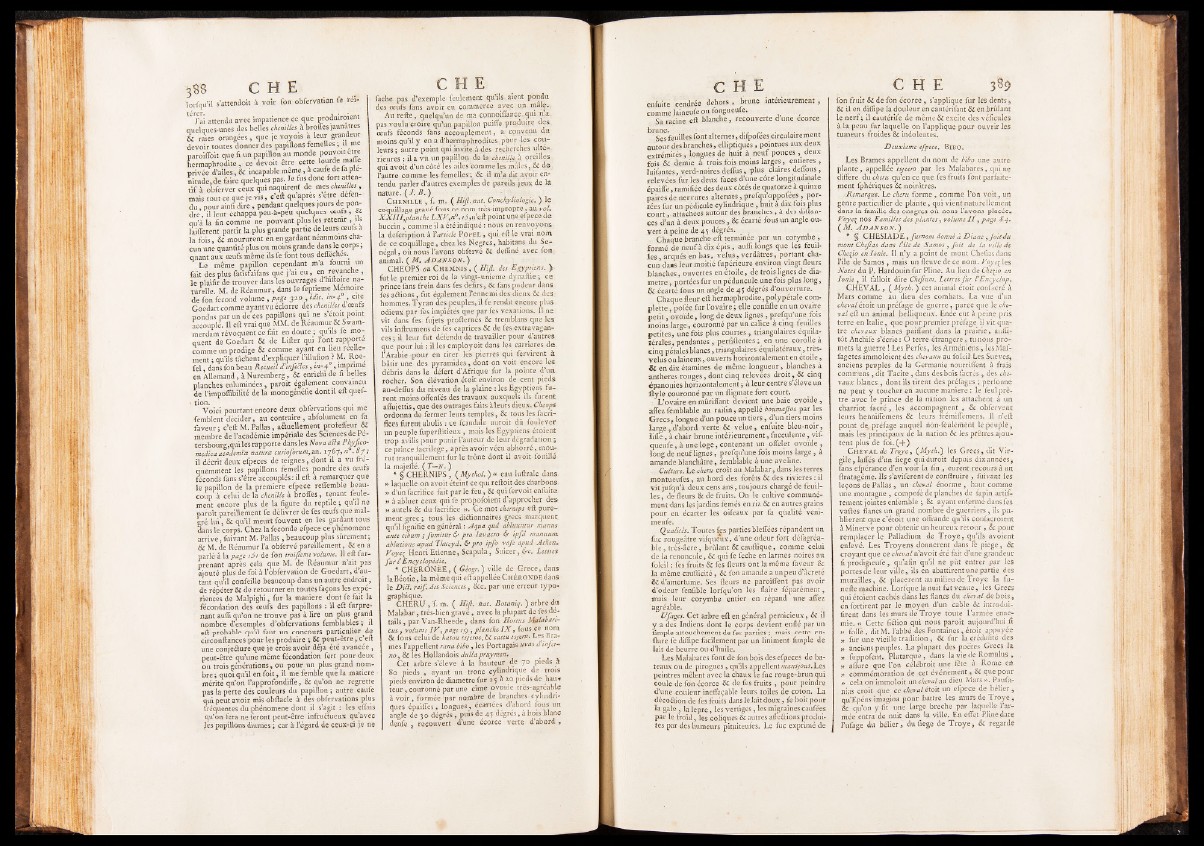
lorfqu’il s'attendent à voir fon obfervation fe téi-
6 J’ai attendu avec impatience ce que produiroient
quelques-unes des belles chenilles à broffes jaunâtres
& raies orangées, que je voyois à leur grandeur
devoir toutes donner des papillons femelles ; urne
naroiffùit que fi un papillon au monde pouvoir être
hermaphrodite, ce devoit être cette lourde malle
privée d’ailes, & incapable même, à caufe de la plénitude,
de faire quelques pas. Je fus donc fort attentif
à obferver ceux qui naquirent de mes chenilles ,
mais tout ce que je vis, e’eft qu apres s etre détendu
, pour ainfi dire I pendant quelques jours de pon-
dre, il leur échappa peu-à-peu quelques oeurs , oc
qu’à la fin comme ne pouvant plus les retenir , ils
laifferent partir la plus grande partie de leurs oeufs a
la fois, ôc moururent en en gardant neanmoins chacun
une quantité plus ou moins grande dans le corps ;
quant aux oeufs même ils fe font tous deffeches.
Le même papillon cependant m’a fourni un
fait des plus fatisfaifans que j’ai eu , en revanche ,
le plaifir de trouver dans les ouvrages d hiftoire naturelle.
M. de Réaumur, dans le feptieme Mémoire
de fon fécond volume , page 320 , édit, in-4 , cite
Goedart comme ayant vu éclorre des chenilles a oeuls
pondus par un de Ces papillons qui ne s’etoit poipt
accouplé. Il eft vrai que MM. de Réaumur ôcSwam-
merdam révoquent ce fait en doute ; qu’ils fe moquent
de Goedart ôc de Lifter qui font rapporte
comme un prodige ôc comme ayant eu lieu réellement
; qu’ils tâchent d’expliquer l’illufion ? M. Roe-
fel dans fon beau Recueil d’infectes, in-4° , imprime
en Allemand, à Nuremberg, Ôc enrichi de fi belles
planches enluminées, paroît également convaincu
de l’impoffibilité delà monogénéfte dont il eft quef-
Iion.
Voici pourtant encore deux obfervations qui me
femblent décider, au contraire, abfolument en fa
faveur ; c’eft M. Pallas, usuellement profeffeur ôc
membre de l’académie impériale des Sciences de Pé-
tersbourg,qui les rapporte dans les Nova acta Phyfico-
medica acadtmïïe naturce curioforum, an. 1767, n°. 87;
il décrit deux efpeces de teignes, dont il a vu fréquemment
les papillons femelles pondre des oeufs
féconds fans s’être accouplés: il eft à remarquer que
le papillon de la première efpece reffemble beaucoup
à celui de la chenille à broffes, tenant feulement
encore plus de la figure du reptile ; qu’il ne
paroît pareillement fe délivrer de fes oeufs que malgré
lu i, ôc qu’il meurt fouvent en les gardant tous
dans le corps. Chez la fécondé efpece ce phénomène
arrive, fuivant M. Pallas , beaucoup plus sûrement;
& M. de Réaumur l’a obfervé pareillement, & en a
parlé à la page 161 de fon troifeme volume. Il eft fur-
prenant après cela que M. de Réaumur n’ait pas
ajouté plus de foi à l’obfervation de Goedart, d’autant
qu’il confeille beaucoup dans un autre endroit,
de répéter ôc de retourner en toutes façons les expériences
de Malpighi, fur la maniéré dont fe fait la
fache pas d’exemple feulement qu’ils-aient pondu
des oeufs fans avoir eu commerce, avec un male.
fécondation des oeufs des papillons : il eft furpre-
nant aufli qu’on ne trouve pas à lire un plus grand
nombre d’exemples d’obfervations femblables ; il
eft probable qu’il faut un concours particulier de
circonftances pour les produire ; & peut-être, c’eft
une conjecture que je crois avoir déjà été avancée ,
peut-être qu’une même fécondation fert pour deux
ou trois générations, ou pour un plus grand nombre
; quoi qu’il en foit, il me femble que la matière
Au refte, quelqu’un de ma connoiffance.qui n,a
pas voulu croire qu’un papillon puiffe produire dçs.
oeufs féconds fans accouplement, a/ convenu du
moins qu’il y en a d’hermaphroditeSr-pbur les copieurs
mérite qu’on l’approfondiffe, Ôc qu’on ne regrette
pas la perte des couleurs du papillon ; autre caufe
qui peut avoir mis obftacle à des obfervations plus
fréquentes, du phénomène dont il s’agit : les effais
qu’on fera ne feront peut-être infructueux qu’avec
Jes papillons diurnes ; car à l’égard de ceux-ci je ne
; autre point qui invite, à des recherches ultérieures
: il a vit un papillon de \z chenU-fa^ oreilles
qui avoit d’un côté les ailes comme les mâles, & de,
l’autre comme les femelles'; 'ôc il m?a dit\ayoir entendu
parler d’autres exemples de pareils jeux de la
nature. ( J . B . )
C henille , f. m. ( Hiß.nat. Conchyliologie. ) le
coquillage gravé fous ce nom très-impropre, au vol.
XXIII,planche LXV,n°. /5,n’eft point une,efpeçe de
buccin , comme il a été indiqué : nous en renvoyons
la defeription à Y article Popel , qui eft le vrai nom
de ce coquillage, chez les Negres, habitans du Sénégal,
oîi nous l’avons obfervé ôc delîiné avec fon.
animal. ( M. A d a n s o n . )
CHEOPS ou CheMNIS , ( Hiß. des Egyptiens. \
fut le premier roi de la vingt-unième dynaftie; ce
prince fans frein dans fes defirs, Ôc fans pudeur dans
fes actions, fut également l’ennemi des dieux & des
hommes. Tyran des peuples, il fe rendit encore plus
odieux par fes impiétés que par fes vexations. Il ne
vit dans fes- fujets profternés ôc tremblans que les.
vils inftrumens de fes caprices ÔC de fes extravagances
; il leur fut défendu de travailler pour d’autres
que pour lui : il les employoit dans les cârrieres de
l’Arabie .pour en tirer lès pierres qui fervirent à
bâtir une des pyramides , dont on voit encore les
débris dans le défert d’Afrique fur la pointe d’un
rocher. Son élévation étoit environ de cent pieds
au-deffus du niveau de la plaine : les Egyptiens furent
moins offenfés des travaux auxquels ils furent
affujettis, que des outrages faits àleurs dieux. Cheops
ordonna de fermer leurs temples, ôc tous les facri-
fices furent abolis : ce fcandale auroit dû foule ver
un peuple fuperftitieux , mais les Egyptiens etoient
trop avilis pour punir l’auteur de leur dégradation ;
ce prince facrilege, après avoir vécu abhorré, mourut
tranquillement fur le trône dont il avoit fouille
la majefté. ( T — N .)
* § CHERNIPS , ( Mythol. ) « eau luftrale dans.
; » laquelle on avoit éteint ce qui reftoit des charbons
» d;un facrifice fait par le feu, Ôc qui fervoit enfuite
| » à abluer ceux qui fe propofoient d’approcher des
» autels & du facrifice ». Ce mot chernips eft purement
grec ; tous les di&ionnaires grecs marquent
qu’il lignifie en général : Aqua quâ abluuntur manus
ante cibum ; fïtmitur & pro lavacro & ipfd manuuni
ablutione apud Thucyd. & pro ipfo vafe apud Athen*
Voyei Henri Etienne, Scapula, Suicer, &c. Lettres
\ fur IEncyclopédie.
* CHÊRONÉE, ( Géogr. ) ville de Grèce, dans
la Béotie, la même qui eft appellée C héronde dans
le Dict. raif. des Sciences, ôce. par une erreur typographique.
■ . •
CHERU , ï. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) arbre du
Malabar , très-bien gravé, avec la plupart de fes détails,
par Van-Rheede, dans fon Honus M&laban-
tu s , volume IV , page i() , planche I X , fous ce nom
& fous celui de katou tsjeroe, ÔC cattu tsjerit. Les Bra?
mes l’appellent ranà bibo, les Portugais uvas d infer-
no , ôc les Hollandois dulla pruymen*
Cet arbre s’éleVe à la hauteur de 70 pieds à
80 pieds , ayant un tronc cylindrique de trois
pieds environ de diamètre fur 15 à .2-0 pieds de liait*
teur-, couronné par une cime ovoïde très-agreable
à vo ir , formée ‘par nombre de branches-cylindriques
épaiffes, longues, écartées d’abord fous un
angle de 30 dégrés, puis de 45 dégrés, à bois blanc
denfe , recouvert d’une écorce verte d’abord ,
enfuite cendrée âehors , brune intérieurement,
comme laineufe ou fongueute.
Sa racine eft blanche, recouverte d une écorce
^ e s feuilles font alternes, difpofées circulaire ment
autour des branches, elliptiques, pointues aux deux
extrémités , longues de huit à neuf pouces , deux
fois ôc demie à trois fois moins larges, entières,
luifantes, verd-noires deffus, plus^ claires deffous,
relevées fur les deux faces d’une cote" longitudinale
épaiffe /ramifiée des deux côtés de quatorze à quinze
paires de nervures alternes, prefqu’oppofees , portées
fur un pédicule cylindrique , huit à dix fois plus
court, attachées autour des branches -, à des diftan-
ces d’un à deux pouces, Ôc écarté fous un angle ou-
yert à peine de 45 dégrés. , v , •
Chaque branche eft terminée par un corymbe,
formé de neuf à dix épis , aufli longs que les feuille
s , arqués en bas, velus, verdâtres, portant chacun
daàis leur moitié fupérieure environ vingt fleurs
blanches, ouvertes en étoile, de trois lignes de diamètre
, portées fur un péduncule une fois plus long,
& écarté fous un angle de 45 dégrés d’ouverture.
Çhaque fleur eft hermaphrodite, polypétale eom-
plette, pofée fur l’ovaire ; elle confifte en un ovaire
p e tit, ovoïde, long de deux lignes, prefqu’une fois
moins large, couronne par un calice à cinq feuilles
petites, une fois plus courtes , triangulaires équilatérales,
pendantes , perfiftentes ; en une corolle à
cinq pétales blancs, triangulaires équilatéraux, tres-
velus ou laineux, ouverts horizontalement en étoile,
& en dix étamines de même longueur, blanches à
anthères rouges, dont cinq relevées droit , & cinq
épanouies horizontalement ; à leur centre s’élève un
ity le couronné par un ftigmate fort court.
L’ovaire en mûriffant devient une baie ovoïde ,
affez femblable au raifin, appellé boumafios par les
Grecs, longue d’un pouce un tiers, d’un tiers moins
large, d’abord verte & velue, enfuite bleu-noir,
liffe , à chair brune intérieurement, fucculente, vif-
queufe, à une loge, contenant un offelet ovoïde ,
long de neuf lignes, prefqu’une fois moins large, à
amande blanchâtre, femblable à une aveline.
Culture. Le cheru croît au Malabar, dans les terres
montueufes, au bord des forêts & des rivières : il
vit jufqu’à deux cens ans, toujours chargé de feuilles
, de fleurs & de fruits. On le cultive communément
dans les jardins femés en riz & en autres grains
pour en écarter les oifeaux par fa qualité veni-.
meufe.
Qualités. Toutes fes parties bleffées répandent un
fuc rougeâtre vifquéux, d’une odeur fort défagrea-
b le , très-âcre, brûlant & cauftique, comme celui
de la renoncule, & qui fe feche en larmes noires au
foleil : fes fruits & fes fleurs ont la même faveur &
la même caufticité , & fon amande a un peu d’âcreté
& d’amertume. Ses fleurs ne paroiffent pas avoir
d’odeur fenfible lorfqu’on les flaire féparément,
mais leur corymbe entier en répand une affez
agréable. 1
Ufages. Cet arbre eft en général pernicieux, & il
y a des Indiens dont le corps devient enflé par un
iimple attouchement de fes parties ; mais cette enflure
fe diflipe facilement par un Uniment (impie de
lait de beurre ou d’huile.
Les Malabares font de fon bois des efpeces de bateaux
ou de pirogues , qu’ils appellent mansjous. Les
peintres mêlent avec la chaux le fuc rouge-brun qui
coule de fon écorce & de fes fruits , pour peindre
d’une couleur ineffaçable leurs toiles de cotpn. La
déco&ion de fes fruits dans le lait doux, fe boit pour
la gale , la lepre, les vertiges, les migraines caufées
par le froid, les coUques & autres affedions produir.
tes par des humeurs pituiteufes. Le fuc exprimé de ]
fon fruit & de fon écorce, s’applique fur les dents ;
& il en diflipe la douleur en cautérifant & en brûlant
le nerf ; il cautérife de même & excite des véficules
à la peau fur laquelle on l’applique pour ouvrir les
tumeurs froides 5c indolentes.
Deuxieme efpece. Bibo.
Les Brames appellent du nom de bibo une autre
plante , appellée tsjeero par les Malabares, qui ne
différé du cheru qu’en ce que fes fruits font parfaitement
fphériques & noirâtres.
\Remarque. Le cheru forme , comme l’on Voit, un
genre particulier de plante, qui vient naturellement
dans la famille des onagres ôïi nous l’avons placée,
V)yeç nos Familles des plantes, volume I I , page 84.
(Àf. A d a n so n . )
* § C H ESI AD E , furnom donné à Diane , J oit du
mont Chejîas dans Cîle de Samos , foit de la ville de
Cheçio en Ionie. Il n’y a point de mont Chelias dans
l’île de Samos , mais un fleuve de ce nom. Voye[ les
Notes du P. Hardouin fur Pline. Au lieu de Che^io en
Ionie , il falloit dire Chejium. Lettres fur IEncyclop.
CHEVAL , ( Myth. ) cet animal étoit confacré à
Mars comme au dieu des combats. La vue d’un
cheval étoit unpréfage de guerre, parce que le cheval
eft un animal belliqueux. Enée eut à peine pris
terre en Italie, que pour premier préfage il vit quatre
chevaux blancs paiffant dans la prairie, aufli-
tôt Anchife s’écrie: O terre étrangère, tu,nous promets
la guerre ! Les Perfes, les Arméniens , lesMaf-
fagetes immoloient des chevaux au foleil Les Sueves,
anciens peuples de la Germanie nourriffent à frais
communs, dit Tacite, dans des bois facrés , des chevaux
blancs , dont ils tirent des préfages ; perfonne
ne peut y toucher en aucune maniéré : le, feul prêtre
avec le prince de la nation les attachent à un
charriot facré , les accompagnent , 5c obfervent
leurs henniffemens 5c leurs frémiffemens. Il n’eft
point de, préfage auquel non-feulement le peuple,
mais les principaux de la nation 5c les prêtres ajoutent
plus de foi. (+ )
C hev al de Troye, (Myth.) les Grecs, dit Virg
ile, laffés d’un fiege quiduroit depuis dixannées.j
fans efpérance d’en voir la fin , eurent recours à un
ftratagême. Ils s’aviferent de conftruire , fuivant les
leçons de Pallas , un cheval énorme, haut comme
une montagne , çompofé de planches de fapin artif-
tement jointes enfemble ; 5c ayant enfermé dans fes
vaftés flancs un grand nombre de guerriers, ils publièrent
que. c ’étoit une offrande qu’ils confacroient
à Minerve pour obtenir un heureux retour , & pour
remplacer le Palladium de T ro y e , qu’ils avoient
enlevé. Les Troyens donnèrent dans le piege, 5c
croyant que ce cheval n’avoit été fait d’une grandeur
fi prodigieufe, qu’afin qu’il ne pût entrer par les
portes de leur ville, ils en abattirent une partie des
murailles, 5c placèrent au milieu de Troye la fu-
nefte machine. Lorfque la nuit fut venue, les Grecs
qui étoient cachés dans les flancs du cheval de bois,
enfortirent par le moyen d’un cable ôc introdui-
firent dans les murs de T roye toute l ’armée enner
mie. « Cette fiftion qui nous paroît aujourd’hui fi
» folié , ditM. l’abbé des Fontaines * étoit appuyée
» fur une vieille tradition, ôc fur la crédulité des
» anciens peuples. La plupart des poètes Grecs la
» fuppofent. Plutarque , dans la vie de Romulus ,
» afl'ure que l’on célébroit une fete à Rome en
» commémoration de cet événement ., 5c que pour
» cela on immoloit un cheval au dieu Mars ». Paufar
nias croit que ce cheval étoit un efpece de bélier ,
qu’Epéus imagina pour battre les murs de Troye *
5c qu’on y fit une large breche par laquelle l’armée
entra de nuit dans la ville. En effet Pline date
l’ufage du bélier, du fiege de Troye * 6c regarde