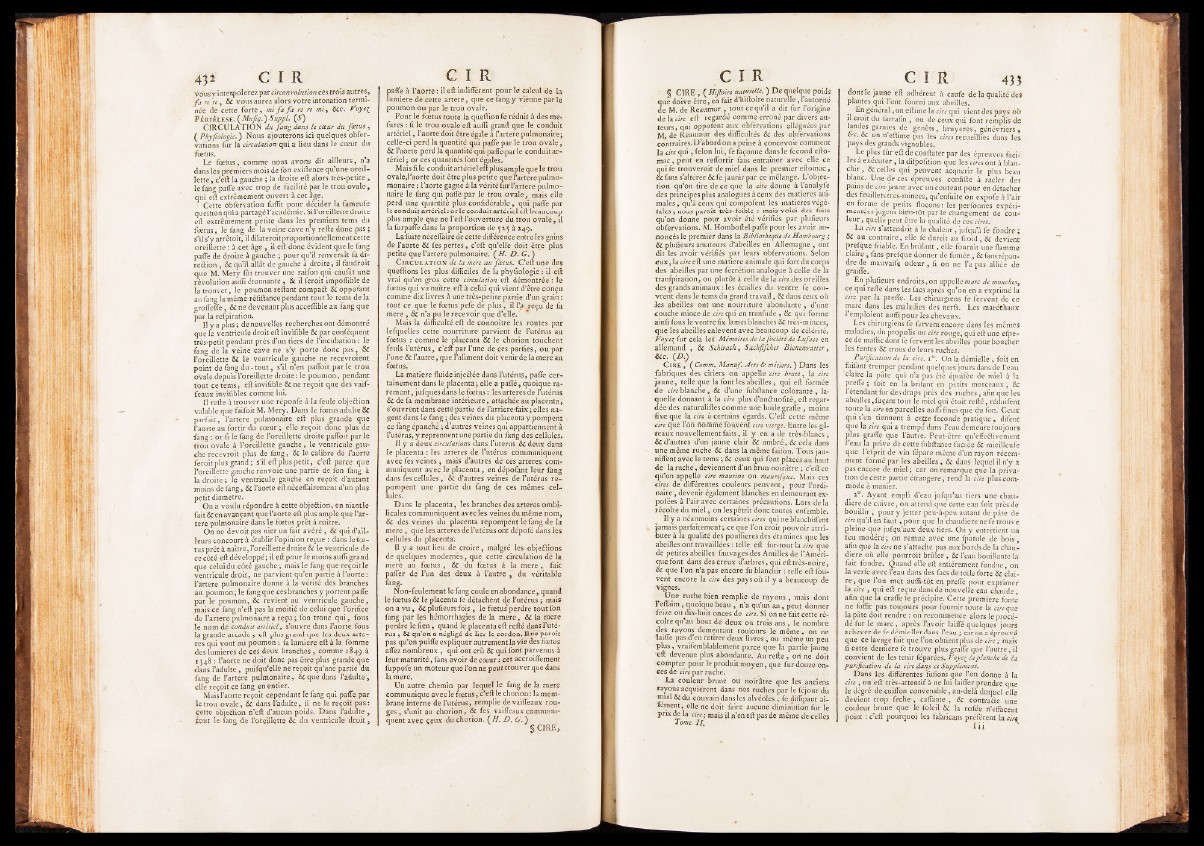
vôüs'y iriteitpolerez par circonvolutionces trois autres,
fa. re re, & vous aurez alors votre intonation terminée
de cette forte , mi fa fd re re mi, &c. Voye^
PÉRIÉLESE. (Mufiq.) Suppl. (S)
CIRCULATION du fang dans le coeur du foetus,
( Phyjîologie. ) Nous ajouterons ici quelques obfervations
fur la circulation qui a lieu dans le coeur du
foetus, -
Le foetus, comme nous avons dit ailleurs, n’a
dans lés premiers mois de fon exiftence qu’une oreillette
, c’éft la gauche ; la droite eft alors très-petite,
le fang paffe avec trop de facilité par le trou ovale,
qui eft extrêmement ouvert à cet âge.
Cetre obfervation fuffit pour décider la fameufe
queftion qui a partagé l’académie. Si l’oreillette droite
eft extrêmement petite dans les premiers tems du
foetus, le fang de la veine cave n’y refte donc pas ;
s’il s’y arrêtoit, il dilateroitproportionnellement cette
oreillette : à cet âge , il eft donc évident que le fang
paffe de droite à gauche ; pour qu’il renversât fa di-
reâion , & qu’il allât de gauche à droite, il faudroit
que M. Mery fut trouver une raifon' qui câufât une
révolution aufli étonnante , & il feroit impoffible de
la trouver, le poumon reftant compatt &oppofant
au fang la même réfiftance pendant tout le tems de la
groffeffe, & ne devenant plus accelîible au fang que
par la refpiration.,
Il y a plus ; de nouvelles recherches ont démontré
que le ventricule droit eft invifible & par conséquent
très-petit pendant près d’un tiers de l’incubation : le
fang de la veine cave ne s’y porte donc pas, &
l’oreillette & le ventricule gauche ne recevroient
point de fang d u -tou t, s’il n’en paffoit par le trou
ovale depuis l’oreillette droite: le poumon, pendant
tout ce tems, eft invifible & ne reçoit que des vaif-
feaux invifibles comme lui.
Il refte à trouver une réponfe à la feule obje&ion
valable.que faifoit M. Mery. Dans le foetus adulte &
parfait, l’artere pulmonaire eft plus grande que
l’aorte au fortir du coeur ; elle reçoit donc plus de
fang : or fi le fang de l’oreillette droite paffoit par le
trou ovale à l’oreillette gauche, le ventricule gauche
recevroit plus de fang, & le calibre de l’aorte
feroit plus grand ; s’il eft plus petit, c’eft parce que
l’oreillette gauche renvoie une partie de fon fang à
la droite; le ventricule gauche en reçoit d’autant
moins de fang, & l’aorte eft néceffairement d’un plus
petit diamètre.
On a voulu répondre à cette bbjeâion, en niantle
fait & en avançant que l’aorte eft plus ample que l’artere
pulmonaire dans le foetus prêt à naître.
On ne devoit pas nier un fait avéré , & qui d’ailleurs
concourt à établir l’opinion reçue : dans lefoe-
tus prêt à naître, l’oreillette droite & le ventricule de
ce côté eft développé; il eft pour le moins aufligrand
que celui du côté gauche ; mais le fang que reçoit le
ventricule droit, ne parvient qu’en partie à l’aorte:
l’artere pulmonaire donne à la vérité des branches
au poumon; le fang que ces branches y portent paffe
par le poumon, & revient au ventricule gauche,
mais ce fang n’eft pas la moitié de celui que l’orifice
de l’artere pulmonaire a reçu ; fon tronc q ui, fous
le nom de conduit artériel, s’ouvre dans l’aorte fous
la grande.arcade , eft plus grand que les deux artères
qui vont au poumon : fa lumière eft à la fomme
des lumières de ces deux branches, comme 1849 à
1348 : l’aorte ne doit donc pas être plus grande que
dans l’adulte, puifau’elle ne reçoit qu’une partie du
fang de l’artere pulmonaire, 8c que dans l’adulte,
elle reçoit ce fang en entier.
Mais l’aorte reçoit cependant le fang qui paffe par
le trou ovale, & dans l’adulte, il ne le reçoifpas:
cette obje&ion n’eft d’aucun poids. Dans l’adulte ,
iout le fang de l’oreillette 8c du ventricule droit.,
paffe à l’aorte : il eft indifférent pour le calcul de la
lumière de cette artere, que ce fang y vienne parle
poumon ou par le trou ovale.
Pour le foetus toute la queftion fe réduit à des me»
litres : fi le trou ovale eft aufli grand que le conduit
artériel, l’aorte doit être égale à l’artere pulmonaire;
celle-ci perd la quantité qui paffe par le trou o vale,
8c l’aorte perd la quantité qui paffopar le conduit artériel
; or ces quantités font égales.
Mais fi le conduit artériel eft plus ample que le trou
ovale,l’aorte doit être plus petite que l’artere pulmo-
monaire : l’aorte gagne à la vérité fur l’artere pulmonaire
le fang qui paffe par le trou o vale, mais elle
perd une quantité plus confidérable, qui paffe par
le conduit artériel : or le conduit artériel eft beaucoup
plus ample que ne l’eft l’ouverture du trou ovale, il
la furpaffe dans la proportion de 515 à 249.
La fuite néceffaire de cette différence entre les gains
de l’aorte 8c fes pertes, c’eft qu’elle doit être plus
petite que l’artere pulmonaire. ( H. D . G. )
C ircula t ion de la mere au foetus. C ’eft une des
queftions les plus difficiles de la phyfiologie : il eft
vrai qu’en gros cette circulation eft démontrée: le
foetus qui va naître eft à celui qui vient d’être conçu
comme dix livres à une très-r-petite partie d’un grain :
tout ce que le foetus pefe de plus, il l’p reçu de fa
mere, 8c n’a pu le recevoir que d’elle. ' ”
Mais la difficulté eft de connoître les routes par
lefquelles cette nourriture parvient de l’utérus au
foetus : comme le placenta 8c le chorion touchent
feuls l’utérus, c’eft par l’une de ces parties, ou par
l’une 8c l’autre, que l’afiment doit venir de la mere au
foetus.
La matière fluideinje&ée dans l’utérus, paffe certainement
dans le placenta ; elle a paffé, qùoique rarement,
jufques dans le foetus : les arteres de l’utérus
8c de fa membrane intérieure, attachée au placenta,
s’ouvrent dans cettè partie de l’arriere-faix; elles nagent
dans le fang ; des veines du placenta y pomment
ce fang épanché ; d’autres veines qui appartiennent à
l’utérus, y reprennent une partie du fang des cellules.
Il y a deux circulations dans l’uterus 8c deux dans
le placenta : les arteres de l’utérus communiquent
avec fes veines, mais d’autres dé ces arteres communiquent
avec le placenta, en dépofant leur fang
dans fes cellules,' 8c d’autres veines de l’utérus repompent
une partie du fang de ces mêmes cellules.
Dans le placenta, les branches des arteres ombilicales
communiquent avec les veines du même nom,
8c des veines du placenta repompent le fang de la
mere, que les arteres de l’utérus ont dépofé dans les
cellules du placenta":
Il y a tout lieufde croire, malgré les objeftions
de quelques modernes, que cette circulation dè la
mere au foetus , 8c du foetus à la mere , fait
paffer de l’un des deux à l’autre , du véritable
fang.
Non-feulement le fang coule en abondance, quand
le foetus 8c le placenta fe détachent de l’utérus ; mais
on a v u , 8c plufieurs fois , le foetus perdre tout fon
fang par les hémorrhagies de la mere, & la mère
perdre le fien, quand le placenta eft refté dans l’utérus
, 8c qu’on a négligé de lier le cordon. Ilne paroît
pas qu’on puiffe expliquer autrement la vie des foetus
affez nombreux , qui ont crû 8c qui font parvenus à
leur maturité, fans avoir de coeur : cet accroiffement.
fuppofe un moteur que l’on ne peut trouver què dans
la mere.
Un autre chemin par lequel le fang de la mere
communique avec le foetus, c’eft le chorion: la membrane
interne de l’utérus, remplie de vaiffeaux rouges
, s’unit au chorion, 8c fes vaiffeaux communiquent
avec ceux du chorion. {H, D . G.')
$ CIRE,
§ CIRE , ( Hijloire naturelle. ) De quelque poids
que doive être, en fait d’hiftoire naturelle, l’autorité
de M. de Reaumur , tout ce qu’il a dit fur l’origine
de la cire eft regardé comme erroné par divers auteurs,
qui oppofent aux obfervations alléguées par
M. de Reaumur des difficultés 8c des obfervations
contraires. D’abord on a peine à concevoir comment
la cire q u i, félon lui, fe façonne dans le fécond efto-
mac, peut en reffortir fans entraîner avec elle ce
quife trouveroit de miel dans le premier eftomac,
& fans s’altérer 8c fe jaunir par ce mélange. L’objection
qu’on tire de ce que la cite donne à l’analyfe
des principes plus analogues à ceux des matières animales
, qu’à ceux qui compofent les matières végétales
, nous paroît très-foible : mais voici des faits
qu’on donne pour avoir été vérifiés par plufieurs
obfervations. M. Homboftel paffe pour les avoir annoncés
le premier dans la Bibliothèque de Hambourg ;
8c plufieurs amateurs d’abeilles en Allemagne , ont
dit les avoir vérifiés par leurs obfervations. Selon
eux, la cire eft une matière animale qui fort du corps
des abeilles par une fécrétion analogue à celle de la
tranfpiration, ou plutôt à celle de la cir&des oreilles
des grands animaux : les écailles du ventre fe couvrent
dans le tems du grand travail, 8c dans ceux oli
des abeilles ont une nourriture abondante , d’une
couche mince de cire qui en tranfude , 8c qui forme
ainfi fous le ventre fix lames blanches 8c très-minces,
que les abeilles enlevent avec beaucoup de célérité.
Voye{ fur cela le? Mémoires de la fociétè de Luface en
allemand , 8c Schirach, Sachfifcher Bienenvatter,
& c . (D /)
C ire , ( Comm. Manuf Arts & métiers. ) Dans les
fabriques des ciriers on appelle cire brute, la cire
jaune, telle que la font les abeilles, qui eft formée
de cire blanche, 8c d’une fubftance colorante , laquelle
donnant à la cire plus d’onftuofité, eft regardée
des naturaliftes comme une huile graffe , moins
fixe que la cire à certains égards. C ’eft cette même
cire que l’on nomme foivvent cire vierge. Entre les gâteaux
nouvellement faits, il y en a de très-blancs ,
8c d’autres d’un jaune clair 8c ambré, 8c cela dans
une même ruche 8c dans la même faifon. Tous jau-
niffent avec le tems ; 8c ceux qui font placés au haut
de la ruche, deviennent d’un brun noirâtre ; c’eft ce
qu’on appelle cire maurine ou maurefque. Mais ces
cires de différentes couleurs peuvent, pour l’ordinaire
, devenir également blanches en demeurant ex-
pofées à l’air avec certaines précautions. Lors de la
récolte du miel, on les pétrit donc toutes enfemble.
Il y a néanmoins certaines cires qui ne blanchiffent
jamais parfaitement ; ce que l’on croit pouvoir attribuer
à la qualité des pouffieres des étamines que les
abeilles ont travaillées : telle eft fur-tout la cire que
de petites abeilles fauvages des Antilles de l’Amérique
font dans des creux d’arbres, qui eft très-noire,
8c que l’on n’a pas encore fu blanchir : telle eft fou-
vent encore la cire des pays où il y a beaucoup de
vignes.
Une ruche bien remplie de rayons , mais dont
•l’effaim, quoique beau , n’a qu’un an, peut donner
•feize ou dix-huit onces de cire. Si on ne fait cette récolte
qu’au bout de deux ou trois ans , le nombre
des rayons demeurant toujours le même, on ne
laiffe pas d’en retirer deux livres, oü même un peu
•plus, vraifemblablement parce que la partie jaune
eft devenue plus abondante. Au refte , ori ne doit
compter pour le produit moyen, que fur douze onces
de cire par ruche.
La couleur brune ou noirâtre que les anciens
rayons acquiérent dans nos ruches par le féjour du
miel 8c du couvain dans les alvéoles ,• fe diflïpant aisément,
elle ne doit faire aucune diminution fur le
prix de la cire ; mais il n’en eft pas de même de celles
Tome ƒƒ,
dont le jaune eft adhérent à caufe de la qualité des
plantes qui l ’ont fourni aux abeilles.,
•1 EnJ enéral >on e^*me la cire qui vient des pays oîi
il croît du farrafin , ou de ceux qui font remplis de
landes garnies de genêts, bruyères, génévriers ,
G'c. 8c on n eftime pas les cires recueillies dans les
pays des grands vignobles.
Le plus fur eft de conftater par des épreuves fàci*
les à exécuter , la difpofition que les cires ont à blanchir
, 8c celles qui peuvent acquérir le plus beau
blanc. Une de ces épreuves confifte à racler des
pains de cire, jaune avec un couteau pour en détacher
des feuillets très-minces, qu’enfuite on expofe à l ’air
en forme de petits flocons : les perfonnes expérimentées
jugent bien-tôt par le changement de couleur
, quelle peut être la qualité de ces cires.
La cire s attendrit à la chaleur, jufqu’à fe fondre ;
& au contraire, elle fe durcit au froid, 8c devient
prefque friable. En brûlant, elle fournit une flamme
claire , fans prefque donner de fumée, & fans répandre
de mauvaife odeur , fi on ne l’a pas alliée de
graiffe.
En plufieurs endroits, on appelle marc de mouches,
ce qui refte dans les facs après qu’on en a exprimé la
cire par la preffe. Les chirurgiens fe fervent de ce
marc dans les maladies des nerfs. Les maréchaux
l’emploient aufli pour les chevaux.
Les chirurgiens fe fervent encore dans les mêmes
maladies, du propolis ou cite rouge, qui eft une efpe-
ce de maftic dont fe fervent les abeilles pour boucher
les fentes 8c trous de leurs ruches.
Purification de la cire. i° . Onia démielle , foit en
faifant tremper pendant quelques jours dans de l’eau
claire la pâte qui n’a pas été épuifée de miel à la
preffe ; foit en la brifant en petits morceaux ', 8c-
l’étendant fur des draps près des ruches, afin que les
abeilles,fuçant tout le miel qui étoit refté, réduifent
toute la cire en parcelles aufli fines que du fon. Ceux
qui s’en tiennent à cette leconde pratique, difent
que la cire qui a trempé dans l’eau demeure toujours
plus graffe que l’àutre. Peut-être qu’effe&ivement
l ’eau la prive de cette fubftance fucrée 8c mieilleufe
què l’efprit de vin fépare même d’un rayon récemment
formé par les abeilles, 8c dans lequel il n’y a
pas encore de miel ; car on remarque que la privation
de cette partie étrangère, rend la cire plus commode
à manier.
20. Ayant empli d’eau jufqu’au tiers une chaudière
de cuivre, on attend que cette eau foit près de
bouillir , pour y jetter peu-à-peu autant de pâte de
cire qu’il en fau t , pour que la chaudière ne fe trouve
pleine que jufqu’aux deux tiers. Oh y entretient un
feu modéré; on remue avec une fpatule de bois ,
afin que la cire ne s’attache pas aux bords.de la chaudière
oîi elle pourroit brûler , & l’eau bouillante la
fait fondre. Quand elle eft entièrement fondue, on
la verfe avec l’eau dans des facs de toile forte 8c claire
, que l’on met aufli-tô.t en preffe pour exprimer
la cire , qui eft reçue dans de nou velle eau chaude
afin que la craffe fe précipite. Cette première fonte
ne fuffit pas toujours pour fournir toute la cire que
la pâte doit rendre : on recommence alors le procé-
. dé fur le marc, après l’avoir laiffé quelques jours
achever de fe démieller dans l’eau ; caron a éprouvé
que ce lavage fait que l’on obtient plus de cire; mais
fi cette dernière fe trouve plus graffe que l ’autre, il
convient de les tenir féparées. Voye%_ la planche de la
purification de la cire dans ce Supplément.
Dans les différentes fufions que l’on donne à la
cire , on eft ’très-attentif à ne lui laiffer prendre que
le dégré de cuiffon convenable, au-delà duquel elle
devient trop feche , caffante , & contraûe une
couleur brune que le foleil & la rofée n’effacent
point : c’eft pourquoi les fabricajis préfèrent la cire