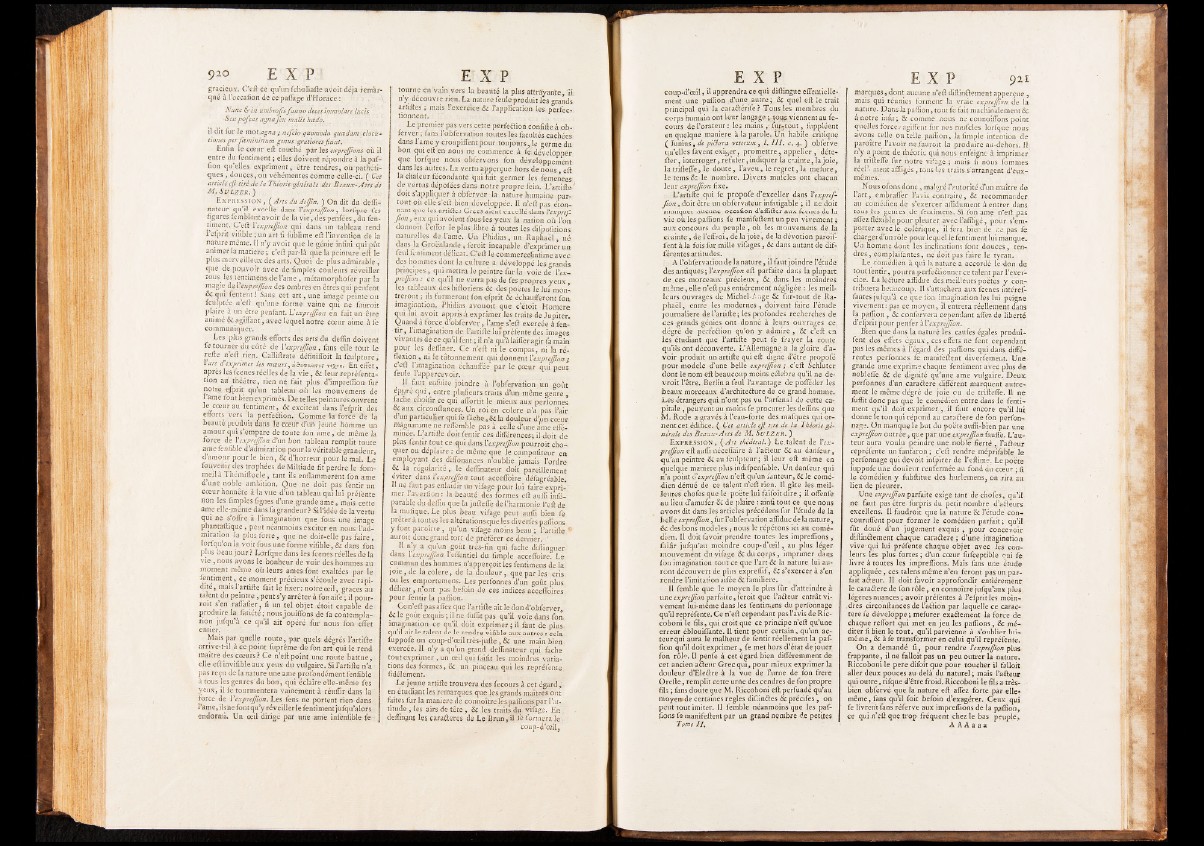
gracieux. C’eft ce qu’un fcholiafte :avoit déjà remarqué
à l’occafion de ce paffage d’Horâce :
Nune & in ùmbrofis fauno decet immolàre lùeis
■ Seu pofeat agna feu nïalit hcedo.
il dit fur le motagna ; nef cio ,quomodo quoedam elocii-
t ion es per feemitunutn genus gratiores finit.
Enfin le coeur eft touché par les expreffons oii il
entre du fentiment ; elles doivent répondre à lapaf-
fion qu’elles, expriment j être tendres, ou pathétiques
, douces, ou véhémentes comme celle-ci. ( Cet
article çfi tiré de la Théorie générale .des Beaux- Ans de
M. SULZER. )
E x p r e s s i o n , ( Arts du deffn. ) On dit du deffi-
nateur qu’il excelle dans Yexpreffon, lorfque fes
figures femblent avoir, de la v ie , des penfées, du fentiment,^
Ç eft. Y expreffonqui dans un tableau rend
l’efprit vifible ; un art fi fublime eft l’invention de la
nature même. II n’y avoit que le génie infini qui put
animer la matière ; c’eft par-là que la peinture eft le
plus merveilleux des arts. Quoi de plus admirable-,
que de pouvoir avec de fimples couleurs réveiller
tous les 'fentimens de l’ame , métamorphofer par la
magie de Yexpreffon des ombres en êtrès qui penfent
& qui-fentent ! Sans cet art , une image peinte ou
jculptée n’eft qu’une forme vaine qui ne faliroit
plaire à un être penfant. L’expreffon en fait un être
animé & agiflant, avec lequel notre coeur aime à fe
communiquer. ,
Les plus grands efforts des arts du deflin doivent
fe tournerdu côté de l'expreffon , fans elle tout le
refte n’eft rien. Cailiftrate définiffoit la fculpture,
la/? dexprimer les moeurs, hôowo/'htoc En effet,
après les feenes réelles de la v ie , 6c leur repréfenta-
tion au théâtre, rien ne fait plus d’impreffion fur
notrg. efprit qu’un tableau. où les mouvemens de
I amè font bien exprimés. De telles peinturés.ouvrent
Je coeur au fentiment, & excitent dans l’efprit des
efforts vers la perfection. Comme la force de la
beaute produit dans le coeur d’un jeune homme un
amour qui s’empare de toute fon ame, de même la
force de YexpreJJion d’un bon tableau remplit toute
ame fenfible d’admiration pour la véritable grandeur
d’amour pour le bien, 6c d’horreur pour le mal. Le
fouvertir des trophées de Miltiade fit perdre le fom-
meil a Thémiftocle, tant ils enflammèrent fon ame.
d une noble ambition. Que ne doit pas fentir un
coeur honnete à la vue d’un tableau qui lui préfente
non les fimplesfignesd’une grande.ame, niais cette
ame elle-meme dans fa grandeur? Si l’idée de la vertu
qui ne s offre a 1 imagination que fous une image
phantaftique, peut néanmoins exciter en nous l’admiration
la plus, forte, que ne doit-elle pas faire,
lorfqu’on la voit fous une forme vifible, 6c dans fon
plus beau jour ? Lcfrfque dans les feenes réelles de la ;
vie , nous ayons le bonheur de voir des hommes au
moment même, où leurs' âmes font exaltées par le
fentiment, ce moment précieux s’écoule avec rapidité
^ mais l’artifte fait le fixer: notre oeil, grâces au
talent du peintre, peut s’y arrêter à fon aife ; il pour-
roit s’en raffafier , fi un tel objet , étoit capable de
produire la fatiété; nousjouiffons de fa contempla^
tion jufqu’a ce qu’il ait opéré, fur nous fon effet
entier.
Mais par quelle route, par quels dégrés l ’artifte
arrive-t-il à ce point fuprême de fon art qui le rend
maître des coeurs? Ce n’eft point une route battue,
elle eftinvifible aux yeux du vulgaire. Si l’artifte n’a
pas reçu de la nature une ame profondément fenfible
à tous les genres du bon, qui éclaire elle-même fes ; J
yeux, il fe tourmentera vainement à réuffir dans la
force de Yexpreffon. Les fens ne portent rien dans
l’ame, ils ne font qu’y réveiller le fentiment jufqu’alors
endormi. Un oeil dirigé par une amè infenfible fe
tourne én’vain vers la beaiité la plus attrayante, il:
n’y découvre rien. La nature feule produit les grands
artiftes ; mais l’exercice 6c l’application les perfectionnent.
Le premier pas; vers cette perfeftion confifte à observer;
fah& l’obfervation toutes les facultés cachées
dans l’ame y c'roupiffent pour toujours,.le germe du
bon qui eft en nous ne* eoiïimèpce à fe développer
que lorfque nous obiervons fon développement
dans les autres. La vertu apperçue hors de nous, eft
la chaleur, fécondante qui fait germer les femences
de vertus dépoféès dans, notre propre fein. L artifte/
doit s’appliquer à obfe.r.ver :1a nature humaine partout
où-elles’eft bien-développée. 11 n’eft pas étonnant
que les^artiftes Grecs aient excellé dans Yexpref-
fion , eux qui avoient fous/les yeux la nation où l’on
donnoit l’effor le plus'libre à toutes les difpofitions
naturelles de l’ame. Un Phidias, un Raphaël, né
dans la Groënlande ; feroit incapable d’exprimer un
feul fentiment délicat. C’ eft le commercelintime avec
des hommes dont la culture a développé les.grands
principes, qui mettra le peintre fur la voie de Yex-
preffon : ce qu’il ne verra pas de fes propres yeux ,
les tableaux des hiftoriens & des poètes le lui mon**
treront ; ils formeront fon efprit & échaufferont fon
imagination. Phidias avouoit que c’étoit Homere
qui lui avoit appris à exprimer les traits-de Jupiter.
Quand a force d’obferVer, l’ame s’eft exercée à fentir
, l’imagination de l’artifte lu*préfente des images
vivantes de ce qu’il fent ;.il n’a qu’à laiffer agir fa main
pour les defîiner. Ce n’eft ni le compas, ni la réflexion
, ni le tâtonnement qui donnent l'expreffon;
c’eft l’imagination échauffée par le coeur qui peut
feule l’appercevoir.
' ^ fatit enfuite joindre à l’obfervation un goût
epjyré q ui, entre.plufieurs traits d’ùn même genre ,
fâche .çhçûfir.ce qui affortit le mieux aux perfonnes
6c aux circonftances. Un roi en colere n’a pas l’air
d un particulier quife fâche,& la douleur d’un coeur
magnanime ne reffemble pas à celle d’une ame efféminée.
L’artifte doit fentir ces différences; il doit de
plus fentir tout ce qui dans Y expreffon pourroit choquer
ou déplaire : de même que le compofiteur en
employant des diffonances n’oublie jamais l’ordre
& la régularité, le deflinateur doit pareillement
éviter dans Yexpreffon tout acceffoire défagréable.
II ne faut pas enlaidir un vifage pour lui faire exprimer
l’averfion: la beauté des formes eft auffi infé-
parable du deflin que la jufteffe de l’harmonie l’eft de
la mufique. Le plus beau vifage peut auffi bien fe
prêter à toutes les altérations que les diverfes pallions
y font paroître , qu’un vifage moins beau ; l’artifte c
auroit donc grand tort de préférer ce dernier. '
II n’y a qu’un goût très-fin qui fâche diftinguer
dans Yexpreffon l’effentiel du fimple acceffoire. Le
commun des hommes n’apperçoit les fentimens de la
jo ie , de la colere, de la douleur, que par les cris,
ou les emportemens. Les perfonnes d’un goût plus
délicat, n’ont pas befoin de ces indices acceffoires.
pour fentir la paffion.
Çe n’eft pas affez que l’artifte ait le dond’obferver,
6c le goût exquis ; il ne fuffitpas qu’il voie dans fon.
imagination ce qu’il doit exprimer ; il faut de plus•
qu’il ait le talent de le rendre vifible aux autres : cela
fuppofe un coup-d’oeil très-jufte , & une main bien
exercée. Il n’y a qu’un grand deflinateur qui fâche
tout exprimer , un oeil qui faifit les moindres variations
des formes, 6c un pinceau qui les repréfente
fidèlement.
Le jeune artifte trouvera des fecours à cet égard |
en étudiant les remarques que les grands maîtres ont
faites fur la maniéré de .connoître les paflions par l ’attitude
, les airs de tête , 6c les traits du vifage. En
deffingnt les caraéteres de Le Brun, il fé formera le
coup-d’oeil,
coup-d’oeil, il apprendra ce qui diftingue effentielle-
inent une paffion d’une autre ; 6c quel eft le trait
principal qui la, caraôérife ? Tous les membres du
corps humain ont leur langage ;->toijs viennent au fecours
de l’orateur: les mains fupjtout, fuppîéent
en quelque maniéré à la parole. Un habile critique
( Junius, de piclura veùrum, l, I I I . c. 4. ) obferve
qu’elles favent exiger, promettre, appeller , déte-
fter, interroger, refufer, indiquer la crainte, la joie,
la trifteffe, le doute, l’aveu, le regret, la mefure,
le tems&: le nombre. Divers mufcles ont chacun
leur expreffon fixe.
L’artifte.qui; fe propofe d’exceller dans Yexpref-
Jion, doit être un obfervateur infatigable ; il ne doit
manquer aucune occafion d’affifter aux feenés ,de la,
vie où,-le.s paflions fe manifeftent un peu vivement ;:
aux concours du peuple , où les- mouvemens dé la
cr-amte > de l’effroi., de la joie, de la dévotion paroif-
fent à la fois fur. mille vifages, 6c dans autant de différentes
attitudes.
A l’obfervationde la nature, il faut joindre l’étude'
des antiques ; Yexpreffon eft parfaite dans la plupart
de.ces morceaux précieux, 6c dans les moindres
même, elle n’eft pas entièrement négligée ; les meilleurs
ouvrages de Michel Ange 6c fur-tout de Raphaël',.
entre les modernes , doivent faire l’étude
journalière de l’artifte; les profondes recherches de
ces grands génies, ont donné ,à .leurs ouvrages ce:
dégré de perfeélion qu’on y admire , 6c c’eft en
les étudiant que l’artifte peut fe frayer la route
qu’ils ont découverte. L’Allemagne a .la gloire d’avoir
produit un àrtifte qui eft digne d’être propofé
pour modèle d’une belle expreffon ; ...c’eft Schluter
dont le nom è'ft beaucoup moins célébré qu’il ne de-
-vroit l’être. .Berlin a feul l’avantage de pofféder les
beaux morceaux d’architeélure de cé grand homme.
Les étrangers qui n’ont pas vu l’arfenal de cette car
pitale , peuvent au moins fë procurer les deffins que
M. Rode a gravés à l’eau-forte des mafques qui ornent
cet édifice. (. Çetarùcle_ef.tiré de la Théorie générale
des Beaux-Arts de M. S u l z e r . )
Expression, (Art théâtral.') Le.talent de l’e^r-
preffon eft auffi riéceffaire à l’aéieur & au darifeur,
qu’au peintre & au.fculpteur ; il leur eft même en
quelque maniéré plus indifpenfable. Un danfeur qui
n’a point (Yexpreffon ri eft qu’un fauteur, 6c le comédien
dénué de ce talent n’ eft rien. Il gâte les meilleures
chofes que lé poete lui faifoit dire ; il offenfe
au lieu d-’amufer 6c de plaire : ainû tout ce que nous
avons dit dans les articles précédens fur l’étude de la
belle expreffon, fur l’obfervation affidue de la nature,
6c des bons modèles / nous le répétons ici au comédien.
Il doit favoir prendre toutes les, impreffions ,
faifir jufqu’au moindre coup-d’oe il, au plus léger
mouvement du vifage 6c du corps, imprimer dans
fon imagination tout ce que l’art & la nature lui auront
découvert de plus expreffif, & s’exercer à s’en
fendre l’imitation aifée 6c familière.
Il femble que le moyen le plus fûr d’atteindre à
une expreffon parfaite, feroit que l’afteur entrât vivement
ïui-même dans les fentimens du perfonnage
qu’il repréfente. Ce n’eft cependant pas l’avis de Ric-
coboni le fils, qui croit que ce principe n’eft qu’une
erreur éblouiffante. Il tient pour certain, qu’un acteur
qui aura le malheur de fentir réellement la paffion
qu’il doit exprimer, fe met hors d’état de jouer
fon rôle. Il penfe à cet égard bien différemment de
cet ancien afteur Grec qui, pour mieux exprimer la
douleur d’Eleélre à la vue de l’urne de ion frere
Orefte, remplit cette urne des cendres de fon propre
fils ; fans doute que M. Riccoboni eft.perfuadé qu’au
moyentde certaines réglés difiinftes 6c précifes , on
peut tout imiter. 11 femble néanmoins que les paf-
fions fa manifeftent par un grand nombre de petites
Tome II.
marques, dont aucune,n’eft diftinftement.apperçue ,
mais qui réunies formenr la vraie expreffon. de la
nature. Dans la paffion , tout fe fait machinalement 6c
à notre infu ; & comme , nous ne connoiffons point
quelles forcer agiflènt fur nos mufcles lorfque nous
avons telle, ou telle paffion, iafimple intention de
paroître l’avoir ne/aurq,it la produire au-dehors. Il
n y a point de théorie qui nous enfeigne à imprimer
la trifteffe fur..notre vifage; mais fi nous fommes
. réell ment affligés, tous Içs traits.s'arrangent d’eux-
; mêmes.
Nous ofons donc, malgré l’autorité d’un maître de
? l’art, embrafler Pavis contraire, 6c recommander
au comédien de s’exercer aflidument à entrer dans
tous les genres de fentimens. Si.,fon ame n’eft pas
j affez flexible,po,ur pleurer, avec l’affligé, pour s’em-
: porter avec le colérique, il fera bien de ne pas fe
- charger d’un rôle pour lequel le fentiment lui manque,
i Un homme dont les inclinations font douces, ten-
| dres, coniplaifantes, ne doit pas faire le tyran.
Le comédien à qui la nature a accordé le .don de
tout fentir., pourra.perfe&ionner ce talent par l’exer-
: cice. La lefture affidue des.meilleurs poètes y .contribuera
beaucoup. Il s’attachera aux feenes intéref-
.fautes jufqu’à ce que fon imagination les lui peigne
vivement: par, ce moyen, il entrera réellement dans
la paffion , 6c confervera cependant affez de liberté
d’efprit pour penfer à Yexprèjfon.
. Bien que dans la naturé les. caufes égales produi-
fent de-s effets égaux,, cçs effets ne font cependant
pas les mêmes à l’égard des paflions qui dans, différentes
perfonnes fe manifeftent diverfement. Une-
grande ame exprime chaque fentiment avec plus de
nobleffe 6c de dignité qu’une ame vulgaire. Deux
perfonnes d’un caraélere différent marquent autrement
le même dégré de joie, eu de trifteffe. Il ne
fuflit donc pas que le comédien entre dans le fentiment
qu’il doit exprimer;, il faut encore qu’il lui
donne le ton qui répond au caractère de fon perfonnage.
On manque le but du poete auffi-bien par une
expreffon outrée, que par une expreffon fauffe. L’auteur
aura voulu peindre une.noble fierté , l’aéteur
repréfente un fanfaron ; c’ eft rendre méprifable le
perfonnage qui devoit infpit;er de l’eftime. Le poète
fuppofe une douleur renfermée au fond du coeur ; fi
le comédien y fubftitue des hurlemens, pn rira au
lieu de pleurer.
. Une expreffon parfait e exige tant de chofes, qu’il
ne faut pas être furpris du petit nombre d’aêteurs
excellens. Il faudroit que la nature 6c l’étude con-
eouruffent pour former le comédien parfait ; qu’il
fût doué d’un jugement exquis , pour concevoir
diftinâement chaque cara&ere ; d’une imagination
vive-qui lui préfente chaque objet avec les couleurs
lès plus fortes; d’un coeur fufceptible oui fe
• livre à toutes les impreffions. Mais fans une étude
appliquée, ces talens même n’en feront pas un parfait
afteur. Il doit favoir approfondir entièrement
le caraâere de fon rôle, en connoître jufqu’aux plus
légères nuances ; avoir préfentes à l’efprit les moin-
. dres circonftances de l’aûion par laquelle ce caractère
le développe; mefurer exactement la force de
chaque reffort qui met en jeu les paflions, & méditer
fi bien le tout, qu’il parvienne à s’oublier lui-
même, & à fe transformer en celui qu’il repréfente.
On a demandé f i , pour rendre Yexpreffon plus
frappante, il ne falloit pas un peu outrer la nature.
Riccoboni le per e difoit que pour toucher il falloit
aller deux pouces au delà du naturel; mais l’aâeur
qui outre, rifque d’être froid. Riccoboni le fils a très-
bien obfervé que la nature eft affez forte par eilet
même, fans qu’il foit befoin d’exagérer. Ceux qui
fe livrent fans réferve aux impreffions de la paffion,
ce qui n’eft que trop fréquent chez le bas peuple,
A A A a a a
fe ; 'i|i
l i