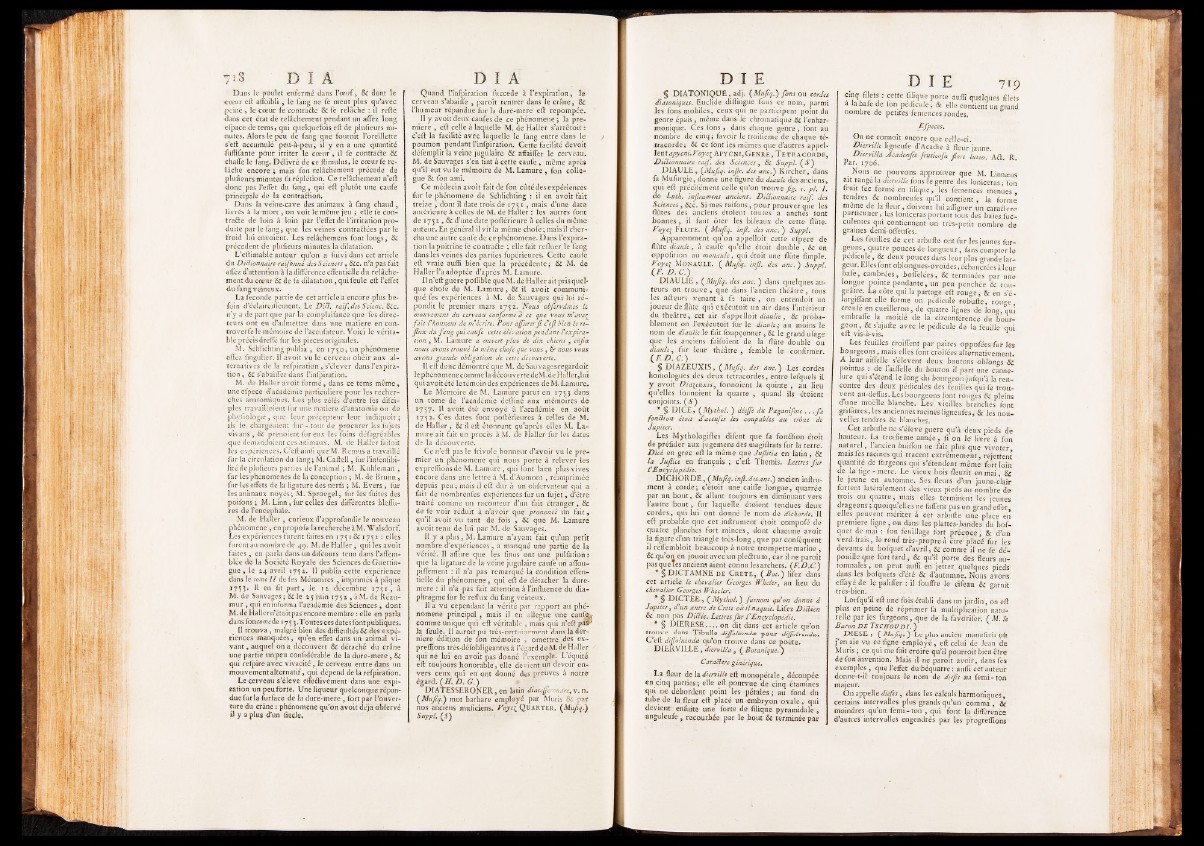
Dans le poulet enfermé dans l’oe uf, & dont le
coeur eft affoibli , le fang ne fe meut plus qu’avec
peine, le coeur fe contraâe & f e relâche : il refte
flans cet état de relâchement pendant un affez long
efpace de tems, qui quelquefois eft de plufieurs minutes.
Alors le peu de fang que fournit l’oreillette
A’eft accumulé peu-à-peu, il y en a une quantité
foffifante pour irriter le coe u r, il fe contrarie &
chafle le fang. D élivré de ce ftimulus, le coeur fe relâche
encore ; mais fon relâchement précédé de
plufieurs minutes fa réplétion. Çe relâchement n’eft
donc pas l’effet du fang, qui eft plutôt une caufe
principale de la contraction.
Dans la veine-cave des animaux à fang chaud ,
livrés à la mort, on voit le même jeu ; elle fe contracte
de loin à loin par l’effet de l’irritation produite
par le fang, que les veines contractées par le
froid lui envoient. Les relâchemens font longs, &
précèdent de plufieurs minutes la dilatation.
L’eftimable auteur qu’on a fuivi dans cet article
du Dictionnaire raifonné des Sciences, &c. n’a pas fait ,
allez d’attention à la différence effentielle du relâchement
du coeur & de fa dilatation, qui feule eft l’effet
du fang veineux.
La fécondé partie de cet article a encore plus be-
foin d’éclairciffemenf. Le Dicl. raif. des Scienc. &c.
n’v a de part que par la- complaifance que fes directeurs
ont eu d’admettre dans une matière en con-
troverfe le mémoire de l’accufateur. Voici le véritable
précis dreffé fur les pièces originales.
M. Schlichting publia , en 1750, un phénomène
affez fingulier. Il avoit vu le cerveau obéir aux alternatives
de la refpiration, s’élever dans l’expiration
, & s’àbaiffer dans l’infpiration.
M. de Haller avoit formé, dans ce tems, même,
uneefpece d’académie particulière pour les recherches
anatomiques. Les plus zélés d’entre fes difci-
ples travailloient fur une matière d’anatomie ou de
phyfiologie , que leur précepteur leur indiquoit ;
ils fe chargeoient fur - toiit de procurer les fujets
vivans , & prenoient fur eux les foins défagréables
que demandoient ces animaux. M. de Haller faifoit
les expériences. C’eft ainfi que M. Remus a travaillé
fur la circulation du fang; M. Caftell, furl’infenfibi-
litéde plufieurs parties de l’animal ; M. Kuhleman ,
fur les phénomènes de la conception ; M. de Brunn,
fur les effets de la ligature des nerfs ; M. Evers , fur
les animaux noyés; M. Sproegel, fur les fuites des
poifons ; M. Linn, fur celles des différentes bleffu-
res de l’encephale.
M. de Haller , curieux d’approfondir le nouveau
phénomène , en propofa la recherche à M.'W’alsdorf.
Les expériences furent faites en 1 7 5 1& 1 7 5 2 : elles
furdnt au nombre de 49. M. de Haller, qui les avoit
faites , en parla dans un difcours tenu dans l’affem-
blée de la Société Royale des Sciences deGoettin-
g u e , le 24 avril 1752. Il publia cette expérience
dans le tome I I de fes Mémoires , imprimés à pâque
1753. U en fit part, le 12 décembre 1 7 5 1 , à
M. de Sauvages; & le 25 juin 1752 , àM. de Réau-
mur , qui en informa l’académie des Sciences , dont
M. de Hallern’étoitpas encore membre : elle en parla
dans fon torne de 17 5 3 .Toutes ces dates font publiques.
Il trouva, malgré bien des difficultés & des expériences
manquées, qu’en effet dans un animal vivant
, auquel on a découvert & détaché du crâne
une partie un peu confidérable de la dure-mere, &
qui refpire avec vivacité, Je cerveau entre dans un
mouvement alternatif, qui dépend de la refpiration.
Le cerveau s’élève effeâivement dans une expiration
un peu forte. Une liqueur quelconque répandue
fur la furface de la dure-mere , fort par l ’ouvert
ture du crâne : phénomène qu’on avoit déjà obïervé
il y a plus d’un fiede.
Quand l’infpiration fuccede à l’expiration, le
cerveau s’abaiffe , paroît rentrer dans le crâne, &
l’humeur répandue fur la dure-mere eft repompée.
Il y avoit deux caufes de ce phénomène ; la première
, eft celle à laquelle M. de Haller s’arrêtoit î
c’eft la facilité avec laquelle le fang entre dans le /
poumon pendant l’infpiràtion. Cette facilité devoit
défemplir la veine jugulaire & affaiffer le cerveau.
M. de Sauvages s’en tint à cette caufe, même après
qu’il eut vu le mémoire de M. Lamure, fon collègue
'& fon ami.
Ce médecin avoit fait de fon côté des expériences
fur le phénomène de Schlichting : il en avoit fait
treize dont il date trois de 1751 , mais d’une date
antérieure à celles de M. de Haller : les autres font
de 1752, & d’une date poftérieure à celles du même
auteur. En général il vit la même chofe;maisil chercha
une autre caufe de ce phénomène. Dans l’expiration
la poitrine fe contrafte ; elle fait refluer,le fang
dans les veines des parties fupérieures. Cette caufe
eft vraie auffi bien que la précédente; & M. de
Haller l’a adoptée d’après M. Lamure.
Il n’eft guere poffible que M. de Haller ait pris quelque
chofe de M. Lamure, & il avoit communiqué
fes expériences à M. dq Sauvages qui lui répondit
le premier mars 1751. 'flous obfervdmes le
mouvement du cerveau conforme a ce que vous m’ave^
fait Vhonneur de m écrire. Pour affurer Ji cefl bien le reflux
du fang qui caufe cette élévation pendant Ûexpiration
, M. Lamure a ouvert plus de dix chiens , enfin
nous avons trouvé la même chofe que vous, 6* nous vous
avons grande obligation de cette découverte.
Il eft donc démontré que M. de Sauvages regardoit
le phénomène comme la découverte deM.de Haller,lui
qui avoit été letémoin des expériences de M. Lamure.
Le Mémoire de M. Lamure parut en 1753 dans
un tome de l’académie deftiné aux mémoires de
1757. Il avoit été envoyé à l’académie en août
1752. Ces dates font poftérieures à celles de M.
de Haller , & il eft étonnant qu’après elles M. Lamure
ait fait un procès à M. de Haller fur les dates
de la découverte.
Ce n’eft pas le frivole honneur d’avoir vu le premier
un phénomène qui nous porte à relever les
expreffions.de M. Lamure, qui font bien plus vives
encore dans yne lettre à d’Aumont, réimprimée
depuis peu; mais il eft dur à un obfervateur qui a
fait de nombreufes expériences fur un fujet, d’être
traité comme un raconteur d’un fait é t r a n g e r&
de fe voir réduit à n’avoir que prononcé lin fa it ,
qu’il avoit vu tant de fois , & que M. Lamure
avoit tenu de lui par M. de Sauvages.
Il y a plus, M. Lamure n’ayant fait qu’un petit
nombre d’expériences, a manqué une partie de la
vérité. II affure que les finus ont une pulfation :
que la ligature de la veine jugulaire caufe un affou-
piffement : il n’a pas remarqué la condition effentielle
du phénomène, qui eft de détacher la dure-
mere : il n’a pas fait attention à l’influence du diaphragme
fur le reflux du fang veineux.
Il a vu cependant.la vérité par rapport au phénomène
principal , mais il en allégué une caufes
comme unique qui eft véritable , mais qui n’eft pire*
la feule. Il auroit pu très-certainement dans la dernière.
édition de fon mémoire , omettre des ex-
preflïons très-défobligeantes à l’égard de M. de Haller /
qui n.e lui en avoit pas donné l’exemple. L’équité
eft toujours honorable, elle devient un devoir envers
ceux qui en ont donné des preuves à notre
égard. (H .D . G.)
DIATESSERONER, en latin diatefl'eronare, v. n.
( Muflq.) mot barbare employé par Mûris & par
nos anciens muficiens. Voye\ Q uarter. (Muflq.)
Suppl. (S)
§ DIATONIQUE, adj. ( Muflq. ) fons ou cordes
■ diatoniques. Euclide diftingue fous ce nom, parmi
les fons mobiles, ceux qui ne participent point du
genre épais ; même dans le chromatique & l’enharmonique.
Ces fons , dans chaque genre, font au
nombre de cinq ; favoir le troifieme de chaque té-
tracorde; & ce font les mêmes que d’autres appellent
apyçni. Voye\_ Ap y cn i ,G en re, T etr à cor d e ,
Dictionnaire raif. des Sciences, & Suppl. ( S )
DIAULE, (Muflq. infir. des anc.) Kircher, dans
fa Mufurgie, donne une figure du diaule des anciens,
qui eft précifément celle qu’on trouve fig. 1. pl. I.
de Luth, inflrumens anciens. Dictionnaire raif. des
Sciences, &c. Si mes raifons, pour prouver que les
flûtes des anciens étoient toutes à anches font
bonnes, il faut ôter les bifeaux de cette flûte.
yoye^ F LUTE. ( Muflq. inft. des anc. ) Suppl.
Apparemment qu’on appelloît cette efpece de
flûte diaule, à caufe qu’elle étoit double , & en
oppofition au monaule, qui étoit une flûte fimple.
Voye{ Mo naule. ( Mu/iq. inft. des anc.) Suppl.
( F .D .C .) J J ™
DIAUL1E , (Muflq. des anc. ) dans quelques auteurs
o.n trouve , que dans l’ancien théâtre, tous
les a/fteurs venant à fe taire , on entendoit un
joueur de flûte qui exécutait un air dans l’intérieur
(du théâtre, cet air s’appelloif diaulie, & probablement
on l'exécutait fur le diaule; au moins le
nom de diaulie le fait foupçonner, & le grand ufage
que les anciens faifoient de la flûte double ou
diaule, fur leur théâtre , femble le confirmer.
( F .D . C.)
§ DIAZEUXIS, ( Muflq. de? anc. ) Les cordes
homologues des deux tetracordes, entre lefquels il
y avoit Dia^euxis, fonnoient la quinte , au lieu
qu’elles fonnoient la quarte , quand ils étoient
conjoints. ( S )
* § DICÉ, (Mythol. ) déejfe du Paganifme . . . fa
fonction étoit aaccufer les coupables au trône de
Jupiter.
Les Mythologiftes difent que fa fonélion étoit
de préfider aux jugemens des magiftrats fur la terre.
Dicé en grec eft la même que Juflitia en latin, &
la Jufiice en françois ; c’eft Thémis. Lettres fur
C Encyclopédie.
DICHORDE, (Muflq. inft. des anc.) ancien infiniment
à corde; c’étoit une caiffe longue, quarrée
par un bout, & allant toujours en diminuant vers
l ’autre b o u t , fur laquelle étoient tendues deux !
cordes, qui lui ont donné le nom de dichorde. II
eft probable que cet inftrument étoit compofé de
quatre planches fort minces, dont chacune avoit
la figure d’un triangle très-long, que par conféquent
il reffembloit beaucoup à notre trompette marine ,
& qu’on en joitoit avec un pleélrum, car il ne paroît
pas que tes anciens aient connu les archets. (F.D.C.)
* §DICTAMNE de C r e t e , (B o t.) lifez dans j
cet article le chevalier Georges Wheler) au lieu du ]
chevalier Georges Whecler.
* § D IC T É E , (Mythol.) furnom qu'on donne à
Jupiter, d’un antre de Crete ou il naquit. Lifez Dicléen 1
& non pas Dictée. Lettres fur C Encyclopédie.
Rj § DIERE SE.... on dit dans cet article qu?on ■
trouve dans Tibulle diffolütndce pour diflblvendce. i
C ’eft diffoluenda qu’on trouve dans ce poète.
DIERVILLE, diervilla , ( Botanique. )
Caractère génériaue.
La fleur de la di.erville eft monopétale, découpée
en cinq parties ; elle eft pourvue de cinq étamines
qui ne débordent point les pétales ; au fond du
tube de la fleur eft placé un embryon ovale, qui
devient enfuite une. forte de fiiiquè pyramidale ,
anguleufe , recourbée par le bout & terminée par
cinq filets : cette filique porte auffi quelques filets
à la bafe de fon pédicule, & elle contient un grand
nombre de petites femences rondes.
Efpecès,
On ne connoit encore que celle-ci.
DicrvilU lignenle d’Acadie à fleur jaune.
Pm y ilh Acadmjisifruùcofa More -luteo. Aft. R.
Par. 1706.
Nous ne pouvons approuver que M. Linnæus
ait rangé la dierville {o\\s le genre des loniceras ; fon
fruit fe.c forme en filique, les femences menues ,
tendres & nombreufes qu’il contient, la forme
meme de la fleur, doivent lui affigner un caraélere
particulier, les loniceras portant tous des baies fuc-
culentes qui contiennent un très-petit nombre de
graines demi-oflèufes.
Les feuilles de cet arbufte ont fur les jeunes fur—
geons, quatre pouces de longueur, fans compter le
pédicule, & deux pouces dans leur plus grande largeur
. Elles font oblongues-ovoïdes, échancrées à leur
bafe, cambrées, boffelées, & terminées par une
longue pointe pendante, un peu penchée & rougeâtre.
La cote qui la partage eft rouge, & en s’é-
largiffant elle forme un pédicule robufte, rouge,
creufé en cueilleron, de quatre lignes de long, qui
embraffe la moitié de la circonférence du bourgeon,
& s’ajufte avec le pédicule de la feuille qui
Les feuilles croiffent par paires oppofées fur les
bourgeons, mais elles font croifées alternativement.
A leur aiffelle s’élèvent deux boutons ôblongs &
pointus : de I’aiffelle du bouton il part une cannelure
qui s’étend le long du bourgeon jufqn’à la ren-
I contre des deux pédicules des feuilles qui fe trouvent
au-deffus. Les bourgeons font rOuges Ôc pleins
d’une moelle blanche. Les ’ vieilles, branchés font
grifâtres,les anciennes racines ligneufes,1 & les nouvelles
tendres & blanches.' " f- y^-i e
Cet arbufte ne s’eleve guefe qu’à deux pieds de
hauteur. La troifieme. année , fi 00 le" livre à fon
naturel, 1 ancien buiflbn ne fait plus que vivoter
mais les racines qui tracent extrêmement, rejettent
quantité de forgeons qui s’étendent même fort loin
de la tige .-mere. Le vieux bois fleurit en m ai, &
le jeune en automne. Ses fleurs d’un jaune,-clair
fortent latéralement des vieux pieds au nombre de
trois' ©u quatre ; mais elles terminent :les jeunes
drageons'; quoiqu’elles ne faffent pas un grand effet
elles peuvent-mériter à eèr arbufte une place eh
première ligne , ou dans les plattes-bàndès du bof-
auet de mai : fon feuillage fort précoce; & d’un
verd-fràis , le rend très-propre à être' placé for. les
devants du bofquet d’avril, ôc comme il ne fe dé^
pouilfoque fort tard , & qu’il porte dès fleurs automnales
, on peut auffi en jetter, quelques pieds
dans les bofquets d’été & d’automne. Nous avonS
effayé de le paliffer : il fouffre le cifeau & garnît
très-bien.
Lorfqu’il eft une fois établi dans un jardin, on eft
plus, en peine de réprimer fa multiplication naturelle
par les furgeoris, que de la favdrifer. ( M. h
Baron DE Ts c h o ü d i . )
D IESE , (Muflq:') Le plus ancien manufcritoît
j’en aie vu ce ligne employé ; eft celui de Jean de
Mûris ; ce qui me fait croire qu’il poiirroit bièn être
de fon invention. Mais-il ne paroît avoir , dans fes
exemples , que l’effet du béquarre: auffi cetautéur
donne-t-il toujours le nom de diefls au femi-ton
majeur.
On appelle diefes, dans les calculs harmoniques ,
certains intervalles plus grands qu’un comma , &
moindres qu’un femi - ton , qui font la différence
d'autres intervalles engendrés par les progreffions