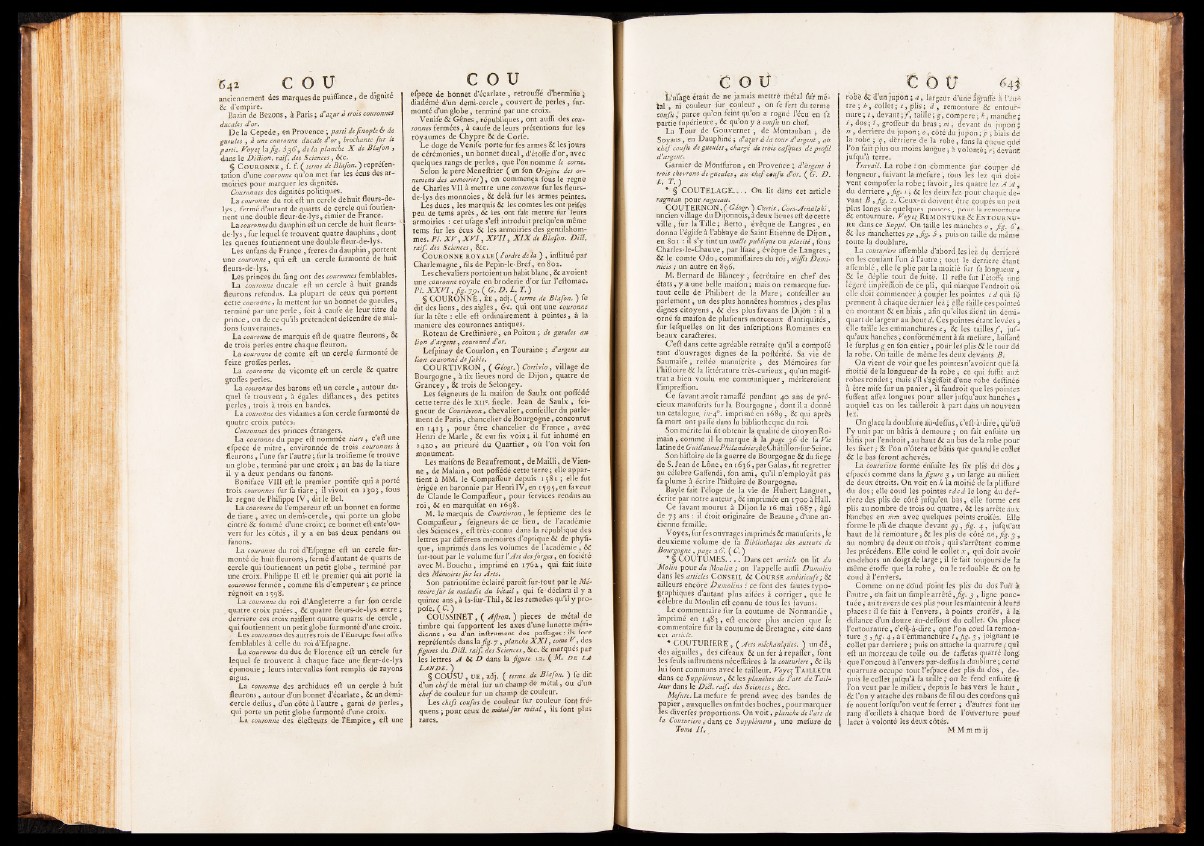
anciennement des marques de puiffance, de dignité
& d’empire. ^ ^
Bazin de Bezons, à Paris ; d'azur à trois couronnes
ducales déor.
De la Cepede, en Provence ; parti definople & de
gueules j à une couronne ducale d'or, brochante fur le
parti. Voye\ la fig. $3 G, de la planche X de Blafon ,
dans le Di&ion. raif. des Sciences, &c.
§ COURONNE, f. f. ( terme de Blafon. ) représentation
d’une couronne qu’on met fur les ecus des armoiries
pour marquer les dignités.
Couronnes des dignités politiques.
La couronne du roi eft un cercle de huit fleurs-de-
îy s , fermé d’autant de quarts de cercle qui Soutiennent
une double fleur-de-lys, cimier de France.
hdiCouronneà.v\ dauphin eft un cercle de huit fleurs- v
de-lys, fur lequel fe trouvent quatre dauphins, dont
les queuès Soutiennent une double fleur-de-lys.
Les enfans de France, frer.es du dauphin, portent
une couronne, qui eft. un cercle Surmonté de huit
fleurs-de-lys.
Les princes du fang ont des couronnes Semblables.
La couronne ducale eft un cercle à huit grands
fleurons refendus. La plupart de ceux qui portent
cette couronne, la mettent fur un bonnet de gueules,
terminé par une perle, Soit à caufe de leur titre de
prince, ou de ce qu’ils prétendent defcendre de mai-
ions Souveraines.
La couronne de marquis eft de quatre fleurons> &
de trois perles entre chaque fleuron.
La couronne de comte eft un cercle Surmonte de
Seize greffes perles.
La couronne de vicomte eft un cercle & quatre
grofles perles.
La couronne des barons eft un cercle, autour duquel
fe trouvent, à égales diftances, des petites
perles , trois à trois en bandes.
La couronne des vidâmes a Son cercle Surmonte de
quatre croix pâtées.
Couronnes des princes étrangers.
La couronne du pape eft nommée tiare, c’eft une
efpece de mitre, environnée de trois couronnes à
fleurons, l’une fur l’autre ; fur la troifieme fe trouve
un globe, terminé par une croix ; au bas de la tiare
il y a deux pendans ou fanons.
Boniface VIII eft le premier pontife qui a porté
trois couronnes fur fa tiare ; il vivoit en 1303 , fous
le régné de Philippe IV , dit le Bel.
La couronne de l’empereur eft un bonnet en forme
de tiare , avec un demi-cercle, qui porte un globe
cintré & fommé d’une croix; ce bonnet eft entr’ou-
vert fur les côtés, il y a en bas deux pendans ou
fanons.
La couronne du roi d’Efpagne eft un cercle fur-
monté de huit fleurons, fermé d’autant de quarts de
cercle qui foutiennent un petit globe, terminé par
une Croix. Philippe II eft le premier qui ait porté la
couronne fermée , comme fils d’empereur ; ce prince
régnoit en 1598.
Ldi couronne du roi d’Angleterre a fur fon cercle
quatre croix pâtées, & quatre fleurs-de-lys entre ;
derrière ces croix naiflent quatre quarts de cercle,
qui foutiennent un petit globe furmonté d’une croix.
Les couronnes des autres rois de l’Europe font allez
Semblables à celle du roi d’Efpagne.
La couronne du duc de Florence eft un cercle fur
lequel fe trouvent à chaque face une fleur-de-lys
épanouie ; leurs intervalles font remplis de rayons
aigus.
La couronne des archiducs eft un cercle à huit
fleurons, autour d’un bonnet d’éçarlate, & un demi-
cercle deflus, d’un côté à l’autre , garni de perles ,
qui porte un petit globe furmonté d’une croix.
La couronne, des électeurs de l’Empire., eft une
efpece de bonnet d’écarlate , retrouffé d’hermine ;
diadémé d’un demi-cercle, couvert de perles, fur-
monté d’un globe, terminé par une croix.
Venife & G ênes, républiques, ont aufli des cou*
ronnes fermées, à caufe de leurs prétentions fur les
royaumes de Chypre & de Corfe.
Le doge de Venife porte fur fes armes & les jours
de cérémonies, un bonnet ducal, d’étoffe d’o r , avec
quelques rangs de perles, que l’on nomme le corne.
Selon le pere Meneftrier ( çn fon Origine des or-
nemens des armoiries'), on commença fous le régné
de Charles V II à mettre une couronne furies fleurs-
de-lys des monnoies, & delà fur les armes peintes.
Les ducs, les marquis & les comtes les ont prifes
peu de tems après, & les ont fait mettre fur leurs
armoiries : cet ufage s’eft introduit prefqu’en même
tems fur les écus & les armoiries des gentilshommes.
PL X V , X V I , X V I I , X I X de Blafon. Dicl.
raif. des Sciences, &c.
Couronne royale {tordre d elà ) , inftitué par
Charlemagne, fils de Pepin-le-Bref, en 802.
Les chevaliers portoient un habit blanc, & avoient
une couronne royale en broderie d’or fur l’eftomac.
PI. X X V I , fig . 79. ( G. D .L . T. )
§ COURONNÉ, ÉE , adj. ( terme de Blafon. ) fe
dit des lions, des aigles, &c. qui ont une couronne
fur la tête : elle eft ordinairement à pointes, à la
maniéré des couronnes antiques.
Roteau de Creftiniere, en Poitou ; de gueules au
lion d'argent, couronne d or.
Lefpinay de C ourlon, en Touraine ; d'argent au
lion couronné de fable.
COURTIVRON , ( Géogr.) Cortivio, village de
Bourgogne, à fix lieues nord de Dijon, quatre de
Grancey, & trois de Selongey.
Les feigneurs de la maifon de Saulx ont poffédé
çette terre dès le x n e. fiecle. Jean de Saulx , fei-
gneur de Courtivron, chevalier, confeiller du parlement
de Paris, chancelier de Bourgogne, concourut
en 1413 , pour être chancelier de France , avec
Henri de Marie, & eut fix voix ; il fut inhumé en
14 10 , au prieuré du Quartier, où l’on voit fon
monument.
Les maifons de Beaufremont, de M ailli, de Vienne
, de Malain, ont poffédé cette terre; elle appartient
à MM. le Compaffeur depuis 1581 ; elle fut
érigée en baronnie par Henri IV, en 159 ç, en faveur
de Claude le Compaffeur, pour fervices rendus au
ro i, & en marquifat en 1698.
M. le marquis de Courtivron, le feptieme des 1er
Compaffeur, feigneurs de ce lieu, de l’académie
des Sciences , eft très-connu dans la république des
lettres par différens mémoires d’optique & de phyfi-
que,. imprimés dans les volumes de l’académie, Sc
fur-tout par le volume fur l'Art des forges, en fociété
avec M.Bouchu, imprimé en 1762, qui fait fuite
des Mémoires furies Arts,
Son patriotifme éclairé paroît fur-tout par le Mémoire
fur la maladie du bétail, qui fe 1 déclara il y a
quinze ans, à Is-fur-Thil, Sc les remedes qu’il y pro-
pofe. ( C. )
COUSSINET, ( Afiron. ) pièces de métal de
timbre qui fupportent leS axes d’une lunette méridienne
, ou d’un inftrument des. paffages : ils font
repréfentés dans la fig. 7 , planche X X I , tome V , des
figures du Dicl. raif. des Sciences., &c. & marques par
les lettres A & D dans la figure i&. ( IéL d e l a
La n d e . )
§ CO U SU , UE, adj. ( terme, de. Blafon. ) fe dit
d’un chef de métal fur un champ de métal, ou d’un
chef de couleur fur un champ de couleur.
Les chefs coufus.de couleur fur couleur font fré-
quens ; pour ceux de métal fur métal, ils font plus
rares.
ii’uïagë étant de ne jamais mettre ffiéîàl für mét
a l , ni couleur fur couleur , on fe fert du terme
coufu ,* parce qu’on feint qu’on a rogné l’écù ën fà
partie fupérieure, & qu’on y à coufu un chef
La Tour de Gouvernet , de Montauban ; dé
Soyàns, en Dauphine ; d'azur à la tour d'argent, ah
'chef coujh de gueules , chargé de trois cafauts de profil
d'argent.
Garnier de Montfüïon * eh Broveftcê ; d'argent à
trois chevrons de gueules, au chef coufu dé or. ( G. D .
* § COUTELAGE.. . * On lit dàhs èet article
ragneau pour ragueau.
COUTERNON, ( Géogr. ) Cïirtis, Cors-ArMlphi •
ancien village du Dijonnois, à deux lieues eft de cette
ville , fur la T ille ; Betto, évêque de Lahgrès , en
donna l’églife à l’abbaye de Saint Etienne de D ijon ,
en 801 : il s’y tint ün indtle publique OU placité # fous
Charles-le-Chaüve, par Ifaae ; évêque de Lângres ;
& le comte Odo ; commiffaireS du fdi ; mljfis Dômi-
nids ; un autre en 896*
M. Bernard de Blànceÿ y ïecrëtaire en chef des
états, y a une belle maifon ; mais on remarque fur-
tout celle de Philibert de là Mare; cohfeiller au
parlement, un des plus honnêtes hommes î des plus
dignes citoyens , Sc des plus favans de Dijôh : il a
orné fa maifon de plufieurs morceaux d’antiquités,
fur leftjuelles on lit des infcriptiôns Romaines en
beaux carafteres.
C ’eft dans cette agréable retraite qu’ii a edriipofé
tant d’ouvrages dignes de la poftérité. Sa vie de
Saumaife, reftée manuferite ; des Mémoires für
l ’hiftoire Sc la littérature très-curieux, qu’un magif-
trat a bien voulu me communiquer, mériteroient
Pimpreflion.
Ce favant avoit ramaffé pendant 40 ahs dé précieux
mariuferits fur la Bourgogne , dont il a donné
un catalogue, in-40. imprimé en 1689, & qui après
fa mort ont pafle dans la bibliothèque du roi.
Son mérite lui fit obtenir la qualité de citoyen Ro^
main , comme il le marque à la page.3 6 de fa Vie
latine de Guillaume P hilandrier^àçÙdiktdlon-ivir-SoiïiQ.
Son hiftoire de la guerre de Bourgogne & du fiege
de S. Jean de Lône; en 163 6 , par Galas, fit regretter
âu célébré Gàffendi, fon ami, qu’il n’employât pas
fa plume à écrire l’hiftoire de Bourgognej
Bayle fait l’éloge de la vie de Hubert Lànguet,,
écrite par notre auteur, Sc imprimée en 1700 à Hall.
Ce favant mourut à D>ijon le 16 mai 1687 ; âgé
de 73 ans : il étoit originaire de Beaune , d’une ancienne
famille.
Voyez, fur fes ouvrages imprimés & mariuferits, le
deuxieme volume de fa Bibliothèque des auteurs de
Bourgogne , page 2 G. ( C. )
* § COUTUMES.. . . Dans cet article on lit du
Molin pour du Moulin ; on l’appélle aufli Dumolin
dans les articles CONSEIL & C qüRS'E ambitieufe; Sc
ailleurs ehcôrè Dumolins : ce font des fautes typographiques
d’autant plus aifées â corriger , que le
célébré du Moulin eft connu de tous fes favans;
^ Le commentaire fur la coutume dè Normandie ,
imprimé en 1483 , eft ericôre plùs ancien que le
commentaire fur là coutume dé Bretagne, cité dans
Cet article.
* COUTURIERE , ( Arts méciidniqiiei. ) u n d é ,
d e s a i g u i l l e s , d e s c i f e a u x & u n f e r à r e p a f f e r , f o n t
l e s f e u l s in f t r u m e n s n é c e f f a i r e s à la couturière, & i l s
l u i f o n t c o m m u n s a v e c ' l e t a i l l e u r . Voye{ T a i l l e u r
d a n s c e Supplément, & \es planches de l'art du T ail*
leur d a n s l e Dicl. raif. des Sciences ; & c .
Mefure, La mefure fe prend avec des bandes de
papier, auxquelles on fait des hoches, pour marquer
les diverfes proportions. On v o it , planche de Part de
la Couturière y dans ce Supplément, une mefure de
Tome I L ,
roBè & cî’ùn jiipôrt ; à, làfgeür d’uriè afraffë ü Paul
tre ; b , collet ; c > plis ; d , remonture & entournure
; è -, devant ; f , taille ; g, compere ; 'h ; manthe ;
i , dos 2, groffeu'r du bras;/ri, devant du jupon;
n , derrière du jupon; 0, côté du jupon ; p ; biais de!
f® r°k®, » f i t dèrrief e de la robe, fans la queue qüé
l’on fai‘t plus ou moins longue ; à volonté - r' devârit
jufqu’à terre. '
Travail. La robe : on commence par couper dé
longueur, füivant là mefure ', tous les lez qui doi-&
vent compofer la robe ; favoir, les quatre lez À A i
du derrière , fig. 1 ; & les deux lez pouf chaque devant
B ,fig. 2. Ceux-ci doivent être coupés un peil
plus longs de quelques pouces, pour là remonturé
& entournure. Voyeq_ R e m ô n t u r e & E n t o u r n u *
PE dans ce Suppl. On taille les manches o , fig. G $
èc les manchettes pp ,fig. 6 , puis on taillé de même
toute la dpublure.
La couturière âffembie d’abord,les ie2 dû deffjeré
en les coulant l’un à l’autre ; tout ie derrière .étant
affemblé., elle le plie par la moitié fur fa longueur [
& lë^ déplie tout de fuite. II reftè fur l’étoffe uné
légere impfeflion de ce pli, qui marque Pendroit ou
elle doit cômmëneer.à çouper lès.pointes cd qui fé
prennent à cHàqüe dernier léz ; plie taille ces pointes
èri montant & en biais , afin qu’elles aient un demi-
quart de largeur au bout<L Ces pointes étant levées 4
elle taille les emmanchures e , & les tailles/, juf-
qu’aiiX Hanches ; conforriiément à fà rflefure, laiffant
lé furplus g. en fon ehtier, pbür leé plis St lé tour Hé
la robe. On taille de même les deiix devants B ;
On vient de voir que les pointes ri’avôiént quë là
ffîoitie de la longueur dè la robe ; ce qui fuffit au i
robes rôridëS ; mais s’il s’àgiffoit d’üne robe deftiriéé
à être mife fur un panier, il faudroit que les pointes
fuffent àffez longues pour aller jufqu’aux hanches y
auquel tas on les taiflerdit à part dans uh nouveau
le&
On glace la doublure âü-deffus, c’eft-à-dire, qü’óö
l’y unit par un bâtis à demeure ; on fait enfiiitè üfc
bâtis par Pendroit, au haut & au bas de là robe pouf
les fixer; & l’on n’ôtera cé bâtis que quand le cdlleÉ
& le bas feront achevés;
La Couturière formé é’rifuxte lés fllX plis dri dós i
efpacés comme dans la figure 3 , uri large au milieu
de deux étroits^ On voit én h la moitié de la pliffuré
du dos ; elle èoud les pointés eded lé long du def-
riefe des plis dè côte jufqu’eri bas ,■ elle formé céS
plis au nombre de trois ôri quatre, & les arrête à’uX
hanches en ihrh avec quelques! pdîrits croifés. Elle
fornîe lé pli dé Chaque devant qq, fig. 4 , jufqu’ai*
haut de là rèriionture; & les plis de côté nn, fig.3^
au nombre de déuX ou trois j1 qùi s’arrêtent Commé
les p’récédens. Elle cô'ud le collet x , qui doit avoir
eri-dehors un doigt de largé ; il fe fijit toujours de la
même étoffe que la robe, on le redouble Sc où le‘
ëoüd à PénVers.
Comme on ne coud p’ôirit tes plis" dû Hós 1’ufi' à
l’autre, o“n fait un (impie arrêté ,fig. 3 , ligné ponctuée
, ari travers de ces plis pour les maintenir à léufâ
places : il fe fait à l’envers, à points croifésf, à lai
diftance d’un douze âu-déflbus du colléf.' Ori placé
Pentourntire, c’eft-à-dire, que Pori coud là rembrt-
ture 3 ,fig. 4 , à l’effimanchuré l , fig. g joignant le*
Collet par derrière ; puis on attache la quarrufe / qui
eft un morceau de tollé ou cfe taffetas quarré long-
que l’on coud à l’envers par-deffus la doüblurè ; cetté
quarrufè Occupé tout Pefp'ace d'eS plis du dôs , depuis
le collet jufqu’à la taille ;' ori le fend enfuite fï
l’on veut par le milieu' ,• depuis le bas vérs' le haut „■
& l’on y attache des rubans de fil ou des cordons quf
fe nouent lorfqu’ort veut fe ferrer ; d’autres font Un!
rang d’oeillets à chaque bord de l’ôtfvéfture poué
lacer à volonté les deux côtés'.
M M m m1 i j