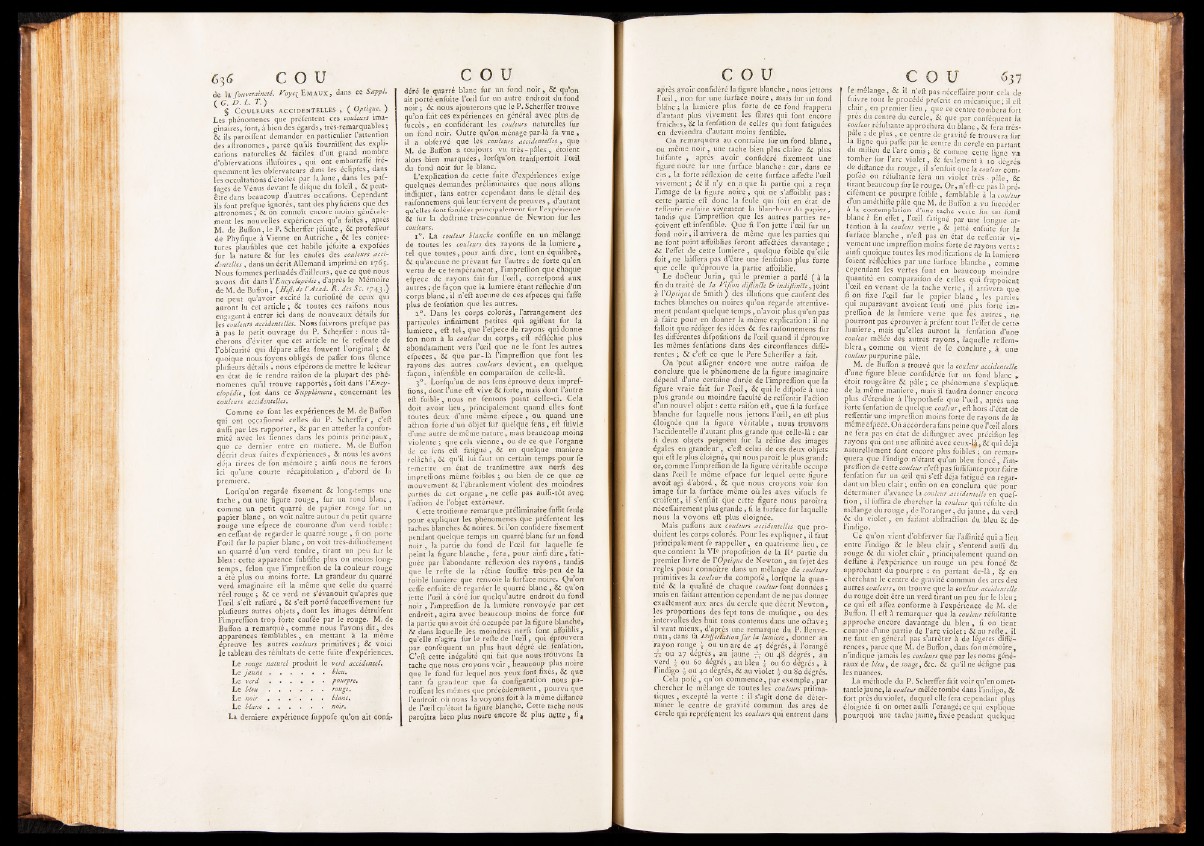
6e la fouverained. Voyt{ E m a u x , dans ce Suppl.
( G .D .L .T .)
§ Couleurs accidentelles , ( Optique. )
Les phénomènes que préfentent ces couleurs imaginaires,
font, à bien des égards, très-remarquables ;
6i ils paroiffent demander en particulier l’attention
des agronomes, parce qu’ils fourniffent des explications
naturelles 8c faciles d’un grand nombre
d’oblervations illufoires , qui ont embarraffe fréquemment
les obfervateurs dans les éçlipfes, dans
les occultations d’étoiles par la lune, dans les paf-
fages de Vénus devant le difque du fole il, 8c peut-
être dans beaucoup d’autres occafions. Cependant
ils font prefque ignorés, tant des phyficiens que des
aftronomes ; 8c on connoît encore moins généralement
les nouvelles expériences qu’a faites, après
M. de Buffon, le P. Scherffer jéfuite , 8c proféfleur
de Phyfique à Vienne en Autriche, 8c les conjectures
plaufibles que cet habile jéfuite a expofées
fur la nature 8c fur les caufes des couleurs acc'v-
dentelles , dans un écrit Allemand imprimé en 1765.
Nous fommes perfuadés d’ailleurs, que ce que nous
avons dit dans l'Encyclopédie, d’apres' le Mémoire
de M. de Buffon, ( Hijl.de l'Acad. R. des Sc. '743^
ne peut qu’avoir excite la curiofite de ceux qui
auront lu cet article ; 8c toutes ces raifons nous
engagent à entrer ici dans de nouveaux détails fur
les couleurs accidentelles. Nous fuivrons prefque pas
à pas le petit ouvrage du P. Schqrffer : nous tâcherons
d’éviter que cet article ne fe reffente de
l ’obfcurité qui dépare affez fouvent l’original ; 8c
quoique nous foyons obligés de paffer fous filence
plufieurs détails , nous efpérons de mettre le lefteur
en état de fe rendre raifon de la plupart des phénomènes
qu’il trouve rapportés, foit dans VEncyclopédie
^ foit dans ce Supplément, concernant les
couleurs accidentelles.
Comme ce font les expériences de M. de Buffon
qui ont occafionné celles du P. Scherffer , c’eft
aufli par les rapporter, 8c par en attefter la conformité
avec les liennes dans les points principaux,
que ce dernier entre en matière. M. de Buffon
décrit deux fuites d’expériences, & nous les avons
déjà tirées de fon mémoire ; ainfi nous ne ferons
ici qu’une courte récapitulation , d’abord de la
première.
Lorfqu’on regarde fixement 8c long-temps une
ta ch e, ou une figure rouge, fur un tond blanc ,
comme un petit quarré de papier rouge fur un
papier blanc , on voit naître autour du petit quarre
rouge une efpece de couronne d’un verd foible :
en ceffant de regarder le quarré rouge , fi on porte
l’oeil fur le papier blanc, on voit très-diftin&ement
un quarré d’un verd tendre, tirant un peu fur le
bleu : cette apparence fubfifte plus ou moins longtemps
, félon que l’impreffion de la couleur rouge
a été plus ou moins forte. La grandeur du quarré
verd imaginaire eft la même que celle du quarré
réel rouge ; 8c ce verd ne s’évanouit qu’après que
l’oeil s’eft raffuré , 8c s’efl porté fucceffiveinent fur
plufieurs autres objets, dont les images détruifent
l’impreffion trop forte caufée par le rouge. M. de
Buffon a remarqué, comme nous l’avons dit, des
apparences femblables, en mettant à la même
épreuve les autres couleurs primitives; 8c voici
le tableau des réfultats de cette fuite d’expériences.
Le rouge naturel produit le verd accidentel.
Le ja u n e ..............................bleu.
Le verd , . . . . . • pourpre.
Le b l e u ............................. rouge.
Le noir . . . • . . . blanc.
Le blanc . . . . . . noir.
La derniere expérience fuppofe qu’on ait confia
déré le quarré blanc fur un fond n oir, &t qu’on
ait porté enfuite l’oeil fur un autre endroit du fond
noir ; 8c nous ajouterons que le P. Scherffer trouve
qu’on fait ces expériences en général avec plus de
fuccès, en confidérant les couleurs naturelles fur
un fond noir. Outre qu’on ménage par-là fa vue ,
il a obfervé que le s . couleurs accidentelles, que ■
M. de Buffon a toujours vu très-pâles., étoiçnt
alors bien marquées, lorfqu’on tranfportoit l’oeil
du fond noir fur le blanc.
L’explication de cette fuite d’expériences exige
quelques demandes préliminaires que nous allons
indiquer, fans entrer cependant dans le détail des
raifonnemens qui leur fervent de preuves, d’autant
qu’ elles font fondées principalement fur l’expérience
8c fur la do&rine très-connue de Newton fur les
couleurs.
i° . La couleur blanche confifte en un mêlangç
de toutes les couleurs des rayons de la lumière ,
tel que toutes, pour ainfi dire, font en équilibre,
8c qu’aucune ne prévaut fur l’autre: de forte qu’en
vertu de ce tempérament, l’impreffion que chaque
efpece de rayons fait fur l’oeil, correfpond aux
autres ; de façon que la lumière étant réfléchie d’un
corps blanc, il n’eft aucune de ces efpeces qui faffe
plus de fenfation que les autres.
a°. Dans les corps colorés , l’arrangement des
particules infiniment petites qui agiffent fur la
lumière, eft te l, que l’efpéce de rayoris qui donne
fon nom à la couleur du corps, eft réfléchie plus
abondamment vers l’oeil que ne le font les autres
efpeces, 8c qüe par-là Pimpreffion que font les
rayons des autres couleurs devient, en quelque
façon, infenfible en comparaifon de celle-là.
30. Lorfqu’un de nos fens éprouve deux impref-
fions, dont l’une eft vive 8c forte, mais dont l’autre
eft foible, nous ne fentons point celle-ci. Cela
doit avoir lieu, principalement quand elles font
toutes deux d’une même efpece , ou quand une
a&ion forte d’un objet fur quelque fens, eft fuivie
d’une autre de même nature, mais beaucoup moins
violente ; que cela vienne, ou de ce que l’organe
de ce fens eft fatigué, 8c en quelque mgniere
relâché, 8c qu’il lui faut un certain temps pour fe
remettre en état de tranfmettre aux nerfs des
iinpreffions même foibles ; ou bien de ce que ce
mouvement 8c l’ébranlement violent des moindres
parties de cet organe, ne celle pas auffi-tôt avec
l’aftion de l’objet extérieur.
Cette troifieme remarque préliminaire fuffit feule
pour expliquer les phénomènes que préfentent les
taches blanches ,8c noires. Si l’on confidere fixement
pendant quelque temps un quarré blanc fur un fond
noir, la partie du fond de l’oeil fur laquelle fe
peint la figure blanche, fera, pour ainfi dire, fatiguée
par l’abondante réflexion des rayons, tandis
que le refte de la rétine fouffre très-peu de la
foiblé lumière que renvoie la furface noire. Qu’on
ceffe enfuite dé regarder le quarré blanc , 8c qu’on
jette l’oeil à côté lur quelqu’autre endroit du fond
n o ir, l’impreffion de la lumière renvoyée par cet
endroit, agira avec beaucoup moins de force fur
la partie qui avoir été occupée par la figure blanche,
8c dans laquelle les moindres nerfs font affoiblis ,
qu’elle n’agira fur le refte de l’oe il, qui éprouvera
par conféquent un plus haut dégré de fenfation.
C’eft cette inégalité qui fait que nous trouvons la
tache que nous croyons voir , beaucoup plus noire
que le fond fur lequel nos yeux font fixes, 8c que
tant fa grandeur que fa configuration nous paroiffent
les mêmes que précédemment,^pourvu que
l’endroit où nous la voyons fort à la meme diftancc
de l’oeil qu’étoit la figure blançhe. Cette tache nous
paraîtra bien plus noire encore 8c plus nette, fi*
après avoir confidéré la figure blanche, nous jettons
l’oe il, non fur une furface noire , mais fur un fond
blânc ; la lumière plus forte de ce fond frappera
d’autant plus vivement les fibres qui font encore
fraîches, 8c la fenfation de celles qui font fatiguées
en deviendra d’autant moins fenfible.
On remarquera au contraire fur un fond blanc,
ou même noir, une tache bien plus claire 8c plus
luifante , après avoir confidéré fixement une
figure noire lur une furface blanche: car, dans ce
ca s , la forte réflexion de cette furface affe&e l’oeil
vivement ; 8c il n’y en a que la partie qui a reçu
l’image de la figure noire, qui ne s’affoiblit pas :
cette partie eft donc la feule qui foit en état de
reffentir enfuite vivement la Blancheur du papier,
tandis- que, l ’impreffion que les autres parties reçoivent
eft infenfible. Que fi l’on jette l’oeil fur un
fond noir, il arrivera de même que les parties qui
ne font point affoiblies feront affeâées davantage ;
8c l’effet de cette lumière , quelque foible qu’elle
foit, ne laiffera pas d’être une fenfation plus forte
que celle qu’éprouve la. partie affoiblie.
Le dofteur Jurin, qui le premier a parlé ( à la
fin du traité de la Vijîon dijlincle & indijlincle, joint
à l'Optique de Smith ) des illufions que caufent des
taches blanches ou noires qu’on regarde attentivement
pendant quelque temps, n’avoit plus qu’un pas
à faire pour en donner la même explication : il ne
falloit que rédiger fes idées 8c fes raifonnemens fur
les différentes difpofitions de l’oeil quand il éprouve
les mêmes fenfations dans des circonftances différentes.;
8c c’eft ce que le Pere Scherffer a fait.
On rpeut affigner encore une autre raifon de
conclure que le phénomène de la figure imaginaire
dépend d’une certaine durée de l’impreffion que la
figure vraie fait . fur l’oe il, 8c qui le difpofe à une
plus grande ou moindre faculté de reffentir l’aâion
d’un nouvel objet : cette raifon eft, que fi la furface
blanche fur laquelle nous jettons l’oeil, en eft plus
éloigné,e que la figure véritable , nous trouvons
l’accidentelle d’autant plus grande que celle-là : car
fi deux objets peignent fur la rétine des images
égales en grandeur, c’eft celui de ces deux objets
qui eft le plus éloigné, qui nous paroît le plus grand :
or, comme l’impreffion de la figure véritable occupe
dans l’oeil le même efpace fur lequel cette figure
avoit agi d’abord, 8c que nous croyons voir fon
image fur la furface même où les axes vifuels fe
croifent, il’ s’enfuit que cette figure nous paroîtra
néceffairement plus grande, fi la furface fur laquelle
nous la voyons eft plus éloignée.
Mais paffons aux couleurs accidentelles - que pro-
duifent les corps colorés. Pour les expliquer, il faut
principalement fe rappeller, en quatrième lieu, ce
que contient la V Ie propofition de la IIe partie du
premier livre de l'Optique de Newton, au fujet des
réglés pour connoître dans un mélange de couleurs
primitives la couleur du compofé, lorfque la quantité
8c la qualité de chaque couleur font données ;
mais en failant attention cependant de ne pas donner
cxaftement aux arcs du cercle que décrit Newton,
les proportions des fept tons de mufique, ou des.
intervalles des huit tons contenus dans une o&ave ;
il vaut mieux, d’après une remarque du P. Benve-
nuti, dans fa DiJjerTationfur la lumière, donner au
rayon rouge ^ ou un arc de 45 dégrés, à l’orangé
4^ ou 27 dégrés, au jaune ou 48 dégrés, au
verd j ou 60 dégrés, au bleu \ ou 60 dégrés , à
l’indigo ± oit 40 degrés, 8c au v iolet f ou 80 dégrés.
Cela p o fé, qu’on commence, par exemple, par
chercher le mélange de toutes les couleurs prifma-
tiques, excepté la verte : il s’agit donc de déterminer
le centré de gravité commun des arcs de
cercle qui repréfentent les couleurs qui entrent dans
| le mélange, 8c il n’eft pas néceffaire pour cela de
I fuivre tout le procédé preferit en mécanique ; il eft
cla|r, en premier lieu , que ce centre tombera fort
près du centre du cercle, 8c que par ^conféquent la
couleur réfultante approchera du blanc, 8c fera très-
pale : de plus , ce centre de gravité fe trouvera fur
la ligne qui paffe par le centre du cercle en partant
du milieu de l’arc omis ; Sc comme cette ligne va
tomber fur l’arc viole t, 8c feulement à 10 dégrés
de diftance du rouge, il s ’enfuit que la couleur com-
pofée ou réfultante fera un violet' très - pâle 8c
tirant beaucoup fur le rouge. O r , n’eft-ce pas là pré-
cifément ce pourpre foible , femblable à la couleur
d’un améthifte pâle que M. de Buffon a. vu fuccéder
à la contemplation d’une tache verte fur un fond
blanc ? En effet, l’oeil fatigué par une longue attention
à la couleur ve r te , & jette enfuite fur la
furface blanche , n’eft pas en état de reffentir vivement
une impreffion moins forte de rayons verts:
ainfi quoique toutes les modifications de la lumierê
foient réfléchies par une furface blanche , comme
cependant les vertes font en beaucoup moindre
quantité en comparaifon de celles qui frappoient
l’oeil en venant de la tache v erte, il arrivera que,
fi on fixe l’oeil fur le papier blanc, les parties
qui auparavant avoient fenti une plus forte impreffion
de la lumière verte que lès autres, ne
pourront pas éprouver à préfent tout l’effet de cette
lumière, mais qu’elles auront là fenfation d’une
couleur mêlée des autres rayons, laquelle reffem-
blera, comme on vient de le conclure, à une
couleur purpurine pâle.
} M. de Buffon a trouvé que la Couleur accidentelle.
d’une figure^ bleue confidérée fur un fond blanc „
etoit rougeâtre 8c pâle ; ce phénomène s’explique
de la même maniéré, mais il faudra donner encore
plus d’étendue à l’hypothefe que l’oe il, après une
forte fenfation de quelque couleur, eft hors d’état de
reffentir une impreffion moins forte de rayons de la
même efpece. On accordera fans peine que l’oeil alors
ne fera pas en état de diftinguer avec préçifion les
rayons qui ont une affinité avec ceux-$, 8c‘qui déjà
naturellement font encore plus foibles ; on remar-^
'quera que l’indigo n’étant qu’un bleu foncé, l’impreffion
de cette couleur n’eft pas fuffifanre pour faire
fenfation fur un oeil qui s’eft déjà fatigué en regardant
un bleu clair; enfin on en conclura que pour
déterminer d’avance la couleur accidentelle en quef*
tion , il fuffira de chercher la couleur qui réfulte du
mélange du rouge , de l’oranger, du jaune, du verd
8c du viole t, en faifant abftraftion du bleu 8c de-
l’indigo.
Ce qu’on vient d’obferver fur l’affinité qui a lieu,
entre l’indigo 8c le bleu clair, s’entend auffi du
rouge 8c du violet clair , principalement quand on
deftine à l’expérience un rouge un pèu foncé 8c
approchant du pourpre : en partant de-là, & en
cherchant le centre de gravité commun des arcs des
autres couleurs, on trouve que la couleur accidentelle-
du rouge doit être un verd tirant un peu fur le bleu ;
ce qui eft affez conforme à l’expérience de M. de
Buffon. Il eft à remarquer que la couleur réfultante
approche encore davantage du b leu, fi on tient
compte d’une partie de l’arc violet ; 8c au refte, il
ne faut en général pas s’arrêter à de légères différences,
parce que M. de Buffon, dans fon mémoire,
n’indique jamais les couleurs que par les noms généraux
de bleu y de rouge y 8cc. 8c qu’il ne défigne pas
les nuances.
La méthode du P. Scherffer fait voir qu’en omet-
tantle jaune, la couleur mêlée tombe dans l’indigo, 8c
fort près du violet, duquel elle fera cependant plus
éloignée fi on omet aufli l’orangé; ce qui explique
.pourquoi une tache jaune, fixée pendant quelque