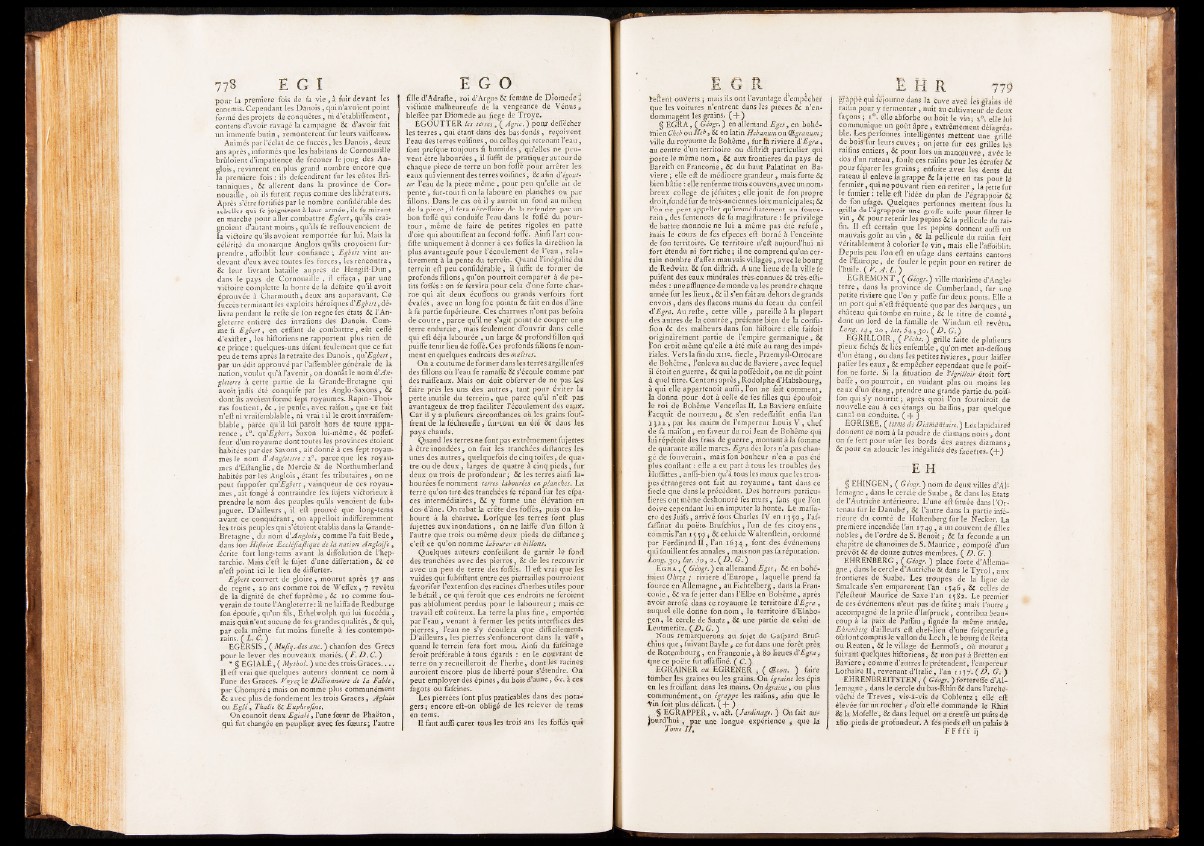
■ /JO J_< VJ J.
pour la première fois de fa v ie , à fuir devant leS
ennemis. Cependant les Danois, qui n’avoient point
formé des projets de conquêtes, ni d’établiffement,
contens d’avoir ravagé la campagne Sc d’avoir fait
un immenfe butin , remontèrent fur leurs vaiffeaux.
Animés par l’éclat de ce fuccès,les Danois, deux
ans après, informés que les habitans de Cornouaille
brûloient d’impatience de feeouer le joug des An-
glois, revinrent en plus grand nombre encore que
la première fois : ils defcendirent fur les cotes Britanniques,
Sc allèrent dans la province de Cornouaille
où ils furent reçus comme des libérateurs.
Après s’être fortifiés par le nombre confidérable des
rebelles qui fe joignirent à leur armée, ils fe mirent
en marche pour aller combattre Egbert, qu’ils crai-
gnoient d’autant moins, qu’ils fe reffouvemoient de
la victoire qu’ils avoient remportée fur lui. Mais la
célérité du monarque Anglois qu’ils croyoient fur-
prendre, affoiblit leur confiance ; Egbert vint au-
devant d’eux avec toutes fes forces, les rencontra,
Sc leur livrant bataille auprès, de Hengift-Dun,
dans le pays de Cornouaille , il effaça, par une
viftoire complette la honte de la défaite qu’il avoit
éprouvée à Charmouth, deux ans auparavant. Ce
fuccès terminant les exploits héroïques d Egbert, délivra
pendant le refte de fon régné fes états Sc l’Angleterre
entière des invafions des Danois. Comme
fi Egbert, en ceffant de combattre, eût ceffé
d’exifter , les hiftoriens ne rapportent plus rien de
ce prince : quelques-uns difent feulement que ce fut
peu de tems apres la retraite des Danois, qu'Egbert,
par un édit approuvé par l’affemblée générale de la
nation, voulut qu’à l’avenir, on donnât le nom & Angleterre
à cette partie de la Grande-Bretagne qui
avoit jadis été conquife par les Anglo-Saxons, Sc
dont ils avoient formé fept royaumes. Rapin-Thoi-
ras foutient, Sc , je penfe, avec raifon > que ce fait
n ’eft ni vraifemblable, ni vrai : il le croit invraifem-
blable, parce qu’il lui paroît hors de toute apparence
, i° . qu'Egbert, Saxon lui-même, & poffef-
feur d’un royaume dont toutes les provinces étoient
habitées par des Saxons, ait donné à ces fept royaumes
le nom d’Angleterre : z°. parce que les royaumes
d’Eftanglie, de Mercie & de Northumberland
habités par les Anglois, étant fes tributaires, on ne
peut fuppofer qu 'Egbert, vainqueur de ces royaumes,
ait fongé a contraindre fes fujets victorieux à
prendre le nom des peuples qu’ils venoient de fub-
juguer. D ’ailleurs , il eft prouvé que long-tems
avant ce conquérant, on appelloit indifféremment
les trois peuples qui s’étoient établis dans la Grande-
Bretagne , du nom d Anglois, comme l’a fait Bede,
dans fon Hifloire Eccléjiajtique de la nation Angloife ,
écrite fort long-tems avant la diffolution de l’hep*
tarchie. Mais c’eft le fujet d’une differtation, Sc ce
n’eft point ici le lieu de differter.
Egbert couvert de gloire, mourut après 37 ans
de régné , 20 ans comme roi de "Weffex, 7 revêtu
de la dignité de chef fuprême, & 10 comme fou-
verain de toute l’Angleterre : il ne laiffade Redburge
fon époufe, qu’un fils, Ethelwolph qui lui fuccéda ,
mais qui n’eut aucune de fes grandes qualités, & qui,
par cela même fut moins funefte à fes contemporains.
( L. C. )
EGERSIS, ( Mujiq.. des anc. ) chànfon des Grecs
pour le lever des nouveaux mariés. (F . D . C. )
* § EGIALÉ, ( Mythol. ) une des trois G râces.. . .
Il eft vrai que quelques auteurs donnent ce nom à
l’une des Grâces. Voye[ le Dictionnaire de la Fable,
par Chompré ; mais on nomme plus communément
Sc avec plus de fondement les trois Grâces, Aglaia
ou Eglé, Thalie & Euphrojine.
On connoît deux Egialé, l’une foeur de Phaëton,
qui fut changée en peuplier avec fes foeurs; l’autre
fille d’Adrafte, roi d’Argos Sc femme de Dîomédé *
yiClime malheureufe de la vengeance de Vénus ÿ
bleffée par Diomede au fiege de Troyè.
ÉGOUTTER les terres, ( Agric. ) pouf deffécher
les terres , qui étant dans des bas-fonds , reçoivent
l’eau des terres voifines, ou celles qui retenant l’eau ,
font prefque toujours fi humides , qu’elles ne peuvent
être labourées , il fuffit de pratiquer autour de
chaque piece de terre un bon foffé pour arrêter les
eaux qui viennent des terres voifines, & afin dégoutter
l’eau de la piece même, pour peu qu’elle ait de
pente, fur-tout fi on la laboure en planches ou par
filions. Dans le cas où il y auroit un fond au milieu
de la piece, il fera néceffaire de la refendre par uni
bon foffé qui coqduife l’eau dans le foffé du pourtour
, même de faire de petites rigoles en patte
d’oie qui aboutiffent au fécond foffé. Ainfi l’art con-
fifte uniquement à donner à ces foffés la diredion là
plus avantageufe pour l’écoulement de l’eau , relativement
à la pente du terrein. Quand l’inégalité dut
terrein eft peu confidérable, il fuffit de former de'
profonds filions, qu’on pourroit comparer à de petits
foffés : on fe fervira pour cela d’une forte charrue
qui ait deux écuffons ou grands verfoirs fort
évafés, avec un long foc pointu Sc fait en dos d’âne
à fa partie fupérieure. Ces charrues n’ont pas befoitï
de coutre, parce qu’il ne s’agit point de couper une
terre endurcie, maris feulement d’ouvrir dans celle;
qui eft déjà labourée , un large Sc profond fillon qui
puiffe tenir lieu de foffé. Ces profonds filions fe nomment
en quelques endroits des maîtres.
On a coutume de former dans les terres argilleufes'
des filions où l’eau fe ramaffe & s’écoule comme par*
des ruiffeaux. Mais on doit obferver de ne pas lesf
faire près les uns des autres, tant pour éviter là
perte inutile du terrein, que parce qu’il n’eft pas
avantageux de trop faciliter l’écoulement des eaux»
Car il y a plufieurs circonftances où les grains fouf-
frent de la féchereffe, fur-tout en été Sc dans les
pays chauds.
Quand les ferres ne font pas extrêmement fujettes
à être inondées, on fait les tranchées diftanres les
unes des autres, quelquefois de cinq toifes, de quatre
ou de deux, larges de quatre à cinq pieds, fui*
deux ou trois de profondeur ; Sc les terres ainfi labourées
fe nomment terres labourées en planches. La
terre qu’on tire des tranchées fe répand fur les efpa-
ees intermédiaires, Sc y forme une élévation en:
dos-d’âne. On rabat la crête des foffés, puis on laboure
à la charrue. Lorfque les terres font plus
fujettes aux inondations, on ne laiffe d’un fillon à
l’autre que trois ou même deux pieds de diftance j
c’eft ce qu’on nomme labourer en billons.
Quelques auteurs confeillent de garnir le fond!
des tranchées avec des pierres, & de les recouvrir
avec un peu de terre des foffés. Il eft vrai que les
vuides qui fubfiftent entre ces pierrailles pourroient
fayorifer l’extenfion des racines d’herbes utiles pour
le bétail, ce qui feroit que ces endroits ne feroient
pas abfolument perdus pour le laboureur ; mais ce
travail eft coûteux. La terre la plus fine, emportée
par l’eau, venant à fermer les petits interftices des
pierres, l’eau ne s’y écoulera que difficilement.
D ’ailleurs, les pierres s’enfonceront dans la vafe ,
quand le terrein fera fort mou. Ainfi du fafcinage
feroit préférable à tous égards : en le couvrant de
terre on y recueilleroit de l’herbe, dont les racines
auroient encore plus de liberté pour s’étendre. On
peut employer des épines, du bois d’aune, &c. à ces
fagots ou fafcines.
Les pierrées font plus praticables dans des potagers
; encore eft-on obligé de les relever de tems
en tems.
Il faut auffi curer toits les trois ans les foffés qui-
E. G R
FèftéAt ouverts ; mais ils ont l’avantage d’empechéf
que les voitures ri’erttrent dans les pièces Sc n’en-
üommagetit les grains* ( + )
§ EGRA, ( Géogr. ) en allemand Égtï, en bohé-
ihien Cheb ou ïfeb, & en latin Hebanum ou QEgranum ;
Ville du royaume de Bohême, fur fe riviere d'Egra,
nu centfe d’un territoire ou diftriét particulier qui
porte le même nom, Sc aux frontières du pays de
Bareith en Franconie, Sc du haut Palatirtat en Bavière
; elle eft de médiocre grandeur, mais forte Sc
bien bâtie : elle renferme trois couverts,avec un nombreux
college de jéfuites ; elle jouit de fon propre
droit,fondélur de très-anciennes loix municipales; Sc
l’ôn ne peut àppeller qu’immédiatement au fouve-
rain , des fentences de fa magiftrature : le privilège
de battre monnoie ne lui a même pas été refufé ,
mais lé cOurs de fes efpeces eft borné à l’eneeihte
de fon territoire» Ce territoire n’eft aujourd’hui ni
fort étendu ni fort riche ; il né comprend qu’un certain
nombre d’affez mauvais villages, avec le bourg
de Redwitz Sc fon diftriét; A une lieue de la ville fe
puifent des eaüX minérales très-connues Sc très-efti-
mées : une affluence de monde va les prendre chaque
année fur les lieux, & ii s’en fait au-dehors de grands
envois* darts des flacons munis du fceau du confeil
d'Egra. Au refte, cette ville , pareille à la plupart
des autres de la contrée, préfente bien de la confii-
fion Sc des malheurs dans fort hiftoiré : elle faifoit
originairement partie de l’empire germanique * Sc
l’on croit même qu’elle a été mife au rang des impériales.
Vers la fin du xne. fiecle, Przemyfl-Ottocaré
de Bohême * l’enleva au duc de Bavière * avec lequel
il étoit en guerre, & qui la pôffédoit, on ne dit point
à quel titre. Cent ans après* Rodolphe d’Habsbourg*
à qui elle appàrtenoit auflï, l’on iie fait comment*
la donna pour dot à Celle de fes filles qui épOufoii
le roi de Bohême Veneeflas II. La Bavière enfuite
l’acquit de nouveau, & V en redeffaifit enfin l’an
3312* par les mains de l’empereur Louis V , chef
de fa maifon* en faveur du roi Jean de Bohême qui
lui répétoit des frais de guerre * montant à la fomme
de quarante mille marcs, Egra dès lors n’a pds changé
de fouverain * mais fon bonheur n’en a pas été
plus confiant 2 elle a eu part à tous les troubles des
Huffittes, auffi-bien qu’à tous les maux que les troupes
étrangères ont fait au.royaume, tant dans ce
fiecle que dans le précédent. Des horreurs particulières
ont même deshonoré fes murs, fims que l’on
doive cependant lui en imputer la.hqnte. Le maffa-
çre des Juifs, arrivé fous Charles IV en 1350, l’af-
fafîittat du poëto Brufchius * l’un de fes citoyens,
commis l’art 15 59 * & celui de Waltenftein, ordonné
par Ferdinand I I , Fan *634 , font des événetriens
qui fouillent fes annales, mais nûn pas fa réputation»
Long, j o * lat. oo * 2 . ( D . G. )
E g r a * ( Géogr. ) en allemand Éger^ ê i en bohémien
Ohr^e l riviere d’Europe, laquelle prend fa
fource en Allemagne * au Fichtelberg * dans la Frart-
conie, & va fe jetter dans l’Elbe en Bohême, après
avoir arrofé dans ce royaume le territoire dEgra ,
auquel elle dortfie fon nom , le territoire d’Elnbo-
gen, le cercle de Saatz, & une partie de celui de
Leutmeritz. (.Di G.')
Nous remarquerons du fujet de Gafpard ïmif-
thius que, fuivant Bayle * ce fut dans une forêt près
de Rotembourg, en Franconie, à 80 lieues dEgra *
que ce poëte fut affaflïné. ( C. )
EGRAINER ou EGRENER * ( <5côn. ) faire
tomber les graines Ou les grains. O n égraine les épis
en les froiffant dans les mains. On égraine, ou plus
communément* on égrappe les raifins, afin que le
"Vin foit plus délicat. ( - f )
§ EGRAPPER* v. a â . ( Jardinage. ) On fait àû-
lourd’h u i, par une longue expérience que là
'X o trie l i t
Ë H R *770
gîàppê qui iejourne darts là êuvü aVeè les grains dê
raifin poyÉ y fermenter } huit âu éiütivateut de deux
façons ; I°; 'elle àbforbé du boit le vint elle lui
communique un goût âprë * éitrêmément défagréa-
ble. Les perfonnes intelligentes mettent une grillé
de boiS*fur leurs cuves ; on jette fur ces grilles le&
raifins entiers, & pour lors ùn manoeuvre, avéc lé
dos d’un rateau, foule ces raifins pour les écrafef
pour féparer les grains ; ertfuite avec les dents dd
râteau il enleve la grappe & la jette ert tas pour lé
fermiér, qui ne pôuvant riért en retirer, la jette fut
le fumier : telle eft l’idée du plan de l’égrappoir St
de fon ufagé. Quelques perfortrtes mettent fous la
grille de l’égrappoir une groffe toile pour filtrer lé
yirt , & pour retenir les pépins & la pellicule du raifin.
Il eft certain que les pépins donnent auffi uri
mauvais goût au vin * Sc là pellicule du raifin fert
véritablement à Colorier le virt, mais elle l’âffôiblit:
Depuis peu l’on eft eh ufage dans certains cantons
de l’Europe, de fouler le pépin poiir eh retirer dé
l’huile. ( y. A . L. )
ÉGREMONT , ( Géogr S) ville maritime d’Àngle*
terre * dans la province de Cumberland * fiir uné
petite riviere que l’on y paffe fur deux ponts. Elle à
un^poft qui n’eft fréquenté que par des barques, un
ehâtëau qui tombe en ruine* & le titre de comté *
dont un iord de la famille de Windarti eft revêtu.
Long. 14, 20 , ïat. 6 4, jà i ( D. G .)
' EGRILLOIR, ( Pêche. ) grille faite de plufieurs
piéux fiches & lies enfemble , qu’on met àu-deffous
d’un étang, Ou dans les petites rivières, pour làiffer
paffer les eaux , & empêcher cependant que le poif-
fort né forte. Si la fituâtion de Ÿégrilloir étoit fort
baffe, On jiourroit * en vuidant plus qu moins les
eaux d’ùn étang, prendre urte grande partie du poif-
fon qui. s’y nourrit ; après quoi l’on fourniroit de
nouvelle eau à ces étangs ou baffins, par quelque
canal ou conduite. ( + )
EGRISEE, ( terme de Diamantaire.) Lés lapidaire^
donnent ce nom à la poudré de diamans noirs, dont
cm fe fert pour ufer lés bords des autres diâmans*
& pour ert adoucir les inégalités des facettes, (-f-)
Ë H
§ ËHINGEN, ( Géogr. ) ndni de deux villes d’Àfe
iemagne ? dans le cercle de Suabe, & dans lés Etats
de l’Autriche antérieure; L’une eft fituée dans l’Or-
tenau fur le Danubé * & l’autre dans la partie inférieure
du comté de Hohenberg fur le Necleer. La
première incendiée l’ân 1749, a un couvent dé filles
hobles * de l’ordre de S. Benoît ; & la fécondé a un
chapitre de chanoines de S. Maurice * eompofé d’un
prévôt & de douze autres membres. ( D. G. )
EHRENBERG, (Géogr. ) place forte d'Allemagne,
dans le cercle d’Autriche & dans le T ÿ r o l, aux
frontières dé Suabe. Les troupes de la ligue dé
Smalcade s’en emparerent i’an 1546, & celles dé
l’éle&eür Maurice de Saxe l’an iç S i. Le premier'
de ces évértemens n?eut pas de fuite ; maïs l’autre *
accompagné de la prife d’Infprucfc, Contribua beaucoup
à la paix de Paffau* figrtée la même année;
Ehrenberg d’ailleurs eft chef-lieu d’une feigneürie *
oùfont compris le vallon du Lech * le bourg dé Reita
ou Reutert, Sc le village de Lermofs, où mourut $
fuivant quelques hiftoriens, & non pas à Brëttén eri
Bavière * comme d’autres le prétendent, l’empereur
Lothâire II, revenant d’Italie, l’an 1x37. ( D . G. )
EHRENBREITSTEN, ( Géogr. )fortereflè d’Allemagne
, dans le cercle du bas-Rhin Sc dans l’arché-
Veché de TreveS, .vis-à-vis de Coblentz ; elle eft
élevée fur un rOch'ef * d’où elié commande le Rhiri
& la Mofellé, Sc dans lequel ort à eréufé un puits de
i8o pieds-de profondeur. A fes pieds eft un palais à
F F f f f ij