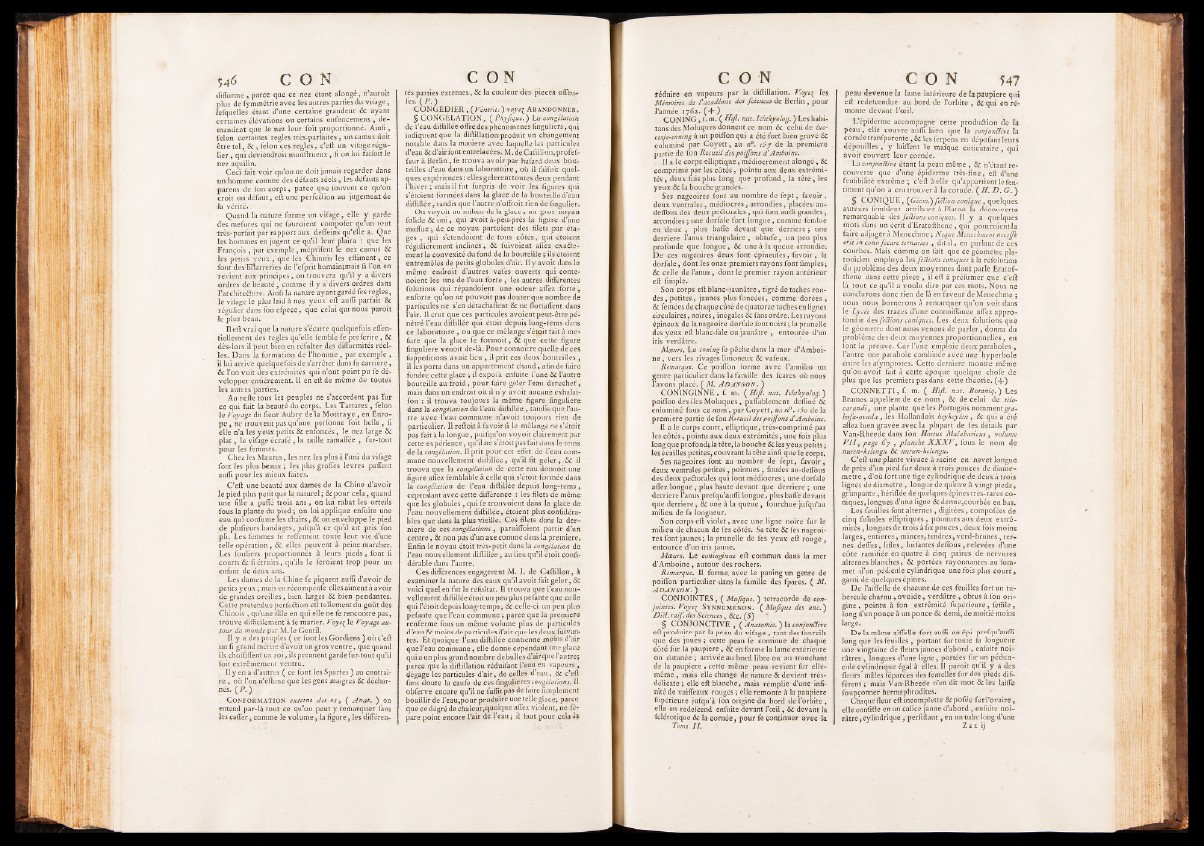
difforme , parce que ce nez étant alongé, n’auroit
plus de fy mmétrie avec les autres parties du vifage,
lefquelles étant d’une certaine grandeur 6c ayant
certaines élévations ou certains enfoncemens , de^-
mandent que le nez leur foit proportionné» Ainfi,
félon certaines réglés très-parfaites, un camus doit
être tel, & , félon ces réglés, c’eft un vifage régulier
, qui deviendroit monftrueux, li on lui faifoit le
nez aquilin.
Ceci fait voir qu’on ne doit jamais regarder dans
un homme comme des defauts reels, les defauts ap-
parens de fon. corps, parce que. fouvent ce qu’on
croit un défaut, eft une perfection au jugement de
la vérit'éi $ •
■ Quand la nature forme un vifage, elle y garde
des mefures qui ne fatiroient compofer cju’un tout
■ très-parfait par rapport aux deffeins qu’elle a. Que
les hommes en jugent Ce qu’il leur plaira : que les
François , par exemple * méprifent le nez camus 6c
les petits yeux , que les Chinois les eftiment, ce
font dês-'Bîfârreriès de refprit humainjmais li l’on en
revient aux principes, on trouvera qu’il y a divers
ordres de beauté, comme il y aNdivers ordres dans
Tarchiteélure. Ainfi la nature ayant gardé fes réglés,
le vifage le plus laid à nos yeux eft auffi parfait 6c
-régulier dans foh efpece, que celui qui nous paroît
-le plus beau.
Il eft vrai que la nature s’écarte quelquefois effen-
tiellement des réglés qu’elle femble fe prefcrire, &
dès-lors il peut bien en réfuiter des difformités réelle
s . Dans la formation de l’homme , par exemple ,
il lui arrive quelquefois de s’arrêter dans fa carrière,
6c l’on voit des extrémités qui n’ont point pu fe développer
entièrement. Il en eft de même de toutes
les autres parties.
Au refte tous le$ -peuplés ne s’accordent pas fur
ce qui fait la beauté du corps. Les Tartares , félon
le Voyage du fieur Aubry de la Mottraye , en Europe
, ne trouvent pas qu’une perfônne foit belle , fi
elle n’a les yeux petits & enfoncés, le nez large &
plat, le vifage écrafé, la taille ramaffée , fur-tout
pour les femmes.'
Chez les Maures, les nez les plus à l’uni du vifage
font les plus beaux ; les plus groffes levres paffent
auffi pour les mieux faites.
C’eft une beauté aux dames de la Chine d’avoir
le pied plus petit que le naturel ; 6c pour cela, quand
une fille a paffé trois ans, on lui rabat les orteils
fous la plante du pied ; on lui applique enfuite une
eau qui confume les chairs, & on enveloppe le .pied
de plufieursbandages, jufqu’à ce qu’il ait pris fon
pli. Les femmes fe reffentent toute leur vie d’une
telle opération, 6c elles peuvent à peine marcher.
Les fouliers proportionnés à leurs pieds, font fi
courts & fi étroits, qu’ils le feroient trop pour un
enfant de deux ans.
Les dames de la Chine fe piquent auffi d’avoir de
petits yeux ; mais en récompenfe elles aiment à avoir
de grandes oreilles, bien larges 6c bien pendantes.
Cette prétendue perfection eft tellement du goût des
Chinois , qu’une fille en qui elle ne fe rencontre pas,
trouve difficilement à fe marier. Voyeq_ le Voyage autour
du monde par M. le Gentil.
Il y a des peuples ( ce font les Gordiens ) oit c’eft
un fi grand mérite.d’avoir un gros ventre, que quand
ils choififfent un ro i, ils prennent garde fur-tout qu’il
foit extrêmement ventru.
. Il y en a d’autres ( ce font les Spartes ) au contraire
, oit l’on n’eftime que les gens maigres 6c décharnés.
( P. )
Conformation externe des os, ( Anat. ) on
entend par-là tout ce qu’on peut y remarquer fans
les caffer, comme lé volume, la figure, les différenr
tes parties externes, & la couleur dès pièces offêu-i
fes. ( P. )
CONGÉDIER , ( Vénerie. ) voye{ Ab andonner»
§ CONGÉLATION, ( Phyjique.) La congélation
de l’eau diftillée offre des phénomènes finguliers, qui
indiquent que la diftillation; produit un changement
notable dans la maniéré avec laquelle les particules
d’eau 6c d’air font entrelacées» M. de CaltiLlo.n,:profef-
feur à Berlin, fe trouva avoir par hafard deux boUr
teilles d’eau dans un laboratoire, où il faifoit quelques
expériences: ellesgelerenttoutes deux pendant
l’hiver; mais il fut furpris de voir les figures qui
s’étoient formées dans la glace de la bouteille d’eau
diftillée, tandis que l’autre n’offroit rien de fingulier.
Oii voyoit au milieu de la glace , un gros noyait
folide 6c uni, qui avoità-peu-près la figure d’une
maffue ; de ce noyau partoient des filets par étages
, qui s’étendoient de tous côtés, qui étoient
régulièrement inclinés, 6c fuivoient allez exactement
la convexité du fond de la bouteille ; ils étoient
entremêlés de petits globules d’air. Il y avoit dans le
même endroit d’autres vafes ouverts qui conte-
noient les uns de l’eau forte , les autres différentes
folutions qui répandoient une odeur affez forte,
enforte qu’on ne pôuvo'it pas douter que nombre de
particules ne s’en détachaffent 6c ne fiottaffent dansi
l’air. Il crut que ces particules avoient pèut-.être.pé*
nétré l’eau diftillée qui étoit depuis long-tems dans
ce laboratoire, ou que ce mélange s’étjsit tait à me*
fure que la glace fe formoit, 6c que cette figure
finguliere venoit de-là. Pour connoître quelle de ces
fuppefitions avoit lieu , il prit ces deux bouteilles ;
il les porta dans un appartement chaud, afin de faire
fondre cette glace ; il expol'a enfuite l’une 6c l’autre
bouteille au froid, pour faire geler l’eau derechef *
mais dans un endroit où il n’y avoit aucune exhalai-
fon : il trouva toujours la même figure finguliere
dans la congélation de l’eau diftillée , tandis que l’autre
avec l’eau commune n’avoit toujours rien de
particulier. Il reftoit à favoir fi le mélange ne s’étoit
pas fait à la longue, puifqu’on voyoit clairement par
cette expérience, qu’il ne s’étoit pas fait dans le tems
de la congélation. Il prit pour cet effet de l’eau commune
nouvellement diftillée, qu’il fit geler, & il
trouva que la congélation de cette eau donnoit :uné
figure auez femblable à celle qui s*étoit formée dans
la congélation de l’eau-diftillée depuis long-tems ,
cependant avec cette différence : les filets de même
que les globules, qui fe trouvoient dans la glace de
l’eau nouvellement diftillée , étoient plus confidéra-
bles que dans la plus vieille. Ces filets dans la dernière
de ces congélations , paroiffoient partir d’un
centre, & non pas d’un axe comme dans la première»
Enfin le noyau étoit très-petit dans la congélation de
l’eau nouvellement diftillée, au lieu qu’il étoit considérable
dans l’autre.
Ces différences engagèrent M. J. de Caftillon, à
examiner la nature des eaux qu’il avoit fait geler, 6c
voici quel en fut le réfultat. Il trouva que l’eau nouvellement
diftillée étoit un peu plus pefante que celle
qui l’étoitdepuis long-temps, 6c celle-ci un peu plus
pefante que l’eau commune ; parce que la première
renferme fous un même volume plus de particules
d’eau 6c moins de particules d’air que les deux fui vantes.
Et quoique l’eau diftillée contienne moins d’air
que l’eau commune, elle donne cependant une glace
qui a un plus grand nombre de bulles d’air que l’autre;
parce que la diftillation réduifant l’eau en vapeurs ,
dégage les particules d’air, de celles d’eau, 6c c’eft
fans doute la caufe de cesfingulieres congélations. Il
obferve encore qu’il ne fuffit pàs de faire fimplement
bouillir de l’eau,pour produire une telle glace; parce
que ce dégré de chaleur,quoique affez violent, ne fe-
pare point encore l’air de 1 eau; il faut pour cela ia
féduire en vapeurs par la diftillation. Voyei les
Mémoires de C académie des fdences de Berlin , pour
l’année 1762. ( + ) _
CONING, f. m. ( Hifl. mot. Ichthyolog. ) Les habi-
tans des Moluques donnent ce nom 6c celui de luc-
cesje-coning à un poiffon qui a été fort bien gravé 6c
enluminé par C o y e tt, au n°.. 16y de la première
partie de fon Recueil despoijjons d!Amboine.
Il a le corps elliptique, médiocrement alongé, 6c
comprimé par les côtés, pointu aux deux extrémités,
deux.fois plus long que profond, la tête, les
yeux & la bouche grandes.
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir .
deux ventrales , médiocres, arrondies, placées au-
deffous des deux pe&orales , qui font auffi grandes-,
arrondies ; une dorfale fort longue, comme fendue
en ’deux , plus baffe devant que derrière ; une
derrière l’anus triangulaire, obtufe, un peu plus
profonde que longue, 6c une à la queue arrondie.
D e ces nageoires deux font épineufes, favbir, la
dorfale, dont les onze premiers rayons font fimples;
6c celle de l’anus , dont le premier rayon antérieur
eft fimple..
Son corps eft blanc-jaunâtre, tigré dé tachés rondes
,• petites, jaunes plus foncées, comme dorées,
& femées de chaque côté de quatorze taches en lignes
circulaires, noires, inégales 6c fans ordre. Les rayons
épineux de la nageoire dorfale font noirs ; la prunelle
des yeûx eft blanc-fale ou jaunâtre , entourée d?un
iris verdâtre.
Moeurs. Le coning fe pêche dans la mer d’Amboi-
n e , vers les rivages limoneux ôc vafeux.
Remarque. Ce poiffon forme avec l ’anniko un
genre particulier dans la famille des feares oit nous
l’avons placé. ( M. A d a n s o n . )
CONINGINNE , f. m. ( Hift. nat. Ichthyolog. )
poiffon des îles Moluques, pafl'ablement deffiné 6c
enluminé fous ce nom', par Coyett, au n°. i5o de la
première partie de fon Recueil des poijjons d?Amboine.
Il a le corps court, elliptique, très-comprimé par
les.côtés, pointu aux deux extrémités, une fois plus
long que profond; la tête, la bouche 6c les yeux petits ;
les écailles petites, couvrant la tête ainfi que le corps»
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir,
deux ventrales petites, pointues , fituées au-dëffôtis
des deux peCtorales qui font médiocres ; une dorfale
affez longue , plus haute devant que derrière ; une
derrière l’anus prefqu’auffi longue, plus baffe devant
que derrière, 6c une à la queue, fourchue jufqii’au
milieu de fa longueur.
Son corps eft violet, avec une ligne noire fur lé
milieu de chacun de fes côtés. Sa tête 6c fes nageoires
font jaunes ; la prunelle de fes yeux eft rouge ,
entourée d’un iris jaune.
Moeurs. Le eoninginne eft commun dans la mer
d’Amboine, autour des rochers.
Remarque. Il forme, avec le paning un genre de
poiffon particulier dans la famille des fpares. ( M.
A d a n s o n . )
CONJOINTES, ( Mujîque. ) tetracorde de conjointes.
Voye{ SYNNEMENON. ( Mujîque dés anc. )
Dicl. raif. des Sciences, 6cc. (S') " *
§ CONJONCTIVE, ( Anatomie. ) la conjonctive
eft produite par la peau du vifage , tant des fourcils
que des joues ; cette peau fe continue de chaque
côté fur la paupière, 6c en forme la lame extérieure
ou cutanée ; arrivée au bord libre ou au tranchant
de la paupière , cette même peau ■ revient fur èllé-
même , mais elle change de nature & devient très-
délicate ; elle eft blanche, mais remplie d’une infinité
de vaiffeaux rouges ; elle remonte à la paupière
fupérieure jufqu’à fon origine du bord de l’orbite ,
elle en redefeend enfuite devant l’oe il, 6c devant la
felérotique 6c la cornée, pour fe continuer avec la
Tonie II.
peau devenue la lame intérieure de la paupière qui
eft redefeendue au bord de l’orbite , 6c qui en ré*
monte devant l’oeil.
L’épiderme accompagne cette production de lâ
peau, elle couvre auffi bien que lâ conjonctive la
cornée tranfparente, 6c lesferpens en dépofant leurs
dépouilles', y laiffent le mafque cuticutâire , qui
avoit couvert leur cornée.
La conjorictive étant la peâu même , 6C n’étant re*
couverte que d’une épiderme très-fine, eft d’une
fenfibilité-extrême ; c’eft à elle qu’appartient le fen-
timent qu’on a cru trouver à la cornée. ( H. D . G. )
§ CONIQUE, (Géom.jfeclion conique , quelques
auteurs fèmblent attribuer à Platon la découverte
remarquable des ferions coniques. Il y a-quelques
mots dans un écrit d’Eratofthene, qui pourroient la
faire adjuger à Menechme ; Neque Menechmeos ne “ f l
erù in cono fecare ternarios , dit-il, en parlant de ces
courbes. Mais comme on fait que ce géomètre platonicien
employa les feclions coniques à la réfolution
du problème des deux moyennes dont parle Eratof-
thèn'e dans cette pièce , il éft à préfumer que c ’eft:
là tout ce qu’il a voulu dire par ces mots. Nous ne
conclurons donc rien de là en faveur de Menechme ;
nous nous bornerons à remarquer qu’on voit dans
le Lycée des traces d’une connoiffance affez approfondie
des feclions coniques. Les deux folutions que
le géomètre dont nous venons de parler, donna du
problème des deux moyennes proportionnelles, en
font la preuve. Car l’une emploie deux paraboles ,
l’autre une parabole combinée avec une hyperbole
entre les afyrtiptotes. Cette derniere montre même
qu’on avoit fait à cette époque quelque chofe de
plus que les premiers pas dans cette théorie. (4-)
CONNETTI, f. m. ( Hiß. nat. Botaniq.') Les
Brames appellent de ce nom , 6c de celui de tilo•
carandi, une plante que les Portugais nommentgra-
bofa-ovàda , les Hollandois heykeylên, 6c qui a été
affez bien gravée avec la plupart de fes détails par
Van-Rheede dans fon Hortus Malabaricus, volume
V I I , page €y , planche X X X V , ions le nom de
nuren-kelengu 6c nurun-kelerigu.
C ’eft une plante vivace à racine en navet longue
de près d’un pied, fur-deux à trois pouces de diame-
metre , d’où fort une tige cylindrique de deux à trois
lignes de diamètre , longue de quinze à vingt pieds,
grimpante, hériffée de quelques épines très-rares coniques,
longues d’une ligne & demie,courbée en bas.
Les feuilles font alternes, digitées, compofées de
cinq folioles elliptiques , pointues aux deux extrémités
, longues de trois à fix pouces, deux fois moins
larges, entières, minces, tendres, verd-brunes , ternes
deffus, liffes, luifantès deffous , relevées d’une
côte ramifiée en quatre à cinq paires de nervure-s
alternes blanches, 6c portées rayonnantes au fom-
met d’un pédicule cylindrique une fois plus court,
garni de quelques épines.
De l’aiffelle de chacune de ces feuilles fort un tubercule
charnu , ovoïde, vetdâtre , obtus à fön origine
, pointu à fön extrémité fupérieure, feffile ,
long d’un pouce à un pouce & demi, de moitié moins
large.
De la même aiffelle fort auffi uft épi prèfqu’auffi
long que les feuilles , portant fur toute fa longueur
une vingtaine de fleurs jaùnes d’abord , enfuite noirâtres
, longues d’une ligne, portées fur un pédoncule
cylindrique égal à elles. Il paroît qu’il y a des
fleufs mâles fépaféës des femelles fur dés pièds dif-
férens ; mais Van-Rheéde n’eii dit mot 6c les laiffe
foupçonner hermaphrodites.
Chaque fleur eft incomplette &pôfée fur l’ovaire,
elle confifte en un eâlicë jaune d’abord, ‘enfuite noirâtre
, cylindrique,- perfiftant, en un tube long d’une
Z z z i j