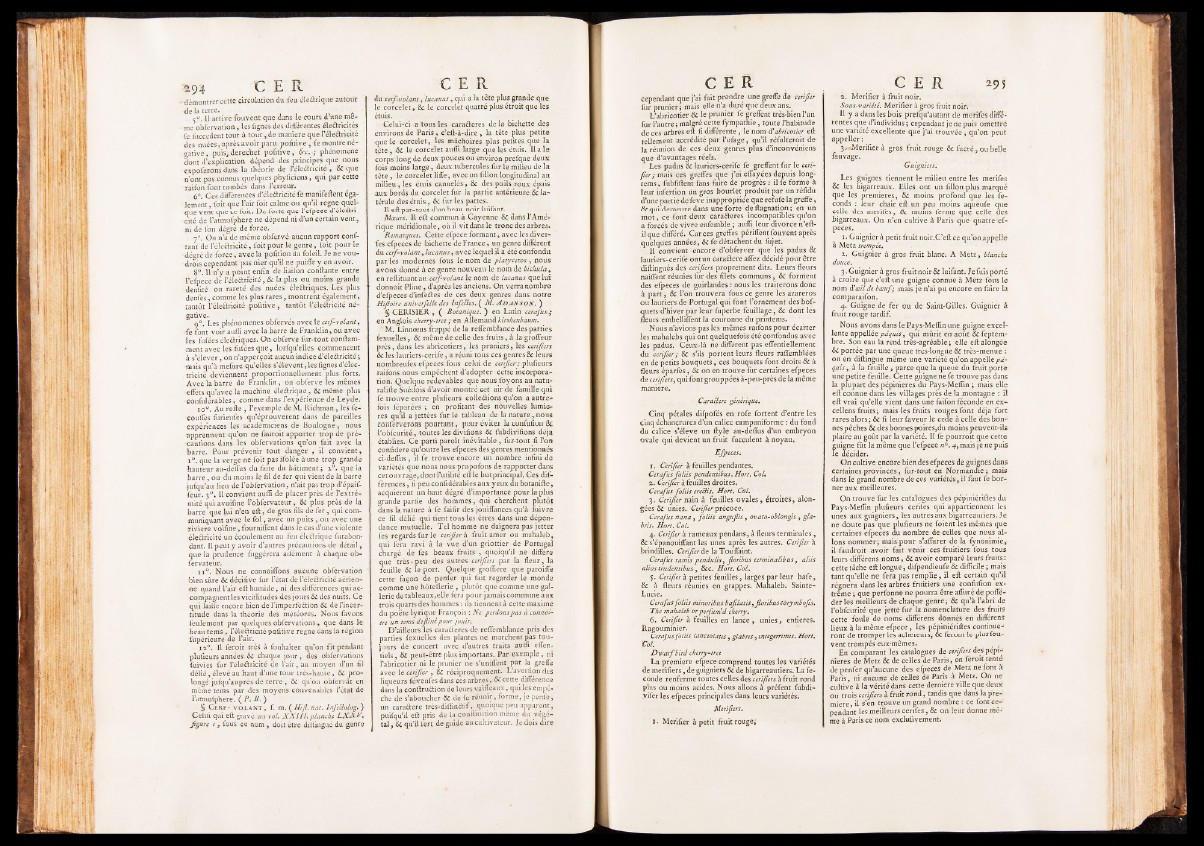
^94 C E R
démontrer cette circulation du feu éleârique autour
de la terre.
5?. Il arrive fouvent que dans .le-cours d une meme
obfervation, les fignes des différentes éle&rkités
fe fuecedent tour à tour,de maniéré quel’éle&ricité
des nuées, après avoir paru.pofitive , fe montre négative,
puisjderechef pofitive, &c.-; phénomène
dont d’explication dépend des principes que npus
expoferons dans la théorie de Téleélricite , 6c que
n’ont pas conpus .quelques phyficiens , qui par cette
• raifon font tombes dans 1 erreur.
6°. Ces différences d’éleûricité fe manifeftent également
, foit que l’air fait calme ou qu’il regne quel- ”
que vent que ce foit. De forte que l’efpece d’éleétri-
cité de l’atmofphere ne dépend ni d’un certain vent,
ni de l’on dégré de force. '
y?. On n’a de même obferve aucun rapport confiant
de l’éleâricité, foit pour le genre, foit pour le
dégré de force, avec la pofition du foleil. Je ne vou-
■ drois cependant pas nier qu’il ne puiffe y en avoir.
8°. Il n’y a point enfin de Iiaifon confiante entre
l’efpece de l’éleûricité, 6c Ja plus ou moins grande
denfité ou rareté des nuées éleétriqués. Les plus
denfes, comme les plus rares, montrent également,
-tantôt l’éleétrieité pofitive , tantôt l ’éleétricité négative.
o°. Les phénomènes obfervés avec le cef-volant,
f e font voir aufîi avec la barre de Franklin, ou avec
les fufées éleétriques. On obferve fur-tout conftam-
ment avec les fufées que, lorfqu’elles commencent
à s’élever, on n’apperçoit aucun indice d’éleélricité ;
mais qu’à mefure qu’elles s’élèvent, les fignes d’élec-
.tricité deviennent proportionnellement, plus forts.
Avec la barre de Franklin, on obferve les mêmes
effets qu’avec la machine éleélrique, 6c même plus
•confidérables, comme dans l’expérience de Leyde.
IO°. Au reffe , l’exemple de M. Richman, les fe-
couffes furieufes qu’éprouverent dans de pareilles
expériences les académiciens de Boulogne-, nous
apprennent qu’on ne fauroit apporter trop de précautions
dans les obfervarions qû’on fait avec la
barre. Pour prévenir tout danger , il convient,
i° . que la verge ne foit pas ifolée à une trop grande
hauteur au-deflus du faîte du bâtiment ; i° . que la
barre, ou au moins le fil de fer qui vient de la barre
jufqu’au lieu de l’obfervation, n’ait pas trop d’épaif-
feur. 3°. Il convient aufli de placer près de l’extrémité
qui avoifine l’obfervateur, 6c plus près de la
barre que lui n’en eft, de gros fils de fe r , qui communiquant
avec le fo l , avec un puits , ou avec une
riviere voifine, fourniffent dans le cas d’une violente
éleftricité un écoulement au feu éleélrique furabon-
dant. Il peut y avoir d’autres précautions de détail,
que la prudence fuggérera aifément à chaque ob-
fervateur.
i i °. Nous ne connoiffons aucune obfervation
bien sûre & décifive fur l’état de l’éleélricité aerienne
quand l’air eft humide, ni des différences qui accompagnent
les viciflitudes des jours & des nuits. Ce
qui laitfe encore bien de l’imperfeélion 6c de l’incertitude
dans la théorie des météores. Nous favons
feulement par quelques obfervations,, que dans le
beau tems , l’éleftricité pofitive regne dans la région
fupérieure de l’air.
12°. Il feroit trè$ à fouhaiter qu’on fit pendant
plufieurs années 6c chaque jour , des obfervations
fuivies fur l’éleélricité de l’air, au moyen d’un fil
délié, élevé au haut d’une tour très-haute, 6c prolongé
jufqu’auprès de terre , 6c qu’on obfer-vât en
même tems par des moyens convenables l’état de
l’atmofphere. ( P. B. )
§ C erf - v o l a n t , f. m. ( Hift. nat. Infeclolog. )
Celui qui eft gravé au vol. JCX11L planche LX X V .
ßgure i , fous ce nom, doit être diltingué du genre
C E R
du cerf-volant, lucanus, qui a la tête plus grande que
le corcelet, 6c le corcelet quatre plus,étroit que les
étuis.
Celui-ci a ;tOusles caraéteres delà bichette des
environs de Paris, c’eft-à-dire , la tête plus petite
que le corcelet, les mâchoires plus petites que la
tpte, 6c le corcelet aufli large .que les étuis. Il a le
corps long de deux pouces ou environ prefque deux
fois moins large, deux tubercules fur le milieu de la
tê te , le corcelet liffe, avec un fillon longitudinal au
milieu-, les étuis cannelés, 6c des poils roux épais
aux bords du corcelet fuir la partie antérieure 6c latérale
des étuis, 6c fur les pattes.
Il eft par-tout d’un beau noir luifant.
Moeurs. Il eft commun à Cayenne 6c dans l’A métrique
méridionale, ©h il v it dans le tronc des arbres^
Remarques. Cette efpece formant, avec les.diver-
fes efpeces de bichette de France, un genre différent
du cerf-volant, lucanus-, avec lequel il a été confondu
par les modernes fous le nom de platycer.os , pous
avons donné à ce genre nouveau Le nom de hichula ,
en reftituantau cerf-volant le nom de lucanus que lui
donnoit Pline, d’après les anciens. On verra nomhre
d’efpeces d’infeéles de ces deux genres dans notre
Hijloire univerfelle des Infectes. ( M. A d an s o n . )
§ CERISIER , ( Botanique. ) en Latin cerafus4
en Anglois cherry-tree ; en Allemand kirshtnbaum.
‘ M. Linnoeus frappé de la reffemblaiïce des parties
fexuelles, 6c même de celle des fruits , à la groffeur
près, dans les abricotiers, les pruniers, les cerijiers
6c les'lauriers-cerife, a réuni tous ces genres.& leurs
nombreufes efpeces fous celui de cerijief; plufieurs
raifons nous empêchent d’adopter cette incorporation.
Quelque redevables que nous foyons au natu>
ralifte Suédois d’avoir montré cet air de famille qui
fe trouve entre plufieurs collections qu’on a autre»
fois féparées ; en profitant des nouvelles lumières
qu’il a jettées fur le tableau de la nature, nous
conferverons pourtant, pour éviter la confiifion 6c
l’obfcurité, toutes les divifions 6c fubdivifions déj$
établies. Ce parti paroît inévitable , fur-tout û l’ob
confidere qu’outre les efpeces des genres mentionnés
ci-deflus , il fe trouve encore un nombre infini de
variétés que nous nous propofons de rapporter dans
cet ouvrage, dont l’utilité eft le butprincipal. Ces différences
, fi peu confidérables aux yeux du botanifte,
acquièrent un haut dégré d’importance pour la plus
grande partie des hommes, qui cherchent plutôt
dans la nature à fe faifir des jouiffances qu’à fuivre
ce fil délié qui tient tous les êtres dans une dépendance
mutuelle. T el homme ne daignera pas jetter
fes regards fur le cerifier à fruit amer ou mahaleb,
qui fera ravi à la vue d’un griottier de Portugal
chargé de fes beaux fruits , quoiqu’il ne différé
que très - peu des autres cerijiers par la fleur , la
feuille 6c le port. Quelque grofliere que paroiffe
cette façon de penfer qui fait regarder le monde
comme une hôtellerie , plutôt que comme une gal-
lerie de tableaux,elle fera pour jamais commune aux
trois quarts des hommes : ils tiennent à cette maxime
du poète lyrique François : Ne perdons pas à connaître
un tepis defiiné pour jouir.
D’ailleurs les caraéteres de reffemblance pris des
parties fexuelles des plantes ne marchent pas toujours
de concert avec d’autres traits aufli eflen*
tiels, 6c peut-être plus importans. Par exemple , ni
l’abricotier ni le prunier ne s’uniflent par la greffe
avec le cerifier , 6c réciproquement. L’averfion des
liqueurs féveufes dans ces arbres, 6c cette différence
dans la conftruétion de leurs vaiffeaux, qui les empê-
! ehe de s’aboucher & de fe réunir, forme,, je penfe ,
| un caraélere très-diftinélif, quoique peu apparent,
puifqu’il eft pris de la çonftuution même du végéta
l, 6c qu’il lert de guide au cultivateur. Je dois dire
C E R
cependant que j’ai fait prendre une greffe de cerifier
fur prunier; mais elle n’a di\ré que deuxans.^
L’abricotier 6c le prunier fe greffent très-bien l’un
fur l’autre ; malgré cette fympathie, toute l’habitude
de ces arbres eft fi différente, le nom d’abricotier eft
tellement accrédité par l’ufage, qu’il réfulteroit de
la réunion de ces deux genres plus d’inconvéniens
que d’avantages réels.
Les padus & lauriers-cérife fe greffent fur le ceri-
fier; mais ces greffes que j’ai effayées depuis long-
tems, fubfiftent fans faire de progrès : il fe formé à
leur infertion ün gros bourlet produit par un réfîdu
d’une partie de feve inappropriée que refufe la greffe,
& qui demeuré dans une forte de ftagnation ; en un
mot, ce font deux carâéteres incompatibles qu’on
a forcés de vivre enfemble ; aufli leur divorce n’eft-
ilque différé. Car ces greffes périffent fouvent après
quelques années, & fe détachent du fujet.
Il convient: encore d’obferver que les padus &
lauriers-cerife ont un cafaCtere affez décidé pour être
diftingués des cerijiers proprement dits. Leurs fleurs
naiffent réunies fur des filets communs, 6c forment
des efpeces de guirlandes : nous les traiterons donc
à part, & l’on trouvera fous ce genre les azareros
ou lauriers de Portugal qui font l’ornement des bof-
quets d’hiver par leur fuperbe feuillage, 6c dont les
fleurs embelliffent la couronne du printems.
Nous n’avions pas les mêmes raifons pour écarter
les mahalebs qui ont quelquefois été confondus avec
les padus. Ceux-là ne different pas effentielleMent
du cerifiér; 6c s’ils portent leurs fleurs raffemblées
en de petits bouquets, ces bouquets font droits 6c à
fleurs éparfes j & on en trouve fur certaines efpeces
de cerijiers, qui font grouppées à-peu-près de la même
maniéré.
Caractère générique.
Cinq pétales difpofés en rofe fortent d’entre les
cinq échancrures d’un calice campaniforme : du fond
du calice s’élève un ftyle au-deflus d’un embryon
ovale qui devient un fruit fucculent à noyau.
Efpecesi
i . Cerner à feuilles pendantes.
Cerafus foliis pendentibus. Hort. Col,
а. Cerifier à feuilles droites*
Cerafus foliis erectis. Hórt. CóL
3. Cerifier nain à feuilles ovales, étroites, alon-
gées 6c unies. Cerifier précoce.
Cerafus nana , foliis angujtis, ovato-oblongis, gla-
bris. Hort. Colt
4. Cerifier à rameaux pendans, à fleurs terminales,
& s’épanouiffant les unes après les autres. Cerifier à
Brindilles. Cerifier de laTouffaint.
Cerafus ramis pendulis, JLoribus terminalibus, aliis
alios trudentibus , &C. Hort. Cól.
5. Cerifier à petites feuilles, larges par leur bafe,
& à fleurs réunies en grappes. Mahaleb. Sainte-
Lucie*
Cerafus foliis minoribtti bajilatis, jloribus côrymbojis.
The mahaleb or perfurrjd cherry.
б. Cerifitr à feuilles en lance, unies4 entières.
Ragouminier:
Cerafus foliis Idhceolatis, glabris, integenimisi Hort.
Vol.D
wdrf bird cherry-trec
La première efpece comprend toutes les variétés
de merifiers, de guigniers 6c de bigarreautiers. La fécondé
renferme toutes celles des ceri fiers à fruit rond
plus ou moins acides. Nous allons à préfent fubdi-
yifer les efpeces principales dans leurs variétés;
. Merifieri.
1. Merifier à petit fruit rouge,’
C E R 295
1. Merifier à fruit noir.
Sous-variété. Merifier à gros fruit noir.
Il y a dans les bois prefqu’autànt de inérifes différentes
que d’individus ; cependant jene puis omèttré
une variété excellente que j’ai trouvée, qu’on peut
appeller :
3î*Merifierà gros fruit rôuge 6c fucré, ou belle;
fauvage.
Guigniers'.
Les guigties tiennent le milieu entre les merifes
6c les bigarreaux. Elles ont un fillon plus marqué
que les premières, 6c moins profond que les féconds
: leur chair eft un peu moins aquëufé que
celle des merifes, 6c moins ferme que celle des
bigarreaux. On n’en cultive à Paris que quatre-'ef-
peces*
1. Guignier à petit fruit noir.C’eft ce qu’on appelle
à Metz trempée.
2. Guignier à gros fruit blanc. A Metz, blanchi
douce.
3. Guignier à gros fruit noir & luifant. Je fuis porté
à croire que c’eft une guigne connue à Metz fous le
nom d’oeil de boeuf; mais je n’ai pu encore en faire là
comparaifon.
4. Güigne de fer ou de Saint-Gilles. Guignier à
fruit rouge tardif*
Nous avons dans le Pays-Meflin une guigne excellente
appellée pâquis, qui mûrit en août 6c feptem-
bre. Son eau la rend très-agréable; elle eft alongée
6c portée par une queue très-longue 6c très-menue :
on en diftingue même une variété qu’on appelle pâ-
quis, à la feuille , parce que la queue, du fruit porte
une petite feuille* Cette guigne ne fe trouve pas dans
la plupart des pépinières du Pays-Meflin ; mais elle
eft connue dans les villages près de la montagne : il
eft vrai qu’elle vient dans une faifon féconde en ex-
cellens fruits; mais les fruits roüges font déjà fort
rares alors; 6c fi leur faveur le eede à celle des bonnes
pêches 6c des bonnes poires,du moins peuvent-ils
plaire au goût par la variété. Il fè pourroit que cette
guigne fut là même que l’efpece n°. 4, mais je ne puis
le décider*
On cultive encôre bien des efpeces de guignes dans
certaines provinces, fur-tout en Normandie ; mais
dans le grand nombre de ces variétés, il faut fe borner
aux meilleures.
On trouve fur les catalogues des pépiniériftes du
Pays-Meflin plufieurs ceriles qui appartiennent les
unes aux guigniers, les autrésaux bigarreautiers. Je
ne doute pas que plufieurs ne foierit les mérites que
certaines efpeces du nombre de celles que nous allons
nommer; mais pour s’affurer de la fynonimie^
il faudroit avoir fait venir ces fruitiers fous tous
leurs différens noms, & avoir comparé leurs fruits:
cette tâche eft longue, difpendieufe 6c difficile ; mais
tant qu’elle ne fera pas remplie, il eft certain qu’il
régnera dans lès arbres fruitiers une confufion extrême
; que perfonriè ne pourra être affuré de poffé-
der les meilleurs de chaque genre; 6c qu’à l’abri de
Fobfcurité que jette fur la nomenclature des fruits
cette foule de noms différens donnés en différens
lieux à la même efpece, les pépiniériftes continueront
de tromper les acheteurs; & feront le plus fouvent
trompés eux-mêmes. . t ;
En comparant les catalogues de cerijiers des pepï^
nieres de Metz & de celles de Paris, on feroit tenté
de penfer qu’aucune des efpeces de Metz ne fönt à
Paris, ni aucune de celles de Paris à Metz. On né
cultive à la vérité dans cette derniérè ville que deux
ôu trois cerifiers à fruit rond, tandis que dans la première,
il s’en trouve un grand nombre : ce font cependant
les meilleurs cerifes, & on leur donne
me à Paris ce nom exclvtfivement.