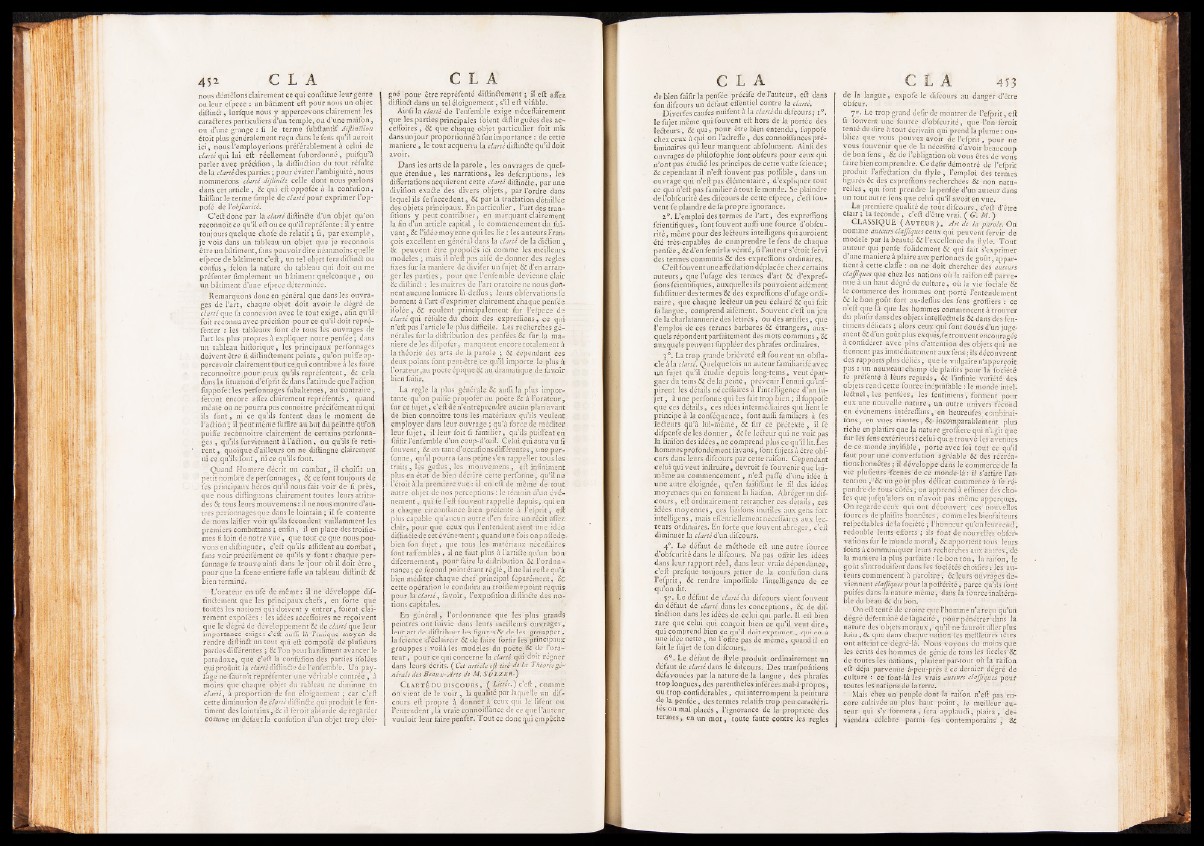
nous démêlons clairement ce qui conftitue leur genre
ou leur efpece : un bâtiment eft pour nous un objet
diftinri , lorfque nous y appercevons clairement les
cararieres particuliers d’un temple, ou d’une maifon,
ou d’une grange : li le terme fubftantif difiincBon
étoit plus généralement reçu dans lé fens qu’il auroit
ic i, nousT’employerions préférablement à celui de
clarté qui lui eft réellement fubordonné, puifqu’à
parler avec précifion ; la diftinûion du tout réfiïfte
de la clarté des parties ; pour éviter l’ambiguité, nous
nommerons clarté dijlincle celle dont nous parlons
dans cet article , R qui eft oppofée à la confufion,
laiflant le terme fimple de clarté pour exprimer l’op-
pofé de l’objcurité.
C ’eft donc par la clarté diftinrie d’un objet qu’on
reconnoît ce qu’il eft ou ce qu’il repréfente : il y entre
toujours quelque chofe de relatif; li, par exemple,
je vois dans un tableau un objet que je reconnois
être un bâtiment, fans pouvoir dire néanmoins quelle
efpece de bâtiment c’eft, un tel objet fera diftinri ou
confus, félon la nature du tableau qui doit ou me
préfenter fimplement un bâtiment quelconque , ou
un bâtiment d’une efpece déterminée.
Remarquons donc en général que dans les ouvrages
de l’art, chaque objet doit avoir le dégré de
clarté que fa connexion avec le tout exige, afin qu’il •
foit reconnu avec précifion pour ce qu’il doit repré-
fenter : les tableaux font de tous les ouvrages de
l’art les plus propres à expliquer notre penfée ; dans
un tableau hiftorique, les principaux perfonnages
doivent être fi diftinftement peints, qu’on puiffe ap-
percevoir clairement fout ce^qui contribue à les faire
reconnoître pour ceux qu’ils repréfentent, R cela
dans la fituatiori d’efpr'it R dans l’attitude que l’ariion
fuppofe : les perfonnages fubaltérnes, au contraire,
feront encore affez clairement repréfentés , quand
même on ne pourra pas connoître précifément ni qui
ils fon t, ni ce qu’ils fentent dans le moment de
l ’ariion ; il peut même fuffire au but du peintre qu’on
puiffe recônnoître clairement de certains perfonnages
, qu’ils furviennent à l’âriion, ou qu’ils fe retirent,
quoique d’ailleurs on ne diftingue clairement
ni ce qu’ils fon t, ni ce qu’ils font.
Quand Homere décrit un combat, il choifit un.
petit nombre de perfonnages, R ce font toujours de
. les principaux héros qu’il nous fait voir de fi près *
que nous diftinguons clairement toutes leurs attitudes
& tous leurs mouvemens : il ne nous montre d’autres
perfonnages que.dans le lointain ; il fe contente
de nous laiffer voir qi>’ils fécondent vaillamment les
premierscombattans ; enfin, il en place destroifie-
mes fi loin de notre vué', que tout ce que nous pouvons
en diftinguer, c’eft qu’ils affilient au combat ,
fans voir précifément ce qu’ils y font : chaque per-
fonnage fe trouve ainfi dans le' jour oii il doit être,
pour que la feene entière faffe un tableau diftinri R
bien terminé.
L’orateur en ufé de même : il ne développe dif-
tinriement que les principaux chefs , en forte qué
toutes les notions qui doivent y entrer, foiént clairement
expofées flès.idées acceffoires ne reçoivent
que le degré de développement R de clarté que leur
importance exige: c’ eft aufli là 'Punique moyen de
rendre diff inri un tout qui eft compolé de plufieurs
parties différentes ; R l’on peut hardiment avancer le
paradoxe, que c’eft la confufion des parties ifoléès
qui produit la clarté diftinrie de l’enfemble. Un pay-
fage ne fauroit repréfenter une véritable contrée , à
itioins que chaque objet du tableau ne diminue en
clarté, à proportion de fon éloignement ; car c ’eft
cette diminution de clartédiftinrie qui produit le fen-
tïment des lointains , & il feroit abfurde de regarder
comme un défaut la confufion d’un objet trop éloigné
pour être repréfenté diftinriement ; il eft affez
diftinri dans un tel éloignement, s’il eft vifible.
Ainfi la clarté de l’enfemble exige n éceflairement
que les parties principales foient diftinguéès des acceffoires
, & que chaque objet particulier foit mis
dans un jour proportionné à fon importance : de cette
maniéré , le tout acquerra la clarté diftinrie qu’il doit
avoir.
Dans les arts de la parole, les ouvrages de quelque
étendue , les narrations, les defcriptions, les
differtations acquièrent cette clarté diftinrie, par une
divifion exade des divers objets, par l’ordre dans
lequel ils fe fuccedent, R par la tradation détaillée
des objets principaux. En particulier, l’art des tran-
fitions y peut contribuér, en marquant clairement
la fin d’un article capital, le commencement du fui-
vant, 6c l’idée moyenne qui les lie : les auteurs François
excellent en général dans la clarté de la didion ,
& peuvent être propofés ici comme les meilleurs
modèles ; mais il n’eft pas aifé de donner des regies
fixes fur la maniéré de divifer un fujet 6c d’en arranger
les parties, pour que l’enfembîe devienne clair
6c diftind : les maîtres de l’art oratoire ne noué donnent
aucune lumière là-deffus ; leurs obfervations fe
bornent à l’art d’exprimer clairement chaque penfée
ifolée, 6c roulent principalement fur l’efpece de
clarté qui réfulte du choix des expreffions, ce qui
n’eft pas l’article le plus difficile. Les recherches générales
fur la diftribution des penfées 6c fur Ia manierede
les difpofer, manquent encore totalement à
la théorie des arts de la parole ; & cependant ces
deux points font peut-être/ce qu’il importe le plus à
l’orateur,au poète épique 6c au dramatique de favoir
bien faifir.
La regie la plus générale R aufli la plus importante
qu’on puiffe propofér au poète 6c à l’orateur,
fur ce fujet, c’eft de n’entreprendre aucun plan avant
de bien connoître tous les matériaux qu’ils veulent
employer dans leur ouvrage ; qu’à force de méditer
leur fujet, il leur foit fi familier, qu’ils puiffent en
faifir l’enfemble d’un coup-d’oeiK Celui qui aura vu fi
fouvenr, & en tant d’occafions différentes., une perfonne,
qu’il pourra fans peine s’en rappeller tous les
traits , les geftes, les mouvemens, eft infiniment
plus en état de bien décrire cette perfonne, qu’il ne
l’étoit à la première vue : il en eft de même de tout
autre objet de nos perceptions : le témoin d’un événement,.
qui f e l’eft fouventrappellé depuis, qui en
a chaque cireonftance bi.en préfente à î’efprit, eft
plus capable qu’aucun autre d’en faire -;un récit affez
clair, pour qué ceux qui l’entendent aient il ne idée .
diftinrie de cet événement ; quand une fois onpoffede-
bien fon fujet, que tous les matériaux néceffaires
font raffemblés , il ne faut plus à l’artifte qu’un bon
difcernement, pour faire la diftribution 6c l’ordon-.
nance ; ce fécond point étant réglé, il ne lui refte qu’à
bien méditer chaque chef principal féparément, 6c
cette opération le conduira au troifieme point requis,
pour la clarté, favoir, l’expofition diftinrie des notions
capitales,
En général-*' l’ordonnance que les' plus grands
peintres ont fuivie dans leurs meilleurs ouvrages,■
leur art de diftribuer les figures R de les gro upper,
la fcience :d’éclaircir 6c de faire fortir lés principaux
grouppes : voilà les modèles du poète R de l’orateur,
pour ce qui concerne la clarté qui doit régner
dans leurs écrits. ( Cet article ejl tiré de'ï'a Théorie générale
des Beaux-Arts de M.SüLZER-')
Clarté du discours, ( Littér.) c’e ft , comme
on vient de le voir , la qualité par laquelle un discours
eft propre à donner à ceux qui le lifent ou
l’ entendent la vraie connoiflance de ce que l’auteur
vouloit leur faire penfer. Tout ce donc qui empêche
de bien faifir la penfée précife de l’auteur, eft dans
fon difcours un défaut effentiel contre la clarté,
Diverfes caufes nuifent à la clarté du difcours; i° .
le fujet même qui fouvent eft hors de la portée des
lerieurs , 6c qui, pour être bien entendu, fuppofe
chez ceux à qui on Fadreffe , des connoiffances préliminaires
qui leur manquent abfolument. Ainfi,des
ouvrages de philofophie font obfcurs pour ceux qui
n’ont pas étudié les principes de cette vafte fcience ;
8c cependant il n’eft fouvent pas pofîible , dans un
ouvrage qui n’eft pas élémentaire, d’expliquer tout
ce qui n’eft pas familier à tout le monde. Se plaindre
de l’obfcurité des difcours de cette efpece, c’eft fouvent
fe plaindre de fa propre ignorance.
2°. L’emploi des termes de l’art, des expreffions
fcientifiques, font fouvent aufli une fource d’obfcu-
rité, même pour des le rieurs intelligens quiauroient
été très-capables de comprendre le fens de chaque
penfée, & d’en fentir la vériré, fi l’auteur s’étoit fervi
des termes communs 6c des expreffions ordinaires.
C’eft fouvent une afferiation déplacée chez certains
auteurs, que i’ufage des termes d’art 6c d’expref-
fiôns fcientifiques, auxquellesils pouvoient aifément
fubftituer des termes R des expreffions d’ufage ordinaire
, que chaque lerieur un peu éclairé 6c qui fait
fa langue, comprend aifément., Souvent c’eft un jeu
de la charlatannerie des lettrés ; ou des artiftes, que
l ’emploi de ces termes barbares 6c étrangers, auxquels
répondent parfaitement des mots communs, 6c
auxquels peuvent fuppléer des phrafes ordinaires.
3°. La trop grande brièveté eft fouvent un obfta-
cle à la clarté. Quelquefois un auteur familiarifé avec
un fujet qu’il étudie depuis long-tems, veut épargner
du tems R de la peine, prévenir l’ennui qu’inf-
pirent les détails néceffaires à l’intelligence d’un fujet
, à une perfonne qui les fait trop bien ; il fuppofe
que ces détails, ces idées intermédiaires qui lient le
principe à la conféquence, font aufli familiers à fes
lerieurs qu’à lui-même, 6c fur ce prétexte, il fe
difpenfe de les donner, 6c le lerieur qui ne voit pas
la liaifon des idées, ne comprend plus ce qu’il lit. Les
hommes profondément favans, font fujets à être obfcurs
dans leurs difcours par cette raifon. Cependant
celui qui veut inftruire, devroit fe fouvenir que lui-
même au commencement , n’eft paffé d’une idée à
une autre éloignée, qu’en faififfant le fil des idées
moyennes qui en forment la liaifon. Abréger un difcours,
eft ordinairement retrancher cés détails, ce$
idées moyennes, ces liaifons inutiles aux gens fort
intelligens, mais effentiellèmentnéceffaires aux lecteurs
ordinaires. En forte que fouvent abréger, c’eft
diminuer la clarté d’un difcours.
4°. Le défaut de méthode eft une autre fource
d’obfcurité dans le difcours. Ne pas offrir les idées
dans leur rapport réel, dans leur vraie dépendance,
c’eft prefque toujours, jetter de la confufion dans
l ’efprit, 6c rendre impoflible l’intelligence de ce
qu’on dit.
■ 5?. Le défaut de clarté du difcours vient fouvent
du défaut de clarté dans les conceptions , 6c de dif-
îinriion dans les idées de celui qui parle. Il eft bien
rare que celui qui conçoit bien ce qu’il veut dire,
qui comprend bien ce qu’il doit exprimer, •qui en a
une idée nette , ne l’offre pas de même, quand il en
fait le fujet de fon difcours.
6°. Le défaut de ftyle produit ordinairement un
défaut de clarté dans le difcours. Des tranfpofitions
défavouées par la nature de la langue , des phrafes
trop longues, des parenthefes inférées mal-à-prdpos:,
ou trop confidérables, qui interrompent la peinture
de la penfée, des terme? relatifs trop peu carariéri-
ies ou mal placés , l’ignorance de la propriété des
termes, en un mot, toute faute contre les réglés
de la langue, expo fe le difcours au danger d’être
obfcur.
7Z- Le trop grand defir de montrer de l’efprit, eft
fi fouvent une fource d’obfcurité, que l’on1 feroit
tenté de dire à tout écrivain qui prend la plume : oubliez
que vous pouvez avoir de l’efprit, pour ne
vous fouvenir que de la néceffité d’avoir beaucoup
de bon fens , 6c de l’obligation où vous êtes de vous
faire bien comprendre. Ce defir démontré de l’efprit
produit l’afferiation du f ty le , l’emploi des termes
figurés 6c des expreffions recherchées R non naturelles
, qui font prendre la penfée d’un auteur dans
un tout autre fens que celui qu’il avoit en vue.
La première qualité de tout difcours, c’eft d’être
clair ; la fécondé , c’eft d’être vrai. ( G. M. )
CLASSIQUE (A u teu r ; , Art de la parole. On
nomme auteurs clajjiques ceux qui peuvent fervir de
modèle par la beauté R l’excellence du ftyle. Tout
auteur qui penfe folidement & qui fait s’exprimer
d’une maniéré à plaire aux perfonnes de goût, appartient
à cette claffe : on ne doit chercher des auteurs
clajjiques que chez les nations oîi la raifon eft parvenue
à un haut dégré de culture, où la vie foçiale R
le commerce des hommes ont porté l’entendement
6c le bon goût fort au-deffus des fens grofliers : ce
n eft que là que les hommes commencent à trouver
du plaifir dans des objets intelleriuels R dans des fen-
timens délicats ; alors ceujc qui font doués d’un jugement
R d’un goût plus exquis,fe trouvent encouragés
à confidérer avec plus d’attention dés objets qui ne
tiennent pas immédiatement aux fens ; ils découvrent
des rapports plus déliés, que le vulgaire n’apperçoit
pas : un nouveau; champ de plaifîrs pour là fociété
fe préfenté à léuKS regards , 6c l’infinie variété-des
objets rend cette fource inépuifable : le monde iritel-
leriuel, les penfées, les1- fentimensV forment pour
eux une nouvelle nature-, un-autre univers fécond
en événemens intéreflans', "en heurelifés éombinai-
fons, en vues riantes, êcrincoteparablernèfit plus
riche en plaifîrs que la nature groffiere qui n’agit que
fur lèS fens extérieursî céliii qui a trouvé les avenues
de ce monde invifible, porte avec foi tout ce qu’il
faut pour une Converfation agréable & dès'récréations
honnêtes;‘il développe dans le commerce de la
vie plufieiirs ‘Icenés de ce monde-là: il s’attire Fat1
tention ,|r& un goût plus dëlîcàt commencé à* fe ré1
pandrè de toussotes ; on apprend à eftimér des cho-
fes que jufqu’àlors on n’âvoit pas iùême apperçiiës.
On regarde ceux qui ont. découvert ces; nouvelles
fources de plaifirs honnêtes . comme les'bienfàiteurs
refperiables delà fociété ; Éhonneur qu’onleurrend;
redouble leurs efforts ; ils font de nouvelles o.bfef-
vations fur le'm'ondè moral,-' Rapportent tous leurs
foins àcommitniquer leurs recherches aux à.utres , dô
la maniéré la plus parfaite :1e bon ton, la raifon, le
goût s’introduifent dans les fbciëtës choifiës : les: auteurs
commencent à paroîtré;1 Rieurs ouvragés de^
viennent clajjiques pour la poftérité j parce qu’ils font
puifés dans la nature même, dans la fource inaltérable
du beau R du bon.
On eft tenté de croire que l’homme n’a reçu qu’urt
dégré détermine de fagacitë , p'ô'ùr pénétrèr' dans là
nature des objets moraux, qu’il ne fauroit aller plus
loin , R que dans chaque nation lés meilleures "tê tes
ont atteint ce dégré-là. Nous voyons du moins que
les écrirè des hommes de génie de tous les' fiecles 'R
de toutes les nations, plaifent par-tout oirla raifon
eft déjà parvénue à-pèu-près à ce dernier dégré de
culture : ce font-là les vrais auteurs clajjiques pour
toutes les-’natiorisdë la terre.
' Mais chez un' peiiplë dont la raifon n’eft pas encore
cultivée au plus haut point, le meilleur auteur
qui s’y-fOrmera fera applaudi, plaira , deviendra
célébré- parmi fes contemporains1, R