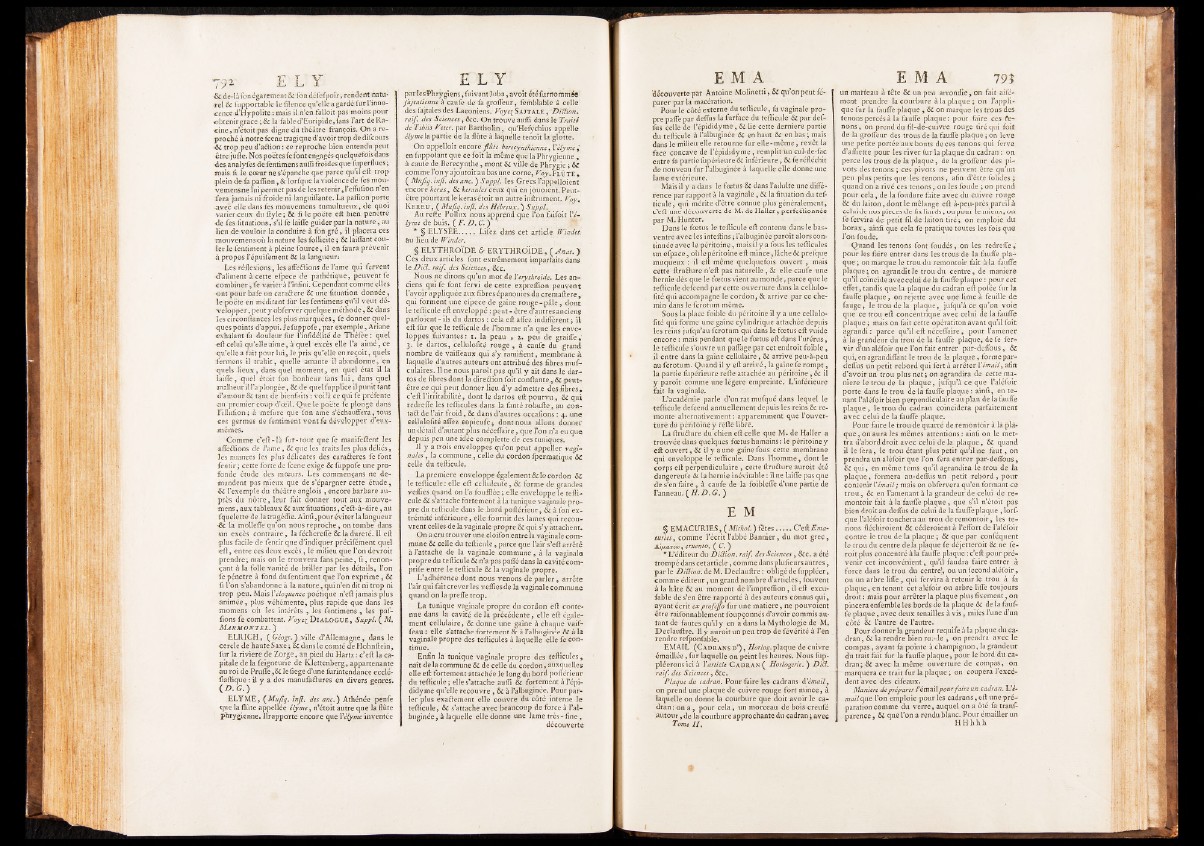
&c de-làfôn égarement 8c'.fon défefpoîr, rendent naturel
& fupportable le filence qu’elle a gardé fùr l’innocence
d’Hypolite : mais il n’en falloit pas moins pour
obtenir grâce ; 8c la fable d’Èuripide, lans l’art de Racine,
în-’étoit;pas digne du théâtre françois. On a .reproché
à notre fcene tragique d’a voir trop de difcours
•8c trop,peu d’attion : ce reproche bien entendu peut
être jufte. Nos poètes fefont engagés quelquefois dans
desanalyfes de fentimens aufli froides que fuperflues ;
mais fi le coeur ne s’épanche que parce qu’il eft trop
.plein de fa palïion, & lorfque la violence de fes mou-
vemensne lui permet pas de les retenir, l’efFufion n?en
fera jamais ni froide ni languiffante. La paflion porte
•avec elle dans fes mouvemens tumultueux, de quoi
varier ceux du ftyle ; & f ile poète eft bien pénétré
de fesfituations, s’il fe laiffe guider par la nature, au
lieu de vouloir la conduire à fon gré, il placera ces
•mouvemens où la nature les follicite ; 8c laiffant couler
le Sentiment à pleine fource, il en faura prévenir
-à propos l’épuifement 8c la langueur*
Les réflexions, les affeftions d e l’ame qui fervent
d’aliment à cette efpece de pathétique, peuvent fe
■ combiner, fe varierà l’Infini. Cependant comme elles
•ont pour bafe un caraftere 8c une fituation donnée,
le poète en méditant fur les fentimens qu’il veut développer
, peut y obferver quelque méthode, 8c dans '
les circonftances les plus marquées, fe donner quelques
points d’appui. jefuppofe, par exemple, Ariane
exhalant fa douleur fur l’infidélité de Théfée : quel
eft celui qu’elle aime, à quel excès elle l’a aimé, ce
qu’elle a fait pour lui, le prix qu’elle en.reçoit, quels
fermens il trahit, quelle amante il abandonne, en
quels lieux, dans quel moment, en quel état il la
laiffe, quel étoit fon bonheur tans lu i, dans quel
malheur ill’a plongée, 8c de quelfupplice il punit tant
d’amour 8c tant de bienfaits : voilà ce qui fe préfente
•au premier coup d’oeil. Que le poète fe plonge dans
l’illufion ; à mefure que fon ame s’échauffera, tous
ces germes de fentiment vont fe développer d’eux-
mêmes.
Comme c’ eft-là fur-fout que fe manifeftent les
■ affeâions de l’ame, 8c que les traits les plus déliés,
les nuances les plus délicates des cara&eres fe font
fentir ; cette forte de fcene exige 8c fuppofe une profonde
étude des moeurs. Les commençans ne demandent
pas mieux que de s’épargner cette étude,
& l’exemple du théâtre anglois , encore barbare auprès
du nôtre, leur fait donner tout aux mouvemens
, aux tableaux 8c aux fituations, c’eft-à-dire, au
fquelette de la tragédie. Ainfi, pour éviter la langueur
•& la molleffe qu’on nous reproche, on tombe dans
un excès contraire, la féchereffe & la dureté. Il eft
plus facile de fentir que d’indiquer précifément quel
e f t , entre ces deux excès, le milieu que l’on devroit
prendre; mais on le trouvera fans peine, f i , renonçant
à la folle vanité de briller par lès détails, l’on
fe pénétré à fond du fentiment que l’on exprime, 8c
fi l’on s’abandonne à la nature, qui n’en dit ni trop ni
trop peu. Mais l'éloquence poétique n’eft jamais plus
animée, plus véhémente, plus rapide que dans les
momens oit les intérêts , les fentimens , les paf-
fions fe combattent. Voye^ D ia lo g u e , Suppl. ( M.
M a r m o n t e l . )
ELRICH, ( Géogr. ) ville d’Allemagne, dans le
cercle de haute Saxe ; 8c dans le comté de Hohnftein,
fur la riviere de Zorge, au pied du Hartz : c’eft la capitale
d elà feigneurie de Klettenberg,appartenante
au roi de Pruffe ,8c le fiege d’une furintendance ecclé-
fiaftique : il y a des manufaâures en divers genres.
(■ D .G . ) S
ELYME, ( Mujiq. injl. des anc. ) Athénée penfe
que la flûte appelïée èlyme, n’étoit autre que la flûte
phrygienne. Ilrapporte encore que Vélyme inventée
par lesPhrygiens ,fuivant Juba, a voit été fur nommée
Jajtalienne à caufe de fa groffeur, fèmblable à celle
des fajtales des Laconiens. Voye^ Sajtale , Diction,
raif. des Sciences, êcc. On trouve aufli dans le Traité
de Tibiis Pîter. par Bartholin, qu’Hefychius appelle
èlyme la partie de la flûté à laquelle tenoit la glotte.
O n appelloit encore flûte berecynjhiennc, Vélyme ;
en fuppolànt que ce foit la fitfêmè que la Phrygienne ,
à caule de.Berecynthë, mont 8c ville-de Phrygie ; 8c
comme l’on y ajoutoit au bas une corne, Voy. Fl û t e ,
( Mujîq.infl. des anc. ) Suppl, les Grecsl’appelloienc
encore keras, 8c kerautes'ceux qui en jôuoient. Peut-
être pourtant le keras étoit un autre infiniment. V.oy,
K e r e u , ( Mujiq. infl. des Hébreux. ) Suppl.
Au refte Pollux nous apprend que l’on faifoit 1Y-
lyme de buis. ( F. D , C. j
* § ELYSÉE........ Liiez dans cet article Windet\
au lieu de Winder.
% ELYTHROÏDE & ERYTHROlDE, ( Jnat. )
Ces deux articles font extrêmement imparfaits dans
le Dict. raif, des Sciences, 8cc.
_ Nous ne dirons qu’un mot de Verythroide. Les anciens
quife font fervi de cette expreffion peuvent
l’avoir appliquée aux fibres épanouies du cremaftere ,
qui forment une efpece de gaine rouge-pâle, dont
le tefticule eft enveloppé :peut - être d’autres anciens
parloient - ils du dartos : cela eft affez indifférent ; il
eft fûr que le tefticule de l’homme n’a que les enveloppes
fuivantes: i. la peau , z. peu de graiffe,'
3. lé dartos, cellulofité rouge , à caufe du grand
nombre de vaiffeaux qui s’y ramifient, membrane à
laquelle d’autres auteurs ont attribué des fibres muf-
culaires. Il ne nous paroît pas qu’il y ait dans le dar-
tos de fibres dont la direâion foit confiante, 8c peut-
être, ce qui peut donner lieu d’y admettre des fibres,
c’eft l ’irritabilité, dont le dartos eft pourvu, 8c qui
redreffe les tefticules dans la fanté robufte, au contact
de l’air froid, 8c dans d’autres occafions : 4. une
cellulofité affëz copieufe, dont nous allons donner
un détail d’autant plus néceffaire, que.l’on n’a eu que
depuis peu une idée complette de ces tuniques.
11 y a trois enveloppes qu’on peut appeller vaginales
, la commune, celle du cordon fpermatique 8i
celle du tefticule,
La première enveloppe également & le cordon &
le tefticule : elle eft celluleufe, 8c forme de grandes
veffiés quand on l’a foufflée ; elle enveloppe le tefticule
8c s’attache fortement à la tunique vaginale propre
du tefticule dans le bord poftérieur, 8c à fon ex-
j trémité inférieure, elle fournit des lames q u i recou-
vrentiCeHes de la vaginale propre & qui s’y attachent.
On,a.cru trouver une cloifon.entre la vaginale commune
& celle du tefticule, parce que l’air s’eft arrêté
à l’attache de la vaginale commune, à la vaginale
propre du tefticule 8c n’a pas pafle dans la cavité com-
prife entre le tefticule 8c la vaginale propre.
L’adhérence dont nous venons de parler, arrête
l’air qui fait crever les veflies de la vaginale commune
quand on la preffe trop.
La tunique vaginale propre du cordon eft contenue
dans la cavité delà précédente, elle eft également
cellulaire, 8c donne une gaine à chaque vaif-
feau : elle s’attache fortement & à l’albuginée & à la
vaginale propre des tefticules à laquelle elle fe continue.
Enfin la tunique vaginale propre des tefticules,
naît de la commune 8c de celle du cordon, auxquelles
elle eft fortement attachée le long du bord poftérieur
du tefticule ; elle s’attache aufli 8c fortement à l’épi-
didyme qu’elle recouvre , & à l’albuginée. Pour parler
plus exaftement elle couvre du côté interne le
tefticule, & s’attache avec beaucoup de force à l’albuginée,
à laquelle elle donne une lame très-fine,
découverte
découverte par Antoine Molinetti, & qu’on peut fé-
parer par la macération.
Pour le côté externe du tefticule, fa vaginale propre
paffe par deffus la furface du tefticule & par def-
fus celle de l’épididyme, & lie cette derniere partie
du tefticule à l’albuginéë & en haut & en bas ; mais
dans le milieu elle retourne fur elle-même, revêt la
face concave de l’épididyme, remplit iin cul-de-fac
entre fa partie fupérieure & inférieure, & fe réfléchit
de nouveau fur l’albuginée à laquelle elle donne une
lame extérieure.
Mais il y a dans le foetus & dans l’adulte une différence
par rapport à la vaginale, & la fituation du tefticule,
qui mérite d’être connue plus généralement,
c’eft une découverte de M. de Haller, perfectionnée
par M. Hunter.
Dans le foetus le tefticule eft contenu dans le bas*
ventre avec les inteftins ; l’albuginée paroît alors continuée
avec le péritoine, mais il y a fous les tefticules
un efpace, oîile péritoine eft mince,lâche & prefque
muqueux : il eft même quelquefois ouvert , mais
cette ftrufture n’eft pas naturelle, & elle caufe une
hernie dès que le foetus vient au monde, parce que le
tefticule defcend par cette ouverture dans la cellulofité
qui accompagne le cordon, & arrive par ce chemin
dans le fcrotum même.
Sous la place foible du péritoine il y a une cellulofité
qui forme une gaîne cylindrique attachée depuis
les reins jufqu’au fcrotum qui dans le foetus eft vuide
encore : mais pendant que le foetus eft dans l’utérus,
le tefticule s’ouvre un paffage par cet endroit foible ,
il entre dans la gaîne cellulaire, & arrive peu-à-peu
au fcrotum. Quand il y eft arrivé, la gaîne fe rompt,
la partie fupérieure refte attachée au péritoine, & il
y paroît comme une légère empreinte. L’inférieure
fait la vaginale.
L’académie parle d’un rat mufqué dans lequel le
tefticule defcend annuellement depuis les reins & remonte
alternativement: apparemment que l’ouver-
turè du péritoine y refte libre.
La ftrufture du chien eft celle que M. de Haller a
trouvée dans quelques foetus humains: le péritoine y
eft o uvert, & il y a une gaîne fous cette membrane
qui enveloppe le tefticule. Dans l’homme, dont le
corps eft perpendiculaire , cette ftru&ure auroit été
dangereufe & la hernie inévitable : il ne laiffe pas que
de s’en faire, à caufe de la foibleffe d’une partie de
l’annèau. ( H .D .G . )
E M
§ EM ACURIES, ( Miihot. ) fêtes. . . . . C ’eft Ema-
turies, comme l’écrit l’abbé Bannier, du mot grec,
AipcLToa, cruento. ( C. )
* L’éditeur du Diction, raif. des Sciences, & c . a été
trompé dans cet article, comme dans plufieurs autres,
parle Diction, de M. Declauftre: obligé de fuppléer,
comme éditeur, un grand nombre d’articles, fouvent
à la hâte & au moment de l’impreflïon, il eft excu-
fable de s’en être rapporté à des auteurs connus qui,
ayant écrit ex profejfo fur une matière, ne pouvoient
être raifonnablement foupçonnés d’avoir commis autant
de fautes qu’il y en a dans la Mythologie de M.
Declauftre. Il y auroit un peu trop de févérité à l’en
rendre refponfable.
EMAIL (Cadrans d’) , Horlog.plaque de cuivre
émaillée, fur laquelle on peint les heures. Nous fup-
pléerons ici à Varticle C adran ( Horlogerie. ) Dict.
raif. des Sciences, &c.
Plaque du cadran. Pour faire les cadrans à'émail,
on prend une plaque de cuivre rouge fort mince, à
laquelle on donne la courbure que doit avoir le cadran
: on a , pour cela, un morceau de bois creufé
autour, de la courbure approchante du cadran ; avec
Tome I I ,
Un marteau à tête & un peu arrondie, on fait aifé*
ment prendre la courbure à la plaque ; on l’applique
fur la fauffe plaque , & on marque les trous des
tenons percés à la fauffe plaque : pour faire ces Tenons
, on prend du fil-de-cuivre rouge tiré qui foit
de la groffeur des trous de la fauffe plaque ; on leve
une petite portée aux bouts de ces tenons qui ferve
d’aflîetre pour les river fur la plaque du cadran : on
perce les trous de la plaque, de la groffeur des pivots
des tenons ; ces pivots ne peuvent être qu’un
peu plus petits que les tenons, afin d’être folides ;
quand on a rivé ces tenons, on les foude ; on prend
pour cela, de la foudure faite avec du cuivre rouge
& du laiton, dont le mélange eft à-peu-près pareil à
celui de nos pièces de fix liards ; ou pour le mieux, on
fefervira de petit fil de laiton tiré; on emploie du
borax, ainfi que cela fe pratique toutes les fois que
l’on foude.
Quand les tenons font foudés f on les redreffe
pour les faire entrer dans les trous de la fauffe plaque;
on marque le trou du remontoir fait à la fauffe
plaque ; on agrandit le trou du centre, de maniéré
qu’il coïncide avec celui de la fauffe plaque : pour cet
effet, tandis que la plaque du cadran eft polee fur la
fauffe plaque, on rejette avec une lime à feuille de
fauge, le trou de la placjue, jufqu’à ce qu’on voie
que ce trou eft concentrique avec celui de la fauffe
plaque ; mais on fait cette opératiton avant qu’il foit
agrandi : parce qu’il eft néceffaire, pour l’amener
à la grandeur du trou de la fauffe plaque, de fe fer-
vir d’un aléfoir que l’on fait entrer par-deffous, 8c
qui, en agrandiffant le trou de la plaque , forme par-
deffus un petit rebord qui fert à arrêter Vémail, afin
d’avoir un trou plus net; on agrandira de cette maniéré
le trou de la plaque, jufqu’à ce que l’aléfoir
porte dans le trou de la fauffe plaque : ainfi, en tenant
l’aléfoir bien perpendiculaire au plan de la fauffe
plaque , le trou du cadran coïncidera parfaitement
avec celui de la fauffe plaque.
Pour faire le trou de quarré de remontoir à la plaque
, on aura les mêmes attentions : ainfi on le mettra
d’abord droit avec celui de la plaque, 8c quand
il le fera, le trou étant plus petit qu’il ne faut, on
prendra un aléfoir que l’on fera entrer par-deffous,
8c qui, en même tems qu’il agrandira le trou de la
plaque > formera au-deffus un petit record , pour
contenir Vémail; mais on obfervera qu’en formant ce
trou, 8c en l’amenant à la grandeur de celui de re*
montoir fait à la fauffe plaque, que s’il n’étoit pas
bien droit au-deffus de celui de la fauffe plaque , lorfque
l’aléfoir touchera au trou de remontoir, les tenons
fléchiroient 8c céderoient à l’effort de l’aléfoir
contre le trou de la plaque ; 8c que par conféquent
le trou du centre delà plaque fe déjetteroit 8c ne fe-
roit plus concentré à la fauffe plaque : c’eft pour prévenir
cet inconvénient % qu’il faudra faire entrer à
force dans le trou du centre], ou un fécond aléfoir ,
ou un arbre liffe , qui fervira à retenir le trou à fa
plaque, en tenant cet aléfoir ou arbre liffe toujours
droit : mais pour arrêter la plaque plus fixement, on
pincera enfemble les bords de la plaque 8c de la fauffe
plaque, avec deux tenailles à v is , mifes l’une d’un
côté 8c l’autre de l’autre.
Pour donner la grandeur requife à la plaque du cadran
, 8c la rendre bien ro^de , on prendra avec le
compas, ayant fa pointe à champignon, la grandeur
du trait fait fur la fauffe plaque, pour le bord du cadran;
8c avec la même ouverture de compas, on
~ marquera ce trait fur la plaque ; on coupera l’excé-,
dent avec des cifeaux.
Maniéré de préparer /’émail pour faire un cadran. Ue-
mail qiie l’on emploie pour les cadrans, eft une préparation
comme du verre, auquel on a ôté fa tranf-
parence, 8c que l’on a rendu blanc. Pour émailler un
r H H h h h '
KK