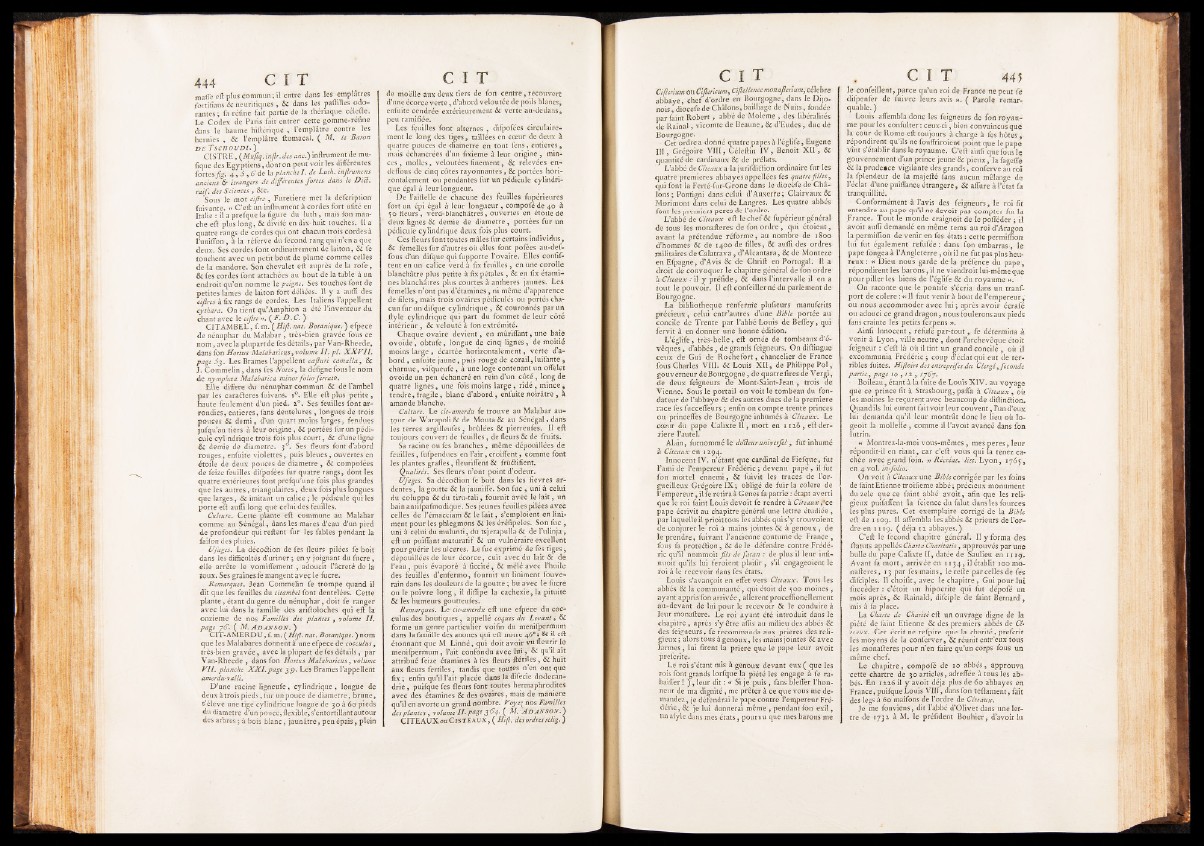
mafl'e eft plus commun ; il entre dans les emplâtres
fortifians & neuritiques , & dans les paftilles odorantes
; fa réfine fait partie de la thériaque célefte.
Le Codex de Paris fait entrer cette gomme-réfine
dans le baume hiftérique , l’emplâtre contre les
hernies , & l’emplâtre ftomacal. ( M. le Baron
d e T s c h o v d i . )
CISTRE, (Mufiq. infir. des dne.)infiniment de mu-
fique des Egyptiens, dont on peut voir les differentes
fortes j%. 4 , J , <T de la planche I. de Luth, inflrumens
anciens & etrangers de differentes fortes dans le Dict.
raif. des Sciences, &c. _ . ,
Sous le mot eißre , Furetiere met la defcription
fuivante. « C’eft un infiniment à cordes fort ufité en
Italie : il a prefque la figure du luth , mais fon manche
eft plus long, & divifé en dix-huit touches. Il a
quatre rangs de cordes qui ont chacun trois cordes à
l’uniffon , à la réferve du fécond rang qui n’en a que
deux. Ses cordes font ordinairement de laiton, & fe
touchent avec un petit bout de pltftne comme celles
de la mandore. Son chevalet eft auprès de la ro fe,
& fes cordes font attachées au bout de la table à un
endroit qu’on nomme le peigne. Ses touches font de
petites lames de laiton fort déliées. Il y a aufii des
cifires à fix rangs de cordés. Les Italiens l’appellent
cythara. On tient qu’Amphion a été l'inventeur du
chant avec le eißre ». (F . D .C . )
CITAMBEL, f. m. (Hiß. nat. Botanique. ) efpece
de nénuphar du Malabar , très-bien gravée fous ce
nom, avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede,
dans fon Hortus Malabaricus, volume I I . pl. X X V I l.
page 5g. Les Brames l ’appellent caßuri camalla, &
J. Commelin, dans fes Notes, la défignefous le nom
de nympheea Malabarica minor folio ferrato.
Elle différé du nénuphar commun & de l’ambel
par les carafteres fuivans. i°. Elle eft plus petite,
haute feulement d’un pied. i ° . Ses feuilles font arrondies,
entières, fans dentelures , longues de trois
pouces & demi, d’un quart moins larges, fendues
jufqu’au tiers à leur origine, & portées fur un pédicule
cylindrique trois fois plus court, & d’une ligne
& demie de diamètre. y°. Ses fleurs font d’abord
rouges, enfuite violettes, puis bleues , ouvertes en
étoile de deux pouces de diamètre , & compoféès
de feize feuilles difpofées fur quatre rangs, dont lés
quatre extérieures font prefqu'une fois plus grandes
que les autres, triangulaires, deux fois plus longues
que larges, & imitant un calice ; le pédicule qui les
porte eft aufli long que celui des feuilles.
Culture. Cette planté eft commune au Malabar
comme au Sénégal, dans les mares d’eau d’un pied
de profondeur qui réftent fur les fables pendant la
faifon des pluies.
Ufages. La déco&ion de fes fleurs pilées fe boit
dans les difficultés d’uriner ; en y joignant du fucre,
elle arrête le vomiffement , adoucit l’âereté de la
toux. Ses graines fe mangent avec le fucre.
Remarques. Jean Commelin fe trompe quand il
dit que les feuilles du citambel font dentelées. Cette
plante, étant du genre du nénuphar, doit fe ranger
avec lui dans la famille des ariftoloches qui eft la
onzième de nos Familles des plantes , volume II.
page jG . ( M. A d a n s o n . )
CIT-AMERDU, f. m. ( Hiß. nat. Botanique. ) nom
que les Malabares donnent à une efpece de cocculus,
très-bien gravée, avec la plupart de fes détails, par
Van-Rheede , dans fon Hortus Malabaricüs, volume
VII. plariche X X I . page 3 <7. Lés Brames l’appellent
amerdu-vdlli.
D’une racine ligneufe, cylindrique , longue de
deux à trois pieds, fur un pouce de diamètre, brune,
s’élève une tige cylindrique longue de 30 à 60 pieds
du diamètre d’un pouce, flexible, s’entortillant autour
des arbres ; à bois blanc, jaunâtre, peu épais, plein
de moelle aux deux tiers de fon centre, recouvert
d’une écorce ve r te , d’abord veloutée de poils blancs,
enfuite cendrée extérieurement & verte au-dedans,
peu ramifiée.
Les feuilles font alternes , difpofées circulaire-
ment le long des tiges, taillées en coeur de deux à
quatre pouces de diamètre en tout fens, entières,
mais échancrées d’un fixieme à leur origine , minces
, molles, veloutées finement, & relevées en-
dèffous de cinq côtes rayonnantes, & portées horizontalement
ou pendantes fur un pédicule cylindrique
égal à leur longueur.
De l’aiflelle de chacune des feuilles fupérieures
fort un épi égal à leur longueur , compofé de 40 à
50 fleurs, verd-blanchâtres, ouvertes en étoile de
deux lignes & demie de diamètre, portées fur un
pédicule cylindrique deux fois plus court.
Ces fleurs font toutes mâles fur certains individus,
& femelles fur d’autres où elles font poféès au-def-
fous d’un difque qui fupporte l’ovaire. Elles confif-
tent en un calice verd à fix feuilles , en une corolle
blanchâtre plus petite à fix pétales , & en fix étamines
blanchâtres plus courtes à anthères jaunes. Les
femelles n’ont pas d’étamines, ni même d’apparence
de filets, mais trois ovaires pédieulés ou portés chacun
fur un difque cylindrique , & couronnés par un
ftyle cylindrique qui part du fommet de leur côté
intérieur , & velouté à fon extrémité.
Chaque ovaire devient, en mûriffant, une baie
ovoïde, obtufe, longue de cinq lignes, de moitié
moins large , écartée horizontalement, verte d’abord
, enluite jaune, puis rouge de corail, luifante 9
charnue, vifqueufë, à une loge contenant un offèlet
ovoïde un peu échancré en rein d’un côté , long de
quatre lignes, une fois moins large , ridé , mince ,
tendre, fragile, blanc d’abord , enfuite noirâtre , à
amande blanche.
Culture. Le cit-'amerdu fe trouve au Malabar autour
de Warapoli & de Monta & au Sénégal, dans
les terres argilleufes, brûléès & pierreufes. Il eft:
toujours couvert de feuilles, de fleurs & de fruits.
Sa racine ou fes branches, même dépouillées de
feuilles, fufpendues en l’air, croiffent, comme font
les plantes grafles, fleuriffent & frü&ifient.
Qualités. Ses fleurs n’ont point d’odeur.
Ufages. Sa décoftion fe boit dans les fievres ardentes
, la goutte & la jauniflë. Son fuc , uni à celui
du coluppa & du tiru-tali, fournit àvèc le lait,. uù
bain antifpafmodique. Ses jeunes feuilles pilées aveé
celles de l’émacciam & le la it , s’emploient en lini-
ment pour les phlegmons & les éréfipeles. Son fuc ,
uni à celui du mulunti, du tsjerapullâ & de l’ulinja -,
eft un puiffant maturatif & un vulnéraire excellent
pour guérir les ulcérés. Le fuc exprimé de festigest
dépouillées de leur écorce, cuit avec du lait & de
l’eau , puis évaporé à ficcité, & mêlé àvec l’huile
des feuilles d’enfermo, fournit un Uniment fouve-
rain dans les douleurs de la goutte ; bu avec le fucre
ou le poivre long, il diflipe la cachexie, la pituite
& lés humeurs goutteufes.
Remarques. Le- cit-amerdu eft une efpece dit cocculus
des boutiques, appellé coques du Levant, &
forme un genre particulier voifin du menifpermum
dans la famille des anones qui eft notre 46e; & il eft
étonnant que M. Linné, qui doit avoir vu fleurir lé
menifpermum, l’ait confondu avec lu i, & qu’il ait
attribué feize étamines à fes fleurs fteriles , & huit
aux fleurs fertiles, tandis que toutes n’en ont que
fix ; enfin qu’il l’ait placée dans la difecie dodecan-
drie, puifque fes fleurs font toutes hermaphrodites
avec des étamines & des ovaires, mais de maniéré
qu’il en avorte un grand nombre. Voye£ nos Familles
des plantes , volume II. Page 3 *^4- ( M- A d a k so N. )
CITEAUX ok C is t e a u x , ( H iß .des ordres relig. )
Ciflerium OU C'ijiencum, Cifiellenee monafterium, célébré
abbaye, ch ef d’ordre en Bourgogne, dans le Dijo-
nois diocefede Châlons,bailliage de Nuits, fondée
par faint Robert, abbé de Moleme , des libéralités
de Rainai, vicomte de Beaune, & d’Eudes, duc dé
Bourgogne*
Cet ordre a donné quatre papes à l’églife, Eugene
I I I , Grégoire V III, Céleftin IV , Benoît XII , &
quantité de cardinaux & de prélats.
L’abbé de Cîteaux a la j urifdi&ion ordinaire fur les
quatre premières abbayes appellées fes quatre filles,
qui font la Ferté-fur-Grone dans le diocèfe de Châlons
; Pontigni dans celui d’Auxerfe ; Clairvaux &
Morimont dans celui de Langres. Les quatre abbés
font les premiers peres de l’ordre.
L’abbé de Cîteaux eft le chef & fupérieur général
de tous les monafteres de fon ordre , qui étoient,
avant la prétendue réforme, au nombre de 1800
d’hommes & de 1400 de filles, & aufli des ordres
militaires de Calatrava, d’Alcantara, & de Monteze
en Efpagne, d’Avis & de Chrift en Portugal. Il a
droit de convoquer le chapitre général de fon ordre
à Cîteaux : il y préfide, & dans l’intervalle il en a
tout le pouvoir. Il eft confeillerné du parlement de
Bourgogne.
La bibliothèque renferme plufieurs manuferits
précieux, celui entr’autrés d’une Bible portée au
concile de Trente par l’abbé Louis de Befley, qui
fervit à en donner une bonne édition.
L’églife, très-belle, eft ornée de tombeaux d’évêques
, d’abbés , de grands feigneurs. On diftingue
ceux de Gui de Rochefort, chancelier de France
fous Charles VIII-. & Louis X I I , de Philippe P o l,
gouverneur de Bourgogne, de quatre lires de Vergi,
de deux feigneurs de Mont-Saint-Jean , trois de
Vienne. Sous le portail on voit le tombeau du fondateur
de l’abbaye & des autres dues de la première
race fes fucçeffeurs ; enfin on compte trente princes
ou princeffes de Bourgogne inhumés à Cîteaux. Le
coeur du pape C a lix t e ll, mort en 1 12 6 , eft derrière
l’autel.
Alain, furnommé le dàcleuruniverfel, fut inhumé
à Cîteaux en 1294.
Innocent IV. n’étant que cardinal de Fiefque, fut
l ’ami de l’empereur Frédéric ; devenu papë , il fut
fon mortel ennemi, & fuivit les traces de l’orgueilleux
Grégoire IX ; obligé de fuir la colere de
l’empereur, ilfe retira à Genes fa patrie : étant averti
que le roi faint Louis devoit fe rendre à Cîteaux ,*ce
pape écrivit au chapitre général une lettre étudiée,
par laquelle il prioittous lés abbés qui s’y trou voient
de conjurer le roi à mains jointes & à genoux, de
le prendre, fuivant l’ancienne coutume de France ,
fous fa prote&ion, & de le défendre contre Frédéric
qu’il nommoit fils de fatan : de plus il leur infi-
fiuoit qu’ils lui feroient plaifir , s’il engageoient le
foi à le recevoir dans fes états.
Louis s’avariçoit en effet vers Cîteaux. Tous les
abbés & la communauté, qui étoit de 500 moines ,
ayant appris fon arrivée, allèrent proceflionellement
au-devant de lui pour Je recevoir & le conduire à
leur rnonafiere. Le roi .ayant été introduit dans le
chapitre , après s’y être aflis au milieu des abbés &
des feigneurs, fe recommanda aux prières des religieux
; alors tous à genoux, les mains jointes & avec
larmes, lui firent la priere que le pape leur avoit
preferite.
Lé roi s’étant mis à genoux devànt eux ( que les
rois font grands lorfque la piété les engage à fe ra-
baifler ! J, leur dit : « Si je puis, fans bleffer l ’honneur
de ma dignité, me prêter à ce que vous me demandez
j je défendrai le pape contré l’empereur Frédéric,
& je lui donnerai même , pendant fon etfil,
un afyle dans mes états, pourvu que mes barons me
îe confeillènt, parce qu’un roi de France ne peut fe
difpenfer de fuivre leurs avis ». ( Parole remarquable.
)
Louis affembla donc les feigneurs de fon royatt*
me pour les confulter : ceux-ci, bien convaincus que
la cour de Rome eft toujours à charge à fes hôtes ,
répondirent qu’ils ne fouffriroient point que le pape
vînt s’établir dans lè royaume. C’eft airifi que fous le
gouvernement d’un prince jeune & pieux, la fageffé
& la prude*ce vigilante des grands, conferve au roi
la fplendeur de la majefté fans aucun mélange de
l’éciât d’une puiffance étrangère, & affure à l’état fa
tranquillité.
Conformément à l’avis des feigneurs, lé roi fit
entendre au pape qu’il ne devoit pas compter fur là
France. Tout le monde craignoit de le pofleder ; il
avoit aufli demandé en même tems au roi d’Aragon
la permiflion de venir en fes états : cette permiflion
lui fut également refuféê : dans .fon embarras , le
pape fongea à l’Angleterre , où il ne fut pas plus heureux
: « Dieu nous garde de la préfence du pape,
répondirent les barons, il ne viendroit lui-même que
pour piller les biens de l’églife & du royaume ».
On raconte que le pontife s’écria dans un tranf-
port de colere : « Il faut venir à bout de l’empereur,
ou nous accommoder avec lui ; après avoir écrafé
ou adouci ce grand dragon, nous foulerons aux pieds
fans crainte les petits ferpens ».
Ainfi Innocent, refufé par-tout, fe détermina à
venir à Lyon, ville neutre , dont l’archevêque étoit
feigneur : c’eft là où il tint un grand concile , où il
excommunia Frédéric j coup d’éclat qui eut de terribles
fuites. Hifloire des entreprifes du Clergé, fécondé
partie, page 10, 12. , rj6y.
Boileau, étant à la fuite de Louis X IV . au voyage
que ce prince fit à Strasbourg, paffa à Cîteaux, où
les moines le reçurent avec beaucoup de diftin&ion.
Quand ils lui eurent fait voir leur couvent, l’un d’eux
lui demanda qu’il leur montrât donc le lieu où lo-
geoit la molleffe, comme il l’avoit avancé dans fon
lutrin;
« Montrez-la-moi vous-mêmes, mes p eres, leur
répondit-il en riant, car c’eft vous qui la tenez cachée
avec grand foin. » Récréât. litt. Ly on , 1765,
en 4 vol. in-folio.- •
On voit à Cîteaux une Bible corrigée par les foins
de faint Etienne troifieme abbé; précieux monument
du zele que ce faint abbé avoit, afin que les religieux
puifaffent la fcience du falut dans les fources
les plus pures. Cet exemplaire corrigé de la Bible
eft de 1109. Il affembla les abbés & prieurs de l’ordre
en 1119. ( déjà 12 abbayes. J
C ’eft le fécond chapitre general: Il y forma des
ftàtuts appellés Charta Charitatis, approuvés par une
bulle du pape Calixte II, datée de Saulieu en 1 119.
Avant fa mort, arrivée en 1 134 , il établit ioomo-
nafteres, 13 par fes mains, lerefte par celles de fes
difciples. Il choifit, avec le chapitre , Gui pour lui
fuccéder : c’étoit un hipocrite qui fut dépofé un
mois après, & Rainald, difciple de faint Bernard,
mis â fa place.
La Charte de Charité eft un ouvrage digne de la
piété de faint Etienne & des premiers abbés de Ci•
teaiix. Cet écrit ne refpire que la charité, preferit
les moyens de la conferver, & réunit entr’eux tous
les monafteres pour n’en faire qu’un corps fous un
même chef.
Le chapitre, compofé dé 10 abbés, approuva
cette chartre de 30 articles, adreflee à tous les abbés.
En 1226 il y avoit déjà plus de 60 abbayes en
France, puifque Louis VIII, dans fon teftament, fait
des legs à 60 maifons de l’ordre de Cîteaux.
Je me fouviens, dit l’abbé d’Olivet dans une lettre
de 1732 à M. le préfident Bouhier, d’avoir lu