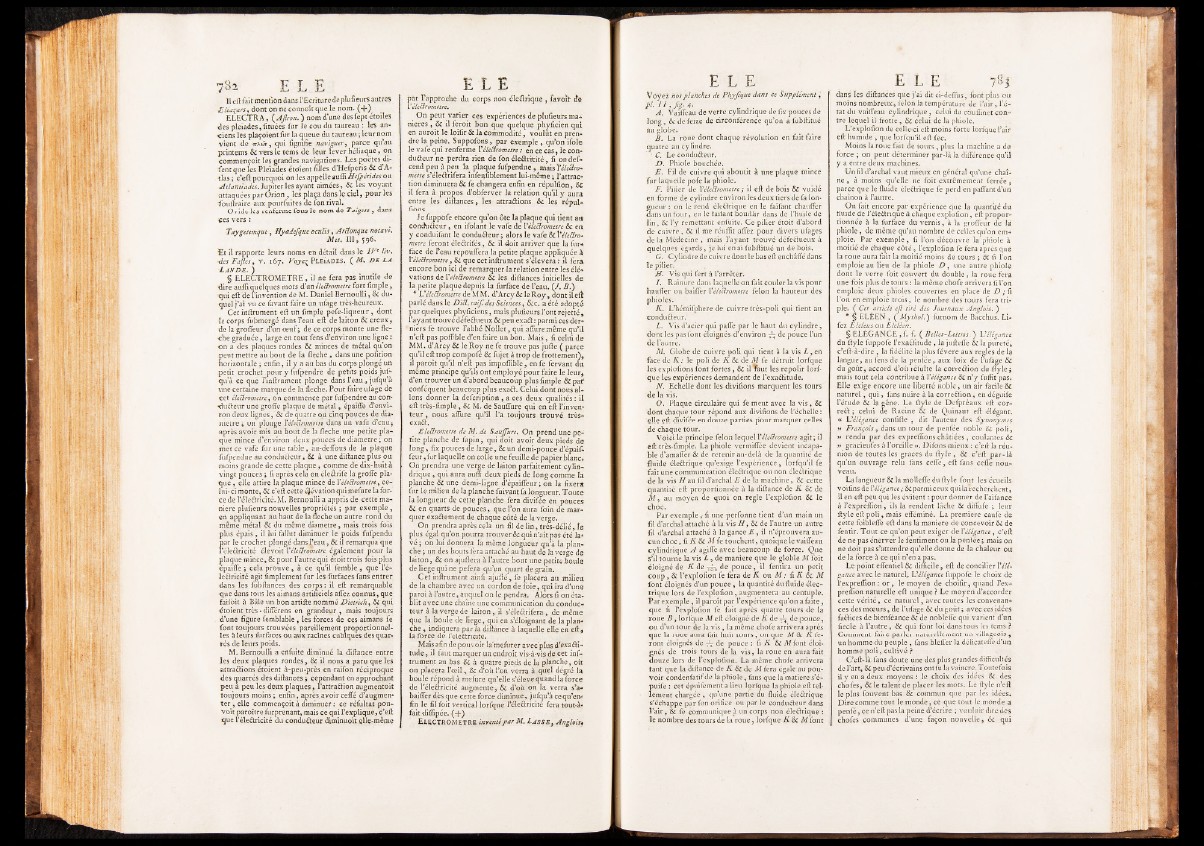
Il eft fait mention dans l’Ecriture de plufieurs autres
Ëlsaçars, dont on ne conDOÎt que le nom. (-$-)
ELECTRA, (,AJlron. ) nom d’une desfept étoiles
des pleïades, fituées lur le cou du taureau : les anciens
les plaçoient fur la queue du taureau ; leur nom
vient de wteiv, qui lignifie naviguer, parce qu au
printems 8c vers le tems de leur lever héliaque, on
commençoit les grandes navigations. Les poètes di-
fent que les Pleïades étoient filles d’Hefperis & d A-
tlas ; c’eft: pourquoi on les appelle auffi Hefperides ou
Atlantiades. Jupiter les ayant aimées, 8c les voyant
attaquées par Orion , les plaça dans le ciel, pour les
■ fiouftraire aux pourfuites de fon rival.
Ovide les renferme fous le nom de Taïgete, dans
ces vers :
Taygetemque , ffyadefque ocitlis, Arclonque notavL
Met. ÏII, 596,
ïît il rapporte leurs noms en détail dans le IV* AV.
-des Fafles, v . 167. Foye^ PLEÏADES. ( M. DE LA
-La n d e . )
§ ELECTROMETRÊ, il ne fera pas inutile de
dire auffi quelques mots d’un èleclrometre fort fimple,
qui efl de l’invention de M. Daniel Bernoulli > & duquel
j’ai vu ce favant faire un ufage très-heureux.
Cet infiniment efl un fimple pefediqueur, dont
le corps fubmergé dans l’eau efl de laiton & creux,
de la groffeur d’un oeuf » de ce corps monte une fléché
graduée, large en tout fens d’environ une ligne :
on a des plaques rondes 8c minces de métal qu’on
peut mettre au bout de la fléché, dans une pofition
horizontale ; enfin, il y a au bas du corps plongé un
petit crochet pour y fufpendre de petits poids jufi-
qu’à ce que l’inflrument plonge dans l’eau, jufqu’à
une certaine marque de la fléché. Pour faire ulage de
cet èleclrometre, on commence par fufpendre au con*-
du£leur une groffe plaque de métal, épâiffe d’environ
deux lignes, & de quatre op cinq pouces de dia*
métré ; on plonge l’èleclrometre dans un vafe d’eau,
après avoir mis au bout de la fléché une petite plaque
mince d’environ deux pouces de diamètre; on
met ce vafe fur une table, au-deffous de la plaque
fufpendue au conducteur, 8c à une diflance plus ou
moins grande de cette plaque » comme de dix-huit à
vingt pouces ; fi après cela on éleétrife la groffe plaque
, elle attire la plaque mince de Y èleclrometre ^ celui
ci monte, & c’eft cette éjévation qui mefure la force
de l’éleCtricité. M. Bernoulli a appris de cette'ma-
■ niere plufieurs nouvelles propriétés ; par exemple ,
en appliquant au haut de la fleçhe un autre rond du
même métal 8c du même diamètre, mais trois fois
plus épais, il lui fallut diminuer le poids fufpendu
par le crochet plongé dans l’eau, & il remarqua que
î’éleftricité élevoit Xèleclrometre également pour la
plaque mince, 8c pour l’autre qui étoit trois fois plus
épaiffe ; cela prouve, à ce qu’il femble , que l’é-
le&ricité agit Amplement fur les furfaces fans entrer
dans les fubflances des corps : il efl remarquable
que dans tous les aimans artificiels affez connus, que
faifoit à Bâle un bon artifle nommé Dietrich, & qui
étoient très - différens en grandeur , mais toujours
d’une figure femblable, les forces de ces aimans fe
font toujours trouvées pareillement proportionnelles
à leurs furfaces ou aux racines cubiques des quar-
rés de leurs poids.
M. Bernoulli a enfuite diminué la diflance entre
les deux plaques rondes, & il nous a paru que les
attractions étoient à-peu-près en raifon réciproque
des auarrés des diftances ; cependant en approchant
peu a peu les deux plaques, l ’attraélion augmentoit
toujours moins ; enfin, après, avoir ceffé d’augmenter
, elle commençoit à diminuer : ce réfultat pou-
voit paroître furprenant, mais ce qui l’explique, c’efl
que l’éledricité du conducteur diminuoit elle-même
par rapproche du corps non éleCtrique , favoit tfô
Y èleclrometre.
On peut varier ces expériences de plufieurs ma*
nieres , & il feroit bon que quelque phyficien qui
en auroit le loifir & la Commodité, voulut en pren*
dre la peine. Suppofqns» par exemple , qu’on ifole
le vafe qui renferme l’èleclrometre : en Ce cas, le conducteur
ne perdra rien de fôn é ledricité, fi on def*
cend peu à peu la plaque fufpendue , mais Xèleclro*
mètre s’éleCtrifera infenfiblement lui-même ; l’attraction
diminuera & fe changera enfin en répuîfion, 8C
il fera à propos d’obferver la relation qu’il y aura
entre les diftances» les attractions 8c les répul*
fibns. V
Je fuppofe encore qu’on ôte la plaque qui tient ait
conduCleur, en ifolant le vafe de l ’èleclrometre 8c en
y conduifant le cohduCteur ; alors le vafe 8tXèleclrometre
feront éleCtrifés, 8c il doit arriver que la fur*
face de l’ eau repouffera la petite plaque appliquée à
Xèleclrometre, 8c que cet infiniment s’élèvera * il fera
encore bon ici de remarquer la relation entre les élévations
de Xèleclrometre 8c les diftances initiellës de
la petite plaque depuis la furface de l’eau. (/. B.)
* L’èleclrometre de M M. d’Arcy & le R o y , dont il eft
parlé dans 1 e.Dicl. raif. des Sciences, & c . a été adopté
par quelques phyficiens, mais plufieurs l’ont rejetté ,
l’ayant trouvé défectueux 8c peu exaCt : parmi ces dern
ie r s fe trouve l’abbé Nollet, qui allure même qu’il
n’eft pas poftible d’en faire un bon. Mais, fi celui de
MM. d’Arcy & le R oy ne fe trouve pas jufte ( parce
qu’il efl trop compofé 8c fujet à trop de frottement),
il paroît qu’il n’eft pas impoffible, en fe fervant du
même principe qu’ils ont employé pour faire le leur,
d’en trouver urt d’abord beaucoup plus fimple & paf
conféquent beaucoup plus exaCt. Celui dont nous allons
donner la defcription , a ces deux qualités: il
eft très-fimple, 8c M. de Sauflure qui en efl l’inventeur
, nous allure qu;il l’a toujours trouvé très*
exaCt.
Eleclrometre de M. de SauJJuVe, On prend Une petite
planche de fa pin, qui doit avoir deux pieds de
long, fix pouces dé large, & un demi-pouce d’épaif*
feur, fur laquelle on colle une feuille de papier blanc*
On prendra une verge de laiton parfaitement cylindrique
, qui aura auffi deux pieds de long comme la
planche 8c une demi-ligne d’épaiffeur ; on la fixera
fur le milieu de la planche fuivant fa longueur. T oute
la longueur de cette planche fera divifée en pouces
8c en quarts de pouces, que l’on aura foin de marquer
exactement de chaque côté de la Verge.
On prendra après cela un fil de lin, très-délié, îè
plus égal qu’on, pourra trouver & qui n’ait pas été lavé
; on lui donnera la même longueur qu’à la planche
; un des bouts fera attaché au haut de la verge de
laiton, 8c on ajuftera à i’autre bout une petite boule
de liege qui ne pefe.ra qu’un quart de grain.
Cet infiniment ainfi ajufté, fe placera au milieu
de la chambre avec un cordon de foie, qui ira d’une
paroi à l’autre, auquel on le pendra. Alors fi on éta-
Blit avec une chaîne une communication du conducteur
à la verge de laiton, il s’éleCtrifera , de même
que la boule de liege, qui en s’éloignant de la planche
, indiquera par la diflance à laquelle elle en eft,
la force de l’éleCtricité.
Mâis afin de pouvoir la’ftiefuter avec plus d’exaCH-
tude, il faut marquer un endroit vis-à-vis de cet inf-
trument au bas 8c à quatre pièfls de la planche» oit
on placera l’oeil., 8c d’où l’on verra à qûel dégré la
boule répond à mefure qu’elle s’élève quand la force
de l'éleCtricité augmente, 8c d’où on la verra s’a-
baiffer dès que cette force diminue, jufqu’à cequ’eiv
fin le fil foit Vertical lorfque l’éleCtricité fera tout-à*
fait diffipée. (+ )
E L ÇCTRQM ETR E inventé par M. L a s s e , Anglais«
Voyez nôs planches de Phyjîque dans ce Supplément »
p l . I I ' f i g .^
A. Vaiffeau de verre cylindrique de fix pouces de
long, 8c de feize de circonférence qu’on a fubftitué
au globe»
B. La rOuè dont chaque révolution en fait faire
quatre au cylindre.
1 C. Le conduCleur.
D . Phiole bouchée.
E. Fil de cuivre qui aboutit à une plaque mince
fur laquelle pofe la phiole.
F. Pilier de l’èleclrometre ; il eft de bois 8c vuidé
tri forme de cylindre environ les deux tiers de fa longueur
: on le rend éleCtrique en le faifant chauffer
dans un four, en le faifant bouillir dans de l’huile de
lin , 8c l’y remettant enfuite. Ce pilier étoit d’abord
de cuivre , 8c il me réuffit affez pour divers ufages
de la Médecine, mais l’ayant trouvé défectueux à
quelques égards, je lui en ai fubftitué un de bois.
G. Cylindre de cuivre dont le bas eft enchâffé dans
le pilier.
H. Vis qùi fert à l’arrêter.
/. Rainure dans laquelle on fait couler la vis pour
haufier ou baiffer Xèleclrometre félon la hauteur des
phioles.
K. L’hémifphere de cuivre très-poli qui tient au
conduCleur.'
L. Vis d’acier qui paffe par le haut du cylindre »
dont les pas font éloignés d’ environ ^ de pouce l’un
de l’autre.
M. Globe de cuivre poli qui tient à la vis Z-, en
face de K : le poli de K 8c de M fe détruit lorfque
les exploitons font fortes, 8c il raut les repolir lorfque
les expériences demandent de l’exaCtitude.
N. Echelle dont les divifions marquent les tours
de la vis.
O. Plaque circulaire qui fe meut avec la v is , &
dont chaque tour répond aux divifions de l’échelle :
elle eft divifée en douze parties pour marquer celles
de chaque tour.
Voici le principe félon lequel l'èleclrometre agit; il
e f t très-fimple. La phiole vermiffée devient incapable
d’amaffer & de retenir au-delà de la quantité de
fluide éleCtrique qu’exige l’expérience, lorfqu’il fe
fait une Communication éleCtrique ou non éleCtrique
dé la vis H au fil d’archal E de la machine, 8c cette
quantité eft proportionnée à la diflance de K 8c de
j j f , au moyen de quoi on réglé l’explofion 8c le
choc.
Par exemple ,• fi une perfonne tient d’un main un
fil d’archal attaché à la vis H , 8c de l’autre un autre
fil d*archal attaché à la gance E » il n’éprouvera aucun
choc, fi K 8c M fe touchent, quoique le vaiffeau
cylindrique A agiffe avec beaucoup de force. Que
S’il tourne la vis L , de maniéré que le globle M foit
éloigné de K de 7^, de pouce, il fentira un petit
coup, & l’explofion fe fera de K ou M : fi K 8c M
font éloignés d’un pouce , la quantité du fluide électrique
lors de l’explofion, augmentera au centuple.
Par exemple, il paroît par l’expérience qu’on a faite,
que fi l’explofion fe fait après quatre tours de la
roue B , lorfque M eft éloigné de K de de pouce,
ou d’un tour de la v is , la même chofe arrivera après
que la roue aura fait huit tours, ou que M & K feront
éloignés de de pouce : fi K 8c M font éloignés
de trois tours de la v is , la roue en aura fait
douze lors de l’explofion. La même chofe arrivera
tant que la diflance de i f & de AI fera égale au pouvoir
condenfatif de la phiole, fans que la matière s’é-
puife : cet épuifementa lieu lorfque la phiole eft tellement
chargée1» qu’une partie du fluide électrique
s’échappe par fon orifice ou par le conduCleur dans
l ’air, & fe communique à un corps non éleCtrique :
le nombre des tours de la roue, lorfque K 8c M font
dàné les diftarlces que j’ai dit ci-deflus, font plus ou
moins nombreux, félon la température de l’a ir , l’état
du vaiffeau cylindrique, celui du cduffinet con*
tre lequel il frotte, 8c celui de la phiole.
L ’explofion de celle-ci eft moins forte lorfque l’air
eft humide , que lorfqu’il eft fec.
Moins la roue fait de tours , plus la machine a des ■
force ; on peut déterminer par-là la différence qu’il
y a entre deux machines.
Un fil d’archal vaut mieux en général qu’une chaîne
, à moins qu’elle ne foit extrêmement ferrée,
parce que le fluide éleCtrique fe perd en paffant d’urt
chaînon à l’autre.
On fait encore par expérience que la quantité du
fluide de PéleCtrique à chaque explofion, eft proportionnée
à la furface du vernis, à la groffeur de là
phiole » de même qu’au nombre de celles qu’on emploie.
Par exemple, fi l’on découvre la phiole à
moitié de chaque cô té, l’explofion fe fera après qué
la roue aura fait la moitié moins de tours ; & fi l’on
emploie aii lieu de la phiole D , une autre phiole
dont le verre foit couvert du double, la roue fera
une fois plus de tours : la même chofe arrivera fi l’on
emploie deux phioles couvertes en place de D ; fi
l’on en emploie trois, le nombre des tours fera triple.
( Cet article ejl tiré des Journaux Anglais. )
* § ELÉEN,, ( Mythol.) furnom de Bacchus. Li-
fez Eleleus ou Eleléen.
§ ÉLÉGANCE , f. f. ( B elles-Lettrés.) L’élégance
du ftyle fuppofe l’exaCtitude, la jufteffe & la pureté»
c’eft-à-dire , la fidélité la plus févere aux réglés de la
langue» au fens de la penfée, aux loix de l’ufage 8c
du goût, accord d’où réfulte la correction du ftyle;
mais tout cela contribue à Xélégance 8c n’y fuflit pas»
Elle exige encore une liberté noble, un air facile 8c
naturel, q ui, fans nuire à la correûion, eh déguife
l’étude 8c la gêne. Le ftyle de Defpréaux eft cor-
reCt ; celui de Racine & de Quinaut eft élégant-,
« L’élégance confifte , dit l’auteur des Synonymes
» François, dans un tour de penfée noble 8c poli,
» rendu par des expreffions châtiées, coulantes &
» graCieufes à l’oreille ». Difons mieux : c’eft la réunion
de toutes les grâces du ftyle , 8c c’eft par-là
qu’un ouvrage relu fans ceffe, eft fans ceffe nouveau
»
La langueur 8c la molleffe du ftyle font les écueils
voifins de [’élégance; & parmi ceux qùi la recherchent»
il en eft peu qui les évitent : pour donner de l’aifance
à l’expreffion, ils la rendent lâche & diffufe ; leur
ftyle eft poli, mais efféminé. La première caufe de
cette foibleffe eft dans la maniéré de concevoir 8c de
fentir. Tout ce qu’on peut exiger de Xélégance, c’eft
de ne pas énerver le fentiment ou la penfée ; mais on
ne doit pas s’attendre qu’elle donne de la chaleur oii
de la force à ce qui n’en a pas.
Le point effentiel 8c difficile,, eft de concilier Xélégance
avec le naturel, \Jélégance fuppofe le choix de
l’expreffion: o r , le moyen de choifir, quand l’ex*
preflion naturelle eft unique ? Le moyen d’accorder
cette vérité, ce naturel, avec toutes les convenant
ces des moeurs, de l’ufage 8c du goût ; avec ces idées
factices de bienféance 8c de nobleffe qui varient d’un
fiecle' à l’autre, 8c qui font loi dans tous les tems ?
Gomment faire parler naturellement un villageois ,
un homme du peuple , fans blëffer ia délicateffe d’un
homme p o li, cultivé ?
G’eft-là. fans doute une des plus grandes difficultés
de l’art, & peu d’écrivains ontfu la vaincre. Toutefois
il y en a deux moyens : le choix des idées & des
chofes, 8c le talent de placer les mots. Le ftyle n’eft
le plus foùvent bas & commun que par les idées*
Dire comme tout le monde, cè que tout le monde ai
penfé, ce n’eft pas la peine d’écrire ; vouloir dite des
chofes communes d’une façon nouvelle» 8c qui