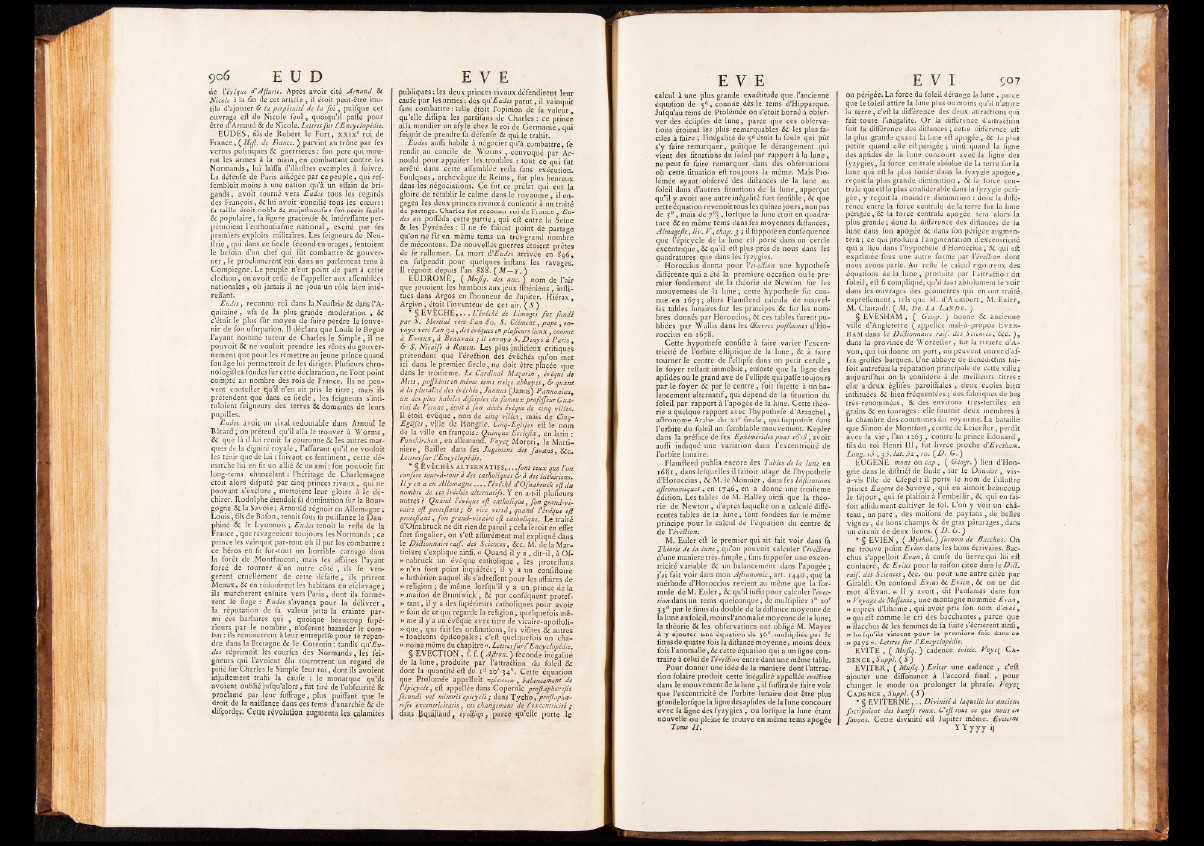
de Yévêque d 'A (lune. Après avoir cité Arnaud 8c
Nicole à la fin de cet article , il étoit peut-être inutile
d’ajouter & la perpétuité de la foi , puifque cet
ouvrage eft de Nicole feul, quoiqu’il paffe pour
être d’Arnaud & de Nicole. Lettres fur l'Encyclopédie.
EUDES, fils de Robert le Fort, x x i x e roi de
France, ( Hifi. de France. ) parvint au trôné par fes
vertus politiques & guerrières : fon pere qui mourut
les armes à 1a. main, en combattant contre les
Normands, lui laiflfa d’illuftres exemples à fuivre.
La défenfe de Paris alfiégée par ce peuple, qui ref-
femblo.it moins à une nation qu’à un effain de brigands
, avoit tourné vers Eudes tous les regards
des François, 8c lui avoit concilié tous les coeurs :
fa taille étoit noble 8c majeftueufe : fon accès facile
& populaire, fa figure gracieufe 8c intéreffante per-
pétuoient l’enthoufiafme national, excité par fes
premièrs exploits militaires. Les feigneurs de Neu-
ftrie , qui dans ce fiecle fécond en orages, fentoient
le befoin d’un chef qui fût combattre 8c gouverner
, le proclamèrent‘rai dans un parlement tenu à
-Compiegne. Le peuple n’eut point de part à cette
élection, on avoit cefîe de I’appeller aux affemblées
nationales, où jamais il ne joua un rôle bien inté-
reflant.
Eudes, reconnu roi dans la Neuftrie 8c dans l’Aquitaine
, ufa de la plus grande modération , 8c
c’étoit le plus fur moyen de faire perdre le fouve-
nir de fon uflirpation. Il déclara que Louis le Begue
l’ayant nommé tuteur de Charles le Simple, il ne
pouvoit 8c ne voulait prendre les rênes du gouvernement
que pour les remettre au jeune prince quand
fon âge lui permettroit de les diriger. Plufieurs chron
o lo g ie s fondés fur cette déclaration, ne l’ont point
compté au nombre des rois de France. Ils ne peuvent
contefter épi’il n’en ait pris le titre ; mais ils
prétendent que dans ce liecle, les feigneurs s’inti-
tuloient feigneurs des terres & domaines de leurs
pupilles.'
Eudes avoit un rival redoutable dans Arnoul le
Bâtard ; on prétend qu’il alla le trouver à Worms ,
& que là il lui remit la couronne 8c les autrès marques
de la dignité royale, l’affurant qu’il ne vouloit
les tenir que de lui : fuivant ce fentiment, cette démarche
lui en fit un allié & un ami : fon pouvoir fut
long-tëms chancelant : l’héritage de Charlemagne
étoit alors difputé par cinq princes rivaux , qui ne
pouvant s’exclure , mettoient leur gloire à le déchirer.
Rodolphe étendoit fa domination fur la Bourgogne
& la Savoie; Arnould régnoit en Allemagne ;
Louis, fils de Bofon, tenoit fous fa puifiance le Dauphiné
8c le Lyonnois ; Eudes tenoit le refte de la
France, qife râvageoieni toujours les Normands ; ce
prince les vainquit par-tout oii il put les combattre :
ce héros en fit fur-tout un horrible carnage dans
la forêt de Montfaucon; mais fes affaires l’ayant
forcé de tourner d’un autre côté , ils fe vengèrent
cruellement de cette défaite, ils prirent
Meaux, 8c en réduifirentlés habitans en efclavage;
ils marcherent enfuite vers Paris, dont ils formèrent
le fiege.: Eudes s’avança pour la délivrer ,
la réputation de fa valeur jetta la crainte parmi
ces barbares qui , quoique beaucoup fupé-
rieurs par le nombre , n’oferent hazarder le combat
: ils renoncèrent à leur entreprife pour fe répandre
dans la Bretagne 8c le Cotentin : tandis qu’-Ew-
des réprimoit les courfes des Normands, les feigneurs
qui l’avoient élu tournèrent un regard de
pitié fur Charles le Simple leur roi, dont ils avoient
injuftement trahi la caufe : le monarque qu’ils
avoient oublié jufqu’alors, fut tiré de l’obfcurité &
proclamé par.leur fuffrage, plus puiflant que le
droit de la naiffance dans ces tems- d’anarchie & de
difççrdes. Cette révolution augmenta Içs calamités
publiques : les deux princes rivaux défendirent leur
caufe par les.armes: dès <\\Y Eudes parut, il vainquit
fans combattre : telle étoit l’opinion de fa; valeur,
qu’elle diflipa les partifans, de Charles : ce prince
alla mendier un afyle chez le roi de Germanie, qui
feignit île prendre fa défenfe & qui. le trahit.
Eudes aufli habile à négocier qu’à combattre, fe
rendit au concile, de Worms , convoqué par Arnould
pour appaifer le‘s troubles : tout , ce qui fut
arrêté dans cette affemblée refta fans exécution.
Foulques , archev.êque.de Reims, fut plus heureux
dans fes négociations. Ce fut. ce prélat qui eut la
gloire de rétablir le calme dans le royaume , il engagea
les deux princes rivaux à confentir à un traité
de partage. Charles fut reconnu roi de France , Eudes
en pqfféda cette partie, qui eft entre la Seine
& les Pyrénées : il ne fe failbit point de partage
qu’on ne f it en même tems un très-grand nombre
de mécontens. De nouvelles guerres étoient prêtes
de fe rallumer. La mort à1 Eudes arrivée en 896,
en fufpendit pour quelques inftans les ravagés.
Il régnoit depuis l’an 888. ( M —y . )
EUDROMÉ, ( Mujiq. des anc. ) nom de l’air
que jouoient les hautbois aux jeux fthéniens , infti-
tués dans Argos en l’honneur de Jupiter. Hiérax,
Argien, étoit l’inventeur de cet air. (S")
* § ÉV Ê CH É ,. . . Uévêché de Limages fu t fondé
par S. Martial vers l'an 80. S. Clément, pape , envoya
vers Pan 94) des évêques en plufieurs lieux , comme
a Evreux, a Beauvais ; il envoya S. Denys à Paris ,
& S. Nicaife à Rouen. Les plus judicieux critiques
prétendent que l’ére&ion des évêchés qu’on met
ici dans le premier liecle, ne doit être placée que
dans le troilieme. Le Cardinal Ma^arin , évêque de
Mets, pojfédoit en même tems .treize abbayes, & quant
à la pluralité des évêchés, Jannus (Janus) Pannonius,
un des plus habiles difciples du fameux profejfeur Gua-
rini de Verone , étoit à fon décès évêque de cinq villes.
Il étoit évêque , non de cinq villes, mais de Cïnq-
EgUfes, ville de Hongrie. Cinq-Eglifes efi le nom
de la ville en françois: Quinque-Ecdefice, en latin :
Funskirchen, en allemandT Voye^ Moreri, la Marti-
niere, Baillet dans fes Jugemens des favans, & c .
Lettresfur P Encyclopédie.
* § É V ÊCHÉ S A L T E R N A T IF S ,,.. .font ceux que Von
conféré tour-à-tour à des catholiques &'à des luthériens.
I l y en a en Allemagne . . . . t'évêché tPOfnabruçk efi du
nombre de ces évêchés alternatifs. Y en a-t-il plufieurs
autres? Quand Péveque efi catholique, fon grand-vicaire
efi protefiant; & vice versa, quand Péveque efi
protéftqnt, fon grand-vicaire efi catholique. Le traité
d’Ofnabruck ne dit rien de pareil ; cela feroit en effet
fort fingulier, on s’eft affurément mal expliqué d^ns
le Dictionnaire raif. des Sciences, &c. M. delaMar-
tiniere s’explique ainfi. « Quand il y a , dit-il,,à Of-
» nabruck un évêque catholique , les prot.eftans
» n’en font point inquiétés; il y a un confiftoire
» luthérien auquel ils s’adreffent pour les affaires de
» religion ; de même lorfqu’il y a un. prince de la
» maifon de Brunfwick, 8c par conféqueijt protef-
» tant, il y a des fupérièurs catholiques pour avoir
» foin de ce qui regarde la religion ; quëlquefois mê-
» me il y a un évêque avec titre de vicaire-apoftoli-
» que, qui fait les ordinations, les vifites & autres
» fondions épifcopales ; c’eft quelquefois un cha-
» noine même du chapitre ». Lettresfur P Encyclopédie.
§ EVECTION, f. f. ( Afiron. ) fécondé inégalité
de la lune, produite par l’attraôion du foleil &
dont la quantité efi; de i d 20/ 34". Cette équation
que Ptolomée appelloit 7rpétmua-/v, balancement de
tépicycle, efi appelléedans Copernic profiapharefis
fecundi vel minoris epicycli ; dans T ych o, profiaphx-
refis excentricitatis, ou changement de l'excentricité ;
dans Bquillaud, éyeffqji, parce qu’elle porte le.
calcul à une plus grande exactitude que l’anciénne
équation de 5d, connue dès le tems d’Hipparque.
Jufqu’au tems de Ptolémée on s’étoit borné à obler-
ver des éciipfes .de lune, parce que ces obfervar
fions étoient Les plus remarquables & les plus faciles
à faire ; ^inégalité de y d étoit la feule qui pût
s’y faire remarquer , puifque le dérangement qui
vient des fituations du foleil par rapport à la lune,
ne peut fe faire1 remarquer dans dés obfervati'ons
oit cette fituation èft toujours la même. Mais Ptolémée
ayant obfervé des diftances.de la lune au
foleil dans d’autres fituations de la lune, apperçut
qu’il y avoit une autre inégalité fort fenfible, & que
cette équation re venoit tous lesquinze jours, non pas
de 5P, mais de , lorfque la lune étoit en quadra^-
ture & en même tems dans fes moyennes diftances,
Almagefie, liv. Jf* chap. 3 ; il fuppofe en conféquence
que l’épicycle de la lune efi porté dans un. cercle
excentrique, & qu’il efi plus près de nous dans les
quadratures que dans les fyzygies. .
Horoccius donna pour Vévection une hypothefe
différente qui a été la première occafion ou ïe premier
fondement de la théorie de Newton fur les
mouvemens de la lune ; cette hypothefe fut connue
en 1673; alors Flamfteed calcula de nouvel^
les tables lunaires fur les principes & fur les nombres
donnés par Horoccius, & ces tables furent pu-*
bliées par Wallis dans les OEuvres pofthumes d’Ho-
roccius en 1678.
Cette hypothefe confifte.à faire varier l’excentricité
de l’Orbite elliptique de la lune, & à faire
tourner le centre de l’ellipfe dans un petit cercle ,
le> foyer reftant immobile, enforte. que la ligne des
apfides ou le grand axe de l’ellipfe qui paffe toujours
par le foyer & par le centre, foit fujette à un balancement
alternatif, qui dépend de la fituation du
foleil par rapport à l’apogée de la lune. Cette théorie
a quelque rapport avec l’hypothefe d’Arzachel,
aftronome Arabe du x ie liecle, qui fuppofoit dans
l’orbite du foleil un femblable mouvement. Kepler
dans la préface de fès Ephéméridespour /b/#,avoit
aufli indiqué une variation dans l’excentricité de
l’orbite lunaire.
Flamfteed publia encore des Tables de la lune en
1681, dans lefquelles il faifoit ufage de l’hypothefe
d’Horoccius, & M. le Monnier, dans fes Infiitutions
agronomiques , en. 1746, en a donné une troifieme
édition. Les tables de M. Halley ainfi que la théorie
de Newton , d’après laquelle on a calculé différentes
tables de la lune, font fondées fur le même
principe pour le calcul de l’équation du centre &
de Yéveclion.
M. Euler efi le premier qui ait fait voir dans fa
Théorie de la lune, qu’on pouvoit calculer Yévection
d’une maniéré très-fimple, fans fuppofer une excentricité
variable & un balancement dans l’apogée ;
j’ai fait voir dans mon Aftronomie, art. 1440, que la
méthode d’Horoccius revient au même que la formule
de M. Euler, & qu’il luffit pour calculer Yévection
dans un tems quelconque, démultiplier i° io /
3 3W par le finus du double de la diftance moyenne de
la lune au foleil, moins l’anomalie moyenne de la lune;
la théorie & les obfervations ont obligé M. Mayer
à y ajouter une équation de 36".multipliée par le
finus de quatre fois4a diftance moyenne, moins deux
fois l’anomalie, & cette équation qui a un ligne contraire
à celui de Yévection entre dans une même table.
Pour donner une idée de la maniéré dont l’attraction
folaire produit cette inégalité appellée éveclion
dans le mouvementée la lime , il fuffira de faire voir
que l’excentricité de l’orbite lunaire doit être plus
grandelorfque la ligne des apfides de la lune concourt
avec la ligne des fyzygies , ou lorfque la lune étant
-nouvelle ou pleine Le trouve en même tems apogée
Tome II.
ou périgée. La force, du foleil dérange la lune , parce
que le foleil attire la lune plus ou moins qu’il n’attire
la terre, c’eft la différence des deux attractions qui
fait toute l’inégalité. Or la différence d’attraétion
fuit là différence des diftances •; cette différence efi
la plus grande quand, la.lune efi apogée , 8c la plus
petite quand elle efi périgée ; ainfi quand la ligne
des apfides de la lune concourt avec la, ligne des
fyzygies, la force centrale abfolue de la terre Lurla
lune qui eftla plus .faible •.dans la fyzygie apogée,
reçoit la plus grande diminution , 6c la force centrale
qui eftla plus confidérable dans la fyzygie périg
ée,,y reçoit la moindre/diminution donc la différence
entr.e la force centrale de la'terre fur la lune
périgée, & la force centrale, apogée fera alors la
plus grande ; donc la djfféren.cë des diftances de la
lune, dans fon apogée & dans fon périgée augmentera;
ce qui produira l’augmentation, d’excentricité
qui a lieu dans l’hypothele d’Horoccius j 8c qui efi
exprimée foùs une autre forme par Ygveflion. dont
nous avons parlé. Au refte le calcul rigoureux des
équations de la lune ,. produite par l’attraétioir du
foleil, eft fi compliqué, qu’il faut ablolument le voir
dans les ouvrages des géomètres qui en. ont traité
expreffément, tels que M. d’Alembert , M..Euler,
M. Clairault. QM. de. l a L a n d e . ) .
§ EVESHAM, ( Géogr.P) bonne 8c ancienne
ville d’Angleterre ( appellée mal-à-propos. Ever-
HAM dans \z Dictionnaire raif. des. Sçieiïçes,y 6ç<i: ) ,
dans la. province de Woreefter , lur la riviere d ’À-
von, qui lui donne un port, oit peuvent entrer d’af-
fez groffes barques. Une. abbaye de Bénédjdtins lai-
foit autrefois la réputation principale de.cette ville;
aujourd'hui on la confidere à de meilleurs litres :
elle a deux églifes paroiflîales ,L.deux écoles .bien
inftituées & bien fréqu'entées ; des fabriques de bas
très-renommées, & des environs très-fertiles . en
grains & en fourages: elle fournit deux membres à
la chambre des communes du royaume. Là bataille
que Simon de Montfort, comte de Leicefter, perdit
avec la v ie , l’an 1263 , contre le prince Edouard ,
fils du roi Henri III, fut livrée proche à’Evéèham:.
Long. iS y^S. lat. 5z , /.o. (.D. G. )
EUGENE mont ou cap,, ( Géogr. ) lieu d’Hongrie
dans le diftriél de Bude , fur le Danube , vis-
à-vis l’île de Cfepel : il porte le nom de l’illuftre
prince Eugène de Savoye, qui en aimoit beaucoup
le féjour, qui fe plaifoit à l’embellir, & qui en faifoit
affidument cultiver Le fol. L’on y voit un château
, un parc , des maifons de paylàns , de belles
vignes , de bons champs & de gras pâturages, dans
un circuit de deux lieues. ( D . G. )
* g EVIEN, ( Mythol. ) fur nom de Bacchüs. On
ne trouve point Evien dans les bons écrivains. Bac-
chus s’appelloit Evan, à caufe du lierre qui lui eft
confacré, & Evius pour la raifon citée dans le Dict.
raif des Sciences, &c. ou pour une autre citée par
Giraldi. On confond Evius 8c Evien, & on ne dit
mot d’Evan. « Il y avoit, dit Paufanias dans fon
» Voyage de Me fin ie , une montagne nommée Evant
» auprès d’Ithome, qui avoir pris fon nom d’evoé,
» qui eft comme le cri deà bacchantes , parce que
» Bacchus 8c les femmes de fa fuite s’écrièrent ainfi ,
» lorfqu’ils vinrent pour la première fois dans ce
» pays ». Lettres fur P Encyclopédie.
ÉVITÉ , ( Mufiq. ) cadence évitée. Voye1 C a -
DEHCE , Suppl. ( S y '• •'
EVITER, (Mufiq.) Eviter une cadence , c’eft
ajouter une diflbnance à l’accord final , pour
changer le mode ou prolonger la phrafe. Foye^
C adence , Suppl. ( S )
* § EVITER N E, . . Divinité à laquelle les anciens
facrifioient des boeufs roux. C’efi tout ce que nous in
favoris. Çette divinité eft Jupiter même. fiviterne
Y Y y y y i ,