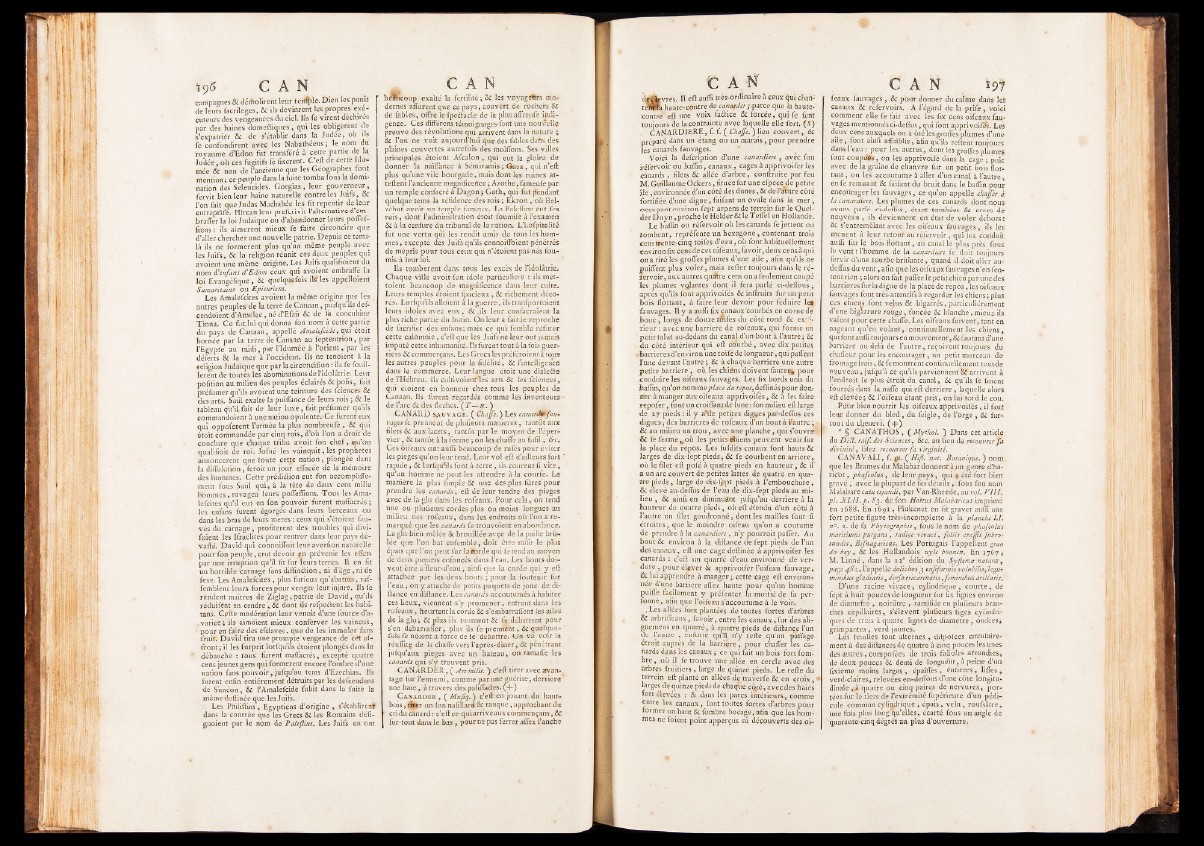
campagnes & démolirent leur teefl^ie. Ôieu les punit
de leurs facrileges, & ils devinrent les propres exécuteurs
des vengeances du ciel. Ils fe virent déchires
par des haines domeftiques, qui les obligèrent de
s’expatrier & de s’établir dans la Judée, où ils
fe confondirent avec les Nabathéens ; le nom du
royaume d’Edon fut transféré à cette partie de là
Judée, où ces fugitifs fe fixèrent. C’eft de cette Idu-
mée & non de l’ancienne que les Géographes font
mention; ce peuple dans la fuite tomba fous la domination
des Seleueides. Gorgias, leur gouverneur,
fervit bien leur haine naturelle contre les Juifs, &
l’on fait que Judas Machabée les fit repentir de leur
entreprife. Hircan leur pre/crivit l’alternative.d em-
braffer la loi Judaïque ou d’abandonner leurs poffef-
lions: ils aimèrent mieux fe faire circoncire que
d’aller chercher une nouvelle patrie. Depuis ce tems-
là ils ne formèrent plus qu’un même peuple avec
les Juifs , & la religion réunit ces deux peuples qui
avoient une même origine. Les Juifs qualifioient du
nom d'infans d'Edom ceux qui avoient embraffe la
loi Evangélique , & quelquefois ité les appelaient
Samaritains ou Epicuriens. . . ?
Les Amalefcites avoient la même origine que les .
autres peuples’ de la terre de Canaan, puifqu ils def»
cendoient d’Amélec, né d’Efaii & de fa concubine
Tinna. Ce fat lui qui donna fon nom à cette partie
du pays de Canaan, appellé Amalefcide, qui étoit •
bornée par la terre de Canaan au feptentrion, par
l’Egypte au midi, par l’Idumee à l’orient, par les*
déferts & la mer à l’occident. Ils ne tenoient à là
religion Judaïque que par la circoncifion : ils fe'fouillèrent
de toutes les abominations de l’idolâtrie. Leur
pofition au milieu des peuples éclairés & polis, fait
préfumer qu’ils avoient une teinture des fciences &
des arts. Sàül exalte la puiffance de leurs rois ; & lé
tableau qu’il fait de leur luxe , fait préfumer qu’ils
commandoient à une nation opulente.*Ce furent eux
qui oppoferent l’armée la plus nombrettfe, & qui
étoit commandée par cinq rois, d’oii l’on a droit de
conclure que chaque tribu avoit fon ch ef, qu’on
qualifioit de roi. Jofué les vainquit, les prophètes
annoncèrent quë toute cetfe nation, plongée dans
la diffolution, feroit un jour effacée de la mémoire
des hommes. Cette prédiction eut fon accompliffe-
ment fous Saiil qui, à la tête de deux cens mille
hommes, ravagea leurs poffeffions. -Tous les Amalefcites
qu’il eut en fon pouvoir furent maffacrés ;
les enfans furent égorgés dans leurs berceaux ou
dans les bras de leurs meres : ceux qui s’étoiént fau-
vés du carnage, profitèrent des troubles qui divi-
foient les Ifraëlites pour rentrer dans leur pays dé-
vaflé. David qui connoiffoit leur averfion naturelle
pour fon peuple, crut devoir gn prévenir les effets
par une irruption qu'il fit fur leurs terres. Il en fit
un horrible carnage fans diftinCtion, ni d’âge , ni de
fexe. Les Amalefcites, plus furieux qu’abattus, raf-
femblent leurs forces pour venger leur injure. Iis fe
rendent maîtres de Ziglag, patrie de David, qu’ils
réduifent en cendre I & dont ils refpettent les habi-
tans. Cette modération leur venoit d’une fource d’a-
.. varice; ils aimoient mieux conferver les vaincus,
pour ert faire des efclaves, que de les immoler fans
fruit; David tira une prompte vengeance de cet affront
; il les furprit lorfqu’ils étoient plongés dans la
' débauche :.tous furent maffacrés, excepté quatre
cens jeunes gens qui formèrent encore l’ombre d’ une
nation fans pouvoir, jufqu’au tems d’Ezechias. Ils
furent enfin entièrement détruits par les defcendans
de Siméon, & l’Amalefcide fubit dans la fuite la
même deftinée que les Juifs.
Les Philiftins, Egyptiens d’origine , s’établir en?
dans la contrée que les Grecs & les Romains défi-
gnoient par le nom de P ale (Une, Les Juifs en ont
beÜtcoup exalté la fertilité ; & les vôyàgetrs me*
dernes affurent que ce pays, couvert de rochers &C
de fables, offre le fpeétaele de la plus affreufe indigence.
Ces différens témoignages*font une nouvelle
preuve des révolutions qui arrivent dans la nature ;
& l’on ne voit aujourd’hui que des fables dahs des
plaines couvertes autrefois des moiflbns. Ses villes
principales étoient Afcalon , qui eut la gloire de
donner la naiffance à Sémiramis ; Gaza , qui n’eft
plus qu’une vile bourgade., mais dont les ruines attellent
l’ancienne magnificence ; Azothe, fameufe par
un temple confacré à Dagon ; Gath, qui fut pendant
quelque tems la réfidence des rois ; Ekron , où Bel-
zébut avoit un temple fameux. La Paleftine eut fes
rois, dont l’adminiftration étoit foumife à l’examen
& à la cenfure du tribunal de la nation. L’kofpitelité
fut une vertu qui les rendit amis de tous les hommes,
excepté des Juifs qu’ils connoiffoient pénétrés
de mépris pour tous ceux qui n’étoient pas nés fournis
à leur loi.
Ils tombèrent dans tous les excès de l’idolâtrie.
Chaque ville avoit' fon idole particulière : ils met-
toient beaucoup de magnificence dans leur culte.
Leurs temples étoient fpacieux, & richement décorés.
Lorfqu’ils alloient à la guerre, ils tranfportoient
leurs idoles avec eu x, & .ils leur confacroient la
plus riche partie du butin. On leur a fait ie reproche
de facrifier des enfans; mais ce qui femble réfuter
cette calomnie , c’eft que les Juifs ne leur ont jamais
imputé cette inhumanité. Fis furent tout à la fois guerriers
& commerçans. Les Grecs les préféroient à tous
les autres peuples pour la fidélité, & l’intelligence
dans le commerce. Leur langue étoit une diale fie.
de l’Hébreu; Ils éultivoient les arts & les fciences *
qui étoient en honneur chez tous les peuples de
Canaan. Ils furent regardés comme les inventeurs-
de l’arc 6c des fléchés. ( T — N. )
CANARD SAUVAGE. ( Chaffe.) Les canard&fau^
vagss fe prennent de plulïeurs maniérés, tantôt aux
filets & aux lacets, tantôt pa rle moyen de>l?éper-
v ie r , 6c tantôt à la forme ; on les .chaffe au fufil, &c*
Ces ôifeaux ont auffi beaucoup de rufes pour éviter
les piégés qu’on leur tend. Leur vol eft d’ailleurs fort *
rapide, & lorfqu^ils font à terre, ils courent fi vite,
qu’un homme ne peut les attendre à la courfe. La
maniéré la plus fimple & une des plus fCires pour
prendre les canard,5, eft de leur tendre des piégés
avec de la glu dans les rofeaux. Pour cela, on tend
une ou plufieurs cordes plus ou moins longues au
.milieu des rô.feaux, dans les endroits ou.l’on a remarqué,
que les canards fe trouvoient en abondance*
La glu bien mêlée & brouillée avec de la paille brûlée
que l’on bat enfemble, doit être mife le plus
épais que l’on peut fur la êrorde qui fe tend au moyen
de deux piquets enfoncés dans l’eau. Les bouts doivent
être à fleur-d’eau, ainfi que la corde qui y eft
attachée par les deux bouts ; pour la .foutenir fur
l’eau, on y attache de petits paquets de jonc de di-
ftance en diftance. Les can'ards accoutumés à habiter
ces lieux-, viennent s’y promener, entrent dans les
rofeaux, heurtent la corde & s’embarraffent les ailes
de la glu ; & plus ils. tournent & fe débattent pour
s’en débarraflër, plus ils fe prennent, & quelque-"'
fois fe noient à force de fe débattre. Gn va voir la
I réuffite de la chaffe vers l’après-dîner, & pénétrant
jufqu’aux piégés avec un bateau, on ramaffe les
canards qui s’y trouvent pris.
CANARDER, ( Artmilit. ) c’eft tirer avec avantage
fur l’ennemi, comme par une guérite, derrière*
une haie, à travers des paliffades. (+ )
C anarder , ( Mufiq. ) c’eft en jouant, du.haut-
Ibois, tèfer un fon nafillard 6c rauque, approchant du
i cri du canard : c’eft ce qui arrive aux commençans, 6c
fur-tout dans le bas , pour ne pas ferrer affez l’anche
•d|dfcvres. Il eft auffi très-ordinaire à eeùx quï chan-
telwia haute-contre de canafder ; parce que la haute-
;contreA‘ eft une voix faélice & forcée, qui fe fènt
toujours de la contrainte avec laquelle elle fort. {S)
. CANARDIERE, f. f. ( Chaffe. ) lieu couvert, 6c
préparé dans un étang ou un marais, pour prendre
les canards fauvages. , , . ~ .
Voici la defeription d’une canardiere , avec fon
■ réfervoir ou baffin, canaux, cages à apprivoifer les
canards, filets & allée d’arbre, conftruite par feu
M. Guillaume Ockers, fituée fur une efpecebe petite
île »environnée d’un côté des dunes, & de l’autre c;ôtç
fortifiée d’une digue, faifant un ovale dans la mer,
occupant environ fept arpens de terrein fur le Quel-
der D u yn , proche le Heider & le Teffel en Hollande.
Le baflîn ou réfervoir où les canards fe jettent où
tombent, repréfente un hexagone, contenant trois
cens trente-cinq toifes d’eau, où font habituellement
environ fix cens de ces oifeaux, favoir, deux cens à qui
on a tiré les groffes plumes d’une aile, afin qu’ils ne
puifferit plus vole r, mais refter toujours dans le ré-
lervoir, âux autres qudlre cens on a feulement coupé,
les plumes valantes dont il fera parlé ci-defl’ou s,
après qu’ils font apprivoifés & inftruits fur un petit
bois flottant , à faire leur devoir pour féduire las
fauvages. Il y a auffi fix canaux'fcourbés en corne de
bouc,'longs de douzet*fes du côté rond & ex-*-
rieur : avec une barrière de rofeaux, qui forme un
petit talut aù-dedans du canal d’un bout à l’autre ; &
du côté intérieur qui eft courbé, avec dix petites
■ barrières d’environ une toifé de longueur, qui paffent
l’une devant l’autre ; & à chaque barrière une autre
petite barrière , où lés chiens doivent fautent pour
conduire les oifeaux fauvages. Les fix bords unis du
baffin j qu’on nomme place du repos, deftinés pour donner
à manger aux oifeaux apprivoifés, & a les faire
repofer, font un croifl'ant de lune : fon milieu eft large
de ^•J pieds : il y <Me petites dignes par-deffus ces
digues, des barrières de rofeaux d’un bout à Vautre ;
& au milieu un trou, avec une planche, qui s’ouvre
•& fë ferme „o u les petits Chiens peuvent venir fur
la place du repos. Les fufdits canaux font hauts &
larges de dix-fept pieds, &c fe courbent en arriéré,
où le filet" eft pofé à quatre pieds en hauteur, & if
a un arc couvert de petites lattes de quatre en quatre
pieds, large de dix-fippt pieds à l ’embouchure,
& élevé au-deffus de l’eau de dix-fept pieds au milieu
, & ainfi en diminuant jufqu’au derrière à la
hauteur de quatre pieds, où eft éfendu d’un côté à
l ’autre un filet "goudronné , dont les mailles font fi
étroites, que le moindre oïfeau qu’on a coutume
de prendre à la canardiere, n’y pourroit paffer. Au
bout & environ à la diftance de fept pieds de l’un
des canaux, eft une cage deftinée à apprivoifer les
canards : c’eft un quarfé d’eau environné de verdure
, pour élf ver St apprivoifer l’oifeau fauvage,
& lui apprendre à manger; cette cage eft environnée
d’une barrière affez haute pour qu’un homme
puiffe facilement y préfenter ,1a moitié de fa per-
fonne, afin que l’oifeau s’accoutume à le voir.
. Les allées, font plantées de toutes fortes d’arbres
& arbriffeaux, favoir, entre les canaux, fur des alir
gnemens en quarré, à quatre pieds de diftance l’un
de l’autre , enforte qu’il n’y refte qu’un paffage
étroit auprès de la barrière, pour chaffer les canards
dans les canaux ; ce qui fait un bois fort fom-
b re , où il fe trouve une allée en cercle avec des
ùrbres fruitiers » large de quinze pieds. Le refte du
terrein eft planté en allées de traverfe & en croix , ’
larges de quinze pieds de chaque cqté, avec des haies
fort élevées : & dans les parcs intérieurs, comme
entre les canaux, font toutes fortes d’arbres pouf
former un haut & fombre bocage, afin que les hommes
ne foient point apperçus ni découverts des oiféaux
fauvages , & pour donner du calme dans les
canaux & réfervoirs. A l’égard de la prife ,: voici
comment elle fe fait avec les fix cens oifeaux fau-
vages mentionnés ci-deffus, qui font apprivoifés. Les
deux cens auxquels on a ôté les groffes plumes d’une
aile , font ainfi affoiblis, afin qu’ils reftent toujours
dans l'eau : pour les autres;, dont les groffes plumes
font eoupéfts, on les apprivoife dans la cage ; puis
avec de là graine de chanvre fur un petit bois flottant
, on les accoutume à aller d’un canal à l’autre,
en fe remuant §£ faifant du bruit dans, le baffin pour
encourager les fauvàges., ce qu’on appelle chaffer. à
la canardiere. Les plumes de ces canards dont nous
avons parlé ci-deffus, étant tombées & crues dç
nouveau , ils deviennent en état de voler dehors:
& s’entremêlant avec les oifeaux fauvages, ils les
mènent à leur retour au réfervoir , qui les conduit
auffi fur le bois flottant, au canal le plus, près fous
le vent ' l’homme, de la canardiere fe doit toujours
fervir d’une tourbe brûlante, quand il doit aller au-
-deflus du vent, afin que les oifeayx fauvages n’en fen-
tent rien ; alors on fait paffer le petit chien par une des
barrières fur la digue de la place de repos, ies'oifeaux
fauvages font très-attentifs à regarder les chiens ; plus
ces chiens font velus & bigarrés, particuliérement
d’une bigarrure rouge, foncée & blanche, mieux ils
valent pour cette chaffe. Les oifeaux fuivenf, tant eh
nageant qu’en volant, continuellement les chiens,
qui font auffi toujours en mouvement, & fau tant d’une
barrière au-delà de l’autre, reçoivent toujours du
chaffeur pour les encourager, un petit morceau de
fromage frais, & fe montrent continuellement tout de
nouveau, jufqu’à ce qu’ ils parviennent Zt arrivent à
l’endroit le plus étroit du canal, & qu’ils fê foient
fourrés dans la.naffe qui eft derrière , laquelle alors
eft éleVée; & l’oifeau étant pris, on lui tord le cou.
Polir bien nourrir les oifeaux apprivoifés , il faut
leur donner du bled, du feigle, de l’orge , &c fur-
tout du cfyenevi.
* § CÀNATHOS , ( Mythol. ) Dans cet article
du Dicl. raif. des Sciences, &c. au lieu de recouvrer fa
divinité, liiez recouvrer fa virginité.
CANAVALI, f. pu ( Hiß. nat. Botanique. ) nom
que lès Brames du Malabar donnent àjm genre d’ha-
riebt, phafeolus, de leur p ays, qui a été fort bien
gravé , avec la plupart de les détails, fous fon nom
Malabare catuts/andi, par Van-Rheede, au vol. FIII.
pl. X L II.p . 83. de fon Hortus Malabaricus imprimé
en 168:8. En 16 91 , Plukenet en fit graver auffi une
fort petite figure trèsrincomplette à la planche LL
n°. 2. de fa Phytographie, fous lé nom de phafeolus
maritimus purgans , radiçe vivaci, foliis craffs fubro-
tundis, Bifnagaricus. Les Portugais l’appellent grao
do bey, 6c les Hofiandois uyle boonen. En 176 7 ,
M. Linné , dans la 12e édition du Syßerna natures,
page 482, l’appelle dolichos j ehfiformis volubilis, legu-
minibus gladiatis, dorfo tricarinatis, minibus arillatis.
D’une racine vivace, cylindrique, courte, de
fept à huit pouces .de longueur fur fix lignes environ
de diamefre , noirâtre , ramifiée en plufieurs branches
capillaires, s’élèvent plufieurs tiges cylindriques
de trois à quatre lignes de diamètre, ondées,
grimpantes, verd jaunes.
Les feuilles font alternes , difpofées circuîaire-
ment .à de.s.diftances de quatre à cinq pouces les unes
des autres, compofées de trois folioles arrondies,
de deux pouces &c demi de longueiir, à peipe d’un
fixieme moins larges , épaiffes , entières , liffes ,
verd-claires:, relevées: en-flefföus d’une côte longitudinale
,*à quatre ou cinq paire? de nervures, portées
fur 1-e.tiers de l’extrémité fupérieure d’un pédicule
commun cylindrique , épais, v e lu , rpufsâtre,
une fois plus long qu’elles, écarté fous un angle de
quarante-cinq degrés au plus d’ouverture.